Nouvelle lecture de Méridien de sang de Cormac McCarthy, dans le sillage de Moby Dick (02/03/2021)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Cormac McCarthy dans la Zone.
Cormac McCarthy dans la Zone. Méridien de sang dans la Zone.
Méridien de sang dans la Zone. Méridien de sang par Gregory Mion.
Méridien de sang par Gregory Mion. C'est la quatrième ou cinquième fois que je relis Méridien de sang de Cormac McCarthy, découvert en 2006. Bien sûr, ma stupéfaction, devant ce texte d'une violence primesautière, augurale, s'est considérablement atténuée, pour laisser la place, au fil du temps, à un sentiment plus trouble, que j'aurai assez bien caractérisé je crois en affirmant qu'il tient d'une suspicion de plus en plus manifeste, comme si m'apparaissait de plus en plus clairement la dimension parodique de ce roman étrange, fascinant à bien des égards, qui se termine comme il a commencé, par l'évocation d'un gamin (devenu grand) qui finira par retrouver sur sa route «l'énorme abjection» (p. 306), le monstrueux juge Holden.
C'est la quatrième ou cinquième fois que je relis Méridien de sang de Cormac McCarthy, découvert en 2006. Bien sûr, ma stupéfaction, devant ce texte d'une violence primesautière, augurale, s'est considérablement atténuée, pour laisser la place, au fil du temps, à un sentiment plus trouble, que j'aurai assez bien caractérisé je crois en affirmant qu'il tient d'une suspicion de plus en plus manifeste, comme si m'apparaissait de plus en plus clairement la dimension parodique de ce roman étrange, fascinant à bien des égards, qui se termine comme il a commencé, par l'évocation d'un gamin (devenu grand) qui finira par retrouver sur sa route «l'énorme abjection» (p. 306), le monstrueux juge Holden. Il est clair aussi que le temps a opéré sa lente décantation mais, surtout, que son opération a pu être accélérée par la lecture de Moby Dick de Melville, pour lequel Cormac McCarthy n'a cessé de manifester son admiration (partagée pour Faulkner ou Joyce), alors même que des cohortes d'universitaires anglo-saxons s'échinent à classifier rigoureusement le plus minuscule emprunt, fût-il aussi éloigné du modèle qu'on le voudra, censé établir la liste apparemment terriblement longue des influences que le prodigieux roman maritime a exercées sur la sanglante aventure des hommes menés par Glanton.
Ces influences existent bien sûr, nombreuses si l'on y tient, mais elles ne m'en paraissent pas moins assez anecdotiques, une fois que l'on a écrit noir sur blanc ce qui, intimement, unit ces deux romans : non point tant la relation de faits de sauvagerie, la blancheur partagée du cétacé maléfique et du juge Holden, qui, maléfique, ne l'est pas moins que la créature des profondeurs océaniques, que la
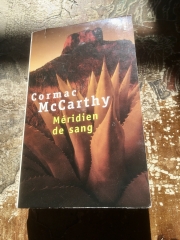 tenace volonté de tenter d'enserrer l'énigme qu'est le monde dans une trame de significations. Plus que cela, même : je crois que nous pourrions lire Méridien de sang comme la tentative de conserver ce qui, dans le monde, ne laisse aucune trace, l'histoire oubliée des innocents massacrés au cours des siècles de sauvagerie, cette dimension ne me paraissant absolument pas première dans l’œuvre de Melville, pourtant tout préoccupé, comme le sera son héritier problématique, de consigner dans un livre l'énigme du monde. Méridien de sang, s'il rappelle ici ou là Moby Dick, s'insère dans la production de Cormac McCarthy, et les rapprochements que nous pourrions établir avec certains de ses textes sont au moins aussi intéressants que ceux que nous ne ferons qu'esquisser avec le roman de Melville.
tenace volonté de tenter d'enserrer l'énigme qu'est le monde dans une trame de significations. Plus que cela, même : je crois que nous pourrions lire Méridien de sang comme la tentative de conserver ce qui, dans le monde, ne laisse aucune trace, l'histoire oubliée des innocents massacrés au cours des siècles de sauvagerie, cette dimension ne me paraissant absolument pas première dans l’œuvre de Melville, pourtant tout préoccupé, comme le sera son héritier problématique, de consigner dans un livre l'énigme du monde. Méridien de sang, s'il rappelle ici ou là Moby Dick, s'insère dans la production de Cormac McCarthy, et les rapprochements que nous pourrions établir avec certains de ses textes sont au moins aussi intéressants que ceux que nous ne ferons qu'esquisser avec le roman de Melville.Ainsi est-il possible d'affirmer que Méridien de sang annonce, en plus d'une de ses occurrences, non seulement Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme baignant tout entier dans la déploration devant la progression du Mal, mais aussi La Route peignant un monde qui se défait : voyez par exemple la mention d'une «contrée remplie d'enfants violents rendus orphelins par la guerre» (p. 401), voyez encore cette notation : «Quand ils traversaient dans la nuit ces récifs nus de gravier on eût dit des créatures sans attache ni substance. Une patrouille condamnée à chevaucher sans fin pour expier une antique malédiction» (p. 191). L'univers de Méridien de sang, pour énigmatique et même hermétiquement fermé sur un ordre dépassant de toutes parts l'empan de la compréhension humaine, ne s'en défait pas moi, ne serait-ce que par la présence satanique du juge Holden, décidément la création la plus imposante et intéressante de Cormac McCarthy. Il me fait penser, comme je l'ai plus d'une fois noté, au Kurtz de Joseph Conrad mais, tout autant, à Monsieur Ouine de Georges Bernanos (ne serait-ce que parce que sa présence est systématiquement signalée par la disparition ou le meurtre d'un enfant) ou encore au Mastemann (également appelé Herr von Mastemann ou encore Pietro Alvise Mastemann) de Guerre et Guerre de László Krasznahorkai.
Quoi qu'il en soit, cette multitude d'indices entre les deux grands romans (le premier, à vrai dire : majestueux et grandiose), du reste plus ou moins patents, est affaire d'exégètes, et le lecteur désireux de comprendre sur quel matériau aussi conséquent qu'hétérogène (historique, géologique, astronomique, biblique, relatif à la faune et à la flore, aux armes, au tarot, au droit, à différentes langues comme le français, le latin, l'allemand ou l'espagnol, etc.) Cormac McCarthy s'est appuyé pour écrire son roman pourra se reporter au très honnête commentaire de John Sepich, intitulé Notes on Blood Meridian (1) ou sur tel recueil d'articles plus ou moins intéressants mais qui tous répètent en boucle d'identiques références point toutes lumineuses, comme They Rode On. Blood Meridian and the Tragedy Of The American West (2).
Ce ne sont pas les détails de ces emprunts et calques transparents ou translucides qui m'intéressent, ni les rapprochements possibles entre l'apparition d'un personnage prophétique, Élie, dans les deux romans, ou bien la destinée de Glanton et celle d'Achab, tous deux pouvant après tout prétendre que «le sort de tout homme [...] lui est donné par avance», ce qui jamais ne doit l'empêcher d'estimer qu'il y a en lui «tout ce qu'il serait jamais et tout ce que le monde serait jamais pour lui et la charte de sa destinée fût-elle inscrite dans la pierre originelle il s'arrogeait l'autorité et le disait et il eût conduit l'inexorable soleil à son extinction définitive comme s'il l'avait tenu sous ses ordres depuis le commencement des temps, avant qu'il y eût ici ou là des chemins, avant qu'il y eût des hommes ou des soleils pour y passer» (p. 305), tous deux encore, comme Achab, pouvant affirmer qu'il n'y a pas un obstacle, pas un coude sur sa voie rectiligne, sa voie d'acier : «Par-dessus les ravins sans fond, par le travers du cœur transpercé des montagnes, par-dessous le lit des torrents, je me rue et ne peux dérailler» (3). Ce n'est pas davantage le fait que Melville évoque une «société mutuelle, un capital social auquel concourent tous les méridiens» (p. 126) ou que McCarthy mentionne une seule fois l'existence des baleines (4), ni même la volonté commune à Melville et McCarthy de façonner je l'ai dit un roman prétendant embrasser la totalité des savoirs, symbolisés par les connaissances du juge Holden dans tous les domaines et langues, que le changement d'assiette, pour ainsi dire, qui s'est opéré entre les deux œuvres. Cette différence qui touche l'assise de la représentation symbolique de l'univers à laquelle se réfèrent les deux écrivains, voilà l'essentiel à mes yeux, qui peut nous aider à comprendre le fait qu'un basculement, et d'importance épistémologique voire ontologique, a eu lieu.
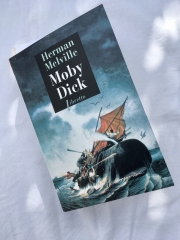 D'un côté, Melville qui, par l'intermédiaire d'Ismahel, ne cesse de nous répéter que son livre tout entier «n'est lui-même qu'une esquisse» et moins que cela, «l'esquisse d'une esquisse» (p. 253) et, de l'autre, le juge Holden, qui lui aussi recourt à la métaphore du Livre comme rassemblement de toutes les traces, vestiges d'êtres passés ou présents, connus ou inconnus : «Ce qui doit être ne s'écarte pas d'un iota du livre où ce qui doit être est écrit. Comment pourrait-il en être autrement ? Ce serait un faux livre et un faux livre n'est pas un livre» (p. 179). Un faux livre est un livre car, après tout, le juge Holden n'est-il pas lui-même un faux mage, un faux initiateur, un faux prophète et un faux savant ? D'un côté comme de l'autre, aussi, les différents protagonistes sont confrontés à des signes énigmatiques qu'ils tentent de déchiffrer («À l'instar de ces roches mystérieusement chiffrées, le cétacé possède ses signes mystiques qui demeurent indéchiffrables», p. 494) mais, dans le roman de Cormac McCarthy, ce savoir universel, le juge Holden ne l'entasse dans les méandres de son cerveau, apparemment aussi prodigieusement développé que le reste de son corps de géant, qu'à seule fin de le détruire. Ainsi, reproduisant méticuleusement dans l'éternel cahier qui accompagne ses déambulations meurtrières des représentations de civilisations disparues, le juge Holden, «se leva et gratta un des dessins avec un morceau de silex, sans laisser d'autre trace qu'un endroit à vif sur la pierre là où avait été la gravure» (p. 219). Tout ce qui échappe à l'emprise souveraine, terrifiante, du juge, vit sans son consentement, ce qui est une insulte à sa toute-puissance ici-bas et une entorse à l'étendue de son savoir.
D'un côté, Melville qui, par l'intermédiaire d'Ismahel, ne cesse de nous répéter que son livre tout entier «n'est lui-même qu'une esquisse» et moins que cela, «l'esquisse d'une esquisse» (p. 253) et, de l'autre, le juge Holden, qui lui aussi recourt à la métaphore du Livre comme rassemblement de toutes les traces, vestiges d'êtres passés ou présents, connus ou inconnus : «Ce qui doit être ne s'écarte pas d'un iota du livre où ce qui doit être est écrit. Comment pourrait-il en être autrement ? Ce serait un faux livre et un faux livre n'est pas un livre» (p. 179). Un faux livre est un livre car, après tout, le juge Holden n'est-il pas lui-même un faux mage, un faux initiateur, un faux prophète et un faux savant ? D'un côté comme de l'autre, aussi, les différents protagonistes sont confrontés à des signes énigmatiques qu'ils tentent de déchiffrer («À l'instar de ces roches mystérieusement chiffrées, le cétacé possède ses signes mystiques qui demeurent indéchiffrables», p. 494) mais, dans le roman de Cormac McCarthy, ce savoir universel, le juge Holden ne l'entasse dans les méandres de son cerveau, apparemment aussi prodigieusement développé que le reste de son corps de géant, qu'à seule fin de le détruire. Ainsi, reproduisant méticuleusement dans l'éternel cahier qui accompagne ses déambulations meurtrières des représentations de civilisations disparues, le juge Holden, «se leva et gratta un des dessins avec un morceau de silex, sans laisser d'autre trace qu'un endroit à vif sur la pierre là où avait été la gravure» (p. 219). Tout ce qui échappe à l'emprise souveraine, terrifiante, du juge, vit sans son consentement, ce qui est une insulte à sa toute-puissance ici-bas et une entorse à l'étendue de son savoir.Il est alors frappant de constater que, parallèlement à la force remarquable de destruction et même d'anéantissement total que représente le juge Holden, Cormac McCarthy ménage, dans son roman, de rarissimes oasis, des arches en quelque sorte, d'autant plus singulières qu'elles sont rares, où il tente, non pas d'opposer une résistance à la force d'arraisonnement du juge Holden, mais de suggérer la possibilité d'une île, une forme d'extraterritorialité sur laquelle la puissance du suzerain maléfique (5) ne s'exercerait pas : «Le juge posa les mains par terre. Il regarda son contradicteur. Cette terre m'appartient, dit-il. C'est ma concession. Et pourtant ici même il y a partout des poches de vie autonome. Autonome. Pour qu'elle m'appartienne vraiment rien ne doit pouvoir s'y produire sans mon consentement». Il poursuit en affirmant que «celui qui s'est donné pour tâche de trouver dans la tapisserie le fil conducteur de l'ordre aura par cette seule décision assumé la responsabilité de l'univers et ce n'est qu'en assumant cette responsabilité qu'il peut trouver le moyen de dicter les clauses de son propre destin» (p. 251). J'avais déjà noté ce point dans une des notes que j'ai écrites sur Méridien de sang, y remarquant : «Dans les jours à venir les fragiles rébus noirs du sang dans les sables allaient se lézarder et s'effriter et se disperser de sorte qu'après quelques révolutions du soleil toute trace de la destruction de ces gens serait effacée» (Méridien de sang, p. 220). Cette thématique est constante dans le roman : la sauvagerie décrite par le romancier ne paraît jamais aussi abjecte que lorsqu'elle prive les humiliés, les offensés et les assassinés de toute perspective de mémoire autre que celle que leur accorde celui qui, dans un certain sens, est le témoin aussi essentiel qu'impondérable, c'est-à-dire l'écrivain. Sur ce point, un rapprochement peut d'ailleurs être esquissé avec 2666, où Bolaño sans relâche, sans paraître même craindre qu'on lui reproche quelque forme de
 complaisance dans l'horreur, n'en termine jamais de décrire, jusqu'au plus sordide détail, les meurtres immondes qui ont réellement eu lieu à Ciudad Juárez (Santa Teresa dans le roman).»
complaisance dans l'horreur, n'en termine jamais de décrire, jusqu'au plus sordide détail, les meurtres immondes qui ont réellement eu lieu à Ciudad Juárez (Santa Teresa dans le roman).»Je vois une telle arche verbale, un mémorial en somme portant témoignage, dans le passage suivant, déjà cité, mais auquel j'ajoute la suite du texte : «Dans les jours à venir les fragiles rébus noirs du sang dans les sables allaient se lézarder et s'effriter et de disperser de sorte qu'après quelques révolutions du soleil toute trace de la destruction de ces gens serait effacée. Le vent du désert rongerait leurs ruines et il n'y aurait rien, pour dire au voyageur sur son passage que des humains avaient vécu ici et comment ils y étaient morts» (pp. 220-1), rien si ce n'est, justement, ces quelques lignes témoignant de l'horreur passée.
Je vois au moins une autre de ces trouées dans une scène magnifique, assez unique dans le roman : «C’était un arbre solitaire qui brûlait sur la surface du désert. Un arbre héraldique auquel l’orage avait mis le feu au passage. Le voyageur solitaire arrêté devant lui avait fait un long chemin pour venir jusqu’ici et il s’agenouilla dans le sable brûlant et avança ses mains insensibles tandis que des congrégations de plus humbles acolytes étaient rassemblées tout autour de ce cercle, attirées par l’insolite lumière, petites chouettes silencieusement accroupies s’appuyant tantôt sur un pied tantôt sur l’autre, tarentules et solifuges et vinaigriers et mygales vénéneuses et lézards granuleux à la queue noire de chiens chowchow, mortels pour l’homme, et petits basilics du désert dont les yeux lancent du sang et petites vipères des sables pareilles à de gracieuses divinités, silencieuses et immuables, à Djedda, à Babylone. Constellation d’yeux ignés qui délimitaient l’anneau de lumière, tous unis dans une trêve précaire devant cette torche dont l’éclat avait repoussé les étoiles dans leurs orbites» (p. 270). Enfin, il me semble que deux autres courts passages sont susceptibles d'appartenir à ce réseau d'images évoquant une suspension, un temps seulement, de l'horreur déchaînée dans le monde, l'un évoquant un bivouac au coin du feu «qui contient en lui quelque chose de l'homme lui-même tant il est vrai que sans lui l'homme est diminué et coupé de ses origines et comme exilé» (p. 307), l'autre mentionnant des Indiens qui sauvent d'une mort certaine deux des membres du gang de Glanton : «Ils tiraient de cette terre une vie sans espoir et ils savaient que seule une traque implacable pouvait conduire les hommes à un tel degré de misère et ils guettaient jour après jour pour voir cette chose sortir de sa terrible incubation dans la maison du soleil et se masser à l'orient du monde et ils attendaient avec une étrange sérénité que surgissent des armées ou on ne sait quel cataclysme ou quoi de plus atroce encore» (p. 374).
 La sauvagerie, dans les deux romans, est plus que présente; chez McCarthy dans de nombreuses scènes dont certaines ont un aspect surréaliste, paroxystique certes mais d'un paroxysme confinant à la parodie; chez Melville, avec l'évocation de «l'affreuse voracité vulturine du monde» (p. 498) jamais mieux symbolisée que par le festin auquel se livrent les requins, dont les cadavres eux-mêmes semblent encore animés d'une vie féroce, comme si «une sorte d'universel élan vital et panthéistique [semblait] rester caché jusque dans leurs articulations et et au creux de leurs os, après que ce qu'on peut appeler la vie individuelle s'en est allée» (p. 488). Cette sauvagerie est même perceptible dans la faim grandiose de connaissances qui anime certains des personnages, le juge Holden bien sûr mais, aussi, Ismahel, le narrateur de Melville qui jamais ne s'estime digne d'avoir pu enserrer, dans les mailles de son expérience, lettrée aussi bien que réelle, encyclopédique, l'existence mystérieuse du cétacé blanc : «N'est-il pas de mon devoir de ne laisser rien échapper de lui, pas la plus microscopique semence vitale de son sang; et de scrupuleusement défaire jusqu'au plus replié des replis de ses circonvolutions intestinales ?» (p. 728). Ismahel, tout autant qu'Achab, poursuit la mystérieuse créature des profondeurs, qui les défie tous deux : au moins Achab finit-il par la rejoindre... Chez Melville, aussi, il s'agit de «faire sauter le sceau et déchiffrer» (p. 718) le contenu, même lorsqu'il s'agit des entrailles d'un nouveau-né cachalot, car, profonde, voilée et même supérieurement difficile à comprendre, il existe toujours «une raison en toutes choses, et même dans la loi» (p. 642). Certes, au bout de cette exploration des savoirs et des entrailles, des profondeurs de l'océan et du cœur des hommes, c'est l'échec qui fait résonner sa cloche d'airain et Ismahel pourra bien disséquer le corps du cétacé autant qu'il le voudra, «la vérité est [qu'il] ne pénètre pas plus avant que sa peau» (p. 606) mais cet échec ne fait aucunement faiblir la folle volonté du narrateur, encore moins celle d'Achab ayant voué son âme à la poursuite du monstre. Voracité, encore une fois, et inextinguible.
La sauvagerie, dans les deux romans, est plus que présente; chez McCarthy dans de nombreuses scènes dont certaines ont un aspect surréaliste, paroxystique certes mais d'un paroxysme confinant à la parodie; chez Melville, avec l'évocation de «l'affreuse voracité vulturine du monde» (p. 498) jamais mieux symbolisée que par le festin auquel se livrent les requins, dont les cadavres eux-mêmes semblent encore animés d'une vie féroce, comme si «une sorte d'universel élan vital et panthéistique [semblait] rester caché jusque dans leurs articulations et et au creux de leurs os, après que ce qu'on peut appeler la vie individuelle s'en est allée» (p. 488). Cette sauvagerie est même perceptible dans la faim grandiose de connaissances qui anime certains des personnages, le juge Holden bien sûr mais, aussi, Ismahel, le narrateur de Melville qui jamais ne s'estime digne d'avoir pu enserrer, dans les mailles de son expérience, lettrée aussi bien que réelle, encyclopédique, l'existence mystérieuse du cétacé blanc : «N'est-il pas de mon devoir de ne laisser rien échapper de lui, pas la plus microscopique semence vitale de son sang; et de scrupuleusement défaire jusqu'au plus replié des replis de ses circonvolutions intestinales ?» (p. 728). Ismahel, tout autant qu'Achab, poursuit la mystérieuse créature des profondeurs, qui les défie tous deux : au moins Achab finit-il par la rejoindre... Chez Melville, aussi, il s'agit de «faire sauter le sceau et déchiffrer» (p. 718) le contenu, même lorsqu'il s'agit des entrailles d'un nouveau-né cachalot, car, profonde, voilée et même supérieurement difficile à comprendre, il existe toujours «une raison en toutes choses, et même dans la loi» (p. 642). Certes, au bout de cette exploration des savoirs et des entrailles, des profondeurs de l'océan et du cœur des hommes, c'est l'échec qui fait résonner sa cloche d'airain et Ismahel pourra bien disséquer le corps du cétacé autant qu'il le voudra, «la vérité est [qu'il] ne pénètre pas plus avant que sa peau» (p. 606) mais cet échec ne fait aucunement faiblir la folle volonté du narrateur, encore moins celle d'Achab ayant voué son âme à la poursuite du monstre. Voracité, encore une fois, et inextinguible.Cette exploration, peu importe qu'elle doive reconnaître son échec, du moment qu'elle se veut intraitable, et que demeure, à l'horizon, non seulement le sillage (et le souffle) de Moby Dick, mais une forme de confiance entre l'homme et l'univers, la certitude qu'existent de «profondes analogies enchaînées, au-delà de toute expression» (p. 502) entre l'âme et la nature, qui me semblent avoir été chassées du roman de Cormac McCarthy, qui jamais ne pourrait se laisser aller à quelque spéculation sur un possible réenchantement du monde, comme c'est par exemple le cas dans le roman de Melville : «Si dans l'avenir, quelque nation poétique et de haute culture devait rétablir dans leurs droits d'aînesse les jeunes dieux joyeux et printaniers de l'Antiquité; si elle devait repeupler de leurs trônes et de leur vie notre ciel d'à présent si serré sur son quant-à-soi; si on allait en remeubler les collines à présent désertées, il ne fait pas de doute qu'élevé au-dessus du trône de Jupiter le grand cachalot en serait le suprême seigneur» (p. 556).
Qu'est-ce qui a été perdu, dilapidé peut-être, entre le roman de Melville et celui de McCarthy ? Si ce dernier pourrait à bon droit prétendre, comme son illustre maître, que «les invisibles sphères ont été faites dans l'effroi», il lui serait rigoureusement impossible d'affirmer que «le monde visible, sous bien des apparences, semble avoir été façonné et formé dans l'amour» (p. 326) ! Dans le roman de Melville, quels que soient les constats d'échec, de bornes inamovibles plantées face à l'indéracinable curiosité des hommes, il est toujours possible de faire le pas au-delà, de s'enfoncer dans les profondeurs, de se tourner «vers les thermes romains, vers les ruines antiques qui sont dessous; loin au-dessous, profondément, de cette pellicule des surfaces où l'homme érige ses tours fantastiques», en se mettant à chercher «la racine de sa grandeur, son essence terrible» qui «tout entière gît là, dans le défi de sa majesté enterrée : l'antiquité ensevelie sous les antiquités» (p. 312). Tout, dans le roman de Melville, est ainsi invitation au voyage définitif, au plongeon dans «de plus abyssales profondeurs» (p. 314) auxquelles Ismahel, il le concède plus d'une fois, ne peut parvenir, mais il n'en reste pas moins que demeure la certitude que de plus hardis explorateurs viendront un jour, capables, eux, de s'enfoncer comme une navette dans la trame serrée des figures, éblouissantes, «du grand tissage en cours», alors que «toujours et encore et à jamais toujours se forme et se déroule l'éternelle tapisserie» (p. 720).
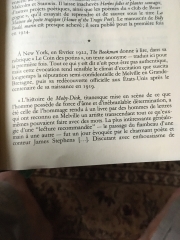 C'est Melville qui peut ne pas craindre d'écrire que «le plus merveilleux et le plus terrifiant de ce qui est vraiment dans l'homme, ni mots ni livres n'y ont touché jusqu'ici» (p. 763); c'est encore Melville qui peut indiquer que le corps tatoué de Quiequeg représente «une cosmogonie complète et un traité mystique sur l'art d'atteindre à la vérité», peu importe même qu'il devienne alors «une énigme à résoudre, une œuvre merveilleuse en un volume» ou que «ces écritures mystérieuses [soient] finalement destinées à pourrir avec le vivant parchemin qui les portait, et par conséquent à demeurer mystère jusqu'au bout» (pp. 768-9); c'est encore Achab qui peut faire la leçon professorale aux éléments quand, au cours d'une nuit apocalyptique, il hurle qu'existe «une immensité au-delà» du feu, «quelque chose d'inétendu au regard de quoi toute [son] éternité n'est que temps, et tout [son] pouvoir créateur, [sa] puissance d'engendrement, une mécanique» (p. 807). C'est enfin Achab qui se revêt de la grandeur de Satan, ne voulant pas «sombrer dans les enfers sans avoir arraché une part vivante du ciel pour s'en coiffer en l'emportant dans sa chute» (p. 909) alors que, dans Méridien de sang, le gamin ayant grandi disparaît, littéralement, entre les bras du juge Holden comme si ce dernier, ainsi que Monsieur Ouine, était une espèce de centre d'attraction dévoratrice, Cormac McCarthy ne nous disant rien du spectacle qu'ont dû voir les hommes qui ont pénétré dans le cabinet, à la suite du gamin, où celui-ci a terminé sa carrière brutale et solitaire, le juge Holden lui-même ne cessant plus de danser, pour une éternité de forfaits et de meurtres, alors que le roman tout entier se referme sur un épilogue ayant fait couler beaucoup d'encre, mais qui n'a pour l'heure pas révélé son chiffre.
C'est Melville qui peut ne pas craindre d'écrire que «le plus merveilleux et le plus terrifiant de ce qui est vraiment dans l'homme, ni mots ni livres n'y ont touché jusqu'ici» (p. 763); c'est encore Melville qui peut indiquer que le corps tatoué de Quiequeg représente «une cosmogonie complète et un traité mystique sur l'art d'atteindre à la vérité», peu importe même qu'il devienne alors «une énigme à résoudre, une œuvre merveilleuse en un volume» ou que «ces écritures mystérieuses [soient] finalement destinées à pourrir avec le vivant parchemin qui les portait, et par conséquent à demeurer mystère jusqu'au bout» (pp. 768-9); c'est encore Achab qui peut faire la leçon professorale aux éléments quand, au cours d'une nuit apocalyptique, il hurle qu'existe «une immensité au-delà» du feu, «quelque chose d'inétendu au regard de quoi toute [son] éternité n'est que temps, et tout [son] pouvoir créateur, [sa] puissance d'engendrement, une mécanique» (p. 807). C'est enfin Achab qui se revêt de la grandeur de Satan, ne voulant pas «sombrer dans les enfers sans avoir arraché une part vivante du ciel pour s'en coiffer en l'emportant dans sa chute» (p. 909) alors que, dans Méridien de sang, le gamin ayant grandi disparaît, littéralement, entre les bras du juge Holden comme si ce dernier, ainsi que Monsieur Ouine, était une espèce de centre d'attraction dévoratrice, Cormac McCarthy ne nous disant rien du spectacle qu'ont dû voir les hommes qui ont pénétré dans le cabinet, à la suite du gamin, où celui-ci a terminé sa carrière brutale et solitaire, le juge Holden lui-même ne cessant plus de danser, pour une éternité de forfaits et de meurtres, alors que le roman tout entier se referme sur un épilogue ayant fait couler beaucoup d'encre, mais qui n'a pour l'heure pas révélé son chiffre.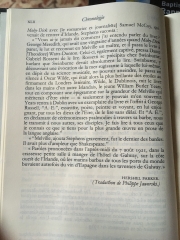 Ainsi, Méridien de sang se referme-t-il sur ses énigmes, et nous ne pouvons imaginer quelle sera la suite de la carrière sanglante du juge, alors que nous pouvons parfaitement deviner qu'Ismahel n'en finira jamais de poursuivre Moby Dick, même si le monstre a disparu avec son plus coriace poursuivant, Achab, tout comme ce roman immense continuera de se transmettre de lecteur en lecteur, de George Meredith, qui avait une vingtaine d'années lorsque Moby Dick parut, et le donna à Theodore Watts-Dunton qui le fit lire à Dante Gabriel Rossetti, lequel le transmit à Swinburne qui le passa en silence à Oscar Wilde qui mit le livre entre les mains d'un autre Irlandais, le jeune William Butler Yeats qui l'offrit à George Russell, l'histoire de bouche à oreille finissant par devenir l'objet d'une anecdote saluant un si remarquable passage de flambeau que n'hésitait jamais à confier le charmant poète et conteur James Stephens qui en fit part au romancier et journaliste Samuel McCoy, et ainsi de suite, qui sait, peut-être, par un tel chemin ou bien un autre, à Cormac McCarthy.
Ainsi, Méridien de sang se referme-t-il sur ses énigmes, et nous ne pouvons imaginer quelle sera la suite de la carrière sanglante du juge, alors que nous pouvons parfaitement deviner qu'Ismahel n'en finira jamais de poursuivre Moby Dick, même si le monstre a disparu avec son plus coriace poursuivant, Achab, tout comme ce roman immense continuera de se transmettre de lecteur en lecteur, de George Meredith, qui avait une vingtaine d'années lorsque Moby Dick parut, et le donna à Theodore Watts-Dunton qui le fit lire à Dante Gabriel Rossetti, lequel le transmit à Swinburne qui le passa en silence à Oscar Wilde qui mit le livre entre les mains d'un autre Irlandais, le jeune William Butler Yeats qui l'offrit à George Russell, l'histoire de bouche à oreille finissant par devenir l'objet d'une anecdote saluant un si remarquable passage de flambeau que n'hésitait jamais à confier le charmant poète et conteur James Stephens qui en fit part au romancier et journaliste Samuel McCoy, et ainsi de suite, qui sait, peut-être, par un tel chemin ou bien un autre, à Cormac McCarthy.Notes
(1) University of Texas Press, Austin, 2008.
(2) Rich Wallach Editor, Casebook Studies in Cormac McCarthy, vol. 2, 2013.
(3) Traduction et postface d'Armel Guerne (éditions Phébus, coll. Libretto, 2005), p. 289. Sans autre mention, les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.
(4) «Le poulain se pressait contre le cheval avec la tête penchée et le cheval regardait au loin, là-bas où s'arrête le savoir de l'homme, où les étoiles se noient, où les baleines emportent leur âme immense à travers la mer sombre et sans faille». Quelles que soient nos différentes notes sur Méridien de sang, nous avons systématiquement cité la version de proche, traduite par François Hirsch, 2006, ici à la page 379. Sans autre mention, les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.
(5) C'est le juge Holden lui-même qui se déclare «suzerain de la terre», établissant d'ailleurs la spécificité de ce terme en l'opposant à celui de maître, déclarant que «toutes les juridictions lui [étaient) subordonnées» (p. 251). De cette thématique de la suzeraineté, finalement assez peu explorée il me semble au sein de ce roman, nous pouvons rapprocher la phrase, de prime abord énigmatique, utilisée par Cormac McCarthy, Et de ceo se mettent en le pays, traduction du latin Et de hoc ponit se super patriam qu'il faudrait étudier dans leur dimension juridique, ainsi, plus loin, que l'énigmatique dernière scène du roman constituant l'épilogue, elle-même annoncée par un rêve où le gamin voit le juge Holden en compagnie d'un faux-monnayeur qui, «avec ses gravoirs et ses burins», cherche «la faveur du juge et il s'efforce de fabriquer avec la froide matière brute qu'il y a dans la cornue un visage qui sera accepté, une image qui fera que cette espèce résiduelle aura cours sur les marchés où les hommes pratiquent le troc» (pp. 386-7).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, moby dick, herman melville, méridien de sang, cormac mccarthy |  |
|  Imprimer
Imprimer
