Les Bienveillantes attendront... encore un peu (24/11/2006)
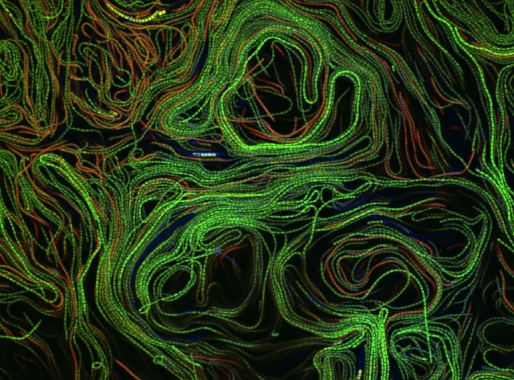
Crédits photographiques : Jonathan Franks.
Certes, tout le monde (id est : Pierre Assouline qui représente à mes yeux et oreilles le triomphal bavardage du On) semble avoir lu ce livre.
Pour défendre (ou stigmatiser) ce livre, On (encore lui) évoque ainsi la banalité du Mal et, au contraire, le raffinement d'un monstre romanesque que l'on veut ou souhaite bien improbable, malgré ce que peut penser, sur ce sujet, George Steiner qui n'a eu de cesse d'évoquer l'énigme crucifiante entre toutes : tous les bourreaux (y compris nazis) n'étaient pas de simples brutes avinées ni même de ridicules Peredonov (le pathétique professeur de l'excellent roman de Sologoub intitulé Un démon de petite envergure) se contentant de repiquer quelque bouture d'ordre dont ils ne pouvaient imaginer la floraison terrifiante. Beaucoup de mes lectures, presque chacun de mes textes écrits sur ce thème m'ont appris que le Mal, effectivement, se pare rarement des fastes d'une péroraison romantico-décadente. La vie, elle aussi, se charge de nous rappeler que les pompeux et stériles Teste (tous ces impuissants doctorants en copiés-collés, ces poussifs théologiens à ce point en extase devant le Neutre blanchotien qu'ils en oublient de se laver), les fuligineux hommes des foules évoqués par Poe, les tristes avocats noyant leurs souvenirs dans quelque bar d'Amsterdam, comme nous le montre La Chute de Camus, sont infiniment plus probables que la découverte, sous un long manteau noir, d'une queue fourchue. Du reste, les incarnations littéraires les plus convaincantes de la monstruosité démoniaque paraissent à leur tour avoir inversé, depuis plus d'un siècle, la proportion des sublimes Gilles de Rais, des redoutables incubes Erzsébet Bathory, des nocturnes Manfred, des dolents Melmoth et autres sophistiqués Claudius Ethal qui, à force d'imaginer de scabreuses tortures, de bizarres horreurs, ne provoquent guère plus qu'un haussement de sourcil : c'est sans doute que, comme le dit l'adage, le lecteur contemporain en a vu bien d'autres... Oui, sans avoir rien vécu, sans avoir souffert dans notre propre chair, nous pouvons bien dire que nous avons tout vu, tout senti, tout expérimenté. Nous avons vu l'homme réduit à n'être qu'un sous-homme, quelques milligrammes de cendres se dissipant dans le lait noir de l'aube, un chiffre oscillant vers le zéro plutôt que vers l'infini. Nous avons vu se développer tranquillement puis hurler (ce hurlement n'a pas fait vibrer un seul brin d'herbe) à la face du monde gris le fanatisme besogneux de l'homme sans aucune qualité. Nous avons surtout lu les récits de celles et ceux qui ont survécu à l'enfer des camps de concentration, au froid meurtrier de la Kolyma puis des prisons humides et pestilentielles où l'on brisait, toujours aussi tranquillement, avec une redoutable monotonie dans l'efficacité déshumanisée, la volonté des plus endurcis en leur prouvant que le Parti ne pouvait jamais se tromper. Et puis nous avons surtout gardé en mémoire d'innombrables articles plus ou moins savants s'interrogeant sur les façons d'exprimer l'inexprimable, de dire l'indicible : des colloques entiers sont consacrés à ce qui désormais, horriblement, s'appelle la littérature des camps. En fin de compte, ce lecteur-témoin ne sait même plus si le Mal existe, bien qu'il ne doute une seule seconde, en revanche, que le diable n'a été qu'une invention commode et redoutablement efficace du clergé catholique pour, selon l'opinion des esprits les plus éclairés, brider les volontés et diriger, à sa guise et pour de sombres fins, les sociétés. Nous savons tout cela, cette pesante routine engluant des certitudes que l'on dirait nôtres de toute éternité, alors qu'elles ne sont sans doute rien de plus que des mauvais rêves paralysant nos forces.
Et pourtant, se dresse la difficulté, inattendue, d'une évocation littéraire du Mal qui serait à la fois grandiose et d'une microscopique banalité, d'une insignifiante petitesse, bien faite pour nous rassurer. Cette évocation ambiguë, par le fait même qu'elle tire sa richesse d'un truchement lui-même torve, parvient à nous convaincre lorsqu'elle se pare des signes complexes et crépusculaires (ils ne sont ni la nuit ni le jour mais appartiennent aux deux royaumes, constituent même le mélange inextricable de ces deux royaumes, apparaissent toujours et tirent leur puissance de cette apparition spectrale, selon l'expression, à la brune) du mythe. J'en veux pour preuve deux récentes illustrations, la seconde ayant d'ailleurs irrésisitiblement rappelé, dans mon esprit, la première, Damnation de Béla Tarr.
Certes, le personnage central du film crève comme un chien (ce n'est point là qu'une image), abandonné de tous, parce qu'il a lui-même descendu, une à une, les marches le menant vers un Enfer d'indifférence percluse. De même, aucun fait d'ordre surnaturel ne paraît trouer la trame répétitive de journées qui toutes se ressemblent. Mais la dimension mythique n'est justement pas le surnaturel même si elle peut s'ajointer à ce dernier pour en obscurcir le dévoilement. Demeure ainsi la présence d'une voix pythique ou plutôt apocalyptique, cette femme qui, à tels moments-clés de Damnation, annonce la faute commise et la sentence qui s'abattra sur le pécheur. Présence mythique (comme l'étrange gardienne des morts de la Nouvelle histoire de Mouchette, comme ces sombres et muettes femmes qui attendent la venue de Marlow, tout près de s'embarquer vers l'inconnu) plutôt que surnaturelle. De la même façon, l'analyse du thème du Mal, dans Les Harmonies Werckmeister, peut sensiblement répondre à un identique étirement entre ces deux pôles que tout devrait éloigner : la médiocrité d'un côté, celle, bien avant qu'elle ne soit popularisée par Hannah Arendt, qui fut sobrement analysée par la littérature patristique et, de l'autre, une forme incandescente, dépassant, pour le dire avec Claude Bruaire (1), le cadre des possibilités humaines, de la Malveillance.
 D'ailleurs, le roman, somptueux et lui-même baignant dans une louche clarté crépusculaire, qui a été adapté à l'écran par Tarr (ou plutôt : cette adaptation ne porte que sur la deuxième partie du livre), La mélancolie de la résistance de László Krasznahorkai, oscille lui-même entre ces deux pôles : un Mal réductible à ses plus grossières incarnations d'un côté (maris buveurs, femmes mégères voire légères, simples voyous), de l'autre sa figuration mythique, qui jamais mieux à mon sens ne s'exprime que par le truchement de ce que Robin nommait la fausse parole, ici maniée par le mystérieux et redoutable Prince, dont il s'agit de traduire la langue inconnue. Le second exemple provient du remarquable roman de Cormac McCarthy intitulé L'Obscurité du dehors (Outer dark), dans lequel un ridicule personnage, incestueux et illettré, abandonne aux bêtes de la nuit son propre enfant avant de se lancer à la poursuite de sa sœur qui a fui la maison où tous deux vivaient dès l'instant où elle a compris que son frère lui avait menti sur le sort réservé à leur enfant : il n'est sans doute pas mort, puisque son père, contrairement à ce qu'il a affirmé, ne l'a pas enterré, il s'agit donc d'en retrouver la trace, et pour cela il faut retrouver celle du colporteur qui a recueilli, abandonné dans la nuit par son propre père incestueux et illettré, l'enfant abandonné. Le Mal, sa simple possibilité intellectuelle, semble à peine effleurer l'esprit lourd de Culla Holme, sorte de Valuska des ténèbres, pourtant oiseau de mauvais augure puisque son passage est marqué par une série de meurtres inexplicables et de catastrophes naturelles. Le Mal même, foulant tel un cheval de feu la terre gaste décrite par le romancier, le Mal même, superbement mis en scène ou en branle par un trio maléfique qui tue à plusieurs reprises et n'hésite pas à dévorer devant lui le propre enfant chétif du fuligineux et pitoyable Culla, le Mal même épargne ce dernier qui, une nouvelle fois, aux toutes dernières lignes de ce roman réellement infernal, manquera à son devoir d'homme, cette fois-ci en se désintéressant du sort d'un aveugle qu'il laissera (bien que le roman ne fasse que suggérer ce point) se diriger vers une mort certaine.
D'ailleurs, le roman, somptueux et lui-même baignant dans une louche clarté crépusculaire, qui a été adapté à l'écran par Tarr (ou plutôt : cette adaptation ne porte que sur la deuxième partie du livre), La mélancolie de la résistance de László Krasznahorkai, oscille lui-même entre ces deux pôles : un Mal réductible à ses plus grossières incarnations d'un côté (maris buveurs, femmes mégères voire légères, simples voyous), de l'autre sa figuration mythique, qui jamais mieux à mon sens ne s'exprime que par le truchement de ce que Robin nommait la fausse parole, ici maniée par le mystérieux et redoutable Prince, dont il s'agit de traduire la langue inconnue. Le second exemple provient du remarquable roman de Cormac McCarthy intitulé L'Obscurité du dehors (Outer dark), dans lequel un ridicule personnage, incestueux et illettré, abandonne aux bêtes de la nuit son propre enfant avant de se lancer à la poursuite de sa sœur qui a fui la maison où tous deux vivaient dès l'instant où elle a compris que son frère lui avait menti sur le sort réservé à leur enfant : il n'est sans doute pas mort, puisque son père, contrairement à ce qu'il a affirmé, ne l'a pas enterré, il s'agit donc d'en retrouver la trace, et pour cela il faut retrouver celle du colporteur qui a recueilli, abandonné dans la nuit par son propre père incestueux et illettré, l'enfant abandonné. Le Mal, sa simple possibilité intellectuelle, semble à peine effleurer l'esprit lourd de Culla Holme, sorte de Valuska des ténèbres, pourtant oiseau de mauvais augure puisque son passage est marqué par une série de meurtres inexplicables et de catastrophes naturelles. Le Mal même, foulant tel un cheval de feu la terre gaste décrite par le romancier, le Mal même, superbement mis en scène ou en branle par un trio maléfique qui tue à plusieurs reprises et n'hésite pas à dévorer devant lui le propre enfant chétif du fuligineux et pitoyable Culla, le Mal même épargne ce dernier qui, une nouvelle fois, aux toutes dernières lignes de ce roman réellement infernal, manquera à son devoir d'homme, cette fois-ci en se désintéressant du sort d'un aveugle qu'il laissera (bien que le roman ne fasse que suggérer ce point) se diriger vers une mort certaine.Je n'ai pas lu Les Bienveillantes, à ma grande honte peut-être, mais me gênent et m'indisposent, par avance, les propos de son auteur, sorte de premier de la classe ayant travaillé comme un forcené sur un thème imposé, qu'il savait scandaleux aux yeux mêmes de nos professeurs de bienséance, me gênent aussi les critiques consacrées à ce roman : y sont évoquées, systématiquement, des années de préparation intense, une documentation énorme, plus ou moins bien digérée selon les uns et les autres. M'indispose en somme dans ce livre ce que je pressens d'écriture appliquée mais point inspirée, de plaquage de thèses sur un phénomène de toute façon parfaitement inexplicable (je parle du Mal, pas du nazisme... encore que, ce dernier, selon Kershaw par exemple, soit d'une nature difficilement conceptualisable). Me gêne la complication de ce roman, plutôt que sa véritable complexité : non pas, puisque je n'ai pas lu ce livre, me gêne donc l'idée que me donnent ses attentifs lecteurs de la complication du roman. Monsieur Ouine, Le Tentateur, cette Mélancolie de la résistance trop brièvement évoquée et qui, à mes yeux, vaut toutes les découvertes rachetant une lamentable rentrée littéraire, les romans de Cormac McCarthy, ceux de David Peace, également récemment lus : un point commun, évident, unit tous ces livres. L'irrésistible coulée de leur écriture, que l'on dirait emportée par une langue pressée de conclure, de parvenir à son dénouement, de briser les sceaux pour nous montrer ce qui doit être vu, l'extraordinaire difficulté de leur rédaction aussi (je songe bien évidemment au roman de Bernanos, fruit d'un labeur épique de près de dix années), sans pourtant, dans chacun de ces cas, qu'une colossale documentation n'ait été nécessaire ni même, surtout, souhaitable. Car ces livres ne prétendent défendre aucune thèse; ils s'en éloigneraient comme de la peste (ou du diable...) plutôt, tant leur volonté est plus farouchement exacerbée, tant leur dimension est éminemment littéraire, en cela qu'elle s'ente sur un verbe qui la dépasse, se nourrit d'images qui l'aveuglent et la hantent, tente d'ouvrir des portes refermées sur des mystères qu'il faut à tout prix tenir loin des yeux souriants. Ces romans paraissent avoir été écrits dans un état second, d'un seul jet (ce n'est bien évidemment pas le cas), comme si leurs auteurs avaient soudainement pris conscience, horrifiés, du fait que le Mal ne peut être décrit, encore moins patiemment analysé, que sa nature même est de constamment échapper à notre attention, comme le dormeur, éprouvé par un mauvais rêve, tente sans succès de recomposer les principales scènes (et leur enchaînement) de la vision l'ayant durement éprouvé : sa texture est le vide qui troue la trame romanesque de Monsieur Ouine, le vide des paroles du Prince difforme et nabot hantant les cervelles des maraudeurs ou le vide de ce vagabond charismatique qu'est Marius Ratti.
«Mais comment chanter les dégoûts,
La fièvre du mal, sa naissance ?», se demande Patrice de La Tour du Pin dans sa Quête de joie. Je répondrai : en redonnant à la littérature sa dimension oraculaire, apocalyptique, c'est-à-dire, en laissant affleurer à sa surface, dans le livre chargé d'une vie profonde, cachée, monstrueuse, une nappe très ancienne, affleurement mythique et symbolique de la parole devenue révélation, retour à sa violence première. Il va sans dire que je me réjouirai qu'une telle quête ait été l'objet d'un écrivain n'appartenant pas au petit sérail puant du parisianisme onaniste tout occupé à secouer son organe flasque : de temps à autre, après des mois d'une poussive masturbation, il en sort, paraît-il, quelque être dégénéré bien heureusement promptement euthanasié, un livre de Christine Angot. Il va sans dire encore qu'une telle leçon, administrée par un écrivain américain à nos petits marquis sollersiens de l'insignifiance verbeuse, serait doublement jubilatoire à mes yeux.
Reste tout de même, à présent n'est-ce pas, à lire ces Bienveillantes, sans d'ailleurs en attendre grand-chose. À moins que, décidément incapable de commencer cette lecture sans cesse procrastinée et cherchant en somme toutes les façons de me donner bonne conscience, je fasse confiance à plusieurs courriels consécutifs à cette note et qui me signifient le peu d'intérêt proprement littéraire de ce roman, sa mauvaise écriture (de gare, me précise-t-on), le fait aussi qu'une seule ligne écrite par Cormac McCarthy, précieuse à force d'avoir été comme dangereusement concentrée dans sa description d'un Mal indescriptible, soit supérieure à ces presque mille pages tonitruantes qui de l'horreur ne nous donnent qu'une compilation laborieuse.
Note
(1) Dans un article intitulé Satan, actif et vaincu, qui écrit : «Toujours au revers de nos progrès, ruinant souvent la volonté bonne, un immense surcroît de mal, jamais explicable par le seul mauvais vouloir, se constate à la moindre réflexion. C'est alors que s'évoque, presque invinciblement, la puissance de l'Esprit du Mal», in Revue Communio, N°IV, 3 Mai-Juin 1979, p. 4.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, les bienveillantes, littell |  |
|  Imprimer
Imprimer