« Jeanne d'Arc et l'Allemagne de Léon Bloy | Page d'accueil | La (seule) librairie française des Éditions L'Âge d'Homme est-elle morte d'une indigestion de cuisine végane ? »
05/05/2016
Philosophie animale (1) : l’animal qui me regarde et qui me somme d’en faire autant, par Gregory Mion

Crédits photographiques : Johannes Eisele (Getty Images).
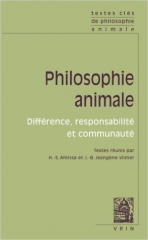 Note préliminaire : le propos qui suit s’appuie sur le recueil de textes clés de philosophie animale paru aux Éditions Jacques Vrin en 2010 (Philosophie animale : Différence, responsabilité et communauté), supervisé par Hicham-Stéphane Afeissa et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer. Notre réflexion concerne plus particulièrement les trois premiers articles du recueil (ceux de John Berger, Pierre Guénancia et Matthew Calarco), qui traitent de la différence entre l’humanité et l’animalité. Suivront dans les prochains mois deux nouvelles notes, qui compléteront la lecture de ce très utile volume.
Note préliminaire : le propos qui suit s’appuie sur le recueil de textes clés de philosophie animale paru aux Éditions Jacques Vrin en 2010 (Philosophie animale : Différence, responsabilité et communauté), supervisé par Hicham-Stéphane Afeissa et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer. Notre réflexion concerne plus particulièrement les trois premiers articles du recueil (ceux de John Berger, Pierre Guénancia et Matthew Calarco), qui traitent de la différence entre l’humanité et l’animalité. Suivront dans les prochains mois deux nouvelles notes, qui compléteront la lecture de ce très utile volume.Acheter Philosophie animale: Différence, responsabilité et communauté sur Amazon.
L’homme et la nature : des relations capricieuses
On se gargarise en général du fait que les hommes ont transformé la nature par un travail constant de la culture et que cet effort de création les a libérés d’une animalité chaotique pour les faire entrer dans la cohérence de l’humanité. En se montrant capable de modifier la nature autour de lui et en lui, l’homme a capitalisé des techniques et des savoirs, il a changé la donne de son environnement tout comme il a instauré des façons de parler, de juger et de réagir, et l’ensemble de ces productions matérielles ou spirituelles a contribué à homologuer des systèmes de valeurs et de représentations, permettant de bâtir sur le long terme des modèles politiques et des options complémentaires d’organisations sociales. D’une certaine manière et pour peu que nous nous gardions autant que possible des Prométhée modernes, la nature continuera de nous contraindre par plusieurs de ses aspects nécessaires, elle s’obstinera à nous dérober son secret, nous priant ainsi de savoir où agir et où maintenir nos distances. Devant cette résistance de la nature, la culture humaine s’est démultipliée pour nous offrir une incroyable variété d’interprétations du monde naturel, comme si chaque homme portait en lui le désir non pas tant de connaître toute la nature, mais de la découvrir selon un éventail de significations qu’il aura patiemment accumulées par le biais de ses expériences.
Ainsi tous les hommes savent par exemple qu’ils finiront par mourir, ils ont compris que la génération engageait la corruption, mais aucun d’entre eux ne se fait exactement la même idée de ce qu’il adviendra de lui une fois qu’il aura quitté ce monde, la mort ayant acquis pour nous un statut supra-culturel, avec son au-delà à géographie variable, ses catacombes innumérables, ses rituels et ses récents concours d’hygiène qui auraient fasciné feu le docteur Ignace Semmelweis. Il y a dans cet engraissement culturel de la mort une sorte de refus catégorique de s’en tenir aux impératifs de la nature en ce qui concerne la finitude, comme si, en définitive, l’homme se sentait le droit et l’habileté de contourner son programme, caressant des désirs d’immortalité tout à fait superflus. En outre, la profondeur même de notre mourir entraîne un vertige qui rend notre futur le plus certain absolument incommunicable. La conscience de la finitude est ce qui nous met en situation d’être misérables dirait Pascal, ceci étant, puisque nous sommes les seuls êtres de la nature à prendre aussi bonne note de la mort, on pourrait en faire un argument de prudence au lieu d’en faire un motif de crainte et de tremblement, somme toute une occasion de mieux nous penser dans l’ordre des événements, et par là même justifier la célèbre image pascalienne du «roseau pensant», dont la fragilité n’empêche pas la persévérance dans la vie étant donné que la pensée constitue une puissance inestimable. La faculté de penser nous donne des forces décisives qui ne nous seront réellement ôtées qu’au moment de disparaître, et cette position privilégiée dans la réflexion sous-entend que nous avons des responsabilités assez nettes vis-à-vis de tout ce qui n’est pas doté de la pensée, c’est-à-dire, finalement, tout le reste de la nature.
Ce qu’il faudrait alors avoir à l’esprit, c’est que la mort de soi, la toute petite mort individuelle, n’est rien en comparaison de la mort-autour-de-soi. Être inquiet pour soi devrait inclure l’inquiétude de l’autre-que-soi, ne serait-ce que parce que tout autre est chaque fois susceptible de me sauver. Qui dirait à ce propos qu’il aime vivre au milieu d’une nature qui paraît abandonnée, laissée pour morte ? Lequel d’entre nous ne s’afflige pas de la carcasse animale qui jonche une route ou d’une forêt qui vient d’être anéantie par un incendie ? Qu’on apprenne enfin que le déluge après nous n’est plus permis, que l’attention au monde n’est pas qu’une affaire qui se délègue aux hypersensibles ou à de prétendus experts. Tout ce que nous faisons ne peut pas se résumer à la sphère des bénéfices personnels, sans quoi nous prendrions le risque de continuer à légitimer des sociétés où l’échange égoïste a valeur de processus fonctionnel. Vivre de soi et rien que pour soi, c’est faire de sa mort une catastrophe insurmontable, mais c’est encore alourdir le bilan de ce qui existe autour de nous et que nous ne percevons pas ou que nous distinguons mal, le désir du rien-que-soi étant l’atomisation simultanée du tout-autre-que-soi. Si la mondialisation doit servir à quelque chose, qu’elle puisse instaurer une mondialisation du sentiment, un agrandissement de la sympathie où nous pourrions améliorer notre perception de ce que c’est que vivre et mourir avec les autres. Si j’ai l’impression en revanche que ma mort emporte avec elle le monde entier, c’est que je n’ai pas compris le sens de mon «passage» ici-bas, que j’ai manqué de générosité et que je m’apprête à m’absenter en étant dévasté par la haine, jaloux des survivants et leur souhaitant, comme certains le font sur des lits de douleurs, les pires cataclysmes. Si nous voulons nous rendre dignes de la pensée qui nous a été offerte en faculté éminente, alors il faut commencer à nous faire à l’idée que nous ne sommes pas au-dessus parce que nous pensons et que la nature ne semble pas en faire autant, mais que nous sommes tenus de justifier de nos capacités en discernant dans la nature de quoi nous faire progresser en humanité.
On serait donc en droit de s’attendre à ce que les hommes aient pris en charge l’ensemble de la nature tout en poursuivant leurs explorations culturelles. Que la pensée nous donne les moyens d’être les maîtres et les possesseurs de ce qui ne pense pas ne doit évidemment pas nous encourager à la condescendance ou à l’insouciance. D’ailleurs l’adage cartésien ne suppose pas une domination à sens unique puisque si l’homme n’exploitait la nature qu’en vue de ses désirs les plus immédiats, il risquerait la destruction des ressources naturelles et, à terme, sa propre extinction anticipée. Le «roseau pensant» n’est fort que par son esprit, aussi ses nombreuses faiblesses le ruineraient s’il devait déraisonner ou se servir de ses atouts pour accomplir des projets excessifs. Pour illustrer cette faiblisse intrinsèque de l’homme qui parfois s’oublie dans une douteuse prétention cognitive, il n’est que de voir ce que la nature a fait des installations de la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011. Par conséquent, maîtriser et posséder la nature, cela ne révèle pas tant l’ambition de conquérir le monde que de se conquérir soi-même tout en faisant l’effort d’augmenter raisonnablement notre connaissance des choses naturelles.
Or ce gain de connaissance ne peut se faire en principe que par l’effort parallèle d’une vie morale où nous considérerons que tout être vivant est digne d’exister, donc digne de notre respect. De ce point de vue et compte tenu des risques potentiels de catastrophe naturelle, il n’était sûrement pas prudent de construire une centrale nucléaire à côté de l’océan, monstre indomptable qui pouvait à tout instant se dégourdir et faire mentir nos prévisions, le plus souvent appuyées sur des habitudes plutôt que sur des certitudes rigoureusement démontrées. En effet, pour reprendre l’exemple très éprouvé de Hume dans son Enquête sur l’entendement humain, c’est bien parce que je vois le soleil se lever tous les jours que j’en viens à fonder la vérité que le soleil se lèvera demain, comme il le fera vraisemblablement tous les autres jours. À partir de l’observation de certains cas particuliers qui se répètent, nous avons tendance à fabriquer des lois générales, mais si nous y regardions de plus près, si nous étions attentifs au problème des raisonnements par induction, nous nous apercevrions que ces lois ne sont pas fondées en raison et que la nécessité qu’elles impliquent n’est qu’une illusion que nous nous formulons, peut-être pour échapper à l’angoisse d’un monde contingent où ce qui arrive aurait très bien pu ne pas arriver. Ainsi, tant qu’il ne nous arrive rien, nous nous obstinons à croire que nous avons raison, nous affirmons vaniteusement le primat du culturel sur le naturel, la prééminence de la raison sur le réel, et dès qu’un malheur survient, dès que la nature nous rappelle à l’ordre, quelquefois nous accusons Dieu d’avoir dérogé aux règles de la Providence, tel Voltaire qui s’attriste du tremblement de terre de Lisbonne de 1755 en argumentant que ce Mal, à l’échelle universelle, ne saurait être compensé par un Bien beaucoup plus grand. En réponse à ce cri de désespoir et à cette critique de la Providence qui devait s’aggraver avec la publication de Candide, Rousseau renvoie Voltaire aux stricts devoirs de l’homme, écrivant dans sa Lettre sur la Providence du 18 août 1756 que le séisme de Lisbonne ne remet nullement en cause la bonté divine et qu’il nous appartenait, à nous autres sujets pensants, d’anticiper les calamités hypothétiques que pourrait engendrer la construction d’une ville à proximité d’un territoire sismiquement connoté. Fidèle à son éloquence, Rousseau a certes fait preuve de plusieurs maladresses dans ses propos, notamment en soutenant que si les maisons des Lisboètes avaient été plus modestes les dégâts n’en auraient été que plus réduits, mais l’assise de l’argumentation n’en demeure pas moins valable parce qu’elle nous confronte à notre désinvolture, notre inconséquence, et même à notre outrecuidance en ce qui concerne nos rapports fluctuants avec la nature.
L’animal, un vivant malgré tout
De ces remarques préliminaires se dégage l’idée que la responsabilité des hommes envers la nature n’a pas suivi une ligne droite. Notre attitude envers les animaux le prouve suffisamment et c’est elle qu’il va falloir creuser. Après tout, à ne s’en tenir qu’à un éclairage philosophique superficiel, on admet que l’animal est distinct de l’homme d’abord parce qu’il n’est pas en mesure de penser (par conséquent il n’est pas apte à se penser, à rendre compte de son existence par l’appropriation d’un «Je» méthodiquement posé), ensuite parce qu’il n’est pas pourvu d’un don de parole et enfin parce qu’il n’a pas la possibilité d’établir le récit historique de son espèce, la mémoire et ses compétences afférentes lui faisant défaut. De la sorte, c’est à nous qu’il reviendrait d’épaissir la vie de l’animal, d’en constituer un savoir fiable sans pour autant le réduire à de grossiers découpages scientifiques. Ceci sous-entend que nous puissions surmonter notre arrogance, dépasser les premières relations de prédation et nous attacher à penser que l’animal n’est pas qu’une proie, un objet nutritif, mais qu’il est aussi et surtout un être vivant singulier, doué d’une sensibilité et d’une motricité spécifiques, affublé de qualités dont il ne serait pas incongru de reconnaître que quelques-unes ont des apparences convaincantes d’humanité. Nous devrions en ce sens reconsidérer l’animal non pas comme ce qui est formellement différent de nous et comme ce qui nous résiste quand nous le pourchassons, mais nous devrions lui approuver spontanément un droit de résidence, car au fond l’animal a toujours vécu dans le sillage des hommes, partageant la même planète avec eux. Aucune complication ne devrait apparaître au sujet de la reconnaissance de l’animal en tant que compagnon de route plus ou moins proche de nous. Car il s’agit bien ici de faire un pas supplémentaire après l’exercice de la connaissance factuelle de l’animal : ce n’est qu’en reconnaissant l’animal pour ce qu’il est en droit (un être vivant respectable) que je pourrai l’accepter auprès de moi autrement qu’à l’instar d’une garniture gastronomique ou qu’une statistique d’écologie. Cependant, tel que le fait remarquer Matthew Calarco à juste titre, la cohabitation d’une éthique environnementale et d’une éthique animale ne va pas de soi. En d’autres termes, les hommes sont encore trop persuadés que le souci de la planète peut se permettre de faire de l’animal une donnée secondaire. De plus, cette propension à faire l’économie de l’animal dans nos délibérations sur la nature ne fait que mettre en évidence le fait brut d’une humanité qui se vit en surplomb, perchée au balcon d’une intelligence discriminante. Que l’animal meure ne fait pas écho à la possibilité imminente de notre mort, et nous ne faisons pas grand cas de la citation que l’on attribue à Albert Einstein au sujet des abeilles, en l’occurrence au fait que si les abeilles venaient à disparaître de la surface de la Terre, l’homme n’aurait plus guère d’années à vivre (1).
Selon M. Calarco, les difficultés que nous avons à pleinement apprécier la vie animale s’expliquent par le fait que nous attachons trop de crédit à la dichotomie homme/animal, influencée par un anthropocentrisme de rigueur. Il dénonce en outre un autre écueil, celui d’une pensée de l’animal largement essentialiste, où les animaux sont encastrés dans des rubriques inflexibles qui leur refusent toute dynamique et partant de là tout devenir. Ces divers constats entérinent la formule de Richard W. Bulliett, qui parle d’une époque de la «post-domesticité» pour qualifier notre présent, alléguant d’une coupure nette entre les animaux d’élevage et les animaux de la maison, les premiers nous étant devenus invisibles et les seconds occupant un terrain de visibilité important, pour ne pas dire standardisé. Nous ne voulons pas voir l’animal que nous mangeons, cependant nous instituons avec nos animaux de compagnie des rapports privilégiés, et paradoxalement nous pouvons nous offusquer des traitements réservés aux animaux que l’on fait passer du circuit naturel au circuit artificiel de l’économie de marché, notre consommation de produits animaliers étant prolifique. Quant à l’animal encore dans la nature, il paraît anecdotique, sujet de quelques reportages télévisés ou d’émotions plus ou moins fortes, l’enfant s’écriant lorsqu’il voit un cerf surgir des bois, le citadin se terrorisant dès lors qu’une araignée lui grimpe sur le bras. Mis à part cela, d’une manière générale, l’animal de la nature est aujourd’hui un être du lointain, une présence reculée qui tiendrait presque du loup-garou ou de la légende urbaine, un monstre du Loch Ness que l’on se grise d’entrevoir pendant une promenade ou que l’on convoque le soir venu, dans les discussions où l’on aime se faire peur. Ceci nous indique à quel point le regard que nous portons aux animaux s’est mué en une sorte de coup d’œil jeté par inadvertance, voire par distraction. Il n’y a malheureusement que les chasseurs qui se montrent plus attentionnés que le commun des hommes – ce sont des vigies aux yeux dédoublés, l’œil se complétant de la lunette du fusil, ne laissant à l’animal qu’une mince chance de s’en sortir. Néanmoins ce n’est quand même pas tout à fait la même chose que la chasse non balistique, où l’homme se mesure plus objectivement à la nature, au cours d’un face à face incertain où les rapports de force ne sont pas joués d’avance. Qu’on en juge par la scène formidable du nouveau film d’Alejandro Iñárittu, The Revenant, où le trappeur du XIXe tout à la fois dévisage, envisage et prend au sérieux l’animal, le regardant pour ainsi dire véridiquement, se battant les yeux dans les yeux contre le grizzli qui est en train de le mettre en capilotade.
La thématique du regard s’avère d’ailleurs fondamentale pour réinvestir notre relation avec l’animal puisque nous l’avons peu à peu perdu de vue, réduit soit au panorama conventionnel d’un zoo (l’animal que je vois amorphe dans son enclos, si loin de ce qu’il est), soit à la vision accidentelle d’un surgissement enchanteur et sauvage bientôt remplacé par un autre divertissement (l’animal qui m’impressionne lors d’une excursion, que je croise inopinément sur mon chemin et dont je raconterai à mes amis la sensation forte qu’il me procura), soit au canevas minutieux d’un tableau scientifique de classification (l’animal logiquement, axiomatiquement démembré). Au milieu de tout cela nos animaux domestiques circulent, mais ils ne sont que très maigrement pris pour ce qu’ils sont puisque nous les humanisons à outrance, à défaut de leur accorder ne serait-ce qu’un léger coefficient de bestialité, une autorisation de manquer un tant soit peu aux réglementations sévères du domicile. Ainsi faudrait-il réapprendre à regarder l’animal, à retrouver avec lui nos accointances de jadis, à regagner la réciprocité qui nous faisait prendre l’animal pour une présence significative à travers laquelle nous approfondissions le savoir interhumain. Avec justesse et très opportunément, H.-S. Afeissa et J.-B. Jeangène Vilmer rappellent que le problème n’est pas neuf et qu’Aristote, déjà, faisait remarquer dans la Rhétorique que nous ne saurions éprouver de la honte dans le regard des enfants ou des animaux, leurs yeux n’étant pas suffisamment expressifs pour qu’on y détecte les symptômes en miroir d’une moindre gêne qui viendrait nous accabler. Dans les yeux de l’enfant ou de l’animal ne se reflète rien, en tout cas rien qui ne soit riche de sens et qui nous pousse à ressentir la honte d’être un homme qui ne sait pas se soumettre à la valeur d’un regard, celui-ci, qui plus est, étant hébergé par des êtres vivants insuffisamment estimés, les uns, trop jeunes, n’étant pas encore animal rationale, les autres, trop bêtes, étant voués à ne jamais l’être. Aussi le vieux proverbe sur lequel s’appuie Aristote, à savoir que «la honte est dans les yeux», ne peut s’appliquer aux enfants et aux animaux, incapables de nous retourner l’abjection que nous leur imposons. En conséquence, l’on continue aisément de dévoiler notre nudité à l’enfant et à l’animal, mais l’on s’affecte de pudeur devant les regards incisifs et renseignés, devant ceux qui, sait-on jamais, pourraient dépister dans notre nudité les préambules d’une bien plus profonde bassesse que celle d’un corps livré à tous les voyeurismes, la vulnérabilité de l’homme nu le ramenant souvent à sa condition de misérable, de toute minuscule chose qui se bâtit des châteaux en Espagne.
Ce réapprentissage du regard ne peut passer que par le décentrement de nous-mêmes, par le rejet progressif de nos visions anthropomorphes, et cela exigerait que nous nous engagions à voir dans l’animal non pas le visage d’un autre homme, non pas un trait de caractère qui ferait de l’animal l’objet d’une morale d’Ésope ou de La Fontaine, mais un visage en tant que tel, des contours animaux à part entière et que j’approuverais comme autant de spécificités prégnantes. C’est M. Calarco qui demande à ce que nous nous mettions en capacité d’octroyer un visage particulier à l’animal, interrogeant à cet égard l’éthique d’Emmanuel Levinas, qui fait du visage le centre névralgique de l’humanité, le point d’arrêt de toute violence parce que le visage est l’incarnation même de la «résistance éthique» (2), la mise en demeure d’une liberté qui s’apprêtait peut-être à commettre l’irréparable et qui a été rattrapée in extremis par le visage de l’autre, ce visage me commandant la tolérance, la non-violence, et d’une certaine façon l’attendrissement de mon désir de possession ou de destruction. Ma liberté, dans ce cas, n’est opérationnelle qu’en étant reformulée à l’aune de la prise de conscience d’autrui et de la responsabilité inconditionnée que j’ai envers lui par le biais de son visage, lequel, pour ainsi dire, me saute à la figure, me prend à la gorge et exige que je le regarde comme une liberté aussi infinie que la mienne. Tout l’enjeu consiste donc à s’affranchir des réflexes qui nous empêchent d’attribuer à l’animal les mêmes qualités que celles que nous repérons aisément dans un visage humain. Du reste, si nous avons mis tant d’adresse à commercialiser des peluches à l’allure affable, si nous avons fait preuve d’inventivité en mettant les animaux en scène dans des dessins animés, leur prêtant volontiers une intelligence que nous leur refusons d’ordinaire et rivalisant par ailleurs dans la création de produits manufacturés, pourquoi restons-nous indécis devant la question du visage des animaux réels ? Qu’est-ce qui fait que la reconnaissance d’un visage chez l’animal nous pousse dans une tracasserie sans nom ou à tout le moins dans un fourbi conceptuel ?
Des éléments de réponse nous sont fournis par l’écrivain et essayiste John Berger, qui situe le début de la rupture entre l’homme et l’animal au XVIIe siècle, prenant Descartes pour coupable philosophique d’un crime de lèse-animalité. En posant que l’animal n’est pas instruit par une âme, Descartes réduit la bête à une pure machine, à un objet dont la compréhension peut être restituée par une investigation mécaniste, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un discours qui stipule que l’organisme est entièrement assimilable à la configuration de ses parties et dont la nature ne comporte aucune intention occulte. L’avantage indéniable de cette approche, c’est qu’elle simplifie la connaissance du vivant, faisant de chaque partie du corps un rouage précis, nullement mystérieux et divinement élaboré. Ceci étant, la schématisation du vivant animal par la thèse mécaniste nous fait manquer sa richesse intrinsèque, voire plus précisément sa finalité interne puisque tout corps vivant, selon Kant, est gratifié d’une force expansive qui se communique à toutes les parties de lui-même qui ne sont pas pourvues de ce dynamisme, cette force jouant de ce fait un rôle déterminant d’organisation, un rôle d’ordonnance qui se distingue du rôle strictement moteur de la force impersonnelle qui préside à l’activité d’une machine (3). C’est ce que Kant défend dans la Critique de la faculté de juger lorsqu’il prend l’exemple d’une montre : je vois dans le mécanisme d’une montre des rouages qui existent les uns pour les autres, mais je ne vois pas que l’un de ces rouages puisse être celui par lequel un autre existe. Ainsi dans le cas où la montre tomberait en panne, dans le cas même où elle se ralentirait seulement, il faudrait une intervention extérieure pour en faire repartir le mouvement, tandis qu’un corps vivant est nanti d’une force initiatrice exclusive, singulièrement organisationnelle de tous ses matériaux, une force depuis laquelle les éléments du corps puisent leur énergie et sont parfois en mesure de se réparer de façon autonome en cas de perturbation. La montre que je fais tomber et qui se brise va donc sans doute nécessiter les réparations d’un artisan ou l’achat d’une nouvelle montre, tandis que le corps qui tombe et qui se blesse cicatrisera sans le soutien d’une force réparatrice étrangère. Et quand bien même un médecin serait utile à ce corps, le médecin serait conscient des facultés auto-régénératrices d’un organisme vivant. En outre, comme Kant l’indique pour enfoncer le clou, pour insister sur le fait que le vivant est irréductible à la machine, nous ne pouvons pas admettre que le rouage d’une montre puisse en faire naître un autre, ni qu’une montre puisse accoucher d’une autre montre. Le cas échéant, ce ne serait qu’un dossier de science-fiction, voire une surréaliste duplication signée de la main de Salvador Dalí, qui des ramollissements à l’œuvre dans La persistance de la mémoire passerait aux parturitions de quelques horloges grosses d’une bien bizarre fécondation.
Il s’ensuit que l’objectivation de l’animal sous la forme d’une machine lui ôte tout espoir d’être considéré comme un sujet et par extension de se voir affublé d’un visage. La thèse cartésienne de l’animal-machine rejette toute espèce de consistance dans la vie des animaux, suggérant d’une certaine manière que l’animal n’est jamais autrement que ce qu’il est, qu’il n’est jamais autrement qu’être dirait Levinas, fidèle à un plan inflexible duquel il n’a pas la moindre possibilité de déviance. Par conséquent, depuis Descartes et les partisans du mécanisme, l’animal est enfermé à double tour dans une prison spéculative qui le pousse sur le bas-côté de la vie. La ligne de démarcation est si prononcée que nous vivons désormais parallèlement aux animaux, sans réel point d’intersection durable. La seule convergence véritable a lieu au moment de la mort : la différence présumée entre l’homme et l’animal s’anéantit à travers l’instant radicalement neutralisant du mourir, sorte de rééquilibrage ultime qui relève l’homme de ses fonctions intellectuellement discriminantes.
Cela ne suffit pas cependant à ralentir et même à délester les tendances sécessionnistes de leurs pesantes certitudes. Que l’animal ait un corps au même titre que l’homme ne sauve pas la bête et son absence d’âme. La substance pensante étant le propre de l’homme, cela lui permet d’avoir sur la substance étendue (son corps) un empire dont l’animal est privé, ce dernier étant tout entier assorti à une machine de fond en comble explicable. Ce serait donc apparemment une erreur de croire que l’animal ait un quelconque pouvoir de maîtrise de soi ou de représentation de ses actions. Nulle part l’animal ne paraît en mesure de suspendre son activité machinale au profit d’une activité où la délibération entrerait en jeu. Conformément à cela, on ne reconnaît pas facilement d’activité éthique au monde animal, partout réduit à une chaîne causale où il n’est question que de persévérer dans les pulsions biologiques. Il n’y a visiblement que l’homme qui se soit montré disposé à refuser l’animalité pour s’incruster dans une vie éthique. Nul autre que l’homme est autrement qu’être, par-delà le plan d’un fonds commun de pulsions qui a été assagi par les pratiques culturelles. L’homme a été le seul à fonder un langage et une morale, et ceux qui se plaisent à déclarer que nombre d’animaux ont un langage sont bien embarrassés par les arguments que Descartes développe dans la fameuse Lettre au marquis de Newcastle, datée du 23 novembre 1646. Dans cette lettre, Descartes certifie que le langage est l’unique propriété des hommes et que nous nous trompons lorsque nous jugeons que certains animaux possèdent quelque aptitude à la communication. Prenant l’exemple d’une pie à laquelle on apprendrait à dire bonjour à sa maîtresse, Descartes n’y voit que le résultat d’un conditionnement, la pie ne faisant que réagir mécaniquement à un contexte précis (prononcer «bonjour» lorsque sa maîtresse apparaît, puis se faire offrir à manger après cette politesse, l’acte de langage étant de la sorte entretenu par l’espoir de la récompense). Un tel conditionnement suppose que la pie ne serait pas capable de se taire ou de dire autre chose que «bonjour» à toutes les apparitions de sa maîtresse. Il n’existe ainsi pas de parole authentique dans le bec de la pie, mais simplement une réponse mécanique, sans profondeur, sans variété, chaque fois identique et ce quels que soient les multiples accoutrements que la maîtresse pourrait emprunter en se présentant devant son animal. Que l’animal soit exercé à proférer des paroles et qu’il figure en conséquence quelque chose d’humain ne se conteste pas, mais qu’il puisse parler est inenvisageable car sitôt qu’il serait amputé des organes de la parole, l’animal ne saurait, comme l’humain, concevoir un langage de substitution qui serait composé de signes tout aussi audibles et compréhensibles que ceux qui nous sortent de la bouche.
Le diagnostic cartésien s’est largement répandu, justifiant la dimension spirituelle des hommes par opposition à la matérialité de la vie animale, le comportement des animaux étant plus ou moins prévisible une fois que nous l’avons étudié d’assez près. Selon toute apparence, le contraste est très net entre l’homme imaginatif et l’animal prosaïque, entre la possibilité de penser contre soi et l’impossibilité de se réveiller du sommeil dogmatique des instincts, et somme toute la différence a l’air incommensurable entre l’homme foncièrement scrupuleux dans ses méditations et la dinde inductiviste imaginée par Bertrand Russell : il s’agit d’une dinde qui constate qu’elle est systématiquement nourrie à neuf heures du matin, quelles que soient les circonstances de la journée. Hiver comme été, qu’il pleuve ou qu’il neige, qu’il y ait du vent ou que le calme règne, la dinde n’est jamais nourrie à une autre heure que celle qui se répète. Par induction la dinde en arrive à la conclusion qu’elle est toujours nourrie à neuf heures du matin et que cela ne saurait se modifier. Pourtant, un jour de Noël, la dinde se fait tordre le cou à neuf heures du matin. Les prémisses de la dinde étaient vraies mais elles pouvaient, du fait de l’induction, conduire à une conclusion erronée. Alors que la dinde ne voyait qu’une redondance passablement agréable dans sa situation, l’homme voyait la dinde à l’instar d’un objet techniquement manipulable, tel un nombre qui évolue correctement lors d’un calcul de bout en bout maîtrisé.
Toutefois le propos de Russell n’est pas de s’assurer qu’une dinde est forcément moins intelligente qu’un homme. Tel que nous l’avons vu plus tôt avec l’exemple du soleil qui doit se lever, les hommes ne sont pas moins immunisés que la dinde contre les raisonnements par induction, et l’enjeu est de se demander si une partie de nos énoncés scientifiques ne serait pas contaminée par une pseudo-logique du même ordre ! Si c’était le cas, alors notre science serait aussi infondée que la conclusion de la dinde de Noël de Russell, et le fait même d’en accepter l’hypothèse devrait nous aider un tant soit peu à corriger nos prétentions vis-à-vis des animaux. Qu’on le veuille ou non, l’animal, par une sensibilité exacerbée à un certain niveau, est mieux armé que nous pour sentir l’imminence d’un tremblement de terre ou de quelque autre dangereux soubresaut de la nature, preuve s’il en est que nous n’avons pas conquis la totalité du territoire naturel et qu’il se trouve sûrement dans le vivant des données indécomposables d’un point de vue mécaniste. Ce n’est donc pas tant que l’animal nous nargue et qu’il est le détenteur d’une connaissance qu’il ne peut nous transmettre parce que nous avons toujours parlé à sa place, mais le sentiment qu’il a de la nature lorsque celle-ci se déchaîne dépasse jusqu’à présent nos plus fiables prédictions. On en revient alors à une forme de naïveté fondatrice, bien exprimée par Condillac dans son Traité des animaux et rappelée expressément par H.-S. Afeissa et J.-B. Jeangène Vilmer : si les animaux n’avaient rien à nous apprendre sur ce que nous sommes, nous ne serions pas si enclins à vouloir les connaître. Certes l’homme dispose des ressources intellectuelles pour élaborer un savoir sur les animaux (l’inverse serait inimaginable sauf dans le cadre naturellement «carnavalesque» de La planète des singes de Pierre Boulle), mais l’homme est en même temps l’objet de ce savoir car l’étude du monde animal doit être l’occasion de distinguer ce qui est proprement humain et ce qui est proprement commun aux hommes et aux animaux.
L’animal qu’il nous faut retrouver
Cet effort de clarté dans le savoir que nous avons établi sur les animaux n’est tout au plus que le résultat de la démarche des zoologues, ainsi que celle de factions isolées constituées de passionnés ou de peuplades pastorales. Pour le restant de l’humanité, John Berger dirait que l’animal a perdu de sa magie et de sa symbolique depuis le XIe siècle, soit à partir de la grande mutation sociale engendrée par la révolution industrielle. Les sociétés économiquement évoluées ont fait disparaître les animaux derrière une épaisse membrane artificielle, cette disparition étant pour partie liée à la prolifération des zoos. Sorte d’espace naturel pasteurisé à l’extrême, le zoo, pour reprendre le vocabulaire de Jesús Sepúlveda (4), marque le passage du «jardin des singularités» à l’invention du «jardin bourgeois» où toute curiosité est asphyxiée par un surcroît de normalisation. Une raison instrumentale a rejeté au large une raison esthétique (au sens fort d’une raison fondée sur la sensation), nous éliminant progressivement de l’histoire naturelle. L’idéologie dominante et ses archétypes agonistiques ont pérennisé une sociologie carnivore, au propre comme au figuré. Nous avons mangé l’autre qui était singulier; nous avons digéré, acculturé, désincarné tout ce qui se donnait comme singulier dans nos sociétés uniformisées. Dans cette doctrine du Même, l’homme, tout en désirant les désirs idéologiquement efficaces, souhaite malgré tout se démarquer de ses congénères. Or cette étrange aspiration à la différence au cœur du Même triomphant se situe dans un monde où le regard s’est auto-réifié, où l’autre ne s’annonce plus comme un être humain mais comme un ustensile – difficile dans ces conditions de revendiquer une quelconque exception de soi, sinon dans la capacité à éradiquer l’autre-que-soi, ce même-que-moi qui entrave ma volonté d’être unique au milieu des plus-que-semblables. On ne voudrait au fond qu’être un objet plus attractif que la moyenne à défaut de pouvoir encore être un sujet qui a toute sa place au milieu de cette rigor mortis politique.
L’altération du sujet en objet semble par conséquent suivre de près le schéma de la dégradation de nos relations avec l’animal. Les regards indifférenciés qui s’échangent au zoo entre l’animal et l’humain ne sont guère plus différents que ceux nous échangeons avec autrui. La léthargie de l’animal qui somnole dans son enclos n’est que la miniaturisation de toute une société avachie, seulement préoccupée par des luttes et des enjeux symboliques, principalement soucieuse de perpétuer la modernisation du potlatch (5). Dans cette perspective, l’animal ne tient qu’un rang secondaire, pour ne pas dire dédaignable. Nous nous servons de lui davantage qu’il ne nous sert à nous connaître et à nous reconnaître. Prenant l’exemple des peintures de Jean-Jacques Grandville, dont l’œuvre est dominée par la figuration du corps humain surmonté d’une tête zoomorphe, John Berger nous sensibilise au fait que l’animal, dans ce contexte créatif, n’est que l’indication d’un trait de caractère, d’un bestiaire totalement emprisonné par une optique anthropomorphe – les animaux sont ainsi connotés en fonction de ce que l’opinion humaine en pense, ce qui aboutit évidemment à des simplification très profitables sur le plan de la caricature, un peu moins sur le plan du patrimoine animalier considéré dans toute sa variété. Le cas de Grandville est associé sans surprise aux animaux qui se déclinent dans les rayons des magasins de jouets et même dans les publicités. Que cherche en effet à nous communiquer le crocodile de Lacoste mis à part que celui qui porte ces vêtements est un prédateur relativement bien situé dans la hiérarchie ? Qu’est-ce que le lapin de Playboy sinon la mise en exergue d’une virilité stéréotypée ? Le pur-sang de Ferrari parle aussi de lui-même, tout comme le sympathique oiseau bleu de Twitter.
Contre cette exacerbation de l’artificialité qui suscite la fermeture de soi, M. Calarco suggère que nous entamions un approfondissement de l’esprit d’ouverture, en l’occurrence une perception de nous-mêmes comme devant nous sentir responsables de l’autre que nous ne sommes pas et que parfois nous ne voulons pas être. S’inscrivant en faux contre l’humanisme de surface tel qu’il est défini par Heidegger dans sa Lettre sur l’humanisme, M. Calarco préfère s’attacher à l’éthique de Levinas et au commandement supérieur impliqué par le visage : «Tu ne tueras point». Le visage m’interdit toute profanation de la personne humaine sacrée, d’où l’intérêt, selon M. Calarco, d’identifier un visage chez l’animal, à savoir chez tout être vivant sans restriction aucune. Si Levinas n’a pas expressément refusé d’attribuer un visage aux animaux, il n’a pas pour autant mené à son terme cette entreprise, qui fut plutôt l’objet d’une étude affective chez Derrida (6). Ce qui rebutait peut-être Levinas, c’était la relative absence de données qui eussent attesté avec régularité des mérites de l’animal en général, c’est-à-dire d’une aptitude à manifester des comportements éthiques.
Par ailleurs, dans un article de Levinas que nous fait redécouvrir à point nommé M. Calarco, le philosophe raconte un moment de sa captivité dans un camp de l’Allemagne hitlérienne, lorsqu’un chien errant vint égayer la vie des prisonniers et qu’il se changea de ce fait en transmetteur optimal d’humanité. Que cela ne suffise pas à valider «un altruisme radical per se», M. Calarco n’en doute pas, cependant c’est un épisode à peu près convaincant pour imputer à l’animal une «posture éthique». Alors que ce chien aurait très bien pu s’acharner dans son errance, dans son reniflement du monde soi-disant pulsionnellement planifié, quelque chose en lui s’est rompu, le mettant en situation remarquable d’humanité. Autrement dit l’animal sait visiblement faire rupture avec la lutte pour la vie, avec le programme qu’on lui a hypothétiquement fixé, en faisant de temps à autre éclater au grand jour une dose d’affection sincère. Au reste, M. Calarco insiste en amont sur les avancées de l’éthologie cognitive contemporaine, qui, sous l’égide des travaux de Frans de Waal, a pu démontrer l’existence de comportements clairement éthiques de la part des animaux. Ce sont autant de marches en avant qui devraient nous inciter à dévisser les boulons impitoyables de la différence homme/animal. À l’inverse d’une réflexion essentialisée de l’animal où nous ne faisons que produire des abrégés du vivant, M. Calarco, reprenant Derrida, nous engage à la revalorisation des différences. Dans cet esprit de retrouvailles et de réexamen, il en va sûrement aussi de nos rapports simplistes à l’humanité, toujours de plus en plus minimalistes, succincts, mis à l’étroit par le novlangue journalistique où se succèdent des formules pauvres en vie, déclamées par des clones de l’insignifiance.
L’animal que nous envions
Il se peut toutefois que la réconciliation avec l’animal nécessite auparavant que l’homme se réconcilie avec lui-même. C’est ce que donne à entendre Pierre Guénancia, qui discute de la différence du corps animal et du corps humain, le premier étant un corps de pure gestualité (nous n’y voyons qu’un corps qui se comporte d’une certaine façon), le second étant un corps redoublé d’une signification (la parole donnant aux gestes de l’homme une densité supplémentaire). Disons alors dans un registre cartésien que le corps matérialise la signification, laquelle est voulue par l’âme. C’est là le drame humain : le corps humain se travestit sous l’impulsion de l’égo, il ne suit pas vraiment ses désirs naturels, l’égo étant inquiet des autres et surtout incertain de lui-même. Tel que Descartes en a eu l’intuition plus qu’il n’en a fourni la démonstration, le cogito présenté comme vérité indubitable certifie que nous existons mais il ne nous indique en rien ce que nous sommes et même qui nous sommes. En d’autres termes, l’homme se distingue comme créature doutant d’elle-même, en perpétuelle insécurité vis-à-vis de son essence. Rapporté au strict point de vue corporel, ce constat nous met en face d’un amas de corps perturbés, dégingandés, tiraillés entre l’injonction des égos en concurrence et la possibilité d’en revenir aux rythmes naturels, aux désirs qui auraient la nature pour seul critère, à l’image de la pédagogie que prescrivait jadis Épicure.
Contrairement à l’homme qui fait de sa quête de la perfection une solution pour se masquer ses faiblesses, l’animal, comme le rappelle P. Guénancia en se référant à Bergson, «est sûr de lui-même» (7). L’animal ne se pose aucune question sur ce qu’il est, sur comment il est, et a fortiori sur les tenants et les aboutissants d’un «monde animal». L’animal mène une vie spontanée, immédiate, tandis que l’homme traverse une existence partout médiatisée par le tourment de ce qu’il est, voire de ce qu’il a pu être et qu’il n’est plus ou de ce qu’il pourrait être et qu’il aura bien de la peine à atteindre. Ce contraste de la vie animale et de la vie humaine fait de la bête un modèle de sagesse et de l’homme un être de turbulences mentales, soumis à l’intranquillité la plus coriace.
L’écart entre les deux attitudes est souligné par Nietzsche dans un texte des Considérations inactuelles où il décrit la conduite de l’homme contemplant un troupeau qui broute paisiblement. Sitôt que l’homme se rend compte que les désirs de l’animal ne font que suivre ses besoins, en parfaite concordance avec la vie naturelle, il s’aperçoit que les siens sont troublés, comme si tout homme désirait d’abord être autre que sa nature, plus fort que ce qu’il est, voulant se ranger majestueusement au-dessus des autres. Pourtant le voilà qu’il se met à envier l’animal qui broute, habituellement réputé pour sa platitude existentielle. Il repère dans l’animal un défaut de lucidité sur sa condition qui lui permet de passer outre toute forme d’irritation ou de mélancolie. Ce défaut d’intelligence est d’ailleurs ce qui procure à l’animal un bonheur instantané, l’homme en étant privé puisqu’il est typiquement un animal temporel, un être du temps long qui s’attriste de son passé révolu et qui s’angoisse de l’incertitude des lendemains, incapable de saisir l’instant, impropre à vivre spontanément car ayant toujours peur de ne pas vivre richement ou très longtemps. En définitive, l’animal oublie et l’homme, de son côté, ne peut qu’avouer qu’il se souvient, qu’il se remémore sans cesse, enchaîné au passé alors que l’animal, lui, est «attaché au piquet de l’instant».
Mais peut-on vouloir être comme l’animal, sans passé ni futur, comme un stylite qui vivrait haut perché dans une ataraxie indestructible ? Il est possible de s’exercer au détachement en appliquant quelques préceptes stoïciens, l’ascèse n’étant pas mauvaise conseillère, cependant l’on doit se demander si cette conception du bonheur est réellement viable. Nietzsche fait de l’oubli une vertu de la vie bonne et accomplie, il en fait la force d’un homme qui se garde de ne pas parvenir à « en finir » avec ce qui pourrait troubler sa digestion psychique (8), semblable à la force tranquille d’une bête qui broute une nourriture terrestre qui s’en va lentement irriguer un corps serein, mais l’entêtement de la mémoire humaine et son flux de souvenirs remettent en question l’accessibilité de cette amnésie volontaire.
Que l’on contemple alors un peu mieux l’animal : son absence de rapport au temps l’aide probablement à ne pas être malheureux, mais rien ne le désigne comme étant en mesure d’apprécier le bonheur, de se ressouvenir par exemple d’une vie qui fut heureuse en dépit de plusieurs déplaisirs classiques. Dans cette perspective, il me reviendrait d’être la mémoire de l’animal, d’être le gardien de sa vie, parce que de la sorte je pourrais l’inscrire dans une temporalité allongée où je prendrais réellement mes responsabilités envers ce qui est moindre que moi mais que parfois je jalouse, sans doute en raison du fait que je perçois dans l’animal les emblèmes d’une dignité exemplaire, l’origine, peut-être, de mon métier d’homme qui s’est perdu en route.
Notes
(1) Ce propos, même douteux quant à son authenticité, a au moins le mérite de nous faire prendre conscience que le sort de l’homme est étroitement lié à celui des animaux, et plus exactement à celui des pollinisateurs. La citation est du reste reprise dans le film Phénomènes, de M. N. Shyamalan, dont on a sans doute négligé la mesure des propositions tant elles constituent une parfaite image de notre insouciance et de notre mégalomanie mêlées.
(2) Cf. Levinas, Totalité et infini.
(3) La terminologie kantienne parle respectivement de «force formatrice» et de «force motrice».
(4) Cf. Jesús Sepúlveda, Le jardin des singularités (Éditions Aux Forges de Vulcain, 2013).
(5) Cf. Marcel Mauss, Essai sur le don : «Nous proposons de réserver le nom de potlatch à ce genre d’institution que l’on pourrait, avec moins de danger et plus de précision, mais aussi plus longuement, appeler : prestations totales de type agonistique». Quoique le texte de Mauss s’intéresse aux sociétés primitives, il est aisé d’en établir une lecture actuelle afin de saisir à quel degré de violence symbolique nous en sommes arrivés.
(6) Cf. Jacques Derrida, L’animal que donc je suis (Éditions Galilée, 2006).
(7) Cf. Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion.
(8) Cf. Friedrich Nietzsche, La généalogie de la morale.


























































 Imprimer
Imprimer