Rechercher : francis moury george romero
Lettres françaises et esthétique allemande, par Francis Moury


 À propos de : Émile Meyerson, Lettres françaises (CNRS Éditions, coll. Hommes et sociétés, 2009) et Michel Espagne, Bénédicte Savoy et collaborateurs, Dictionnaire des historiens d’art allemands 1750-1950 (CNRS Éditions, 2010).
À propos de : Émile Meyerson, Lettres françaises (CNRS Éditions, coll. Hommes et sociétés, 2009) et Michel Espagne, Bénédicte Savoy et collaborateurs, Dictionnaire des historiens d’art allemands 1750-1950 (CNRS Éditions, 2010).«Quant à votre monde de l’art et à votre monde de la réalité, vous les séparez parce que vous ne pouvez supporter savoir ce que vous êtes. Il vous est insupportable de vous dire quels êtres traditionnels, rigides, durs de cuir et brutaux vous êtes réellement; alors vous dites : «c’est le monde de l’art.» Le monde de l’art n’est que la vérité à propos du monde réel, voilà tout, mais vous êtes beaucoup trop emballé pour vous en apercevoir.»
D. H. Lawrence, Love [Femmes amoureuses, 1920] (traduit par Maurice Rancès et Georges Limbour, éditions Gallimard, N.R.F. 1949 – retirage en collection Folio, 1974), p. 618.
«Si nous considérons d’abord la culture, cultura animi, non dans son processus, mais en tant qu’idéal et dans sa perfection, elle est alors, avant tout, une forme particulière – toujours individuelle, une «Gestalt», un rythme dans les limites et selon la mesure duquel se déroulent toutes les activités libres et spirituelles d’un homme, ainsi que, guidées et régies par celles-ci, toutes les manifestations vitales automatiques d’ordre psycho-physique (expression et action, paroles et silence), bref tout le «comportement» de cet homme. La culture est donc une catégorie de l’être, non pas de la connaissance et de l’expérience. […] En ce sens, Platon a son monde, comme Dante, Goethe et Kant ont chacun le leur. Nous ne pouvons pas, nous autres hommes, appréhender complètement une seule chose contingente, effectivement réelle, il y faudrait une suite infinie d’expériences et de déterminations.»
Max Scheler, L’Homme et l’histoire (1926), suivi de Les Formes du savoir et de la culture (1925) (traduction Maurice Dupuy, Éditions Aubier-Montaigne, coll. La Philosophie en poche, 1955, retirage 1970), pp. 101-102.
Ces deux livres sont réunis par un lien plus profond que celui constitué concrètement par leur éditeur, le Centre National de la Recherche Scientifique qui signe avec leur parution l’achèvement d’un beau double effort. Qu’on en juge d’abord par un simple critère quantitatif : un épais volume de 986 pages de correspondance philosophique d’Émile Meyerson retrouvées, classées par ordre alphabétique de correspondants, indexées, annotées et présentées par Bernadette Bensaude-Vincent (de l’Université de Nanterre) et Eva Telkes-Klein (du Centre de recherche français de Jérusalem) d’une part, et d’autre part 460 pages d’un dictionnaire de plus grand format comprenant une quarantaine de notices très détaillées, des notes et une chronologie, un index des noms cités (1), un index des notices et des auteurs, sous la direction d’un Directeur du C.N.R.S., Michel Espagne et d’une universitaire de Berlin, Bénédicte Savoy.
Certes, Émile Meyerson est d’abord connu par sa philosophie des sciences qu’il a ensuite annexée à une philosophie de l’esprit plus générale. En outre Meyerson ne s’est pratiquement pas occupé d’esthétique : le beau ne fut pas sa préoccupation première. Mais, de l’ensemble de cette correspondance avec l’élite universitaire de l’époque (de Charles Andler à Louis Weber, en passant par Gaston Bachelard, Émile Boutroux, Léon Brunschvicg, Henri Delacroix, Albert Einstein, Étienne Gilson, Xavier Léon, Lucien Lévy-Bruhl et bien d’autres) se détache une étrange impression de beauté à jamais perdue. Lorsqu’on lit cette petite invitation de Lévy-Bruhl envoyée à Meyerson le 19 mai 1921 afin qu’il vienne lui rendre visite rue Lincoln, on trouve cette phrase : «Mon troisième est assez haut, mais il y a un ascenseur, que l’on ne voit pas toujours, il est un peu dans l’obscurité.» Et on imagine un intérieur d’immeuble un peu semblable à ceux filmés vingt ans plus tard par le cinéaste français Jacques Tourneur à New York pour la série fantastique produite par Val Lewton. Ce clair-obscur élégant mais inquiétant des escaliers d’un building montés par Simone Simon dans Cat People [La Féline] en 1942, c’est peut-être un peu celui qu’avait vu vingt ans plus tôt Meyerson dans les escaliers haussmanniens de la rue Lincoln, lorsqu’il a rendu visite à l’auteur de La Philosophie d’Auguste Comte [1900] et de Le Surnaturel et la nature dans la mentalité primitive. [1931] Lévy-Bruhl qui précise d’ailleurs à Meyerson le 2 juin 1921 : «Je crois que sur l’interprétation des points de litige d’Auguste Comte, nous finirons par nous mettre d’accord. Sur les contradictions inhérentes à la pensée, les considérations que vous faites valoir permettraient en effet le passage de la mentalité primitive à la nôtre» (2).
De fait, ce livre (qu’il aurait mieux valu titrer Correspondance philosophique française plutôt que Lettres françaises afin d’en faire immédiatement ressortir la spécificité) nous restitue, au fil des pages, une période à jamais disparue, un monde à jamais perdu, au sommet de ses capacités intellectuelles. Sur son papier finement glacé, une beauté foncièrement platonicienne s’inscrit à mesure que les formules de la politesse de cette belle époque alternent avec des discussions techniques sur des passages des œuvres majeures de Meyerson : Identité et réalité (juin 1907), De l’explication dans les sciences (1921), La Déduction relativiste (1925), Du Cheminement de la pensée (1931) ou bien avec des discussions sur les lectures et la philosophie des correspondants eux-mêmes. Dès la première lettre de Charles Andler à Meyerson, datée du 1er août 1926, on se retrouve sur les cimes uniquement fréquentées par une élite : il faut lire les très savoureux paradoxes hégéliens de Lucien Herr tels qu’ils sont rapportés par Andler à Meyerson. On y voit qu’Alain n’était pas le seul à s’intéresser à Hegel à cette époque. Le niveau ne tombe ensuite plus guère jusqu’à la 986e page. Tout cela est en outre très soigneusement annoté.
L’une des dernières notices du Dictionnaire des historiens d’art allemands 1750-1950 – attention au «s» final qu’il faut bien lire : il ne s’agit pas, en effet, d’un livre sur l’art allemand, mais d’un livre sur les historiens et les auteurs allemands de traités sur l’histoire de l’art mondial des origines à leurs jours, et sur les auteurs allemands de traités d’esthétique en général bien que les purs philosophes aient été écartés (Hegel et son esthétique sont souvent cités mais aucune notice ne lui est donc consacrée); peut-être aurait-il mieux valu l’intituler Dictionnaire des historiens allemands de l’art, afin d’éviter toute possibilité de confusion ? – rédigée par François-René Martin comporte, p. 355, ce frappant paragraphe : «L’œuvre de Edgar Wind [1900-1971] appartient bien à un monde révolu de savants qui pouvaient relier fermement la signification des œuvres d’art à des univers culturels infiniment complexes; un monde qui dans les années 30, se voyait menacé par les Barbares qui s’employaient à détruire cette haute culture. Le monde de Wind est en définitive le même que celui d’un Eric Auerbach qui pouvait écrire en octobre 1935 à Walter Benjamin […] : «Y aura-t-il encore des personnes pour lire de tels documents ?».»
Un tel état d’esprit, c’est aussi celui d’Émile Meyerson, La Déduction relativiste (§ XXV, section 281, édition originale Payot, 1925, p. 384) : «Sans suivre jusqu’au bout la sombre eschatologie de M. Branly – dont l’imagination s’apparente, semble-t-il, à celle de l’auteur du Dies Irae – et sans croire que l’homme en sera réduit à proscrire tout usage de l’intelligence et à revenir à l’état de fourmi […] on peut légitimement craindre, semble-t-il, l’avènement d’un nouveau moyen-âge. D’autant que l’archéologie nous a appris que le recul intellectuel que nous décorons de ce nom ne fut point, à beaucoup près, le seul que l’humanité ait dû enregistrer au cours de ses destinées.»
Ce n’est pas non plus un hasard si, quelques pages plus haut, la notice de Claude Imbert (pp. 337-345) sur Aby Warburg [1866-1929] nous décrit un homme angoissé, lecteur de Friedrich Nietzsche et de Jacob Burckhard (ce dernier admiré par Nietzsche et à qui une notice est également consacrée dans le Dictionnaire, pp. 21-33, par Sabine Frommel) et créateur d’une Bibliothèque vouée aux Kulturwissenchaften» [sciences de la culture] qu’il voulut associer à l’Université de Hambourg. De Jacob Burckhardt à Carl Einstein, de Winckelmann à Worringer, de Schlegel à Warburg, on constate que pour l’esprit allemand, la beauté ne peut être pensée qu’en étant coordonnée le plus étroitement possible aux autres disciplines : philologie, philosophie, anthropologie.
La lecture simultanée de la correspondance de Meyerson et d’un tel Dictionnaire aboutit tout naturellement à faire concevoir deux des idées majeures de Meyerson lui-même : à savoir celle de l’unité foncière de l’esprit humain depuis les temps les plus primitifs jusqu’aux périodes contemporaines, d’une part, celle d’une résistance obscure et infinie du monde à son éclaircissement rationnel, d’autre part. Meyerson ne cessa de tenter de maintenir le fil rouge qui sépare le rationnel de l’irrationnel dans les processus épistémologiques, gnoséologiques et logiques qui sont à l’œuvre dans la construction des sciences positives de l’antiquité à nos jours, de la jeunesse de la science grecque (selon la belle expression d’Abel Rey) à la science européenne de 1930. En lisant les notices que nous venons de citer, on peut penser que certains de ces esthètes allemands partagent les mêmes préoccupations transposées dans leur propre domaine, dans leur propre sphère de recherches (3).
Corrigendum aux Lettres françaises d’Émile Meyerson
La notice de présentation de la vie et de l’œuvre d’Émile Boutroux, à la page 77 des Lettres françaises, attribue à Boutroux «Le Fondement de l’Induction» alors que c’est Jules Lachelier son auteur et que le titre exact est Du fondement de l'induction sans «Le» et sans «I» majuscule. Cette ahurissante erreur trouve peut-être sa source dans une lecture trop rapide d’une phrase d’Émile Bréhier (Histoire de la philosophie, tome 2, fascicule 4, Le XIXe siècle après 1850 et le XXe siècle, partie VI, § 6 La Métaphysique, 5e édition P.U.F., 1968, p. 876) qui cite au début de sa notice consacrée à Boutroux, presque en haut de cette page, dans la même phrase, deux œuvres de Boutroux puis cette œuvre de Lachelier en mentionnant seulement le titre de cette dernière sans mentionner son auteur, ce qui peut faire croire à un lecteur – n’ayant pas lu les pages précédentes du §6 (consacré à Ravaisson, Lachelier, Boutroux) ou ignorant tout simplement l’histoire de la philosophie française – que Boutroux aurait lui-même écrit les trois. Je profite de ce corrigendum pour signaler que Lachelier n’est pas cité en 1908 par Meyerson dans son Identité et réalité : c’est une des rares mais graves lacunes philosophiques du premier livre de Meyerson.
Notes
(1) Une petite erreur relevée dans celui-ci : Martin Heidegger est effectivement cité pp. 178 et 356 mais non pas p. 195 : il l’est à celle située juste avant, donc p. 194.
(2) Nous en profitons pour signaler que les remarques de la page 11 de l’introduction (non signée donc tacitement cosignée ?) signalant le désaccord de Meyerson et de Comte, doivent être lues avec une certaine réserve. Meyerson se revendique de Comte (prétendant suivre un programme «tracé mais non réalisé par Comte» dès la page VIII (in 5e tirage, Vrin de 1951)) de la préface de la seconde édition de Identité et réalité. Voir également les précisions données par Meyerson lui-même à Félicien Challaye dans sa grande lettre de 1924, p.107 : «Si j’ai constamment cité Comte, c’est presque toujours pour le combattre. Mais on peut observer, je crois, qu’un philosophe, en général, dépend le plus étroitement de ceux qu’il prétend réfuter […] Et je me rends compte aussi que mon œuvre eût été impossible si celle de Comte ne l’avait précédée.» Au demeurant, cette philosophie de Meyerson n’est pas résumée par l’introduction très détaillée à sa correspondance. Certaines lettres peuvent évidemment être utilisées en guise de première approche, inévitablement ardue. Nous avions, durant notre jeunesse en 1982, à une époque où les archives meyersoniennes avaient déjà quitté depuis longtemps la France pour Israël (Meyerson était sioniste et avait même spécifié qu’aucun juif converti ne pourrait siéger au comité chargé de gérer ses archives) rédigé un mémoire universitaire (inédit) intitulé La Philosophie des sciences d’Émile Meyerson que les deux introductrices ne citent pas dans leur bibliographie. Son objet était précisément d’y introduire en éclairant, par exemple, les points précis sur lesquels Meyerson et Bachelard s’opposaient du point de vue épistémologique mais aussi en montrant comment Meyerson pouvait être considéré comme un des héritiers du positivisme spiritualiste français. La mention du nom de Maine de Biran avait déplu à Maurice Clavelin et c’est au fond le seul point sur lequel il nous avait critiqué : c’était le point plus important ! Nous l’avions relu vers 1990 puis vers 2007 afin de le transformer en Introduction à la philosophie des sciences d’Émile Meyerson. Peine perdue : il demeure aussi inédit que nos Études comtiennes (il s’agissait plus précisément d’une bibliographie critique couvrant environ un siècle d’études comtiennes de 1857 à 1990 – Jacques Muglioni, ancien président du Jury du C.A.P.E.S. de philosophie, l’avait heureusement définie ainsi dans une lettre chaleureuse vers 1995 – sur le problème de l’ontologie chez Auguste Comte) rédigées dans les années 1985 puis revues en 1990. Signalons au lecteur intéressé qu’Henri Gouhier – qui nous avait écrit qu’il aimait aussi bien nos travaux sur Meyerson qu’il avait connu que ceux sur Comte dont il était spécialiste – avait fait verser ces Études comtiennes au fond permanent de la Bibliothèque de la Maison des Amis d’Auguste Comte.
(3) Martin Heidegger a posé, dans sa conférence prononcée en décembre 1936 à Francfort (Main) sur Hölderlin et l’essence de la poésie, le problème esthétique de l’origine de l’œuvre d’art d’une manière typiquement allemande qui pose un rapport de l’art à la vérité proche du rapport de la science à la réalité, et mettant en évidence une sorte de mécanisme dialectique lui-même assez proche de celui que Meyerson avait cru constater entre le rationnel et l’irrationnel. Qu’on lise, si on souhaite s’en convaincre, ces fragments de la page de conclusion du chapitre sur l’esthétique de Heidegger in Alphonse de Waelhens, La Philosophie de Martin Heidegger (Éditions de l’Institut supérieur de Philosophie, Louvain, 1942, pp. 291-292) : «[…] L’origine de l’œuvre d’art est la lutte qui met aux prises la Terre et le monde, l’existant et l’être, Dionysos et Apollon. C’est en un tel combat que se constitue la vérité, qui est la découverte de l’existant. Ce combat prend nécessairement la forme d’une œuvre sans laquelle la vérité n’ex-sisterait pas. […] Il y a aussi la vérité du penseur. Le penseur crée un système – ou plus modestement un concept – grâce auquel l’inintelligibilité de l’existence est captée, ordonnée, illuminée pour un instant et selon une certaine perspective. Par ce système, ce qui n’était que chaos devient vérité et se manifeste. Quelque chose est arraché à l’ineffable Grundverborgenheit, au chaos originel, mais seulement en un temps et pour un temps […]».
28/01/2011 | Lien permanent
Le dernier travail de Platon, par Francis Moury


16/05/2009 | Lien permanent
Actualité ou inactualité de Max Scheler, par Francis Moury

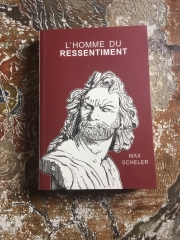 Une nouvelle fois, j'ai le plaisir de proposer à la lecture, avant une étude consacrée à Jules Lequier rédigée par le même auteur, un article de mon ami Francis Moury, initialement paru dans La Sœur de l'Ange de Matthieu Baumier, article mettant en perspective la pensée de Max Scheler. Puisque ce texte est tout de même assez long, j'ai préféré en donner un extrait conséquent, quitte à proposer, ici, l'article dans sa version complète au format PDF.
Une nouvelle fois, j'ai le plaisir de proposer à la lecture, avant une étude consacrée à Jules Lequier rédigée par le même auteur, un article de mon ami Francis Moury, initialement paru dans La Sœur de l'Ange de Matthieu Baumier, article mettant en perspective la pensée de Max Scheler. Puisque ce texte est tout de même assez long, j'ai préféré en donner un extrait conséquent, quitte à proposer, ici, l'article dans sa version complète au format PDF.Ajout du 28 juillet 2021 : Radu Stoenescu se propose de rééditer cet ouvrage devenu introuvable, par le biais d'une cagnotte participative sur Ulule.
Ajout du 28 novembre : le livre a paru !
«Non prorogandam ultra ruinam, nec posse ab una natione totium orbis servitium depelli. Quid profectum caede et incendiis legionum, nisi ut plures validioresque accirentur ?».
«[…] Ils ne devaient pas étendre davantage leurs désastres et une seule peuplade ne pouvait libérer l’univers de son esclavage. Qu’avait-on gagné à détruire des légions par le fer et par le feu, sinon d’en faire accourir en plus grand nombre et de plus fortes ? […]».
P. Cornelii TACITI / TACITE, Historiarum / Histoires, V, §25, texte établi et, d’après Burnouf, traduit par Henri Bornecque (éd. Classiques Garnier, Paris, 1954), p. 548.
«[…] Dans la sphère où nous nous trouvons ici, c’est-à-dire aux degrés supérieurs de l’échelle des valeurs, modèle et chef ne font qu’un. En d’autres termes, les chefs religieux représentent la catégorie principale de l’influence « charismatique ». […] C’est une des grandes erreurs de Spengler d’avoir fait des religions une partie de la culture.».
Max SCHELER, Le saint, le génie, le héros §3, traduction française par Émile Marmy (éd. Egloff, Fribourg en Suisse, 1944), pp. 79-81.
«Il y a quelques années – c’était avant la guerre – au moment où l’on célébrait le bimillénaire d’Horace, j’écrivais quelque part qu’il n’était pas actuel. Il n’était pas actuel, je l’ajoutais aussitôt, parce que jamais il n’aurait été aussi besoin qu’il le fût.».
Pierre BOYANCÉ, Grandeur d’Horace in Bulletin de l’association Guillaume Budé, supplément Lettres d’Humanité t.XIV, quatrième série, n°4 (éd. Les Belles Lettres, Paris, décembre 1955), p. 48.
 On ne vise à rien d’autre ici qu’à permettre au lecteur d’avoir une simple idée de la vie et de l’œuvre de Max Scheler, philosophe allemand qui redevient de plus en plus actuel à mesure qu’on l’oublie : habituelle ironie – peut-être davantage encore que «ruse» – de la raison en histoire de la philosophie. Mais puisque nous sommes condamnés à revivre ce que nous avons oublié, que la raison est peut-être bien l’histoire elle-même (et ses jugements de Dieu successifs dans ce cas !) et que l’ignorance est la conséquence non pas d’une ruse mais d’une faute morale (on est ignorant parce qu’on est mauvais et non pas l’inverse)… enfin pour toutes ces raisons et même d'autres qu’on tient éventuellement en réserve… et aussi en raison d’un désir, faisons un peu revivre ici la vie et l’œuvre philosophique de Max Scheler.
On ne vise à rien d’autre ici qu’à permettre au lecteur d’avoir une simple idée de la vie et de l’œuvre de Max Scheler, philosophe allemand qui redevient de plus en plus actuel à mesure qu’on l’oublie : habituelle ironie – peut-être davantage encore que «ruse» – de la raison en histoire de la philosophie. Mais puisque nous sommes condamnés à revivre ce que nous avons oublié, que la raison est peut-être bien l’histoire elle-même (et ses jugements de Dieu successifs dans ce cas !) et que l’ignorance est la conséquence non pas d’une ruse mais d’une faute morale (on est ignorant parce qu’on est mauvais et non pas l’inverse)… enfin pour toutes ces raisons et même d'autres qu’on tient éventuellement en réserve… et aussi en raison d’un désir, faisons un peu revivre ici la vie et l’œuvre philosophique de Max Scheler.Ce désir est né d’une allusion supposée et de souvenirs nés à l’occasion de cette supposition. Mais l’était-elle, supposée, cette allusion ? Peu importe au fond, comme nous l’écrivions l’été dernier à Juan Asensio, le noble Stalker, le noble Varan ! Car une telle allusion supposée, c’est tout le destin de Scheler aujourd’hui en France ou peu s’en faut. Il est peu lu, peu commenté, peu étudié, peu enseigné : on ne connaît de lui bien souvent que des fragments d’une œuvre qui s’est pourtant voulue (du moins le pensons-nous) système organique et rationnel – même si son objet était précisément l’irrationnel – et un système devant être lu en totalité, d’autant plus qu’il a évolué. Et ce système a évolué en s’enrichissant sans se renier : tout au contraire. Et sur lui, depuis les belles études de Maurice Dupuy parues dans la collection Épiméthée en 1959 – études auxquelles il convient toujours de se référer – il n’y a guère de chose à se mettre sous la dent sauf l’essentiel complété mais pas l’intégralité : de nouvelles traductions de temps à autre mais pas encore d’édition critique française des œuvres complètes. De temps à autres… on évoque Scheler pour ses écrits sur la mort, le pacifisme, la pitié, la pudeur, la sympathie, que sais-je encore ? On se souvient vaguement que Merleau-Ponty a commenté en son temps L’Homme du ressentiment et on rappelle que ce livre de Scheler est lui-même un commentaire de Nietzsche au premier chef.
Mais quoi ! Scheler a pensé sur les valeurs et placé au sommet de sa hiérarchie les valeurs religieuses, synthétisées par le modèle du saint. Et il a pensé sur la mort, sur la pudeur, sur le pacifisme, sur la guerre, sur l’art, sur la politique, sur l’économie, sur l’histoire. Ce n’est pas actuel, ça ? Mais il a pensé tout cela en philosophe allemand phénoménologue et pas en journaliste. Alors évidemment, c’est un peu moins actuel et surtout un peu plus ardu. Vous croyez ? Allez-y voir ! C’est écrit clairement, non ? Un peu laborieusement, très objectivement, très «objectalement» puisque c’est allemand, un peu scientifiquement aussi puisque c’est un universitaire allemand de l’âge d’or de l’université allemande. Un peu génialement aussi puisque c’est Max Scheler qui était nourri par l’influence directe de génies, était assistant d’un génie (avant qu’un autre génie devienne l’assistant du premier : voir infra) et qui vivait en un temps où le génie ne prétendait nullement à la publicité autre qu’universitaire, gage naturel de sa valeur. Ça été écrit, pour tout vous dire, un peu aussi sous l’influence de Carlyle qui s’intéressait aux génies, aux saints et aux héros, lui aussi : justement. Peut-être moins lyriquement, peut-être plus précisément. Peut-être plus rationnellement et davantage philosophiquement. Donc en allemand, héritant de la pensée européenne, occidentale, allemande, anglaise, française, médiévale, antique aussi. En allemand. Mais enfin à défaut de parler allemand, on peut se rabattre sur les excellentes traductions fournies au fil du temps par les passeurs de Scheler en France, ses traducteurs et commentateurs, ses introducteurs naturels : des professeurs français de philosophie donc. Pas des moindres parfois : Gandillac par exemple. Souvent d’une culture aussi immense que l’était celle de Scheler. Donc d’une inactualité terrifiante ! Donc d’une actualité salvatrice ! Par un effet naturel de circularité dialectique, seule la culture d’un homme vivant peut rendre hommage à la pensée de la culture d’un homme mort… a fortiori le traduire. Mais il ne s’agit pas d’une culture de masse : Scheler est le philosophe de la personne. Et le personnalisme façon Mounier (qui n’a d’ailleurs guère de rapport avec la philosophie de Scheler) n’est plus à la mode. Alors celui de Scheler (qui n’a d’ailleurs pas le même sens) n’en parlons pas… Donc parlons-en ! Et commençons par le commencement scolaire naturel sans lequel on ne peut plus comprendre une pensée : une vie résumée autant que possible… donc mal résumée. Mais c’est un mal pour un bien puisque cela permettra de situer l’auteur de La Situation de l’homme dans le monde.
Vie
Max Scheler est né à Munich en 1874. Sa mère était juive. Son père, allemand, s’était converti au judaïsme lors de son mariage. Il étudie la philosophie aux Universités de Berlín, Heidelberg et Iéna : c’est dans cette dernière qu’il soutient sa thèse de doctorat en 1897 ou 1901, suivant les sources. Sa formation philosophique fut influencée par le vitalisme historique de Dilthey, le vitalisme irrationaliste de Nietzsche et le vitalisme spiritualiste d’Eucken et, surtout, par la rencontre décisive de son maître Edmund Husserl dont il est assistant à Göttingen de 1909 à 1913 (avant Martin Heidegger, assistant de Husserl de 1916 à 1922 et avant E. Fink) et c’est là qu’Edith Stein suit ses cours du soir, dont un sur «l’essence de la sainteté» qui constitua la première étape de sa conversion au catholicisme. C’est d’Husserl que Scheler reçoit le désir d’aller à la rencontre de la «chose même» et donc la méthode phénoménologique qui le lui permet. Il l’applique aux domaines que son maître n’a pas explorés : vie éthique, vie émotionnelle (sympathie, haine et amour), religion, etc. En 1916, il reconnaît publiquement son obédience à l’Église catholique. En 1919 ; Il est nommé à la chaire de l’Université de philosophie de Cologne. En 1921, il tombe amoureux d’une de ses élèves et demande à l’Église d’annuler son mariage qui refuse : un mariage civil a néanmoins lieu. Dès lors il s’éloigne du catholicisme et même du théisme et il se rapproche d’une conception panthéiste et évolutionniste. En 1928, alors qu’il vient d’être nommé à Francfort, il meurt d’une crise cardiaque.
Œuvres et réception française des œuvres
Il y a une histoire de la vie de Scheler. Il y a aussi une histoire de ses œuvres de son vivant et après sa mort, pour nous autres vivants. On dit parfois que Max Scheler a écrit (en allemand) ses œuvres majeures de 1914 à 1921, notamment son éthique dont la première édition intégrale paraît en 1916 et la seconde édition en 1918, mais sa dernière philosophie religieuse n’est pas moins philosophique et pas moins majeure que ses œuvres antérieures : en fait, le critère de connaissance de Scheler ne peut être limité à une période de sa production. Il faudrait tout lire, c’est évident. Prenons un simple exemple : le travail sur la distinction morale du modèle et du chef (dont le livre Le saint, le génie, le héros est un assemblage de fragments rédigés à des dates diverses) aura duré de 1911 à 1927. La publication d’un certain nombre d’œuvres en édition allemande est posthume (1933 par exemple en ce qui concerne ce texte précis) et leur traduction en langue française encore plus posthume puisque, mis à part quelques textes isolés – et en tenant compte des introductions de lecteurs illustres qui pouvaient s’en passer tels que Bernard Groethuysen (1926 mais il n’a lu dans le texte que deux livres de Scheler parus en 1921 et 1923), Georges Gurvitch (1930 puis 1949), Émile Bréhier (1932), etc. – l’essentiel n’arrive à nous que dans les années 1950-1955. C’est d’ailleurs au cours de cette période, le 3 décembre 1953, que le futur pape Jean Paul II qui était déjà auteur d’une thèse de doctorat de théologie sur saint Jean de la Croix (1948) et enseignait l’éthique sociale dans une faculté polonaise de théologie, soutient un mémoire d’habilitation philosophique intitulé Évaluations des possibilités de construire l'éthique chrétienne sur la base du système de Max Scheler. Mémoire qu’il serait intéressant d’éditer un jour ou l’autre dans ce pays, soit dit en passant. Et c’est à la fin de cette période que paraissent en France les commentaires universitaires de référence de Maurice Dupuy, en 1958-1959. Cette traduction de l’essentiel et ces commentaires ne suffisent cependant pas vraiment à nous consoler de l’absence d’une édition critique en traduction française dans l’ordre chronologique des œuvres complètes de ce grand penseur. D’autant plus que de récentes traductions de textes jusqu’à présent inédits (1993) font clairement mesurer le profit qu’on en retirerait.
Sources et naissance de la pensée
Scheler réfléchit à partir de Kant et de Husserl pour aboutir à sa théorie de l’intentionnalité émotionnelle dont les objets sont des valeurs. Mais il y réfléchit dans un contexte philosophique et politique marqué par plusieurs courants : montée du marxisme, de l’irrationalisme, découverte de la psychanalyse. Scheler est contemporain intellectuel de la sainte trinité des années 1968 : Marx, Nietzsche et Freud. Et inutile de préciser que Max Scheler cite régulièrement Max Weber. Il est contemporain non seulement de tous ceux-là mais aussi de la Première Guerre mondiale puis des œuvres célèbres des écrivains allemands comme Oswald Spengler et Keyserling qui s’inquiètent du Déclin de l’Occident. Scheler écrit dans un monde matriciel de notre présent : la catastrophique situation de l’Allemagne au lendemain du conflit et l’avènement de la dictature communiste en Russie. Il est contemporain d’Octobre, du Dr Mabuse, d’Ernst von Salomon tout autant que des travaux d’Émile Durkheim, Marcel Mauss, Roger Caillois : il est donc notre contemporain puisque notre présent ne cesse de comprendre qu’il est l’héritier de ces deux évènements mondiaux. Si bien qu’il réfléchit fondamentalement en réaliste plus qu’en idéaliste, même si théorie démarre conceptuellement grâce à l’apriorisme de Kant.
Résumer un système
Ce n’est pas parce que ma très brave professeur de philosophie en Terminale du lycée Henri Bergson m’avait demandé en 1978 de ne plus employer ce mot – elle me l’avait demandé gentiment, malicieusement, en chuchotant son conseil entre deux portes mais suffisamment clairement : - « Ne parlez plus du système d’Aristote, du système de Descartes : c’est fini ! On ne parle plus de systèmes…» – que je me fais une joie adolescente et potache de l’employer. C’est tout bonnement parce que les arriérés qui avaient dicté intellectuellement cette interdiction étaient (et sont, s’ils sont toujours en vie) des imbéciles. Un philosophe se définit depuis 2500 ans par l’ambition systématique ou le renoncement à cette ambition. Il se définit par sa cohérence systématique ou la préférence d’une intuition fragmentaire. Mais il y a toujours une ambition systématique dans la moindre collection de fragments d’Héraclite, de Démocrite ou de qui on veut. Et il y a une telle ambition chez Aristote et chez Descartes : Octave Hamelin l’a montré avant que ceux qui ont déclaré le contraire soient capables de lire ses études d’histoire de la philosophie éditées par ses anciens élèves. Résumer le système d’un grand philosophe est l’une des activités les plus nobles et les plus utiles qui soient : si Diogène Laerce n’avait pas écrit ses doxographies, notre monde serait différent. Scheler a voulu édifier un système, qu’il l’ait fait textuellement et conceptuellement sous une apparence fragmentaire (comme le pense Marmy) ou systématique (comme le pense Dupuy) peu importe : c’était un philosophe qui visait une fin propre à la philosophie : rechercher la vérité totale de la totalité. Il l’a fait. Et maintenant, étant donné que 10 personnes ou moins dans ce pays ont lu son œuvre intégrale, il est nécessaire de la résumer pour les autres. Mais bien évidemment un système résumé est une aberration puisque la vie d’un système naît au contraire de sa complexité, de son ampleur, de sa volonté de totalité et de perfection, volonté elle-même induite par la complexité et la richesse du réel. Tout le contraire d’un résumé qui ne donne qu’un squelette décharné. Mais sans squelette, pas de corps qui se tienne. La séduction du corps total de la pensée de Scheler ne peut être donnée au lecteur que sous les conditions habituelles :
1) Qu’il connaisse à la perfection l’histoire de la philosophie des origines à Scheler.
2) Qu’il lise les œuvres dans leur ordre chronologique de rédaction ou dans l’ordre recommandé de son vivant par l’auteur.
3) Qu’il lise ensuite quelques bons commentaires d’époques variées sur l’auteur.
Le résumé suivant n’a, on vous en prévient, pas grand chose de séduisant. Il est, comme le style de Scheler traduit en français, sec et sans grâce mais clair et précis alors qu’en allemand, on soupçonne qu’il doit produire aux yeux d’un germaniste le charme de l’élégance la plus raffinée et de la puissance conceptuelle la plus noble. Il doit ressentir sans doute un peu la même impression à le lire que nous autres en lisant une page de Jules Lachelier ou d’Émile Boutroux : l’idée d’une perfection stylistique atteinte en raison d’un sommet absolu de culture. Une trace d’un empire de la culture – disparu corps et âme, en somme, des deux côtés du Rhin après 1945.
13/10/2005 | Lien permanent
Apocalypses biologiques, 8 : Resident Evil de P. W. S. Anderson, par Francis Moury

États-Unis, 2002. Umbrella Corporation fournit le marché en produits médicaux et en services informatiques mais, en sous-main, elle mène (à l'insu de ses propres employés) des projets de guerre biologique pour le compte du plus offrant. Alice se réveille dans un manoir désert environné par une forêt sous lequel est enterré un laboratoire secret appartenant à la firme. Elle ne se souvient de rien sur le moment, pas même de sa propre identité. C'est alors que surgissent Matt qui se prétend policier puis un commando militaire dont la mission est de descendre dans les entrailles du laboratoire afin de comprendre pourquoi le système de sécurité informatique a assassiné les dizaines de personnes qui y travaillaient. Ils apprennent qu'un accident ayant répandu le virus T dans les conduits d'aération souterraine est à l'origine de la décision de la «reine» informatique. À mesure que le commando progresse, il affronte les effets terrifiants du virus T et la volonté meurtrière de la reine tandis que les réminiscences d'Alice reconstituent fragmentairement ses dangereuses relations avec la redoutable Umbrella Corporation.
Resident Evil (Europe + États Unis, 2002) de Paul W. S. Anderson, adapté d'une série de jeux vidéo japonais (1), est l'un des premiers grands films de science-fiction du vingt-et-unième siècle. Son succès critique et public engendra une série – il faudrait plus exactement la qualifier de saga voire de mythe moderne : elle présente certains aspects du mythe tel que les mythologues le définissent communément (2) – certes inégale mais globalement riche de titres (3) amples et souvent plastiquement très aboutis, surtout lorsque Anderson les dirige lui-même. Sur le plan purement technique, ceux signés par Anderson à la mise en scène sont, de fait, régulièrement somptueux et leur montage est constamment très sophistiqué. Il faut savoir que George A. Romero avait soumis en 1998 un script qui fut refusé (de justesse car il plaisait paraît-il à tous les producteurs et ayant-droits, sauf un) : c'est celui d'Anderson qui fut finalement accepté (4).
Dans l'histoire du cinéma fantastique, rares sont les intrigues dans lesquelles le nom de l'héroïne n'est révélé que par le générique final (ainsi que par, en vidéo, le verso de la jaquette) : c'est le cas ici puisque, durant toute la continuité, elle l'a oublié. La réminiscence progressive d'Alice est une des clés structurelles de l'intrigue : elle restitue progressivement les enjeux de sa présence mais cette réminiscence elle-même demeure suffisamment fragmentaire pour que l'initiative finale passe du côté de la maléfique entreprise Umbrella qui domine, à leur insu et jusqu'au bout, tous les protagonistes. Ce prénom d'Alice n'est évidemment pas innocent car il fait référence explicitement à l'héroïne du roman fantastique Alice au pays des merveilles (1865) : il y a, en effet, dans l'intrigue de ce premier Resident Evil quelques allusions, plus ou moins discrètes, au livre du logicien anglais Lewis Carroll : à commencer par ce sol décoré comme un échiquier près duquel elle se réveille nue sans oublier, plus tard, une porte-miroir qu'il lui faut franchir pour accéder à la reine, parmi d'autres éléments depuis soigneusement relevés par les cinéphiles lecteurs du logicien.
Certes, des éléments majeurs de l'intrigue (le manoir, le monstre mutant, les chiens modifiés, les morts-vivants réanimés par le virus T qui s'est échappé, le laboratoire secret, le métro souterrain) proviennent directement du jeu original mais ils sont ici intégrés à un suspense reposant sur deux questions concernant l'identité de l'héroïne d'une part, la visée globale d'Umbrella Corporation d'autre part. Questions qui ne trouveront que des réponses partielles à l'issue de ce film fondateur, prélude à une série transformant Alice en déesse salvatrice, à la beauté ambiguë et à la puissance physique androgyne (l'aspect de l'actrice Milla Jovovich et la manière dont elle est photographiée constituent l'aboutissement d'une montée en puissance des héroïnes féminines survivantes puis des héroïnes androgynes combatives à partir de 1980 dans l'histoire du cinéma fantastique) mais semi-déesse seulement : son humanité ayant été en contact avec une sorte de puissance supérieure lui conférant une dualité obsédante, jamais reniée. Elle est, de ce point de vue, assimilable à certains héros antiques grecs. L'idée initiale du virus T sera amplifiée dans les épisodes suivants puisque Umbrella couve puis accouche décidément du vieux rêve d'une nouvelle humanité, d'une destruction de l'ancienne, d'une recomposition biologique générale équivalente à la décomposition puis à la régénération du monde, selon le vieux cycle imaginé par les penseurs stoïciens. Cycle refusé et combattu par l'héroïne qui en est à la fois la première victime et la première incarnation mais aussi la première à se dresser contre son achèvement.
Lorsque Paul W.S. Anderson décrivait en 2002 le style du premier Resident Evil comme étant «sinistrement industriel», il n'avait évidemment pas tort mais il est redevable à un courant esthétique remontant, là-encore, aux années 1980 et même 1970 dans l'histoire du cinéma de science-fiction : le laboratoire souterrain, par son architecture, ressemble (en plus ample encore, il est vrai puisqu'un métro y peut circuler) à celui déjà vu dans Le Mystère Andromède [The Andromeda Strain] (1971) et même, par certains aspects, à celui aussi souterrain déjà vu dans Le Voyage fantastique (1966) de Richard Fleischer. Les machines vivantes (et meurtrières) alors que tout est mort autour d'elles, les couloirs inondés, les morts-vivants : tout cela évoque tantôt les films de Romero à partir de 1978 (raison pour laquelle on avait d'abord songé à lui pour adapter ce sujet), tantôt les séries chronologiquement parallèles des Alien et des Terminator (5). Anderson intègre et recompose cependant tout cela d'une manière inédite et originale : dès le titre suivant, les scènes d'extérieur modifieront le confinement assez classique du premier épisode (néanmoins heureusement aéré par les brèves réminiscences filmées en couleurs sépia, dans la forêt) et utiliseront des extérieurs naturels souvent grandioses. Il s'inspira, en outre, de certains architectes japonais : la boucle est ainsi relativement bouclée, sur le plan esthétique. De l'aveu d'Anderson, la musique composée par Marilyn Manson et Marco Beltrami devait imiter les partitions composées par le cinéaste John Carpenter pour ses propres grands films fantastiques : là encore, une boucle esthétique était bouclée. On le voit : sur le plan mythologique, ce premier épisode a le mérite de poser les virtualités du sujet et d'en incarner déjà, à la perfection, certaines constantes.
Notes
(1) La série de ces jeux vidéos, produits et conçus par Shinji Mikami et Yoshiki Okamoto, comportait quatre titres : Resident Evil (1996), Resident Evil 2 (1998), Resident Evil 3 : Nemesis (1998), Resident Evil : Code Veronica (2000). Anderson les visionna successivement et sans relâche, dit-on, durant plusieurs semaines, afin de les unifier autant qu'il le pouvait, dans son premier film éponyme de 2002.
(2) Roger Caillois, Le Mythe et l'homme (Éditions Gallimard, NRF 1938 + préface à la réédition 1972), Mircea Eliade, Mythes, rêves et mystères (Éditions Gallimard-NRF, 1957 et réédition revue 1972) & Mircea Eliade, Aspects du mythe (Editions Gallimard, NRF, 1963) sont de bonnes introductions.
(3) La série cinéma complète comporte six titres : Resident Evil (2002) de Paul W.S. Anderson + Resident Evil : Apocalypse (2004) d'Alexander Witt avec scénario écrit par Anderson + Resident Evil : Extinction (2007) de Russell Mulcahy avec scénario écrit par Anderson + Resident Evil : Afterlife (2010) de Paul W.S. Anderson + Resident Evil : Retribution (2012) de Paul W.S. Anderson + Resident Evil : The Final Chapter (2016) de Paul W.S. Anderson. Sony Pictures les a rassemblés en 2017 en un seul coffret BRD (Region Free donc All Zone Worldwide) intitulé : Resident Evil : The Complete Collection 2002-2016.
(4) Il y a dans le film d'Anderson de 2002 une référence cinéphilique directe au Jour des morts-vivants (1985) de George A. Romero lorsqu'on aperçoit un journal dont le titre de première page est «The Dead Walk ! (les morts marchent !» : au début du film de Romero, un journal portant un gros titre semblable est aussi montré.
(5) Je renvoie, au sujet du contexte historique de ces deux séries, le lecteur à la cinquième et dernière section de mon article Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines muettes à 2010 archivée ici.
Sources techniques
DVD zone 2 PAL Metropolitan édition prestige, 2002.
19/08/2020 | Lien permanent
Apocalypses biologiques, 1 : The Last Man on Earth de Sidney Salkow et Ubaldo Ragona, par Francis Moury

 Tous les effondrements
Tous les effondrementsArgument du scénario
États-Unis, 1968. Le biologiste Robert Morgan s'éveille pour une nouvelle journée qu'il passe au milieu d'une ville abandonnée, semée de cadavres auxquels il enfonce systématiquement un pieu dans le cœur avant de les jeter dans une décharge à ciel ouvert, afin de les brûler. La nuit, d'autres misérables cadavres, apparemment ressuscités et capables de le reconnaître, tentent de prendre d'assaut sa maison en hurlant son nom. Morgan les repousse grâce aux moyens traditionnels qui furent autrefois utilisés contre le vampirisme. Que s'est-il passé pour que la Terre en soit là ? Morgan se remémore, trois ans plus tôt, la progression fulgurante de la pandémie virale (venue d'Europe mais à l'universalité de laquelle il refusait de croire) qui a décimé sa famille (son épouse Virginia et leur petite fille), ses amis, ses collègues biologistes et le restant de l'humanité normale. À moins que... ?
The Last Man On Earth/L'Ultimo Uomo della terra (États-Unis + Italie, 1963) de Sidney Salkow et Ubaldo Ragona a connu une exploitation cinéma et vidéo assez tourmentée. Il devait être, à l'origine, produit par la Hammer anglaise qui avait annoncé son titre alternatif Night Creatures en 1958 (titre qui servit par la suite de titre d'exploitation américain à un autre Hammer film : Le Fascinant capitaine Clegg [Captain Clegg / Night Creatures] en 1962 avec Peter Cushing et Yvonne Romain) mais le producteur Anthony Hinds, à la lecture du script de Richard Matheson écrit dans un hôtel londonien, renonça au projet, lassé par les problèmes que la Hammer rencontrait avec la censure britannique depuis le succès des films d'horreur et d'épouvante : Hinds était persuadé que certaines scènes seraient refusées par la censure. Il revendit logiquement les droits à une société américaine et le projet revint de l'autre côté de l'Atlantique pour être bel et bien produit aux États-Unis mais... tourné à Rome en totalité. Raison pour laquelle la seule voix anglaise authentique, dans les copies américaines, est celle de l'acteur américain Vincent Price : les autres acteurs, tous italiens, furent post-synchronisés. Il existe plusieurs versions du film, plus ou moins complètes. La plus complète est sans doute celle présentant la séquence finale dans laquelle Ruth parle à son bébé pour le rassurer : son effet est assez glaçant et d'une noire ironie.
The Last Man on Earth est la première adaptation cinématographique du roman de Richard Matheson (1926-2013), I am Legend [Je suis une légende] (1954) dont la traduction française constitua le volume n°10 de la célèbre collection «Présence du futur» des éditions Denoël, volume imprimé en 1955. Par la suite, deux autres adaptations (moins fidèles au livre) furent tournées : The Omega Man [Le Survivant] (États-Unis, 1971) de Boris Sagall et Je suis une légende (États-Unis, 2007) de Francis Lawrence. Cette production 1963 de l'American International Pictures (dirigée par les célèbres producteurs de cinéma fantastique Samuel Z. Arkoff et James H. Nicholson) fut co-réalisée par le cinéaste américain Sidney Salkow (qui était le frère de l'agent artistique de l'acteur Vincent Price) et par le cinéaste italien Ubaldo Ragona. Il faut savoir que Ragona n'est pas crédité réalisateur au générique d'ouverture sur les copies argentiques américaines tandis que Salkow ne l'est pas sur celui des copies italiennes. Leur mise en scène et leur direction d'acteurs est, sur le plan technique, globalement fonctionnelle, stylistiquement assez neutre, modeste et impersonnelle, mais cette simplicité qui n'est pas faiblesse (sauf quelques points de montage un peu hasardeux qui signale les plans manquants ou les brèves séquences coupées ou rajoutées selon les copies et leur nationalité) renforcerait même plutôt la puissance dramatique du scénario.
The Last Man on Earth est doté d'un casting intéressant, à commencer par celui d'un des plus grands acteurs du cinéma fantastique, à savoir Vincent Price (1911-1993) ici assez étonnant en solitaire nostalgique d'une humanité mortelle, sans oublier d'assez bons acteurs du cinéma-bis italien tels que Giacomo Rossi Stuart. Tourné dans un mignon CinemaScope 2.35 N.&B photographié par Franco Delli Colli, il fut co-écrit et co-dialogué par Richard Matheson lui-même sous le pseudonyme de «Logan Swanson» au générique. Matheson était, en effet, insatisfait du résultat : ce fut la raison pour laquelle, (ainsi qu'il le révèle en 2005 dans le supplément de l'édition américaine DVD MGM, entretien reproduit dans le BRD Shout Factory en 2014) il refusa d'être crédité sous son véritable nom. Le temps décantant les oeuvres, bien des lecteurs du roman considèrent pourtant, aujourd'hui encore, que cette première adaptation demeure la plus fidèle des des trois. Elle modifie certes le nom du héros de «Robert Neville» en «Robert Morgan» (ce que ne feront pas les deux autres versions cinéma) mais elle illustre en revanche bien l'idée majeure de l'histoire, à savoir celle d'un renversement sociologique puis ontologique induit par une pandémie biologique poussée au bout de sa logique. Matheson lui-même en devint probablement conscient puisqu'il concluait son entretien accordé à la MGM en précisant, mi-désabusé, mi-joyeux : «I am Logan Swanson !».
«Comment peut-on être Persan ?» se demandait en 1721 Montesquieu dans les Lettres persanes.
«Comment peut-on être un Homme ?» se demandent dorénavant les «vampires» mutants qui ont remplacé, en raison d'un virus biologique inconnu, l'ancienne humanité, mis à part Neville/Morgan.
Mis à part lui et peut-être mis à part d'autres encore ? C'est, bien sûr, tout l'objet du suspense et tout l'objet de la quête journalière de Neville qui est témoin d'un remplacement qu'il croit total alors qu'il ne l'est pas et qu'une troisième catégorie d'êtres a émergé. On peut donc clairement distinguer trois parties dans le récit : une première partie dans laquelle Neville / Morgan se révèle seul et nous fait découvrir une ville abandonnée, désormais peuplée de morts-vivants nocturnes encore dotés d'une conscience et avides de pouvoir; une seconde partie où il se remémore comment la situation en est arrivée là; une troisième partie débutant par la découverte d'une survivante puis du terrible groupe auquel elle appartient. À partir de là, les événements se précipitent et le rythme du récit s'accélère nettement. Dans les circonstances actuelles de la pandémie de Covid-19, c'est probablement à la seconde section du film (peut-être la plus remarquable en raison de son inexorable rigueur dramaturgique) que les spectateurs seront le plus sensibles : elle est soigneusement montée et son économie de moyens renforce encore son impact, alternant séquences illustrant la montée en puissance de la maladie dans la demeure familiale de Morgan et séquences le montrant, en compagnie de ses collègues biologistes impuissants, en train d'étudier au microscope des bacilles, des germes, des globules blancs. Richard Matheson était particulièrement satisfait de la manière scientifique dont il avait, dans son livre, expliqué la naissance puis la progression de la pandémie : il avait consulté des médecins afin d'augmenter la vérité technique de ce qu'il considère comme son unique histoire de science-fiction, bien qu'on puisse rattacher aussi à la science-fiction son admirable L'Homme qui rétrécit, adapté au cinéma en 1957 par Jack Arnold et dont l'une des bandes annonces était commentée en voix-off par Orson Welles.
Du point de vue esthétique pur, un étrange phénomène se produit, assez analogue à la modification par Matheson d'un sujet de littérature fantastique (les vampires) en sujet de science-fiction (l'apocalypse biologique et la fin de l'humanité) car The Last Man on Earth, film de science-fiction, est régulièrement traversé d'allusions aux films fantastiques purs de la série Edgar Poe réalisée par Roger Corman, elle aussi produite et distribuée par Arfkoff et Nicholson entre 1960 et 1964. Lorsque Vincent Price se recueille sur le cercueil de son épouse défunte Virginia (prénom de la jeune épouse de Poe : encore une allusion à la série Poe et à la vie de Poe lui-même), le spectateur de 1963 ne pouvait s'empêcher de penser brièvement aux rôles qu'il tenait à la même époque pour Corman depuis 1960. Les affiches américaines et anglaises maintenaient, pour leur part, un relatif parallélisme esthétique et dramatique entre The Last Man On Earth et cette série Edgar Poe, oubliant que Vincent Price avait pourtant déjà été la vedette de purs films de science-fiction tels que The Fly [La Mouche noire] (États-Unis, 1958) de Kurt Neumann (dont David Cronenberg donnera un remake esthétiquement inférieur à l'original) et Return of the Fly (États-Unis, 1959) de Edward Bernds. Autre allusion mais pour cinéphiles plus pointus encore : c'est par la morsure d'une chauve-souris que Morgan a peut-être bien été vacciné sans le savoir. Les connaisseurs de sa filmographie peuvent se souvenir à cette occasion, certes purement nominale et sémiologique, du titre de l'assez médiocre The Bat [Le Masque] (États-Unis, 1959) de Crane Wilbur, dans lequel Price jouait en vedette.
Sur le plan de l'histoire du cinéma fantastique, certains brefs plans d'ensemble des vampires-zombies attaquant chaque nuit la voiture et la demeure de Price annoncent assez précisément certains plans de l'attaque nocturne de la maison isolée dans La Nuit des morts-vivants (États-Unis, 1968) de George A. Romero. A cet emprunt graphique ponctuel correspond un emprunt littéraire plus ample puisque ce titre de 1968 et les films fantastiques suivants de Romero (1) peuvent d'ailleurs être considérés comme un développement thématique du roman de Matheson. L'idée des camions d'éboueurs récupérant les morts contaminés, sera reprise, pour sa part, presque dix ans plus tard dans l'assez bon Rabid [Rage] (Canada, 1976) de David Cronenberg. Sur le plan sociologique, le personnage de la survivante Ruth ayant besoin régulièrement de son injection intraveineuse de vaccin, évoque inévitablement la montée en puissance de la drogue (héroïne injectable) au sein de la jeunesse occidentale des années 1955-1965. Très belle utilisation des extérieurs naturels des banlieues romaines : elle renforce le réalisme oppressant du récit : Five [Les Cinq survivants] (États-Unis, 1955) de Arch Oboler, Target Earth (États-Unis, 1957) de Sherman A. Rose, Le Monde, la chair et le Diable (États-Unis, 1960) de Ranald McDougall avaient déjà utilisé des plans similaires de ville abandonnée, où erraient tantôt un, tantôt plusieurs survivants, parfois au milieu d'un ou de plusieurs cadavres abandonnés en pleine rue. Bref, vous l'aurez bien compris, The Last Man on Earth demeure indispensable à une connaissance de l'histoire du cinéma fantastique, succursale science-fiction.
Note
(1) Cf. Francis Moury, Le Cinéma eschatologique de George A. Romero, partie 1 (1968 à 1985) et partie 2 (2005 à 2010).
Notes sur les sources techniques
DVD MGM américain zone 1 NTSC de 2005 + DVD Wild Side Vidéo zone 2 PAL, collection «Vintage Classics» (collection essentiellement constituée à partir de films appartenant au domaine public américain), édité à Paris le 6 avril 2011 + BRD Shout Factory américain, MPEG4 1080p, 2014. Image N&B au format original 2.35 respecté compatible 16/9, son VOSTF (il n'existe aucune VF cinéma d'époque à regretter : la VF entendue sur certaines copies de Youtube est une VF vidéo ou TV beaucoup plus récente dans laquelle la voix de Price est inévitablement trahie concernant sa sonorité), durée 87 minutes environ. Le titre d'exploitation vidéo de l'édition française reprend celui de la traduction française du roman en 1954 (Je suis une légende) mais il faut savoir que ce film de 1963 n'a jamais reçu de visa d'exploitation cinéma en France et qu'il demeura donc inédit sous ce titre français dans les salles de cinéma. Seule la Cinémathèque française en montrait, de temps en temps, à l'époque du Palais de Chaillot, une copie argentique en VO sans STF, dotée de son titre original américain s'il s'agissait d'une copie américaine, de son titre italien si c'était la copie italienne qui était projetée : je crois me souvenir qu'elle possédait, en effet, les deux copies. Certains plans d'ensemble de la ville désolée ne possèdent pas tout à fait la même texture vidéo ni la même définition argentique que le restant du métrage : il s'agit, en effet, de plans rapportés à la continuité, donc de ce qu'on nomme couramment des «stock-shots».
09/04/2020 | Lien permanent
Le structuralisme sans son magicien, par Francis Moury

06/11/2009 | Lien permanent | Commentaires (38)
Hamburger Hill, par Francis Moury

 De l’avis de la plupart des spectateurs «professionnels» (les soldats de carrière), le film le plus fidèle du point de vue de la reconstitution des décors naturels (inutile de rappeler qu’aucun film sur la guerre du Viêt-Nam n’a été tourné… au Viêt-Nam, mais souvent, comme c’est le cas ici, aux Philippines), de l’exactitude des accessoires (équipements collectifs et individuels des hommes), de la véracité de la psychologie et de l’exactitude de la tactique (ou action) elle-même est Hamburger Hill (USA, 1987) de John Irvin. Hamburger Hill est ainsi l’un des grands films témoins sur cette guerre avec d’autres, de première main, comme Platoon [Platoon] (USA, 1987) d’Oliver Stone qui fut soldat là-bas ou The Green Berets [Les bérets verts] (USA, 1968) de John Wayne et Ray Kellog (tourné pendant le conflit). Hamburger Hill se révèle néanmoins supérieur à ces derniers : sa structure est plus rigoureuse que celle du second film et ses personnages moins allégoriques que ceux du premier.
De l’avis de la plupart des spectateurs «professionnels» (les soldats de carrière), le film le plus fidèle du point de vue de la reconstitution des décors naturels (inutile de rappeler qu’aucun film sur la guerre du Viêt-Nam n’a été tourné… au Viêt-Nam, mais souvent, comme c’est le cas ici, aux Philippines), de l’exactitude des accessoires (équipements collectifs et individuels des hommes), de la véracité de la psychologie et de l’exactitude de la tactique (ou action) elle-même est Hamburger Hill (USA, 1987) de John Irvin. Hamburger Hill est ainsi l’un des grands films témoins sur cette guerre avec d’autres, de première main, comme Platoon [Platoon] (USA, 1987) d’Oliver Stone qui fut soldat là-bas ou The Green Berets [Les bérets verts] (USA, 1968) de John Wayne et Ray Kellog (tourné pendant le conflit). Hamburger Hill se révèle néanmoins supérieur à ces derniers : sa structure est plus rigoureuse que celle du second film et ses personnages moins allégoriques que ceux du premier.Fidélité empreinte d’un lyrisme sourd qui jaillit à la fin de la dernière séquence, est préparé par des plans d’introduction du Viêt-Nam Mémorial et inscrit au générique final par un poème en prose (un réquisitoire en forme d’éloge ou son contraire, dont la beauté littéraire évoque autant Matthew Arnold que Lucain) d’une quinzaine de lignes, rédigé par un officier américain ayant sans doute participé aux faits.
Fidélité empreinte d’horreur physique grandissante : pratiquement tous les protagonistes (tous jeunes) finissent tués ou mutilés. Ce qui rend la vision du film d’autant plus cruelle que lesdits protagonistes ne sont pas des pantins caricaturaux, des abstractions, des caractères convenus mais des individus que l’on a largement eu le temps de découvrir (casting d’acteurs remarquables mais à l’époque inconnus et dont la plupart mis à part Dylan Mc Dermoth ou Steven Weber, n’ont guère réapparu ensuite : ce qui renforçait la force du film, en appliquant avec justesse une idée issue en droite ligne des préceptes des néo-réalistes italiens) et d’appréhender. Leur peinture psychologique est rapide mais toujours juste. Le remplacement de leur âme individuelle par une sorte d’âme collective est progressif et augmente d’intensité et de visibilité au moyen d’une maîtrise spectaculaire du découpage dans la seconde partie, celle consacrée aux 10 days : pas d’attaque mais de nombreux dialogues – attaque – repos et moins de dialogues – attaque pire – repos et dialogue plus bref – attaque encore pire –, pratiquement plus de dialogue mais quelques mots, des regards, des soupirs… jusqu’à l’attaque finale au cours de laquelle les derniers survivants ne vivent plus que pour deux actions alternées jusqu’à la nausée : être tués ou tuer d’une part, progresser vers le sommet de la Hill 937 d’autre part.
La suite de ce texte figure dans Flammes sur l'Indochine, l'ouvrage érudit de Francis Moury récemment paru aux éditions Ovadia, ici.

12/05/2005 | Lien permanent
Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, fin, par Francis Moury

Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 1.
Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 2.
Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 3.
Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 4.
Les années 1980-1990
Elles ne modifient pas vraiment la donne, et s’avèrent rétrospectivement moins riches que les années 1960-1970 et 1970-1980 du point de vue thématique. On peut même dire que les scénarios de la majorité des films de cette décennie sont moins sophistiqués que ceux de la période précédente : ils signent le retour à une certaine simplicité d'inspiration. La technique cinématographique connaît, en revanche, une série d’innovations qui va en s’accentuant à un rythme haletant jusqu’en 2000 : le montage numérique permet progressivement d’accélérer l’action visuelle, les effets spéciaux devenant numériques eux aussi accèdent à des niveaux de trucages inédits, la définition de l’image chimique et ses différents degrés de propreté ou de saleté deviennent même des éléments de style, signifiant ou référentiels, enfin le cinéma pense d'une manière réflexive son rapport au nouveau médium qu’est la vidéo, comme il avait avant pensé la télévision.
En Italie, Dario Argento a certes connu son âge d’or baroque et onirique, intellectuel et réflexif (L’Oiseau au plumage de cristal, Les Frissons de l’angoisse, Suspiria, Inferno) avant de 1970 à 1980 mais c'est durant notre décennie qu’il signe avec Ténèbres (1982) le plus réflexif de tous les gialli (pluriel de «giallo») jamais tournés et qu’on peut donc éventuellement l’y intégrer. Lamberto Bava, fils de Mario, signe un très intéressant Démons qui prend, comme le fera aussi le cinéaste espagnol Bigas Luna dans son extraordinaire Angoisse, pour lieu de l’action un cinéma. Il signe aussi un nécrophile Baisers macabres dans la lignée de son père tout en étant original et un Demoni 2 dans lequel la vidéo prend symboliquement la place fonctionnelle du cinéma. Lucio Fulci, un ancien du western italien (on voyait encore l’affiche française de son Temps du Massacre tourné vers 1965, affichée à un cinéma de Saïgon en 1970 dans le beau semi-documentaire Hoa-Bin de Raoul Coutard) et du «poliziotti» (Lucas, il contrabandiere [La Guerre des gangs] ultra-violent polar avec Marcel Bozzufi et Fabio Testi en vedettes) signe entre la fin des années 1970 et 1985 quelques œuvres pauvres en budget mais poétiques, très macabres et «gore», ce qu’on lui pardonne mal dans son propre pays, mais qu’on apprécie outre-Atlantique : L’Au-delà (1982) demeure son chef-d’œuvre, Frayeurs [La Paura] et L’Enfer des zombies ont leurs partisans résolus, sans oublier La Maison près du cimetière. Ensuite, le gore (effet spécial sanglant, hérité des films de H. G. Lewis, inspirés et poétiques) semble absorber Fulci presque malgré lui, au détriment du restant, donc de l’essentiel. Le gore et le triomphe des effets spéciaux appauvrissent le genre, d'une manière générale, au lieu de l’enrichir : Fulci incarne presque filmographiquement cette assertion. Le gore finit par le faire virer à la parodie car on était déjà, depuis H.G. Lewis, sur le fil du rasoir à ce sujet et c’est d’ailleurs bien le cas de le dire : c’est presque l’itinéraire suivi par Michele Soavi, qui passe d’un remarquable giallo Aquarius [Bloody Bird] à une sorte de comédie outrancière se passant dans un cimetière dont le titre n’est pas mémorable !
Aux États-Unis, Roger Corman devenu producteur, donne naissance (parmi les divers genres qu'il ne cesse d'illustrer, notamment le film noir) à une belle trilogie de science-fiction durant la période 1980-1985 : Androïd, La Galaxie de la terreur, Mutant [Forbidden World]. Les scénarios sont adultes et novateurs même si les thèmes sont peu originaux. Les idées plastiques sont bien exploitées, les situations mises au point afin d’obtenir un cocktail parfait entre angoisse, terreur, action, suspense. Tentative technique brillante d’utiliser un nouveau procédé technique, le «steadycam», mis au point par Jim Muroe, le Evil Dead [L’Opéra de la terreur] de Sam Raimi est un coup de maître sans postérité. Raimi ne retrouvera plus ensuite son inspiration baroque originale, ni le dépouillement qui lui donnait sa rigueur. Nick (Nicos) Mastorakis se situe dans la grande tradition du cinéma B et donne, comme en se jouant, vers 1985, un film fondamental pour la connaissance de l’évolution du genre fantastique : Heros Boys, «survival» cauchemardesque, partant de la fascination pour le cinéma de la violence pour aboutir aux «snuf movies» (qui étaient aussi le sujet du très remarquable Hardcore de Paul Schrader) posant ses adolescents dans la situation de spectateurs passant de l'autre côté d'un miroir, sans l'avoir voulu, piégés par un destin démoniaque. Le film utilise en outre le rapport cinéma-vidéo d'une manière consciente, réfléchie, lucide et incisive.
La science-fiction retrouve des sujets classiques mais la technique et l’alliage des genres les modernisent une fois de plus : The Hidden (1987) de Jack Sholder reprend intelligemment le postulat de Jack Arnold et Don Siegel pour décrire une invasion interne à l’esprit humain, menée par des extra-terrestres de deux races différentes venus, par accident, se combattre sur Terre. C’est un étonnant mélange de film policier, de film fantastique, de film d’aventure, de film de SF et de politique-fiction, avec une touche finale de merveilleux et de féerique (la réanimation du héros humain) : le prix d’Avoriaz est amplement mérité mais Hidden 2 est (sans Sholder aux commandes, il est vrai) une nullité sans intérêt. Terminator (1984) de James Cameron est un robot voyageant depuis le futur dans le temps présent pour assassiner un homme dont le descendant combattra un nouvel ordre mondial dominé par les machines qui asservissent dorénavant les hommes. On retrouve sans surprise les paradoxes logiques des anciens philosophes grecs et ceux des logiciens anglais du XIXe siècle à la base de tels arguments «sophistiques». Terminator 2 : Judgment Day (1991) le fait revivre mais le scénario en fait cette fois-ci l’ami des hommes et on lui oppose un Terminator d’un modèle plus récent, plus dur, plus impitoyable, encore moins humain. La série est, dans son ensemble, intelligente. Le procédé psychologique déjà à l’œuvre dans les films Universal et dans ceux de la Toho est à nouveau repris. Le monstre, une fois connu et familier, se voit opposer un nouveau monstre inconnu, donc terrifiant car l’infini du possible est rouvert. Predator (1987) de John McTiernan vient de l’espace en des lieux et des périodes précises : les pays en guerre qu’il apprécie pour chasser l’homme à sa convenance. Predator 2 (1990) annonce intelligemment la rencontre Alien vs Predator (2004) dans laquelle le Predator aidera finalement l’homme contre les Alien.
En Australie, c’est un âge d’or vraiment initié par les grands succès de Peter Weir (Pique-Nique à Hanging Rock, en 1975, La Dernière vague, 1977), Colin Eggleston (Long Week-End qui est un film fantastique écologique discrètement eschatologique et apocalyptique), Richard Franklin (Patrick [Coma] en 1978) qui se transforme en vague de fond : Razorback (une traque cauchemardesque pour abattre un sanglier monstrueux qui enlève les enfants dans le «bush» australien, critique écologique acérée des abattoirs de kangourous en prime), Next of Kin, sans oublier l’admirable Contagion de Karl Zwicki ni le film policier «de prison» atteignant parfois, fugitivement mais d’une manière redoutablement efficace, le fantastique et la SF politique qu’est Ghosts of the Civil Dead (1990) de John Hillcoat. Ni fantastique ni science-fiction mais plutôt film policier ultra-violent situé dans un univers de politique-fiction (au sens où un Peter Watkins entendait ce terme lorsqu’il réalisait vers 1970 en Angleterre ou aux États-Unis des documentaires fictifs mais réalistes tels que La Bombe ou Punishment Park) : ainsi pourrait-on définir la série des Mad Max qui n’a pas très bien vieilli. Calme blanc [Dead Calm] (1989) de Philip Noyce mène à bien, avec un brio technique éprouvé, un projet qu'avait voulu tourner… Orson Welles !
On l’a déjà signalé plus haut : la période est favorable au cinéma asiatique, notamment chinois, ce qui signifie, à cette époque, au cinéma produit et réalisé à Hong Kong par des cinéastes chinois formés dans des écoles anglaises. Après la vague "karaté" démesurée des années 1965-1980, ce sont les thrillers ultra-violents pouvant frôler par cette violence un certain fantastique, des féeries, une science-fiction enfantine ou plus adulte, des serials, de l’heroïc-fantasy au sens américain, des légendes antiques chinoises traditionnelles : Hong Kong fait feu de tout bois et produit à tour de bras pour un marché comprenant aussi bien l’Asie du Sud-Est que les marchés occidentaux avides de nouveaux langages et de nouveaux mondes. Les cinéastes français, anglais, américains, allemands nés en 1960 et s’intéressant au fantastique ont vu les films de Tsui-Hark comme ils ont vu ceux de Dario Argento ou ceux des Australiens : ils les ont considérés comme des films novateurs, au moins formellement.
Les années 1990-2000
Aux États-Unis comme dans le reste du monde, ce sont des années de mutation technique accélérée paradoxalement concordante avec un appauvrissement scénaristique et un ralentissement de la production à quelques exceptions notables : Martin Scorsese tourne en 1991 un remake-variation en couleurs et écran très large du film mi-fantastique, mi-policier Les Nerfs à vif [Cape Fear] (1961) de Jack Lee Thompson qui approfondit l’original, l’amplifie, lui confère une portée plastique et thématique impressionnante. Freddie Francis signe une photo extraordinaire : notamment certains effets de passage d’une image négative à une image positive, et certaines équidensités. Le montage est admirable de précision. Le film est incompris en France et ses critiques négatives. Seven (1995) de David Fincher se veut une réflexion morale angoissante sur la réalité du mal et des sept péchés capitaux, le pire étant l’orgueil, celui du Satan miltonien, toujours actif en pleine ville. Le générique d’ouverture du film est original : il sera souvent copié, jamais égalé. The Blair Witch Project (1999) de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez confère au thème de la sorcière une nouvelle vie et la technique vidéo dialogue constamment avec l’action elle-même afin d’augmenter l’effet de réalité et d’immersion plastique dans ce voyage sans retour, reposant sur le vol d’une caméra pour assouvir l’orgueil d’une étudiante en cinéma qui pense que filmer la réalité suffit à la comprendre, et qui comprend trop tard que cela ne suffit pas. Anaconda (1997) de Luis Llosa est la preuve qu’un honnête scénario, réalisé par un honnête technicien et servi par quelques acteurs convenables, et une ancienne star (John Voight) peut donner un film B poétique et efficace, qui retrouve fugitivement le parfum des films fantastiques B américains des années 1950.
Les années 2000-2010
On a moins de recul sur cette période récente et il faut donc être prudent par principe.
Aux États-Unis, deux phénomènes se détachent apparemment : une production considérable de remakes et de variations à partir de films des années 1970 et 1980 devenus des classiques du genre et le retour du fantastique à destination des enfants plutôt que des adolescents ou des adultes. Mais cependant quelques très bonnes surprises, thématiques et/ou plastiques.
Les «remakes, les «prequels», les variations : Renny Harlin qui a pourtant réalisé le très beau Le Cauchemar de Freddy (le plus beau de la série des Nightmare on Elm Street du point de vue plastique) signe en 2005 un médiocre L’Exorciste : au commencement débuté par Paul Schrader. La Nuit des fous vivants [The Crazies] de Romero est refait en 2010 par Breck Eisner, Dawn of the Dead [Zombie] de Romero est refait en 2004 par Zack Snyder sous le titre français d’exploitation L’Armée des morts : notre critique en était initialement négative à sa sortie mais le film, il est vrai, passe mieux en vidéo qu’au cinéma et c’est en le revoyant plusieurs fois sur une télévision que nous avons changé positivement d’avis à son sujet. The Texas Chain Saw Massacre [Massacre à la tronçonneuse] (1974) de Tobe Hooper est refait-varié en 2003 par Marcus Nispel sous le titre subtilement modifié de The Texas Chainsaw Massacre. Amityville la maison du diable [The Amityville Horror] (1979) de Stuart Rosenberg est refait en 2005 par on ne sait plus qui. La crise d’inspiration des scénaristes est telle qu’on voit sortir des remakes qu’on n’attendait pas du tout : le portrait étonnant du flic psychopathe de Ordure de flic [The Killer Inside Me] (1975) de Burt Kennedy refait par Michael Winterbottom encore en 2010 d'après une série noire de Jim Thompson.
Alien vs Predator (version Director’s cut et version exploitée diffèrent juste par l'ajout d'une séquence pré-générique sympathique et celui de quelques plans supplémentaires dans la continuité au demeurant identique pour le restant) est une belle variation qui approfondit les séries respectives auxquelles il appartient en y introduisant un thème mythique qui reprend discrètement l’idée du génial Les Monstres de l’espace [Quatermass and the Pit] (1967) de Roy Ward Baker : l’humanité instruite par une race supérieure, inhumaine, qui lui communiqua peut-être ses premiers mythes et ses premiers rites. La décadence de la Universal avait engendré des rencontres entre monstres appartenant à des histoires différentes : le phénomène se reproduit 60 ans plus tard : Jason vs Freddy. Plus cohérent : les rencontres entre monstres animaux issus ou non du génie biologique humain. Boa, Boa vs Python, Komodo vs Cobra sont tournés à l’économie mais ils veulent servir un genre avec modestie et les enfants prendront beaucoup de plaisir à visionner leurs affrontements assez bien montés, dotés d’image numérique suppléant la faiblesse des budgets et des intrigues, malgré tout suffisamment nerveuses pour pouvoir être visionnées par des adultes.
Au rayon des bonnes surprises novatrices : Resident Evil (2002) de Paul W.S. Anderson est plastiquement très beau, très bien monté et son sujet (les dangers du génie génétique et / ou biologique) surfe sur l’ancienne vague de The Andromeda Strain adapté de Michael Crichton par Robert Wise en 1971 mais en apportant de nombreux éléments narratifs novateurs. La femme devient l’héroïne du film : le phénomène est accentuée depuis la série des Alien. Bien entendu, le succès de Resident Evil donne naissance, comme d’habitude à Hollywood, à une série de variations intéressantes ou honnêtes. Autre bonne surprise : Open Waters (2003) de Chris Kentis et Laura Lau. Ce n’est pas un film fantastique par son argument, comme Jaws de Spielberg ne l’était pas non plus. Mais c’est bien un film fantastique par son traitement thématique et esthétique, qui renouvelle son approche par l’usage remarquable des caméras numériques légères, portées à l’épaule ou montées sur les comédiens eux-mêmes, qui ont pris des risques relatifs et sont tous deux excellents. La perception ontologique du rapport de l’homme à son environnement a rarement été aussi bien captée et aussi bien transmise : cet affinement perceptif est par lui-même une forme d’avant-garde qui renforce l’impact de la peur. Au moment où nous rédigeons ces lignes, nous attendons impatiemment la sortie vidéo du film australien The Reef (2010) inspiré lui aussi d'un fait réel et qui pourrait bien être le troisième très grand film d'horreur biologique ayant pour thème le grand requin blanc. Enfin The Descent (2005) de Neil Marshall est, outre une prouesse technique aussi impressionnante que Open Waters, une prouesse filmée classiquement sur pellicule chimique, doté d’un thème intelligemment traité : un groupe de jeunes femmes spéléologues se retrouve confronté à une nouvelle race créée accidentellement par l’homme lui-même, une race dégénérée et cannibale survivant sous la Terre dans le silence des ténèbres... avec l'aide de l'une d'entre elles qui est en réalité leur mère, complice de leurs crimes.
Au rayon des mauvaises surprises : Minority Report (2002) de Steven Spielberg dont le scénario semble avoir été écrit par un ordinateur plutôt que par un être humain, en dépit de la référence littéraire d’origine. Tout y est ennuyeux et prévisible en dépit d’un budget considérable et de lourds effets spéciaux. Spielberg confirme, au moment où nous écrivons ces lignes, qu’il ne fut que le cinéaste de deux films réellement originaux (Duel en 1971 et Jaws en 1975) avant de devenir un technicien sans intérêt particulier sauf exception ponctuelle d’une séquence ou deux, par la suite. Du côté anglais, un seul film frappant (c’est le cas de le dire) : The Last Horror Movie (2003) de Julian Richards qui semble l’ultime possibilité cinématographique en matière de serial killers à cause de l’écriture raffinée, à la cruauté acide, de son scénario. À rebours de cette originalité plastique, on peut lui opposer le classique mais très bon The Zodiac [The Zodiac, inspiré de faits réels] (2003) d’Alexander Bulkley, film méconnu qui gagnerait à être comparé au «mainstream» Zodiac de David Fincher. On se souvient que le scénario de L’Inspecteur Harry [Dirty Harry] de Don Siegel s’était inspiré (sans le dire) des mêmes faits.
Les meilleures surprises (thématiques
20/08/2012 | Lien permanent
Dracula, 2 : La fille de Dracula de Lambert Hillyer, par Francis Moury

 Cette suite directe du film de Tod Browning ne doit aujourd’hui pas être confondue avec A Filha de Dracula / La Hija de Dracula [La fille de Dracula] (France-Portugal, 1972) de Jess Franco avec Britt Nichols, Anne Libert et Howard Vernon puisque leurs titres d’exploitation français d’époque sont identiques et constituent aujourd’hui des faux-amis redoutables. D’autant que le vampire du film de Franco se nomme Karstein et nullement Dracula !Dracula’s Daughter est un curieux mélange de film policier et de film fantastique comme l’était d’ailleurs l’année précédente Mark of the Vampire [La marque du vampire] (É.-U., 1935) de Tod Browning, le grand absent de ce coffret pour raison éponymique ! Notons d’ailleurs que c’était, comme on sait, un remake de London After Midnight [Londres la nuit] (É.-U., 1927) de Tod Browning, coutumier de tels mélanges à tel point qu’un film comme son Dracula peut presque être considéré par sa relative linéarité générique comme une exception dans sa filmographie ! Son scénario est très sympathique et le personnage joué d’une manière encore aujourd’hui impressionnante par l’actrice Gloria Holden annonce les grandes femmes vampires modernes, conscientes de leur érotisme fatal, telle celui d’une Gianna Maria Canale dans I Vampiri [Les vampires] (France-Italie, 1957) de Riccardo Freda même si, ici, c’est bien une malédiction ontologique et non biologique qu’il faut combattre. Combat inégal duquel le ridicule et pâle psychologue dont elle amoureuse ne comprendra d’abord strictement rien puisqu’ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde ! Le film est souvent beau et son charme poétique opère toujours, son rythme est assez lent mais sa mise en scène ménage de belles séquences. Excellente opposition de deux beautés bien différentes (la très belle Marguerite Churchill, qu’on dirait échappée d’une comédie de Frank Capra, est un intéressant contrepoint qui préfigure bien des rivalités fantastiques et il convient aussi de mentionner la belle victime qui accepte de poser comme modèle et suggère une vampirisation lesbienne), présence inquiétante et mystérieuse d’Irving Pichel, acteur qui sera aussi réalisateur (n’avait-il pas déjà co-signé avec E. B. Schoedsack, The Most Dangerous Game [Les chasses du comte Zaroff] (É.-U., 1932) même si son rôle fut bien inférieur à celui de Schoedsack ?) jusque dans les années 1950, belle photo très épurée de George Robinson : un classique original et, en partie, matriciel d’une lignée de femmes vampires comme héroïnes et non plus comme silhouette magique mais muette, à la différence par exemple de celle jouée par Carol Borland dans Mark of the Vampire [La marque du vampire] (É.-U., 1935) de Tod Browning.
Cette suite directe du film de Tod Browning ne doit aujourd’hui pas être confondue avec A Filha de Dracula / La Hija de Dracula [La fille de Dracula] (France-Portugal, 1972) de Jess Franco avec Britt Nichols, Anne Libert et Howard Vernon puisque leurs titres d’exploitation français d’époque sont identiques et constituent aujourd’hui des faux-amis redoutables. D’autant que le vampire du film de Franco se nomme Karstein et nullement Dracula !Dracula’s Daughter est un curieux mélange de film policier et de film fantastique comme l’était d’ailleurs l’année précédente Mark of the Vampire [La marque du vampire] (É.-U., 1935) de Tod Browning, le grand absent de ce coffret pour raison éponymique ! Notons d’ailleurs que c’était, comme on sait, un remake de London After Midnight [Londres la nuit] (É.-U., 1927) de Tod Browning, coutumier de tels mélanges à tel point qu’un film comme son Dracula peut presque être considéré par sa relative linéarité générique comme une exception dans sa filmographie ! Son scénario est très sympathique et le personnage joué d’une manière encore aujourd’hui impressionnante par l’actrice Gloria Holden annonce les grandes femmes vampires modernes, conscientes de leur érotisme fatal, telle celui d’une Gianna Maria Canale dans I Vampiri [Les vampires] (France-Italie, 1957) de Riccardo Freda même si, ici, c’est bien une malédiction ontologique et non biologique qu’il faut combattre. Combat inégal duquel le ridicule et pâle psychologue dont elle amoureuse ne comprendra d’abord strictement rien puisqu’ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde ! Le film est souvent beau et son charme poétique opère toujours, son rythme est assez lent mais sa mise en scène ménage de belles séquences. Excellente opposition de deux beautés bien différentes (la très belle Marguerite Churchill, qu’on dirait échappée d’une comédie de Frank Capra, est un intéressant contrepoint qui préfigure bien des rivalités fantastiques et il convient aussi de mentionner la belle victime qui accepte de poser comme modèle et suggère une vampirisation lesbienne), présence inquiétante et mystérieuse d’Irving Pichel, acteur qui sera aussi réalisateur (n’avait-il pas déjà co-signé avec E. B. Schoedsack, The Most Dangerous Game [Les chasses du comte Zaroff] (É.-U., 1932) même si son rôle fut bien inférieur à celui de Schoedsack ?) jusque dans les années 1950, belle photo très épurée de George Robinson : un classique original et, en partie, matriciel d’une lignée de femmes vampires comme héroïnes et non plus comme silhouette magique mais muette, à la différence par exemple de celle jouée par Carol Borland dans Mark of the Vampire [La marque du vampire] (É.-U., 1935) de Tod Browning.
05/03/2010 | Lien permanent
Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, par Francis Moury

 Ligne de front franco-allemande en 1916 durant la Première Guerre mondiale. Sur injonction du Général Broulard, le colonel Dax reçoit du général Mireau l'ordre de prendre une colline fortifiée allemande... imprenable. L'attaque échoue inévitablement, entraînant des pertes désastreuses qui repoussent les «poilus» dans leurs tranchées mais aussi en raison d'une sorte de mutinerie passive d'une partie d'entre eux. Le général Mireau exige qu'on fasse sortir des tranchées les hommes en tirant sur eux au canon de 75 mais ses subordonnés refusent d'exécuter son ordre. Mireau demande alors à Broulard l'autorisation qu'on en fusille certains, au hasard et pour l'exemple. Dax obtient la charge d'avocat mais ne pourra sauver les trois soldats désignés par le sort pour mourir. Mireau sera cependant, lui aussi, désavoué et traduit en justice militaire. Le général Broulard croit ainsi satisfaire les exigences de la guerre par cet étrange équilibre : Dax lui signifie son mépris. Un concert improvisé de variété (une jeune chanteuse allemande capturée émeut quelques instants aux larmes des soldats français de tous âges) dont Dax est témoin semble le rassurer sur la capacité des hommes à maintenir l'humanité... avant que l'ordre d'emmener ses hommes au front ne lui soit, une fois de plus, signifié.CritiqueLes Sentiers de la gloire (Paths of Glory, États-Unis, 1957) de Stanley Kubrick que Carlotta films réédite en copie neuve à Paris à partir du 23 mars 2011 n'a été que très tardivement assorti d'un visa d'exploitation (visa n°43 878) en France. Sa présentation à la télévision française, dans le cadre de la célèbre émission Les Dossiers de l'écran, consacrée ce soir-là aux mutineries françaises durant la Grande Guerre, provoqua des réactions passionnées. On se souvient très bien d'un coup de téléphone furieux (en direct au standard ouvert au public pendant le débat qui suivait traditionnellement la téléprojection) d'un ancien combattant qui estimait que ce film attentait à l'honneur de l'armée. Pourtant Kubrick avait déclaré n'avoir choisi ce sujet qu'en raison de la possibilité qu'il lui offrait de critiquer l'idée même de guerre. Fear and Desire (1953) tourné à ses débuts, manifestait déjà son intérêt pour le thème puisqu'il montrait quelques soldats perdus derrière les lignes du front ennemi d'une guerre entre deux entités étatiques indéterminées et ce thème sera, par la suite, plusieurs fois illustré au cours de sa filmographie. C'est, en somme, faute d'avoir trouvé l'équivalent de tels faits symboliques dans l'histoire américaine que Kubrick se rabattit finalement sur un roman d'Humphrey Cobb, un récit inspiré de faits historiques absolument réels survenus en France. Il fut adapté par trois scénaristes crédités, y compris l'écrivain Jim Thompson (2) et Kubrick lui-même. L'énervement de l'ancien combattant français de 14-18 était probablement motivé par une autre raison qui est souvent négligée mais pourtant frappante : le générique – pendant lequel retentit une Marseillaise revue par le compositeur Gerald Fried – indique noir sur blanc que le film fut tourné en Allemagne, avec une équipe partiellement allemande. Qu'un cinéaste américain tourne un film critiquant l'armée française... passait encore, mais qu'il l'ait tourné en Allemagne avec une équipe partiellement allemande, était évidemment insupportable pour nos grands-pères ! Kubrick n'avait peut-être pas une connaissance assez profonde de l'histoire ni de la psychologie des peuples pour en avoir conscience à moins qu'il ne l'ait fait, au contraire, absolument exprès ?
Ligne de front franco-allemande en 1916 durant la Première Guerre mondiale. Sur injonction du Général Broulard, le colonel Dax reçoit du général Mireau l'ordre de prendre une colline fortifiée allemande... imprenable. L'attaque échoue inévitablement, entraînant des pertes désastreuses qui repoussent les «poilus» dans leurs tranchées mais aussi en raison d'une sorte de mutinerie passive d'une partie d'entre eux. Le général Mireau exige qu'on fasse sortir des tranchées les hommes en tirant sur eux au canon de 75 mais ses subordonnés refusent d'exécuter son ordre. Mireau demande alors à Broulard l'autorisation qu'on en fusille certains, au hasard et pour l'exemple. Dax obtient la charge d'avocat mais ne pourra sauver les trois soldats désignés par le sort pour mourir. Mireau sera cependant, lui aussi, désavoué et traduit en justice militaire. Le général Broulard croit ainsi satisfaire les exigences de la guerre par cet étrange équilibre : Dax lui signifie son mépris. Un concert improvisé de variété (une jeune chanteuse allemande capturée émeut quelques instants aux larmes des soldats français de tous âges) dont Dax est témoin semble le rassurer sur la capacité des hommes à maintenir l'humanité... avant que l'ordre d'emmener ses hommes au front ne lui soit, une fois de plus, signifié.CritiqueLes Sentiers de la gloire (Paths of Glory, États-Unis, 1957) de Stanley Kubrick que Carlotta films réédite en copie neuve à Paris à partir du 23 mars 2011 n'a été que très tardivement assorti d'un visa d'exploitation (visa n°43 878) en France. Sa présentation à la télévision française, dans le cadre de la célèbre émission Les Dossiers de l'écran, consacrée ce soir-là aux mutineries françaises durant la Grande Guerre, provoqua des réactions passionnées. On se souvient très bien d'un coup de téléphone furieux (en direct au standard ouvert au public pendant le débat qui suivait traditionnellement la téléprojection) d'un ancien combattant qui estimait que ce film attentait à l'honneur de l'armée. Pourtant Kubrick avait déclaré n'avoir choisi ce sujet qu'en raison de la possibilité qu'il lui offrait de critiquer l'idée même de guerre. Fear and Desire (1953) tourné à ses débuts, manifestait déjà son intérêt pour le thème puisqu'il montrait quelques soldats perdus derrière les lignes du front ennemi d'une guerre entre deux entités étatiques indéterminées et ce thème sera, par la suite, plusieurs fois illustré au cours de sa filmographie. C'est, en somme, faute d'avoir trouvé l'équivalent de tels faits symboliques dans l'histoire américaine que Kubrick se rabattit finalement sur un roman d'Humphrey Cobb, un récit inspiré de faits historiques absolument réels survenus en France. Il fut adapté par trois scénaristes crédités, y compris l'écrivain Jim Thompson (2) et Kubrick lui-même. L'énervement de l'ancien combattant français de 14-18 était probablement motivé par une autre raison qui est souvent négligée mais pourtant frappante : le générique – pendant lequel retentit une Marseillaise revue par le compositeur Gerald Fried – indique noir sur blanc que le film fut tourné en Allemagne, avec une équipe partiellement allemande. Qu'un cinéaste américain tourne un film critiquant l'armée française... passait encore, mais qu'il l'ait tourné en Allemagne avec une équipe partiellement allemande, était évidemment insupportable pour nos grands-pères ! Kubrick n'avait peut-être pas une connaissance assez profonde de l'histoire ni de la psychologie des peuples pour en avoir conscience à moins qu'il ne l'ait fait, au contraire, absolument exprès ? Dans la filmographie de Kubrick, Les Sentiers de la gloire se situe juste après ses deux films noirs policiers The Killing [L'Ultime razzia] (1956) et Killer's Kiss [Le Baiser du tueur] (1955) que certains (dont l'auteur de ces lignes) considèrent d'ailleurs comme demeurant, en fin de compte, ses deux films les plus personnels et les plus réussis, en dépit de la montée en puissance progressive postérieure des budgets qui lui furent attribués, et en dépit de sa notoriété critique et esthétique, croissante aussi mais pourtant si discutable, si on considère la courbe filmographique qui va de sa version de Spartacus (1960) à sa version de la guerre du Viêt-Nam dans Full Metal Jacket (1987) en passant par 2001, l'odyssée de l'espace (1968) et The Shining (1980). Des deux films noirs de 1955 et 1956, Kubrick conserve la volonté esthétique d'unir fugitivement cinéma documentaire et cinéma spectaculaire : la manière de filmer les tranchées, les combats et surtout le procès est clairement une manière davantage télévisuelle que cinématographique lorsqu'on replace Les Sentiers de la gloire dans son contexte esthétique. Certains plans de coupe tranchent aussi volontairement avec la syntaxe en vigueur à l'époque : le montage se permet régulièrement quelques audaces discrètes. La scène la plus surprenante plastiquement demeure celle du procès, glacée, froide, précise, très dynamique et qui semble fixer sur un échiquier virtuel l'ensemble des participants, tous uniformément broyés (moralement ou physiquement) par un mécanisme qu'ils animent de leur énergie vitale. Le budget étant en progression (en dépit de sa relative modicité qui lui interdit la couleur et le cantonne dans un noir et blanc travaillé d'une manière souvent cauchemardesque ou expressionniste), Kubrick peut se permettre de spectaculaires travellings avants ou arrières parfois brefs mais parfois très longs et descriptifs, participant du suspense et de la révélation du cadre, subjectifs comme objectifs. Leur organisation aboutit à enserrer les individus dans une sorte de destinée brutalement matérialisée, jusqu'au travelling sur les poteaux auxquels sont attachés les trois innocents. À noter que des trois, un est inconscient, un devient presque fou, un troisième meurt en héros conscient et stoïque. Variation kubrickienne laïque et philosophique sur la crucifixion du Christ ? Ce n'est pas totalement impossible, d'autant que le thème du mal et de la rédemption hante le film de part en part.
Dans la filmographie de Kubrick, Les Sentiers de la gloire se situe juste après ses deux films noirs policiers The Killing [L'Ultime razzia] (1956) et Killer's Kiss [Le Baiser du tueur] (1955) que certains (dont l'auteur de ces lignes) considèrent d'ailleurs comme demeurant, en fin de compte, ses deux films les plus personnels et les plus réussis, en dépit de la montée en puissance progressive postérieure des budgets qui lui furent attribués, et en dépit de sa notoriété critique et esthétique, croissante aussi mais pourtant si discutable, si on considère la courbe filmographique qui va de sa version de Spartacus (1960) à sa version de la guerre du Viêt-Nam dans Full Metal Jacket (1987) en passant par 2001, l'odyssée de l'espace (1968) et The Shining (1980). Des deux films noirs de 1955 et 1956, Kubrick conserve la volonté esthétique d'unir fugitivement cinéma documentaire et cinéma spectaculaire : la manière de filmer les tranchées, les combats et surtout le procès est clairement une manière davantage télévisuelle que cinématographique lorsqu'on replace Les Sentiers de la gloire dans son contexte esthétique. Certains plans de coupe tranchent aussi volontairement avec la syntaxe en vigueur à l'époque : le montage se permet régulièrement quelques audaces discrètes. La scène la plus surprenante plastiquement demeure celle du procès, glacée, froide, précise, très dynamique et qui semble fixer sur un échiquier virtuel l'ensemble des participants, tous uniformément broyés (moralement ou physiquement) par un mécanisme qu'ils animent de leur énergie vitale. Le budget étant en progression (en dépit de sa relative modicité qui lui interdit la couleur et le cantonne dans un noir et blanc travaillé d'une manière souvent cauchemardesque ou expressionniste), Kubrick peut se permettre de spectaculaires travellings avants ou arrières parfois brefs mais parfois très longs et descriptifs, participant du suspense et de la révélation du cadre, subjectifs comme objectifs. Leur organisation aboutit à enserrer les individus dans une sorte de destinée brutalement matérialisée, jusqu'au travelling sur les poteaux auxquels sont attachés les trois innocents. À noter que des trois, un est inconscient, un devient presque fou, un troisième meurt en héros conscient et stoïque. Variation kubrickienne laïque et philosophique sur la crucifixion du Christ ? Ce n'est pas totalement impossible, d'autant que le thème du mal et de la rédemption hante le film de part en part. Le thème profond des Sentiers de la gloire, en dépit de son apparence de plaidoyer humaniste parfaitement mis en scène, nous semble être celui d'une structure provoquant inévitablement la perte des éléments qui la constituent. Kubrick est fasciné par l'idée d'une telle structure saturnienne dévorant ses enfants pour maintenir sa propre existence : son pessimisme légendaire pourrait en découler métaphysiquement. Toute la narration et ses rebondissements sont, en effet, méticuleusement construits de manière qu'aucun des personnages, quelles que soient ses options morales ou pratiques, n'échappe in fine à son destin le plus évident : la mort et/ou la destruction par le mal. Tout l'effort humain représenté, toutes ces dépenses prodigieuses d'énergie et d'intelligence aboutissent au néant, à un conflit entre des forces en constant déséquilibre, soumises au hasard du temps et de l'espace. L'ennemi allemand demeure totalement invisible du début à la fin des Sentiers de la gloire : il n'est matérialisé que par les obus qu'il tire, ou par une étrange construction vue de loin, dans un paysage lunaire de trous d'obus, et pour l'identification impossible duquel un soldat se fait tuer par une grenade lancée par son propre supérieur, un lâche en état d'ébriété. Cette invisibilité est l'un des traits les plus puissants de la dramaturgie du film. L'autre est son casting : George Macready (admirable d'un bout à l'autre dans le rôle d'un fou criminel défiguré, enfantin et inquiétant à la fois, qui finira broyé par le système auquel il a voué sa vie) pourrait incarner, d'un point de vue presque dualiste sinon gnostique, une humanité déchue tenaillée entre le discours de l'ange (Kirk Douglas) et celui du démon (Adolphe Menjou); ces trois acteurs principaux sont ici d'une puissance remarquable, sans qu'on doive négliger les seconds rôles tels que les soldats interprétés par Timothy Carey ou Ralph Meeker. L'acteur Adolphe Menjou insinue un fantastique démoniaque cérébral, parfois proche de la comédie en raison de l'intelligence cynique du général qu'il interprète, dans toutes les séquences où il a la vedette. Mais c'est bien Macready qui est, en définitive, le personnage essentiel du film, à la manière dont le César joué par John Gavin sera le personnage essentiel de Spartacus en 1960. Son évolution interne comme externe, son destin objectif, soutiennent toute la dynamique du film : de bourreau, il devient victime alors que les autres ne subissent pas de telles transformations, aussi totales. L'alliage demeure impressionnant, en dépit de sa lourde volonté démonstrative qui pèche par défaut (3), de l'abondance de dialogues certes bien écrits mais parfois trop bien écrits, d'une syntaxe parfois un peu artificielle en dépit de son brio. Convenons que la reconnaissance nocturne et l'assaut sont un peu trop stylisés mais demeurent cependant globalement crédibles. On est évidemment loin de la vérité nue, matérielle, historique, psychologique des Croix de bois de Raymond Bernard, ou des films témoignages d'Abel Gance, sans doute bien plus proches de la vérité originelle du conflit, ne serait-ce qu'en raison de leur proximité chronologique avec lui. Cependant, par une alchimie toute naturelle, la démonstration se retrouve intensifiée et humanisée, à nos yeux français à qui Les Sentiers de la gloire restitue bien quelque chose d'un passé concret, encore vivant en nous. Son tournage sur des lieux européens (allemands, certes mais aujourd'hui d'abord européens) n'y est pas étranger.Notes* Captures d'écran réalisées par Francis Moury.(1) Les masters vidéo américains et européens comme les masters vidéos télédiffusés en France sont, pour le moment, tous au format 1.37; aucun ne respecte le format large «1.66 Matted» obtenu à la projection cinéma. On attend un Blue-Ray qui le respecterait, compatible 16/9.(2) Jim Thompson avait écrit pour Kubrick et son producteur James B. Harris, l'année précédente, les dialogues de The Killing (1956) d'après le roman Clean Break de Lionel White; le propre roman de Thompson The Killer Inside Me sera adapté deux fois au cinéma par Hollywood, en 1976 et en 2010.(3) Négligeant un point capital : on ne pouvait pas se permettre de perdre cette guerre et seuls les Allemands d'une part, les communistes révolutionnaires européens d'autre part, avaient intérêt au contraire. Pour bien comprendre ce que fut cette Première Guerre mondiale, l'historien comme le philosophe francophones peuvent se reporter avec intérêt aux deux conférences d'Émile Boutroux prononcées durant la Grande Guerre et réunies par la suite à la fin de ses Études d'histoire de la philosophie allemande (Éditions Vrin, collection B.H.P., 1926).
Le thème profond des Sentiers de la gloire, en dépit de son apparence de plaidoyer humaniste parfaitement mis en scène, nous semble être celui d'une structure provoquant inévitablement la perte des éléments qui la constituent. Kubrick est fasciné par l'idée d'une telle structure saturnienne dévorant ses enfants pour maintenir sa propre existence : son pessimisme légendaire pourrait en découler métaphysiquement. Toute la narration et ses rebondissements sont, en effet, méticuleusement construits de manière qu'aucun des personnages, quelles que soient ses options morales ou pratiques, n'échappe in fine à son destin le plus évident : la mort et/ou la destruction par le mal. Tout l'effort humain représenté, toutes ces dépenses prodigieuses d'énergie et d'intelligence aboutissent au néant, à un conflit entre des forces en constant déséquilibre, soumises au hasard du temps et de l'espace. L'ennemi allemand demeure totalement invisible du début à la fin des Sentiers de la gloire : il n'est matérialisé que par les obus qu'il tire, ou par une étrange construction vue de loin, dans un paysage lunaire de trous d'obus, et pour l'identification impossible duquel un soldat se fait tuer par une grenade lancée par son propre supérieur, un lâche en état d'ébriété. Cette invisibilité est l'un des traits les plus puissants de la dramaturgie du film. L'autre est son casting : George Macready (admirable d'un bout à l'autre dans le rôle d'un fou criminel défiguré, enfantin et inquiétant à la fois, qui finira broyé par le système auquel il a voué sa vie) pourrait incarner, d'un point de vue presque dualiste sinon gnostique, une humanité déchue tenaillée entre le discours de l'ange (Kirk Douglas) et celui du démon (Adolphe Menjou); ces trois acteurs principaux sont ici d'une puissance remarquable, sans qu'on doive négliger les seconds rôles tels que les soldats interprétés par Timothy Carey ou Ralph Meeker. L'acteur Adolphe Menjou insinue un fantastique démoniaque cérébral, parfois proche de la comédie en raison de l'intelligence cynique du général qu'il interprète, dans toutes les séquences où il a la vedette. Mais c'est bien Macready qui est, en définitive, le personnage essentiel du film, à la manière dont le César joué par John Gavin sera le personnage essentiel de Spartacus en 1960. Son évolution interne comme externe, son destin objectif, soutiennent toute la dynamique du film : de bourreau, il devient victime alors que les autres ne subissent pas de telles transformations, aussi totales. L'alliage demeure impressionnant, en dépit de sa lourde volonté démonstrative qui pèche par défaut (3), de l'abondance de dialogues certes bien écrits mais parfois trop bien écrits, d'une syntaxe parfois un peu artificielle en dépit de son brio. Convenons que la reconnaissance nocturne et l'assaut sont un peu trop stylisés mais demeurent cependant globalement crédibles. On est évidemment loin de la vérité nue, matérielle, historique, psychologique des Croix de bois de Raymond Bernard, ou des films témoignages d'Abel Gance, sans doute bien plus proches de la vérité originelle du conflit, ne serait-ce qu'en raison de leur proximité chronologique avec lui. Cependant, par une alchimie toute naturelle, la démonstration se retrouve intensifiée et humanisée, à nos yeux français à qui Les Sentiers de la gloire restitue bien quelque chose d'un passé concret, encore vivant en nous. Son tournage sur des lieux européens (allemands, certes mais aujourd'hui d'abord européens) n'y est pas étranger.Notes* Captures d'écran réalisées par Francis Moury.(1) Les masters vidéo américains et européens comme les masters vidéos télédiffusés en France sont, pour le moment, tous au format 1.37; aucun ne respecte le format large «1.66 Matted» obtenu à la projection cinéma. On attend un Blue-Ray qui le respecterait, compatible 16/9.(2) Jim Thompson avait écrit pour Kubrick et son producteur James B. Harris, l'année précédente, les dialogues de The Killing (1956) d'après le roman Clean Break de Lionel White; le propre roman de Thompson The Killer Inside Me sera adapté deux fois au cinéma par Hollywood, en 1976 et en 2010.(3) Négligeant un point capital : on ne pouvait pas se permettre de perdre cette guerre et seuls les Allemands d'une part, les communistes révolutionnaires européens d'autre part, avaient intérêt au contraire. Pour bien comprendre ce que fut cette Première Guerre mondiale, l'historien comme le philosophe francophones peuvent se reporter avec intérêt aux deux conférences d'Émile Boutroux prononcées durant la Grande Guerre et réunies par la suite à la fin de ses Études d'histoire de la philosophie allemande (Éditions Vrin, collection B.H.P., 1926).
03/04/2011 | Lien permanent



























































