Rechercher : francis moury george romero
Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 2, par Francis Moury

Histoire et esthétique du cinéma fantastique des origines à 2010, 1.
Période parlante : l’âge d’or du cinéma fantastique américain 1931-1945
Il existe depuis la période du muet mais c’est le succès du Dracula (1931) parlant de Tod Browning produit par la Universal qui détermine réellement son essor thématique comme plastique : sans lui, ni le Frankenstein produit à nouveau par la Universal Pictures et réalisé par James Whale, ni le King Kong de E. B. Schoedsack & M.C. Cooper produit par la RKO, ni le Dr. Jekyll et Mr Hyde de Rouben Mamoulian produit par la MGM, ni Les Morts vivants [White Zombie] de Victor Halperin produits par la United Artist, ni le Masque de cire [Mystery of the Wax Museum] (1933) de Michael Curtiz produit par la Warner, ni les autres classiques signés à cette époque par des cinéastes aussi divers que Erle C. Kenton, Charles Brabin, Louis Friedlander, Edgar G. Ulmer, n’auraient vu le jour.
Hollywood s’intéresse à toutes les sources possibles : sources littéraires (roman de Bram Stoker pour Dracula, roman de Mary W. Shelley pour Frankenstein, roman court ou longue nouvelle de R. L. Stevenson pour le Dr. Jekyll & Mr. Hyde, et de H. G. Wells pour L’Ile du Docteur Moreau [Island of Lost Souls], nouvelle ou conte aux dimensions classiques pour Le Crime de la rue Morgue d’après Edgar Poe, et aussi une nouvelle plus brève et contemporaine pour Les Chasses du comte Zaroff / La Chasse du comte Zaroff [The Most Dangerous Game], sources historiques récentes (la malédiction frappant les archéologues anglais ayant découvert la tombe de l’un des Pharaons), sources ethnologiques (le Vaudou à Haïti tel que l'ethnologue Alfred Métraux avait pu l'étudier), mais laisse aussi libre court à l’imagination débridée des scénaristes. Ainsi, Dracula se voit en quelques années doté d’une fille (1936), puis d’un fils (en 1943). Frankenstein (le médecin... mais le public confond très vite le créateur et la créature) avait une fiancée que sa créature voulait lui ravir en 1931. C’est bientôt l’inverse : il tente en 1935 de créer pour sa créature rescapée du film précédent une fiancée artificielle-naturelle, aussi hybride que sa première créature. S’il périt à cette occasion, sa créature est, à nouveau, rescapée et son fils au sens strict du terme comme au sens spirituel (Le Fils de Frankenstein de Rowland V. Lee) tente à nouveau en 1939 de lui redonner une vie pérenne mais elle, à nouveau, compromise par la promiscuité et les meurtres nécessaires à sa survie et au secret de l’expérience. La décadence (en fait, bien plutôt qu'une décadence, un authentique chant du cygne) de la Universal accentue le phénomène en le démultipliant : les monstres se croisent au sein d’un même film et on obtient les surréalistes et démentiels, dynamiques et plastiquement très beaux films d’Erle C. Kenton : Le Spectre de Frankenstein, La Maison de Dracula, La Maison de Frankenstein tournés entre 1943 et 1945. Et il faut évidemment se méfier des faux amis : Le Chat noir d’Edgar G. Ulmer et Le Corbeau de Louis Friedlander ne sont pas des adaptations du conte et du poème homonymes d’Edgar Poe qui leur fournit une inspiration explicitement mentionnée parfois en une phrase ou deux du dialogue mais aussi bien plus profondément active sous la forme d’une vision digne de Poe, vision tentant de retrouver en profondeur Le Démon de la perversité à l’œuvre la plus authentique chez Poe. Ainsi du rapport très étrange qui s’instaure entre Bela Lugosi et Boris Karloff dans Le Chat noir, ainsi du personnage de Lugosi dans Le Corbeau. Ce sont des «faux amis» d’une certaine manière, mais de «faux faux amis» si on les considère sérieusement.
On connaît la formule du philosophe rationaliste Léon Brunschvicg : «L’histoire de l’Égypte, c’est l’histoire de l’Égyptologie». Elle s’applique au cinéma fantastique, et à sa section principale l’horreur et l’épouvante. Dans la mesure même où la critique littéraire française méprisait les œuvres littéraires originales adaptées par Hollywood, elle méprisa les films eux-mêmes, à l’exception de critiques visionnaires (Jean Boullet) ou surréalistes (Ado Kyrou) ou psychanalytiques (Marie Bonaparte). On se souvient du mot de Paul Eluard à qui on proposait de présider un Ciné-Club : «Je veux bien mais… redonnerez-vous King Kong ?». Dans un tel cas, on se souvient aussi que l’un des directeurs de salle parisienne programmant le film pouvait déclarer avec fierté : «J’ai la queue la plus longue de Paris». Mais c’est que King Kong produisait un effet inévitable, attendu : «film-catastrophe» dans sa dernière partie, il touchait à l’inconscient freudien sur toute sa durée (on avait même établi que le film reproduisait dynamiquement une des topiques freudiennes : le royaume de Kong et sa jungle peuplée de monstres = le Ça; la ville civilisée de New York où il trouve la mort = le Surmoi, le couple d’amoureux séparés par le monstre représentant le Moi), et il surprenait le public à la manière dont il avait déjà été surpris par les chambres obscures des grands boulevards au XIXe siècle, sans oublier son ouverture qui faisait référence d’une manière crue, lucide et dramatique aux conséquences sociales de la crise de 1929. Même un critique tel que Georges Sadoul ne pouvait que tenir compte de l’importance du film, quitte à relativement mépriser le genre auquel il appartenait. En revanche, il faut aussi se souvenir de la notation sociologique de Robert Brasillach dans ses souvenirs de Notre avant-guerre (Paris, 1941) concernant la manière dont le public populaire des cinémas de la Bastille ou de Belleville ricanait en visionnant Le Cabinet du Dr. Caligari et Nosferatu, incapable de prendre au sérieux les sujets et leurs traitements, et du coup empêchant Brasillach d’en conserver un autre souvenir que ce «contre-souvenir» : celui d'une moquerie.
Le cinéma fantastique et la Seconde guerre mondiale de 1939-1945
Durant la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945, une série d’adaptations des aventures de Sherlock Holmes, le détective imaginé par Sir Arthur Conan Doyle, est réalisée par le cinéaste Roy William Neil avec l’acteur Basil Rathbone en vedette. Elle allie heureusement le cinéma policier et le cinéma fantastique. Certains épisodes portent des titres sans ambiguïté : La Femme aux araignées, La Griffe sanglante, La Maison de la peur. D’autres titres semblent plus anodins mais … La Femme en vert repose sur un impressionnant équilibre de la terreur. L’insolite ou l’angoissant parviennent même à s’immiscer dans des adaptations purement policières telles que Le Train de la mort ou Mission à Alger. Il est vrai que Roy William Neil est un cinéaste à qui on doit, outre l’incroyable péplum muet Les Vikings qu’il ne faut pas confondre avec le film homonyme de Richard Fleischer tourné en 1958, le mythique film d’horreur et d’épouvante Le Baron Grégor d’une part, Frankenstein rencontre le Loup-garou d’autre part.
Val Lewton produit, durant la même période, une série que l'histoire du cinéma désigne par son nom : l’épouvante plutôt que la peur, telle est sa devise sous-jacente, ainsi que l'a magnifiquement résumé Sabatier. Jacques Tourneur (La Féline [Cat People], Vaudou [I’ve Walked With a Zombie], L’Homme léopard), Mark Robson (L’Ile de la mort, Bedlam), Robert Wise (R. L. Stevenson's The Body Snatcher [Le Récupérateur de cadavres]) tournent des œuvres poétiques et inquiétantes, en totale liberté pour ce producteur cultivé. Albert Lewin en est un autre : ce cinéaste raffiné signe en 1946 la meilleure version jamais filmée du Portrait de Dorian Gray, d’après Oscar Wilde et filmera au Mexique un plastiquement magnifique et non moins fantastique The Living Idol.
Durant la même guerre et encore un peu après, le cinéma français donne quelques films insolites ou relevant de la poésie fantastique, voire du fantastique légendaire médiéval : Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné, L’Éternel retour de Jean Delannoy adapte la légende de Tristan et Isolde, La Belle et la Bête de Jean Cocteau transcende une source littéraire enfantine. La Main du Diable de Maurice Tourneur poursuit la veine médiévale, tandis que le méconnu mais très beau Sortilèges de Christian-Jacques est absolument original. René Clair a été surréaliste dans les années 1925-1930 : il tourne en 1942 aux États-Unis la savoureuse comédie fantastique Ma Femme est une sorcière puis en France en 1950 le faustien et ample La Beauté du Diable qui donne peut-être aux comédiens Gérard Philippe et Michel Simon les plus grands rôles de leurs filmographies respectives.
Les explosions atomiques d’Hiroshima et Nagasaki signent le fin de la Seconde Guerre mondiale et déterminent un courant de la science-fiction américaine et japonaise qui sera fasciné par les dangers de possibles mutations.
Période parlante 1950-2000 : développement américain, essor européen et asiatique
Le fantastique américain d’horreur et d’épouvante régresse jusqu’en 1960, en dépit des tentatives du brillant mais très commerçant William Castle, en dépit aussi de certaines tentatives indépendantes surréalistes et freudiennes (Dementia de John Parker, tourné dans les décors qui seront ceux de La Soif du mal [Touch of Evil] d’Orson Welles) mais la science-fiction américaine prend en revanche un envol décisif dans les années 1950 : certains thèmes classiques sont inlassablement repris mais traités d’une manière de plus en plus sophistiquée. William Cameron Menzies avait filmé une invasion de la terre par des Martiens d’une navrante pauvreté plastique. Jack Arnold reprend le sujet en l’intériorisant : cela donne Le Météore de la nuit [It Came From Outer Space]. Don Siegel pousse en 1955 un cran plus loin l’idée d’une invasion de l’intérieur, les extra-terrestres prenant, à nouveau, possession de l’esprit dans son génial L'Invasion des profanateurs de sépultures [Invasion of the Body Snatchers] qui sera «remaké» par Philip Kaufman en 1978 puis par Abel Ferrara en 1993 sous la forme d'intéressantes variations, plastiquement novatrices et convaincantes. La science-fiction et le fantastique se croisent régulièrement (Frankenstein incarnait déjà un tel croisement) dans certains films de Arnold : L’Homme qui rétrécit, L’Étrange créature du lac noir. Si le nuage qui provoque la mutation du héros du premier est naturel mais inconnu, son rétrécissement ressort du fantastique. S’il est d’origine extra-terrestre, il ressort de la science-fiction. Si la créature du lac noir est une créature primitive archaïque découverte, elle est un personnage fantastique, si elle est la victime d’une mutation (atomique, biologique) alors le film relève davantage de la science-fiction. Les deux films les plus significatifs de cette période sont peut-être le très rigoureux et impressionnant La Chose d’un autre monde (1950) de Christian Nyby, produit et supervisé par Howard Hawks (et dont Carpenter fera en 1982 un remake hanté par la peur du V.I.H., par la peur de sa peur aussi puisque le sang humain abrite désormais littéralement le monstre au lieu de simplement le nourrir comme en 1950, par un certain malheur de la conscience qui force chacun à se méfier de l'autre, minant le concept d'humanité) et le magnifique Planète interdite (1955) de Fred McLeod Wilcox dont l’ampleur plastique et l'intérêt pour l'inconscient seront retrouvés par le Total Recall de Paul Verhoeven en 1990. Il faudra attendre le tournant des années 1970 avec la série de La Planète des singes (une fable philosophique déguisée en SF dont les meilleurs volets sont ceux signés Ted Post et Jack Lee Thompson) puis le tournant des années 1980 (la série des Alien, le premier signé Ridley Scott étant le meilleur et étant d’ailleurs inspiré d’un film de Mario Bava, La Planète des vampires [Terrore nello spazio]) pour retrouver une telle homogénéité esthétique et thématique. Nous considérons, en revanche, la série de La Guerre des étoiles comme un cinéma de SF enfantin et foncièrement mineur, ayant d'ailleurs donné naissance à une série de jeux vidéo ayant rapporté une fortune au concepteur, mais ne méritant pas dans l’histoire du cinéma la place qu’il a méritée au box-office.
Le Japon connaît la même ambivalence concernant certains films fantastiques de Inoshiro Honda pouvant relever de la science-fiction : Godzilla [Gojira] (1954) est-il un lézard géant de l'ère secondaire modifié par une expérience atomique ayant mal tourné ? Rodan [Radon] (1956) est-il un ptérodactyle réveillé par une bombe atomique ou un ptérodactyle ayant en outre subi une mutation à cause des bombes atomiques ? L’Homme H (1958) est-il la victime d’un destin maléfique ou d’une technologie destructrice, les créature-champignons sur l'île de Matango sont-elles naturelles ou victimes d’une exposition expérimentale aux radiations ? C’est dans le livre de Jean-Pierre Bouyxou et Roland Lethem, La Science-fiction au cinéma (Éditions U.G.E., coll. 10/18, 1971) que les comparaisons et les analyses de cette ambivalence furent poussées le plus avant. Le réalisateur majeur du cinéma de science-fiction japonais demeure Honda, aidé par la poésie des effets spéciaux de Eiji Tsuburaya. La preuve qu'il est indépassable est que le Japon ne cesse de produire des remake et des suites de ses classiques : Motha 2 [Mosura] (1997) de Kunio Miyoshi est la descendante de la si belle et poétique Mothra [Mosura] (1961) de Honda.
Le Japon produit également d’authentiques films d’horreur et d’épouvante reposant soit sur une inspiration légendaire classique (Histoires des fantômes de Yotsuya, région de Tokaïdo, est un peu, mutatis mutandis, une sorte de Macbeth shakespearien en plus sanglant et démesuré encore : très nombreuses versions filmées, la meilleure étant celle en scope-couleurs de Nobuo Nakagawa) ou davantage exotique à nos yeux occidentaux (Histoire du chat-fantôme de Nakagawa, la série quasiment ethnologique et mythologique des Yokai). Le réalisateur majeur du cinéma fantastique est sans conteste Nobuo Nakagawa qui signe un incroyable Jigoku [L’Enfer] jamais égalé, bien que «remaké» périodiquement, par exemple par Teruo Ishii. Ancien assistant de Mikio Naruse, Teruo Ishii servira tous les genres mais il s'illustre particulièrement dans une baroque série «ero-guro» (signifiant à peu près érotique-grotesque» en maintenant au second terme sa connotation fantastique) à laquelle appartiennent ses deux œuvres les plus connues en France : Femmes criminelles et L'Enfer des tortures.
Le fantastique peut s’insinuer, au Japon, de bien des manières différentes dans le film expérimental d’avant-garde (La Femme des sables, Le Visage d'un autre, Traquenard de Hiroshi Teshigahara), dans le film de guerre et dans le drame psychologique historique (L’Ange rouge et Tatouage de Yasuzo Masumura, en 1966), dans la comédie policière érotique (Le Lézard noir de Kinji Fukasaku, en 1968), dans le film érotique (Une Femme à sacrifier de Masaru Konuma), dans le thriller ultra-violent (Le Cimetière de la morale [Jingi no hakaba] de Fukasaku, en 1975) : concernant ce dernier grand nom cité, précisons que son ultime Battle Royale (2000) s’avère un titre de politique-fiction pessimiste qui débouche sur le fantastique et la révolte, à la manière dont Les Damnés [The Damned / These are the damned] de Joseph Losey y débouchait. Les thèmes littéraires ou légendaires sont passibles de nouveaux traitements (Irezumi, Kakashi) et l'avant-garde esthétique peut aussi renouveler des thèmes anciens tels que ceux de la goule, de la succube, du fantôme, du savant fou : Angel Dust / Enjeru Dasuto (1994) de Sogo Ishii, Ringu / Ring (1998) de Hideo Nakata, Audition (1999) de Takashi Miike. Ju-On [The Grudge] (2002) de Takashi Shimizu. Chose incroyable, alors que les distributeurs américains investissaient dans les années 1960 de petites sommes pour américaniser les films de Honda en remontant le film et en rajoutant à l'occasion un acteur américain au casting (la version américaine de Godzilla, remontée avec Raymond Burr dans le rôle d'un journaliste commentant l'action en direct, premier et célèbre exemple, suivi du casting de Russ Tamblyn et quelques autres par Honda), ils n'hésitent plus a produire aujourd'hui des remake de ces films japonais, allant jusqu'à reprendre leur titre anglais d'exportation international pour baptiser leur propre ersatz. Occasion de noter que la crise d'inspiration hollywoodienne, en ce début de XXIe siècle, est patente : il y a presque autant de remake de films américains, européens et asiatiques qu'il y a de film américains originaux sur les écrans US.
La Chine sert en général un fantastique légendaire : son meilleur illustrateur fut le cinéaste Ho Meng Hua (1921-2009). Durant l’âge d'or du cinéma de Hong Kong 1970-1995 son potentiel plastique et dramatique est exploité d'une manière sophistiquée : non seulement les fameuses Histoires de fantômes chinois, mais encore le plastiquement si beau Green Snake de Tsui-Hark par exemple ou bien encore le serial fantastique du Heroic Trio, de Johnny To. Le fantastique plane à l'occasion sur le cinéma policier et le thriller, en raison de sa violence forcenée et du culte du secret débouchant sur la folie objective, la démence de situations qui s'apparentent presque à des épreuves rituelles : The Killer, To Be Number One, Hardboiled, Une balle dans la tête, The Mission, Police Tactical Unit, Infernal Affair flirtent discrètement avec le genre l'espace d'un plan, d'une séquence, ou par une influence souterraine du genre sur la structure du scénario.
Le cinéma fantastique des autres pays d’Asie a été longtemps mal distribué en Europe : il nous est beaucoup plus accessible depuis 1978 (apparition de la VHS magnétique) puis du DVD numérique (apparition vers 1997) e
18/07/2012 | Lien permanent
Chien blanc ou du chien blanc comme animal aboyant et comme constellation philosophique, par Francis Moury

À lire : Le Rat blanc de Christopher Priest.
«Ne pouvez-vous haïr sans que la haine éclate ?»
Pierre Corneille, Cinna (1640) acte 1, scène 2, v. 86 (Librairie Hachette, Classiques illustrés Vaubourdoulle, 1935), p. 16.
«L’organe cérébral du langage ne peut donc jamais employer que deux systèmes de signes extérieurs, dont l’un s’adresse à la vue, et l’autre à l’ouïe. Chacun d’eux a des avantages qui lui sont propres, et en vertu desquels tous deux sont usités concurremment chez les animaux supérieurs. Leur application caractéristique aux plus puissantes émotions suscite partout une certaine ébauche spontanée de l’essor esthétique, en faisant surgir les deux arts fondamentaux, la mimique et la musique, dont la source distincte n’empêche pas la combinaison naturelle. De ces deux souches spontanées résultent ensuite tous nos signes artificiels, à mesure que la communication affective s’affaiblit par l’extension des rapports sociaux, pour laisser prévaloir de plus en plus la transmission intellectuelle […]. Cette altération croissante conduit enfin, chez les populations très civilisées, à renverser totalement l’ordre naturel, en persuadant, au contraire, que l’art dérive du langage. Mais tout le règne animal témoigne aussitôt contre cette aberration théorique, en montrant les gestes et les cris employés bien davantage à communiquer les affections qu’à transmettre les notions, ou même à concerter les projets.»
Auguste Comte, Système de politique positive (1851-1854), tome II, 226-227 (édition «identique à la première» (sa ponctuation est respectée), Librairie positiviste Georges Crès & Cie, 1912, cité in Auguste Comte, Sociologie, § IV, textes choisis et présentés par Jean Laubier (PUF, coll. Les Grands textes – Bibliothèque classique de philosophie, 1957), p. 37.
Avertissement
Les deux sous-titres des deux parties de mon article, la première relevant de l’histoire littéraire et de l’histoire du cinéma, la seconde relevant de l’histoire de la philosophie et de la pensée politique, sont évidemment un hommage au titre de l’article classique d’Alexandre Koyré, Le chien, constellation céleste et le chien, animal aboyant (à propos de Spinoza, Éthique I, 17, scolie, paru initialement dans la Revue de Métaphysique et de Morale de janvier-mars 1950, repris ensuite dans ses Études d’histoire de la pensée philosophique) (1). Tel lecteur jugera peut-être, s’il privilégie l’histoire du cinéma, que la seconde partie de cet article eût gagné à être publiée à part. Tel autre, s’il privilégie l’histoire des idées, jugera au contraire que c’est la première partie qu’il eût fallu réduire à la taille d’un argument. Je vise ici, comme je l’ai toujours fait, un lecteur sachant unifier dialectiquement et transdiciplinairement les deux sections, aimant et voulant reproduire le mouvement méditatif qui m’a fait passer d’un domaine à l’autre, mouvement que je crois nécessaire à leur pleine et respective compréhension.
Durant un séjour parisien début novembre 2012 du côté de la Porte de Saint-Cloud, piochant dans la bibliothèque de notre hôtesse, un titre Gallimard NRF au dos parfaitement conservé parmi tout un rayonnage d’autres volumes de la NRF attira vivement mon attention : Chien blanc (1970) de Romain Gary.
J’avais naturellement vu en exclusivité, à sa sortie française dans une salle du Quartier latin, son adaptation cinématographique, White Dog [Dressé pour tuer] (2) (États-Unis, 1982) de Samuel Fuller, au scénario adapté de Gary par Fuller et Curtis Hanson, film que j’avais revu à la télévision une ou deux fois par la suite mais j’avais complètement oublié le nom de Gary à son générique et son origine littéraire. Sur le coup d’ailleurs, devant ce rayon et ce volume bien conservé de l’édition originale française, un doute me saisissait : s’agissait-il vraiment, en dépit de l’homonymie, du livre adapté par Fuller ?
Je l’ouvrais sans plus attendre afin d’en avoir le cœur net et je ne l’ai pas lâché que je ne l’aie achevé, le soir même. C’était bien le récit adapté par Fuller mais si différent du film qu’après l’avoir enfin intégralement découvert, je songeai immédiatement à écrire une étude comparée entre livre et film, que voici.
Je préviens le lecteur que j’y ai trouvé, je crois, deux ou trois choses de plus que la traditionnelle impossibilité d’adapter une œuvre littéraire au cinéma sans la trahir ou, en restituât-on correctement l’essence, sans néanmoins la modifier substantiellement. Impossibilité qui me frappe à chaque fois que j’ai l’occasion d’effectuer un tel exercice (voir mes textes sur Nosferatu le vampire de Murnau, Dracula de Tod Browning, et Le Cauchemar de Dracula de Fisher adaptés tous deux du roman de Bram Stoker, sur Le Coup de l’escalier de Robert Wise adapté d’une série noire parue en traduction chez Gallimard, sur Psychose d’Hitchcock adapté par Joseph Stefano du roman de Robert Bloch, sur Jaws de Spielberg d’après Peter Benchley, par exemple) qui n’est plus toujours possible car il n’est pas évident de trouver les livres physiques dont sont adaptés certains films, parfois non des moindres : chez quel éditeur par exemple, depuis l’édition belge Gérard en collection Bibliothèque Marabout de 1960, peut-on aujourd’hui trouver la traduction française d’un livre aussi important que le Psychose de Robert Bloch ? Bloch qui fut d’abord le jeune correspondant – parmi d’autres grands noms de la littérature fantastique américaine – de Howard Philips Lovecraft ?
Dans le cas de Romain Gary la difficulté est parfois inverse : il est assez facile pour le lecteur français de trouver Les Racines du ciel (1956) de Gary en librairie physique ou virtuelle (ce Prix Goncourt avait été repris dans la si agréable collection du Livre de Poche à laquelle le temps confère une réelle patine et un charme allant de pair) mais il l’est peut-être moins de visionner dans une édition vidéo correcte le beau film qu’en a tiré John Huston (1958).
I Le chien blanc comme animal aboyant – Histoire et esthétique du cinéma
Revenons à Chien blanc : alors que le film de Fuller se présente comme une fiction linéaire, le livre de Gary se pose dès la première page comme un récit authentique, strictement conforme aux événements. Faut-il croire Gary ? Il n’y a pas de raison de ne pas le croire car son récit est d’une grande précision, fourmillant de détails, et sa narration strictement autobiographique est d’une sincérité à laquelle on reconnaît rétrospectivement l’auteur de Au-delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable, premier texte de Gary que nous ayons lu dans notre jeunesse, par hasard. Ce récit est très différent du film de Fuller en dépit d’un commun pessimisme, d’une commune lucidité aussi. L’argument en a été conservé mais totalement modifié par Fuller : alors que le «chien blanc» dressé par un policier sudiste de l’Alabama pour tuer les Noirs est recueilli par une jeune actrice de cinéma chez Fuller, il fut recueilli réellement par Gary lui-même. Le fait que ce soit une actrice qui recueille le chien loup – sa couleur est blanche mais son appellation ne la désigne absolument pas : elle correspond à sa fonction reprogrammée par son ancien maître – chez Fuller est sans doute un clin d’œil biographique et bibliographique à Romain Gary qui vivait en 1968 à Hollywood avec l’actrice Jean Seberg que les connaisseurs de la filmographie de Jean-Luc Godard et d’Otto Preminger visualiseront immédiatement. La progression des premières pages du récit correspond (violence graphique et attaques mortelles en moins, mais de justesse) à celle du premier tiers ou de la première moitié du film de Fuller. La disjonction temporelle instituée par le scénario est patente, démesurée si on la rapporte à la narration du livre original. Gary, en quelques pages amères et sèches, tempérées par une ironie mordante et une indignation qui ne tournent jamais au pathos, découvrait que son chien blanc (rencontré d’une tout autre manière, bien plus naturelle, que dans le début du film de Fuller) risquait de tuer, était certainement programmé pour tuer et pour tuer uniquement des Noirs. Fuller et Curtis Hanson ont simplifié la donne, tout en la rendant baroque : le chien tue à plusieurs reprises avant que sa nouvelle propriétaire ne commence à comprendre ce qui se passe, commettant notamment un ahurissant assaut contre un employé municipal travaillant dans (ou contre un clochard réfugié dans… ? j’ai un doute pendant que j’écris, que je trancherai tôt ou tard par une révision vidéo) une église.
Cet authentique moment de folie avait été considéré comme le point d’orgue visuel du film par Luc Moullet lorsqu’il avait écrit son beau texte sur le cinéma de Fuller comme cinéma du conflit de la lucidité et de la démence, à l’occasion de la rétrospective Fuller à la Cinémathèque française de Paris du 12 septembre au 14 octobre 2001. Dans le film de Fuller, le chien tue effectivement mais seul le spectateur le sait durant une bonne durée alors que si Romain Gary a compris presque tout de suite que son chien pouvait tuer, ce dernier ne passe pas à l’acte, sauf à la fin du récit et pas du tout contre une de ses victimes désignées initiales. Le suspense n’intéresse pas Gary : il raconte une histoire réelle survenue durant l’assassinat de Martin Luther King. La réalité lui amène par hasard un symbole vivant et, à partir de ce symbole, il repense d’une manière nouvelle la réalité. Ce symbole vivant qu’est le chien, on y revient régulièrement au cours du livre mais il s’estompe durant presque toute sa partie centrale pour ne redevenir actif et essentiel qu’à sa fin. C’est l’époque où Gary déjeune avec le cinéaste démocrate John Frankenheimer (qui avait bénéficié du concours favorable de la Maison Blanche lorsqu’il avait tourné son film de politique-fiction Sept jours en mai) et avec le politique Robert Francis Kennedy (ils évoquent ensemble la possibilité de son propre assassinat peu de temps avant qu’il ait réellement lieu, se référant à celui de son frère John lui-même assassiné en 1963 : analyse prophétique) et où Jean Seberg se rend aux réunions de soutien aux Black Panthers, réunions présidées par Marlon Brando et critiquées par Gary d’une manière implacable, sans parler de la saynète comique avec un acteur ivre (hélas non-identifié) voulant l’approbation de Gary pour faire l’amour avec sa femme sous prétexte que la «Method» le nécessite puisqu’ils doivent bientôt tourner ensemble une scène d’amour : acteur chassé à coup de pied.
Le Chien blanc de Gary dévie rapidement, son suspense se dilue, à mesure que son regard s’étend à la situation générale outre-Atlantique : tandis que le chien entre en «rééducation» chez un dresseur noir (beaucoup moins sympathique que le dresseur joué par Paul Winfield dans le film de Fuller, dresseur qui devient vite le héros authentique du film), Gary raconte son retour en France afin d’assister aux événements de mai 1968 qu’il juge dérisoires. Il participe d’ailleurs à la manifestation gaulliste contre mais sa haine du nombre l’en dégoûte rapidement : peut-être ce trait aristocratique authentique le sépare-t-il en profondeur de son ami André Malraux ? Le lien entre la situation américaine et la situation française s’incarne alors d’une manière nouvelle : sous la forme d’un déserteur noir réfugié en France pour échapper à la guerre du Vietnam tandis que son frère y devient volontairement officier. Leur père (que Gary a connu à Pigalle) méprise son fils déserteur, admire son fils officier car il estime que seul l’entraînement militaire permettra d’organiser la révolution noire, une fois la guerre achevée et les soldats noirs rentrés – ce qui n’est d’ailleurs nullement l’idée du fils officier, au contraire fier de s’intégrer par les armes à la nation américaine, ainsi qu’il l’écrit textuellement dans un fragment de correspondance. Le climat du Dead Presidents [Génération sacrifiée] (États-Unis, 1995) des frères Hughes, très exactement celui de la dernière partie du film, avec son personnage de la sœur devenue une «Black Panther» (sinon une féline au sens tourneurien), se retrouve rétrospectivement tel qu’en lui-même intact, ahurissant de violence, à peu près au milieu du livre de Gary qui décrit froidement les assassinats politiques internes (ou commandités) aux Black Panthers de l’époque.
Le White Dog de Fuller ne dévie, pour sa part, pas du tout, car il ne s’intéresse pas à la peinture sociale et politique des années 1968-1970 : il situe l’action comme contemporaine (on n’est plus en 1970 mais en 1980) et cette action linéaire monte en flèche jusqu’à deux extrémités. D’abord la découverte du personnage du raciste qui a dressé le chien, séquence brève mais démentielle (à l’apostrophe de l’actrice hurlant «Salaud, c’est vous qui en avez fait un «chien blanc» !», l’homme au physique de père tranquille réplique, lueur brusquement allumée dans le regard, avec une fierté criminelle revendiquée : «Yes… and the best of all !») alors que Gary l’avait traité réellement (face au shérif de l’Alabama, venu en famille lui réclamer son animal égaré) sur un mode ironique. Ensuite, l’échec de la rééducation du chien : chez Fuller in extremis, par une chute baroque, somptueuse, encore une fois folle; chez Gary par une chute réaliste par elle-même inquiétante et fermant une sorte de boucle. Chez Fuller, le dresseur noir ne peut rien contre l’animalité, son altérité devenue totale par la faute des hommes alors que chez Gary c’est le dresseur noir lui-même qui se révèle être aussi un raciste puisqu’il contre-dresse le chien afin qu’il attaque non plus les Noirs mais les Blancs ! L’ambivalence du chien, tantôt compagnon aimant et sympathique du maître ou de la maîtresse que le destin lui a fait rencontrer, tantôt criminel dangereux promis à l’abattage, est identique dans le livre et dans le film.
Un point commun fondamental est traité avec un soin particulier tant par Gary que par Fuller : la transcription aussi soigneuse que possible – littérairement par description chez Gary, cinématographiquement par un travail soigné de la direction animale et du montage de la bande-son chez Fuller – du langage (imparfait relativement à celui des hommes mais relativement compréhensible par eux : les animaux ont bien un langage… simplement moins clair pour nous que le nôtre, l’inverse étant non moins probable de leur point de vue) du chien blanc. Ses variations, en fonction des circonstances, traduisent d’une manière spectaculaire, tout au long du livre comme du film, le conflit interne suscité en lui entre instinct et individualité, dressage puis contre-dressage. La grande réussite du livre comme du film nous semble être dans cette attention technique scrupuleuse à l’altérité du langage animal, altérité si fascinante pour les hommes en raison de sa récurrente proximité humaine. Gary a toujours témoigné de sa sensibilité envers le monde animal : n’avait-il pas écrit, en 1956, un des livres précurseurs du mouvement écologique, à savoir Les Racines du ciel où quelques déracinés terrestres (mais ensemble enracinés dans un idéal commun) combattaient coûte que coûte pour sauver des braconniers les grands éléphants d’Afrique ?
Faut-il préférer le témoignage autobiographique pris sur le vif de Gary mais constamment refroidi par une analyse intellectuelle des faits relatés ou bien le cinéma visionnaire de Fuller atteignant régulièrement le fantastique à partir du réalisme brutal du film noir, genre dont Fuller fut aussi un illustrateur important : qu’on songe à son Underworld USA [Les Bas-fonds de New York] (États-Unis, 1961) ou à son Shock Corridor (États-Unis, 1963) ? Comment apprécier cette étrange distorsion entre un livre ample, aux multiples facettes, et un film de série B unilatéral bien que saisi régulièrement par le délire, délire totalement absent du livre ?
En fait l’histoire du cinéma permet, me semble-t-il, de trancher le dilemme grâce à deux autres films : dans Chien blanc, Romain Gary écrit son admiration pour le Naked Prey [La Proie nue] (États-Unis, 1966) de Cornel Wilde dans un paragraphe allusif et un peu énigmatique. Précisant qu’on a tenu La Proie nue pour raciste au moment de sa sortie alors que selon Gary il en est au contraire une admirable dénonciation; presque dix ans plus tard, sur le générique de The Klansman [L’Homme du clan] (États-Unis, 1974) de Terence Young, on peut lire que le scénario est de Fuller. Et très curieusement, à présent que nous avons lu Chien blanc, il nous semble que le ton de Gary est exactement le ton du scénario de Fuller dans L’Homme du clan tandis que La Proie nue admirée par Gary est un film totalement fullérien… qu’on se souvienne d’ailleurs du Run of the Arrow [Le Jugement des flèches] qui est le meilleur western réalisé par Fuller si on souhaite s’en convaincre. Fuller et Gary se sont très curieusement ratés lorsque l’un a adapté l’autre mais ils se sont finalement retrouvés par ricochet grâce à ce curieux croisement historique entre un jugement critique positif de Gary sur un film fullérien et à l’écriture d’un scénario par Fuller à la manière de Gary.
II Le chien blanc comme constellation philosophique et politique
«Et puis sur le fond et ces thématiques étant rapportées à notre époque», me demanderez-vous ? Je lis avec intérêt les différentes expressions contemporaines (leurs critiques négatives par Juan Asensio, positives par


























































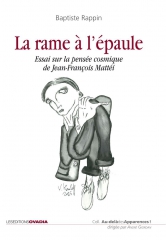 À propos de Baptiste Rappin, La Rame à l'épaule – Essai sur la pensée cosmique de Jean-François Mattéi (
À propos de Baptiste Rappin, La Rame à l'épaule – Essai sur la pensée cosmique de Jean-François Mattéi (



 À propos de Nicolas Stanzick,
À propos de Nicolas Stanzick, 
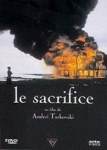

 À propos de Alain Minc, Une histoire politique des intellectuels, avec bibliographie et chronologie de 1715 à 2007 (Éditions Bernard Grasset & Fasquelle, 2010).
À propos de Alain Minc, Une histoire politique des intellectuels, avec bibliographie et chronologie de 1715 à 2007 (Éditions Bernard Grasset & Fasquelle, 2010).
 À propos de Joseph Bidez et Franz Cumont, Les Mages hellénisés - Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la tradition grecque, un fort volume in-8° relié, illustré H.T., de 297+412 pages (710 pages environ) avec notes, addenda, deux tables des matières, trois index des sources bibliographiques, des noms propres, des mots grecs et latins, Éditions Les Belles lettres, collection Études anciennes / série grecque : volume n°134, 1938, nouveau tirage 2007.«[...] Quel sens faut-il donc attacher à l'idéal ascétique chez un philosophe ? Voici ma réponse – on l'aura d'ailleurs devinée depuis longtemps : à son aspect le philosophe sourit, comme à un optimum des conditions nécessaires à la spiritualisation la plus haute et la plus hardie, – par là il ne nie pas «l'existence», il affirme au contraire son existence à lui, et seulement son existence, au point qu'il n'est peut-être pas éloigné de ce voeu criminel : pereat Mundus, fiat philosophia, fiat philosophus fiam !...».Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, troisième dissertation, § 7, traduit de l'allemand (première édition : 1887) par Henri Albert (Éditions Gallimard-NRF, retirage in collection Idées, section Philosophie, 1966), p. 160.«[...] le papier est ancien et décoloré, tombant en morceaux, l'écriture passée, presque indéchiffrable, mais significative, familière dans sa forme et son sens, dans le nom et la présence des forces instables et subtiles : on les mélange dans les proportions requises, mais rien ne se produit; on relit la formule, lentement, attentivement, intensément, pour s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on ne s'est pas trompé dans ses calculs : on mélange de nouveau, et, de nouveau, rien ne se produit : rien que les mots, les symboles, les formes elles-mêmes, vagues, inscrutables et sereines, sur cette toile de fond déclamatoire d'une atroce et sanglante mésaventure humaine».William Faulkner, Absalon ! Absalon ! (avec chronologie, généalogie, plan dessiné et annoté par Faulkner, traduit de l'américain par R.-N. Raimbault et Ch. P. Vorce, Éditions Gallimard-NRF, collection Du monde entier, 1953), p. 88.Ainsi, du moins, le faisait-on parler, et ainsi ne parlait pas toujours le Zarathoustra de Nietzsche mais il faut pourtant bien, après lecture de ce monument de la philologie que sont Les Mages hellénisés, admirer l'ampleur et la profondeur des connaissances philologiques de Nietzsche qui furent bien à l'origine du choix qu'il fit de ce fondateur mythique d'une religion afin d'exprimer sa propre pensée sous formes d'aphorismes poétiques, des aphorismes qu'il fallait interpréter, comme il fallait interpréter les oracles chaldaïques. Ce furent, comme on le sait, les Grecs qui interprétèrent ces mystérieuses énigmes, les Grecs avides de religions inconnues ! Ces Grecs, de Pythagore et des présocratiques jusqu'aux commentateurs alexandrins néo-platoniciens ou aristotéliciens qui collationnaient et annotaient les manuscrits de la bibliothèque d'Alexandrie, influencés par Zoroastre (ou ses autres noms dont les variantes sont d'abord iraniennes, puis babyloniennes, syriennes, judaïques, grecques et latines) que Nietzsche avait si admirablement étudiés, et sur lesquels il avait si admirablement médité, d'abord dans sa Naissance de la tragédie, ensuite dans ce qui demeure un de ses livres majeurs (et pourtant pratiquement jamais étudié à l'université d'une manière réellement suivie ni sérieuse) : nous voulons bien sûr parler de La Naissance de la philosophie antique à l'époque de la tragédie grecque. Ces Grecs qui discutaient de l'origine iranienne du mythe d'Er le Pamphylien à la fin de la République de Platon, et qui discutaient aussi de problèmes zoroastriques (tantôt les rattachant tant bien que mal à leur source, tantôt se les appropriant en les attribuant, légendairement, à une autre source grecque) métaphysiques : le Temps avait-il précédé le couple primordial de la Lumière et des Ténèbres, assimilés ou distingués du couple Bien et Mal, Dieu positif et Dieu négatif ? Quelle était la durée du cycle, en millénaires formant des sous-cycles à part entière, à partir de la création du Monde jusqu'à son terme apocalyptique ? Quelles relation le monde sublunaire entretenait-il avec les sept planètes qui l'entourent ? Les Dieux pratiquaient-ils l'inceste, reproduits dans certaines dynasties proche-orientales ? Celui qui voulait être sauvé devait-il consommer de la viande ? Plus tard, après qu'une sorte de «diaspora magique» iranienne ait fait concurrence en discussions sophistiquées à la diaspora judaïque dans le monde méditerranéen et oriental, Zoroastre fut commenté par les Pères de l'Église, puis les théologiens médiévaux. On se souvient que saint Augustin avait été manichéen (source gnostique voisine du zoroastrisme en dépit du fait qu'il ne faille pas confondre les deux courants) avant de se convertir au catholicisme et qu'il écrivit sur le manichéisme. Les relations tissées par la mémoire individuelle et collective, par l'érudition, les mythes, les légendes, la littérature et l'histoire aboutirent à un corpus (800 manuscrits environ dans la Bibliothèque d'Alexandrie) et à des commentaires considérables de ce corpus. Avec cette conséquence ahurissante, lorsqu'on y réfléchit, que ce sont nos Grecs qui nous ont transmis, en raison des heurs et malheurs linguistiques de l'antiquité orientale, la majorité de nos sources sur le courant original comme sur les courants dérivés. Zoroastre : contempla-t-il un feu sacré surnaturel au sommet d'une montagne ou fut-il au contraire brûlé par ce feu ? Fut-il ennemi de la magie ou au contraire le premier des magiciens et des alchimistes ? Fondateur d'une religion révélée ou sage antique ? La plupart des grandes questions dérivent de ce grand passage, de cette transmission par la Grèce, dépositaire puis subtile modificatrice de ces mythes et rites orientaux. Un Orient où on ne devait ni enterrer ni brûler les morts mais les laisser être dévorés par les oiseaux, en arrière-plan du temple grec classique, aux colonnes doriques, ioniennes, corinthiennes.En 1938, au carrefour de l'histoire des religions, de l'histoire de la philosophie, et de l'histoire littéraire, les deux grands philologues, épigraphes, archéologues belges francophones Joseph Bidez (1867-1945) et Franz Cumont (1868-1947) (1) publièrent Les Mages hellénisés, résultat d'une alliance à laquelle leurs travaux respectifs les prédisposaient : Bidez qui enseigna assez longtemps à l'université de Gand avant que la néerlandisation ne le contraignit à interrompre son enseignement francophone (oui à Gand, la ville natale de Jean Ray... aussi fréquentée par Bidez et Cumont !) était un spécialiste de l'Empereur Julien mais aussi l'auteur de recherches sur la biographie d'Empédocle et sur la Vie de Porphyre, le philosophe néo-platonicien. Cumont de son côté avait suivi très jeune en Allemagne les cours de certains des plus grands savants allemands (Usener, Th. Mommsen, Wilamovitz-Moellendorff, Erwin Rohde) et avait publié, après des Textes et documents figurés relatifs aux mystères de Mithra, son classique Les Religions orientales dans le paganisme romain (c'est la quatrième édition de 1929 parue chez Geuthner qui est systématiquement citée dans Les Mages hellénisés) avant de se spécialiser dans les problèmes de la mort et de la survie de l'âme dans l'antiquité : Lux perpetua, édité posthume en 1949 est toujours l'un des livres majeurs à consulter concernant le milieu païen dans lequel évoluaient les premiers disciples du Christ (2).Religion antique, alchimie, magie, apocalypses proches-orientales pré ou para-bibliques, philosophies présocratiques, platoniciennes, aristotéliciennes et néo-platoniciennes sont les fils entrecroisés tissant, à travers des témoignages iraniens, babyloniens, syriens, judaïques, grecs, romains, médiévaux, les étranges phénomènes que constituèrent, en Iran d'abord puis dans les pays voisins, ensuite en Grèce, les figures apocryphes de ces mages, aux origines de la magie noire comme de la magie blanche, mais aussi aux origines de certains éléments philosophiques pythagoriciens, et aux origines enfin du dualisme manichéen (peut-être le courant religieux le plus persécuté dans l'histoire des religions, en dépit de son immense influence) comme mazdéen, de cet univers religieux du dualisme qu'Henri-Charles Puech et Simone Pétrement (3) devaient, dix ans plus tard, à nouveau illustrer et enrichir de leurs propres recherches.Une ultime remarque matérielle : ce nouveau tirage des Mages hellénisés comporte deux tables des matières distinctes, une située pp. 292-297 concernant les études, une seconde située pp. 411-412 concernant les textes. Cette difficulté de présentation (qui n'est pas éclaircie par un avertissement de l'éditeur et dont on s'est rendu compte assez tardivement durant notre lecture : à l'origine, le livre était paru en deux tomes, cf. note de l'index général en haut de la p.253 de la première partie) nous fournit l'occasion de proposer, infra, un outil original permettant un accès plus aisé à ce livre. Il s'agit d'une table générale des matières rédigée par nos soins et réunissant les deux tables séparées, donnant au lecteur une représentation détaillée de la richesse du livre.Contribution à une table générale des matières de Les Mages hellénisés regroupant les deux tables du volume : la table intermédiaire située pp. 292-297 et la table finale située pp. 411-412. Les numéros entre parenthèses renvoient aux premières pages de chaque chapitre.1) Première partie : études, addenda, 1 index, 1 tableIntroduction.Étude sur Zoroastre.I) Vie de Zoroastre (5); II) Doctrines de Zoroastre (56), III) Oeuvres de Zoroastre : témoignages anciens (85), les livres sacrés (89), écrits philosophiques (102), les quatre livres sur la nature (107), le lapidaire (128), livres d'astrologie (131), livres de magie (143), l'alchimie (151), apocryphes gnostiques (153), oracles attribués à Zoroastre par Gémiste Pléthon (158)Étude sur OstanèsI) Vie d'Ostanès (167), II) Œuvres d'Ostanès : théologie, angélologie, démonologie (175), la nécromancie (180), les vertus des herbes et des pierres (188), l'alchimie (198), appendice : lettres d'Ostanès à Pétasius, de Démocrite à Leucippe, textes syriaques et arabes (208).Étude sur HystaspeI) Vie d'Hystaspe (215), II) Œuvres d'Hystaspe : l'apocalypse (217), le livre de la sagesse (222), écrits astrologiques (223)Addenda et index général de la première partie (253-292)Table de la première partie (293-297)2) Seconde partie : textes, 3 index, 1 tableLa pagination repart de zéro !Textes sur ZoroastreTémoignages biographiques (7), doctrines et appendice : textes syriaques, livres sacrés (63), les quatre livres sur la nature (158), extraits des Geoponica (173), le lapidaire (197), Astéroscopiques et apotélesmatiques (207), appendices (233), écrits magiques (242), apocryphes gnostiques (249), Zoroastre, prétendu auteur des Oracles chaldaïques (251)Textes sur OstanèsTémoignages biographiques (267), fragments religieux et magiques (271), Alchimie (309)Textes sur HystaspeTémoignages biographiques (359), Fragments de l'Apocalypse (361), le livre de la sagesse (376), écrits astrologiques (376).Index de la seconde partieI) index des sources bibliographiques (379), II) des noms propres (385), III) des mots grecs et latins (397). Ces trois index concernent uniquement la seconde partie, à laquelle ils se rattachent en réalité directement bien que leur présentation, en fin de volume, puisse naturellement faire croire qu'ils couvrent l'ensemble du volume. Les numéros des pages renvoyant donc uniquement à la seconde partie (textes), nullement à la première (études).Table de la seconde partieCette table des pp. 411-412 ne couvre que la pagination de la seconde partie et de ses trois index.La pagination totale du livre est donc approximativement de 710 pages.Notes(1)«[...] L'un des plus chers amis belges et ancien collègue de Cumont à l'ancienne Université de Gand était Joseph Bidez. Ils publièrent en collaboration étroite l'admirable édition des Lettres de l'Empereur Julien dans la collection Budé en 1922 et un recueil de documents sur l'influence de Zoroastre en Grèce : Les Mages hellénisés, en 1938. Mais les occupations relatives aux conceptions antiques de la survie dans l'au-delà furent la note dominante des dernières années de Cumont. Ce fut l'objet de multiples études encore sur l'eschatologie du «mysticisme astral» et de deux volumes imposants rédigés dans l'atmosphère lourde et périlleuse de la guerre : Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, 1942, et Lux Perpetua, resté manuscrit et publié en œuvre posthume par les soins de la marquise de Maillé et de Louis Canet, ses amis parisiens, en 1949, mais dont le thème avait été développé en de brillantes leçons au Collège de France en 1943. On y trouve les fruits d'une longue carrière scientifique, consacrée aux angoissants problèmes de la mort et de la survie, tels que les ont considérés les philosophes, les mystiques, les artistes, les écrivains et le simple peuple de l'Antiquité, d'après les témoignages écrits ou figurés, qui en sont parvenus jusqu'à nous [...]», F. De Ruyt, Franz Valéry Marie Cumont in Biographie Nationale [belge] (1976, t. 39), pp. 211-222, recopié in Academia Belgica
À propos de Joseph Bidez et Franz Cumont, Les Mages hellénisés - Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la tradition grecque, un fort volume in-8° relié, illustré H.T., de 297+412 pages (710 pages environ) avec notes, addenda, deux tables des matières, trois index des sources bibliographiques, des noms propres, des mots grecs et latins, Éditions Les Belles lettres, collection Études anciennes / série grecque : volume n°134, 1938, nouveau tirage 2007.«[...] Quel sens faut-il donc attacher à l'idéal ascétique chez un philosophe ? Voici ma réponse – on l'aura d'ailleurs devinée depuis longtemps : à son aspect le philosophe sourit, comme à un optimum des conditions nécessaires à la spiritualisation la plus haute et la plus hardie, – par là il ne nie pas «l'existence», il affirme au contraire son existence à lui, et seulement son existence, au point qu'il n'est peut-être pas éloigné de ce voeu criminel : pereat Mundus, fiat philosophia, fiat philosophus fiam !...».Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, troisième dissertation, § 7, traduit de l'allemand (première édition : 1887) par Henri Albert (Éditions Gallimard-NRF, retirage in collection Idées, section Philosophie, 1966), p. 160.«[...] le papier est ancien et décoloré, tombant en morceaux, l'écriture passée, presque indéchiffrable, mais significative, familière dans sa forme et son sens, dans le nom et la présence des forces instables et subtiles : on les mélange dans les proportions requises, mais rien ne se produit; on relit la formule, lentement, attentivement, intensément, pour s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on ne s'est pas trompé dans ses calculs : on mélange de nouveau, et, de nouveau, rien ne se produit : rien que les mots, les symboles, les formes elles-mêmes, vagues, inscrutables et sereines, sur cette toile de fond déclamatoire d'une atroce et sanglante mésaventure humaine».William Faulkner, Absalon ! Absalon ! (avec chronologie, généalogie, plan dessiné et annoté par Faulkner, traduit de l'américain par R.-N. Raimbault et Ch. P. Vorce, Éditions Gallimard-NRF, collection Du monde entier, 1953), p. 88.Ainsi, du moins, le faisait-on parler, et ainsi ne parlait pas toujours le Zarathoustra de Nietzsche mais il faut pourtant bien, après lecture de ce monument de la philologie que sont Les Mages hellénisés, admirer l'ampleur et la profondeur des connaissances philologiques de Nietzsche qui furent bien à l'origine du choix qu'il fit de ce fondateur mythique d'une religion afin d'exprimer sa propre pensée sous formes d'aphorismes poétiques, des aphorismes qu'il fallait interpréter, comme il fallait interpréter les oracles chaldaïques. Ce furent, comme on le sait, les Grecs qui interprétèrent ces mystérieuses énigmes, les Grecs avides de religions inconnues ! Ces Grecs, de Pythagore et des présocratiques jusqu'aux commentateurs alexandrins néo-platoniciens ou aristotéliciens qui collationnaient et annotaient les manuscrits de la bibliothèque d'Alexandrie, influencés par Zoroastre (ou ses autres noms dont les variantes sont d'abord iraniennes, puis babyloniennes, syriennes, judaïques, grecques et latines) que Nietzsche avait si admirablement étudiés, et sur lesquels il avait si admirablement médité, d'abord dans sa Naissance de la tragédie, ensuite dans ce qui demeure un de ses livres majeurs (et pourtant pratiquement jamais étudié à l'université d'une manière réellement suivie ni sérieuse) : nous voulons bien sûr parler de La Naissance de la philosophie antique à l'époque de la tragédie grecque. Ces Grecs qui discutaient de l'origine iranienne du mythe d'Er le Pamphylien à la fin de la République de Platon, et qui discutaient aussi de problèmes zoroastriques (tantôt les rattachant tant bien que mal à leur source, tantôt se les appropriant en les attribuant, légendairement, à une autre source grecque) métaphysiques : le Temps avait-il précédé le couple primordial de la Lumière et des Ténèbres, assimilés ou distingués du couple Bien et Mal, Dieu positif et Dieu négatif ? Quelle était la durée du cycle, en millénaires formant des sous-cycles à part entière, à partir de la création du Monde jusqu'à son terme apocalyptique ? Quelles relation le monde sublunaire entretenait-il avec les sept planètes qui l'entourent ? Les Dieux pratiquaient-ils l'inceste, reproduits dans certaines dynasties proche-orientales ? Celui qui voulait être sauvé devait-il consommer de la viande ? Plus tard, après qu'une sorte de «diaspora magique» iranienne ait fait concurrence en discussions sophistiquées à la diaspora judaïque dans le monde méditerranéen et oriental, Zoroastre fut commenté par les Pères de l'Église, puis les théologiens médiévaux. On se souvient que saint Augustin avait été manichéen (source gnostique voisine du zoroastrisme en dépit du fait qu'il ne faille pas confondre les deux courants) avant de se convertir au catholicisme et qu'il écrivit sur le manichéisme. Les relations tissées par la mémoire individuelle et collective, par l'érudition, les mythes, les légendes, la littérature et l'histoire aboutirent à un corpus (800 manuscrits environ dans la Bibliothèque d'Alexandrie) et à des commentaires considérables de ce corpus. Avec cette conséquence ahurissante, lorsqu'on y réfléchit, que ce sont nos Grecs qui nous ont transmis, en raison des heurs et malheurs linguistiques de l'antiquité orientale, la majorité de nos sources sur le courant original comme sur les courants dérivés. Zoroastre : contempla-t-il un feu sacré surnaturel au sommet d'une montagne ou fut-il au contraire brûlé par ce feu ? Fut-il ennemi de la magie ou au contraire le premier des magiciens et des alchimistes ? Fondateur d'une religion révélée ou sage antique ? La plupart des grandes questions dérivent de ce grand passage, de cette transmission par la Grèce, dépositaire puis subtile modificatrice de ces mythes et rites orientaux. Un Orient où on ne devait ni enterrer ni brûler les morts mais les laisser être dévorés par les oiseaux, en arrière-plan du temple grec classique, aux colonnes doriques, ioniennes, corinthiennes.En 1938, au carrefour de l'histoire des religions, de l'histoire de la philosophie, et de l'histoire littéraire, les deux grands philologues, épigraphes, archéologues belges francophones Joseph Bidez (1867-1945) et Franz Cumont (1868-1947) (1) publièrent Les Mages hellénisés, résultat d'une alliance à laquelle leurs travaux respectifs les prédisposaient : Bidez qui enseigna assez longtemps à l'université de Gand avant que la néerlandisation ne le contraignit à interrompre son enseignement francophone (oui à Gand, la ville natale de Jean Ray... aussi fréquentée par Bidez et Cumont !) était un spécialiste de l'Empereur Julien mais aussi l'auteur de recherches sur la biographie d'Empédocle et sur la Vie de Porphyre, le philosophe néo-platonicien. Cumont de son côté avait suivi très jeune en Allemagne les cours de certains des plus grands savants allemands (Usener, Th. Mommsen, Wilamovitz-Moellendorff, Erwin Rohde) et avait publié, après des Textes et documents figurés relatifs aux mystères de Mithra, son classique Les Religions orientales dans le paganisme romain (c'est la quatrième édition de 1929 parue chez Geuthner qui est systématiquement citée dans Les Mages hellénisés) avant de se spécialiser dans les problèmes de la mort et de la survie de l'âme dans l'antiquité : Lux perpetua, édité posthume en 1949 est toujours l'un des livres majeurs à consulter concernant le milieu païen dans lequel évoluaient les premiers disciples du Christ (2).Religion antique, alchimie, magie, apocalypses proches-orientales pré ou para-bibliques, philosophies présocratiques, platoniciennes, aristotéliciennes et néo-platoniciennes sont les fils entrecroisés tissant, à travers des témoignages iraniens, babyloniens, syriens, judaïques, grecs, romains, médiévaux, les étranges phénomènes que constituèrent, en Iran d'abord puis dans les pays voisins, ensuite en Grèce, les figures apocryphes de ces mages, aux origines de la magie noire comme de la magie blanche, mais aussi aux origines de certains éléments philosophiques pythagoriciens, et aux origines enfin du dualisme manichéen (peut-être le courant religieux le plus persécuté dans l'histoire des religions, en dépit de son immense influence) comme mazdéen, de cet univers religieux du dualisme qu'Henri-Charles Puech et Simone Pétrement (3) devaient, dix ans plus tard, à nouveau illustrer et enrichir de leurs propres recherches.Une ultime remarque matérielle : ce nouveau tirage des Mages hellénisés comporte deux tables des matières distinctes, une située pp. 292-297 concernant les études, une seconde située pp. 411-412 concernant les textes. Cette difficulté de présentation (qui n'est pas éclaircie par un avertissement de l'éditeur et dont on s'est rendu compte assez tardivement durant notre lecture : à l'origine, le livre était paru en deux tomes, cf. note de l'index général en haut de la p.253 de la première partie) nous fournit l'occasion de proposer, infra, un outil original permettant un accès plus aisé à ce livre. Il s'agit d'une table générale des matières rédigée par nos soins et réunissant les deux tables séparées, donnant au lecteur une représentation détaillée de la richesse du livre.Contribution à une table générale des matières de Les Mages hellénisés regroupant les deux tables du volume : la table intermédiaire située pp. 292-297 et la table finale située pp. 411-412. Les numéros entre parenthèses renvoient aux premières pages de chaque chapitre.1) Première partie : études, addenda, 1 index, 1 tableIntroduction.Étude sur Zoroastre.I) Vie de Zoroastre (5); II) Doctrines de Zoroastre (56), III) Oeuvres de Zoroastre : témoignages anciens (85), les livres sacrés (89), écrits philosophiques (102), les quatre livres sur la nature (107), le lapidaire (128), livres d'astrologie (131), livres de magie (143), l'alchimie (151), apocryphes gnostiques (153), oracles attribués à Zoroastre par Gémiste Pléthon (158)Étude sur OstanèsI) Vie d'Ostanès (167), II) Œuvres d'Ostanès : théologie, angélologie, démonologie (175), la nécromancie (180), les vertus des herbes et des pierres (188), l'alchimie (198), appendice : lettres d'Ostanès à Pétasius, de Démocrite à Leucippe, textes syriaques et arabes (208).Étude sur HystaspeI) Vie d'Hystaspe (215), II) Œuvres d'Hystaspe : l'apocalypse (217), le livre de la sagesse (222), écrits astrologiques (223)Addenda et index général de la première partie (253-292)Table de la première partie (293-297)2) Seconde partie : textes, 3 index, 1 tableLa pagination repart de zéro !Textes sur ZoroastreTémoignages biographiques (7), doctrines et appendice : textes syriaques, livres sacrés (63), les quatre livres sur la nature (158), extraits des Geoponica (173), le lapidaire (197), Astéroscopiques et apotélesmatiques (207), appendices (233), écrits magiques (242), apocryphes gnostiques (249), Zoroastre, prétendu auteur des Oracles chaldaïques (251)Textes sur OstanèsTémoignages biographiques (267), fragments religieux et magiques (271), Alchimie (309)Textes sur HystaspeTémoignages biographiques (359), Fragments de l'Apocalypse (361), le livre de la sagesse (376), écrits astrologiques (376).Index de la seconde partieI) index des sources bibliographiques (379), II) des noms propres (385), III) des mots grecs et latins (397). Ces trois index concernent uniquement la seconde partie, à laquelle ils se rattachent en réalité directement bien que leur présentation, en fin de volume, puisse naturellement faire croire qu'ils couvrent l'ensemble du volume. Les numéros des pages renvoyant donc uniquement à la seconde partie (textes), nullement à la première (études).Table de la seconde partieCette table des pp. 411-412 ne couvre que la pagination de la seconde partie et de ses trois index.La pagination totale du livre est donc approximativement de 710 pages.Notes(1)«[...] L'un des plus chers amis belges et ancien collègue de Cumont à l'ancienne Université de Gand était Joseph Bidez. Ils publièrent en collaboration étroite l'admirable édition des Lettres de l'Empereur Julien dans la collection Budé en 1922 et un recueil de documents sur l'influence de Zoroastre en Grèce : Les Mages hellénisés, en 1938. Mais les occupations relatives aux conceptions antiques de la survie dans l'au-delà furent la note dominante des dernières années de Cumont. Ce fut l'objet de multiples études encore sur l'eschatologie du «mysticisme astral» et de deux volumes imposants rédigés dans l'atmosphère lourde et périlleuse de la guerre : Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, 1942, et Lux Perpetua, resté manuscrit et publié en œuvre posthume par les soins de la marquise de Maillé et de Louis Canet, ses amis parisiens, en 1949, mais dont le thème avait été développé en de brillantes leçons au Collège de France en 1943. On y trouve les fruits d'une longue carrière scientifique, consacrée aux angoissants problèmes de la mort et de la survie, tels que les ont considérés les philosophes, les mystiques, les artistes, les écrivains et le simple peuple de l'Antiquité, d'après les témoignages écrits ou figurés, qui en sont parvenus jusqu'à nous [...]», F. De Ruyt, Franz Valéry Marie Cumont in Biographie Nationale [belge] (1976, t. 39), pp. 211-222, recopié in Academia Belgica 

 modeste logis, tout comme je n'ai pu lire son deuxième roman, Les condors de Montfaucon. Je répare donc, par ces lignes toujours précises de Francis Moury (le sous-titre de son article est : Surnaturalisme et réalisme dans la trilogie parisienne de Mathis), quelque peu de ma procrastination qui, aux yeux d'un auteur (je ne le sais que trop...!), paraît toujours coupable : quoi se dit-il, se peut-il qu'un lecteur ne se précipite pas immédiatement sur mon livre pour le dévorer ? Comment est-ce donc possible ? Oui, hélas, cela se peut, cela est parfaitement possible, cet oubli, cette distraction, ce refus de l'onction du baptême qu'est, en une image à peine exagérée, la lecture. Un livre qui n'est donc pas lu est d'une certaine façon un livre mort (ainsi considérée, ma bibliothèque, pourtant modeste, est déjà un vaste mausolée) ou, mieux, l'une de ces âmes enfantines qui erre plaintivement dans les limbes.
modeste logis, tout comme je n'ai pu lire son deuxième roman, Les condors de Montfaucon. Je répare donc, par ces lignes toujours précises de Francis Moury (le sous-titre de son article est : Surnaturalisme et réalisme dans la trilogie parisienne de Mathis), quelque peu de ma procrastination qui, aux yeux d'un auteur (je ne le sais que trop...!), paraît toujours coupable : quoi se dit-il, se peut-il qu'un lecteur ne se précipite pas immédiatement sur mon livre pour le dévorer ? Comment est-ce donc possible ? Oui, hélas, cela se peut, cela est parfaitement possible, cet oubli, cette distraction, ce refus de l'onction du baptême qu'est, en une image à peine exagérée, la lecture. Un livre qui n'est donc pas lu est d'une certaine façon un livre mort (ainsi considérée, ma bibliothèque, pourtant modeste, est déjà un vaste mausolée) ou, mieux, l'une de ces âmes enfantines qui erre plaintivement dans les limbes. «L’histoire a dans tout ceci resserré le temps, comme l’espace s’est resserré sur cet endroit fatidique de la Beregonnegasse. Ainsi dans les archives de Hambourg, on parle d’atrocités qui se commirent pendant l’incendie par une bande de malfaiteurs mystérieux. Crimes inouïs, pillages, émeutes, hallucinations rouges des foules, tout cela est parfaitement exact. Or, ces troubles eurent lieu plusieurs jours avant le sinistre. Comprenez-vous la figure que je viens d’employer sur la contraction du temps et de l’espace ? […] Et ne doit-on pas, avec horreur et désespoir, admettre cette loi fantastique de contraction de Fitzgerald-Lorenz ? La contraction, monsieur, ah ! ce mot est lourd de choses !»
«L’histoire a dans tout ceci resserré le temps, comme l’espace s’est resserré sur cet endroit fatidique de la Beregonnegasse. Ainsi dans les archives de Hambourg, on parle d’atrocités qui se commirent pendant l’incendie par une bande de malfaiteurs mystérieux. Crimes inouïs, pillages, émeutes, hallucinations rouges des foules, tout cela est parfaitement exact. Or, ces troubles eurent lieu plusieurs jours avant le sinistre. Comprenez-vous la figure que je viens d’employer sur la contraction du temps et de l’espace ? […] Et ne doit-on pas, avec horreur et désespoir, admettre cette loi fantastique de contraction de Fitzgerald-Lorenz ? La contraction, monsieur, ah ! ce mot est lourd de choses !» «Des arbres ? Elle ne se rappelait pas avoir vu une rangée d’arbres à cet endroit lorsqu’elle était passée par-là la fois précédente. Bien sûr, cela remontait à l’été dernier et elle était arrivée à Fairvale en plein jour, fraîche et dispose. Aujourd’hui, elle était épuisée parce qu’elle avait conduit dix-huit heures d’affilée ; néanmoins, elle se souvenait fort bien de la route et sentait confusément qu’elle s’était trompée. Se souvenir : ce mot déclenchait tout. Or, elle se souvenait vaguement avoir hésité il y avait une demi-heure environ en arrivant au carrefour. Oui, c’était bien cela : elle avait tourné dans la mauvaise direction. Et maintenant elle était perdue, Dieu sait où. La pluie tombait et tout était d’un noir d’encre alentour…»
«Des arbres ? Elle ne se rappelait pas avoir vu une rangée d’arbres à cet endroit lorsqu’elle était passée par-là la fois précédente. Bien sûr, cela remontait à l’été dernier et elle était arrivée à Fairvale en plein jour, fraîche et dispose. Aujourd’hui, elle était épuisée parce qu’elle avait conduit dix-huit heures d’affilée ; néanmoins, elle se souvenait fort bien de la route et sentait confusément qu’elle s’était trompée. Se souvenir : ce mot déclenchait tout. Or, elle se souvenait vaguement avoir hésité il y avait une demi-heure environ en arrivant au carrefour. Oui, c’était bien cela : elle avait tourné dans la mauvaise direction. Et maintenant elle était perdue, Dieu sait où. La pluie tombait et tout était d’un noir d’encre alentour…» «Les secrets de l’art sont pour Freud de vrais secrets, inoculant à ceux qui les approchent le désir ardent de les déchiffrer tout en restant, à jamais, indéchiffrables.»
«Les secrets de l’art sont pour Freud de vrais secrets, inoculant à ceux qui les approchent le désir ardent de les déchiffrer tout en restant, à jamais, indéchiffrables.» Qu’on en juge d’abord et tout prosaïquement par le rapport temps/quantité littéraire créée : un premier roman paru de Mathis, Maryan Lamour dans le béton (éd. I.d.é.e.s./Encrage, Les Belles Lettres, 1999) accouché d’abord de 1982 à 1990 puis repris en 1996 jusqu’à sa version définitive de 661 pages et 30 photographies. Aujourd’hui Mathis nous offre ce second roman, Les condors de Montfaucon (éd. E-dite, 2004) en gestation de 1998 à 2001, principalement rédigé de mars à septembre 2001 et comprenant pour sa part 619 pages et 20 photographies. On indique ces données pour l’histoire future de la littérature française qui nous remerciera de notre précision possible grâce à l’amitié de l’auteur. Face au génie, on n’est jamais trop précis. Il faut bien entailler le marbre par un endroit pour le faire sien et commencer à le travailler. Face à ces deux blocs de marbre pur que sont ces deux romans, le critique doit modestement faire son travail, d’abord chronologique et factuel.
Qu’on en juge d’abord et tout prosaïquement par le rapport temps/quantité littéraire créée : un premier roman paru de Mathis, Maryan Lamour dans le béton (éd. I.d.é.e.s./Encrage, Les Belles Lettres, 1999) accouché d’abord de 1982 à 1990 puis repris en 1996 jusqu’à sa version définitive de 661 pages et 30 photographies. Aujourd’hui Mathis nous offre ce second roman, Les condors de Montfaucon (éd. E-dite, 2004) en gestation de 1998 à 2001, principalement rédigé de mars à septembre 2001 et comprenant pour sa part 619 pages et 20 photographies. On indique ces données pour l’histoire future de la littérature française qui nous remerciera de notre précision possible grâce à l’amitié de l’auteur. Face au génie, on n’est jamais trop précis. Il faut bien entailler le marbre par un endroit pour le faire sien et commencer à le travailler. Face à ces deux blocs de marbre pur que sont ces deux romans, le critique doit modestement faire son travail, d’abord chronologique et factuel. L’écriture maintient et même approfondit sa beauté déjà si particulière, celle d’un authentique diamant noir brut et contemporain, nourri de notre présent (bien des faits réels, autobiographiques ou non, y figurent) mais aussi riche de tout notre passé, parfois lourde de notre futur immédiat. De Maryan Lamour dans le béton à Chambres de bonnes en passant par Les condors de Montfaucon, mêmes caractéristiques fondamentales.
L’écriture maintient et même approfondit sa beauté déjà si particulière, celle d’un authentique diamant noir brut et contemporain, nourri de notre présent (bien des faits réels, autobiographiques ou non, y figurent) mais aussi riche de tout notre passé, parfois lourde de notre futur immédiat. De Maryan Lamour dans le béton à Chambres de bonnes en passant par Les condors de Montfaucon, mêmes caractéristiques fondamentales. Différences cependant entre le premier et le second roman : dans Les condors de Montfaucon, moins de monologues pensés donnés ouvertement comme des «courants de conscience» – qui évoquaient directement Faulkner ou Joyce voire Sartre – que dans Maryan Lamour dans le béton. Ils sont encore là certes mais davantage dilués entre des identités qu’on saisit au vol avec souplesse et clarté, entrecoupés de remarques du narrateur, et d’une narration objective classique. Une construction d’ensemble encore plus sophistiquée, plus labyrinthique que dans Maryan Lamour dans le béton mais pourtant plus aisée à pénétrer, plus épurée et aérée : un personnage peut reparaître dix pages plus loin sans que le fil soit interrompu ni perdu tant la structure est solide et étudiée. Elle permet cette interaction démesurée d’une multitude de visions entre deux catégories principales de personnages – les démoniaques et les autres – tournant pour la deuxième fois autour d’une figure salvatrice féminine en danger, témoin pur(e) à abattre. Construction plus ample mais pourtant plus aérée que celle de Maryan Lamour dans le béton, celle des Condors de Montfaucon fait corps, nous a-t-il semblé, plus absolument comme plus naturellement avec son sujet. Elle coule plus aisément.
Différences cependant entre le premier et le second roman : dans Les condors de Montfaucon, moins de monologues pensés donnés ouvertement comme des «courants de conscience» – qui évoquaient directement Faulkner ou Joyce voire Sartre – que dans Maryan Lamour dans le béton. Ils sont encore là certes mais davantage dilués entre des identités qu’on saisit au vol avec souplesse et clarté, entrecoupés de remarques du narrateur, et d’une narration objective classique. Une construction d’ensemble encore plus sophistiquée, plus labyrinthique que dans Maryan Lamour dans le béton mais pourtant plus aisée à pénétrer, plus épurée et aérée : un personnage peut reparaître dix pages plus loin sans que le fil soit interrompu ni perdu tant la structure est solide et étudiée. Elle permet cette interaction démesurée d’une multitude de visions entre deux catégories principales de personnages – les démoniaques et les autres – tournant pour la deuxième fois autour d’une figure salvatrice féminine en danger, témoin pur(e) à abattre. Construction plus ample mais pourtant plus aérée que celle de Maryan Lamour dans le béton, celle des Condors de Montfaucon fait corps, nous a-t-il semblé, plus absolument comme plus naturellement avec son sujet. Elle coule plus aisément. Chambres de bonnes, le troisième roman, se distingue nettement des deux précédents par une phrase plus simple, moins longue mais sa narration utilise toujours le thème de l’entrelacement et des fils tendus constituant progressivement un réseau de consciences : réseau dont le centre ne cesse de se dérober à mesure que la dynamique de l’intrigue se noue, fait rebondir le lecteur d’une facette à l’autre, d’un fragment à l’autre d’une «vérité-réalité» cachée, n’apparaissant que par bribes.
Chambres de bonnes, le troisième roman, se distingue nettement des deux précédents par une phrase plus simple, moins longue mais sa narration utilise toujours le thème de l’entrelacement et des fils tendus constituant progressivement un réseau de consciences : réseau dont le centre ne cesse de se dérober à mesure que la dynamique de l’intrigue se noue, fait rebondir le lecteur d’une facette à l’autre, d’un fragment à l’autre d’une «vérité-réalité» cachée, n’apparaissant que par bribes. Maintien et même approfondissement des thèmes bien résumés au verso du livre et leur énumération précise est exacte : il y a tout cela dans Les condors de Montfaucon. Un Paris contemporain (Marianne Lamour dans le béton, Les Condors de Montfaucon) ou un Paris moderne (Chambres de bonnes se situe dans le quartier du Temple à Paris vers 1950-1958) souvent satirique mais aussi souvent dangereux, vampirisé par un Paris oublié, une économie souterraine du crime que seuls quelques regards professionnels ou impliqués par hasard peuvent décrypter car ils savent rési
Maintien et même approfondissement des thèmes bien résumés au verso du livre et leur énumération précise est exacte : il y a tout cela dans Les condors de Montfaucon. Un Paris contemporain (Marianne Lamour dans le béton, Les Condors de Montfaucon) ou un Paris moderne (Chambres de bonnes se situe dans le quartier du Temple à Paris vers 1950-1958) souvent satirique mais aussi souvent dangereux, vampirisé par un Paris oublié, une économie souterraine du crime que seuls quelques regards professionnels ou impliqués par hasard peuvent décrypter car ils savent rési