Rechercher : pommier girard
Quand Georges Molinié, le plus abominable cacographe que la terre ait jamais porté, parle de la beauté, par René Pommier

 Cacographes (où figurent de nombreux articles de René Pommier et, bien sûr, Georges Molinié, prince des cacographes).
Cacographes (où figurent de nombreux articles de René Pommier et, bien sûr, Georges Molinié, prince des cacographes).À propos de Georges Molinié, De la beauté (Éditions Hermann, 2012). Les pages indiquées entre parenthèses, sans autre mention, renvoient à cette édition.
Qui aurait jamais cru que Georges Molinié qui a écrit tant de phrases abominables, tant de phrases d’une laideur innommable, tant de phrases, qui donnent continuellement envie de vomir à tous ceux qui aiment la langue française, oserait un jour écrire un livre sur la beauté ? Il l’a pourtant fait et il a trouvé un éditeur pour le publier. Je ne vais pas me livrer à une étude exhaustive d’un livre que n’achèteront que ses rares admirateurs et qu’aucun d’eux sans doute ne lira vraiment. Je me contenterai de quelques remarques à propos de ce qui est apparemment la thèse essentielle de son livre, à savoir «que, nucléairement et proprement, c’est le sexe qui est beau, que le sexe est la beauté même, que le sexe est indépassablement et totalement beau».
«Ce qui est, continue-t-il, exprimé d’une manière lapidaire dans la citation de W. Blake que Jean-Marie Gleize a mise en exergue de l’un de ses livres les plus suggestifs, Le principe de nudité intégrale : Les organes génitaux sont la beauté. On ne peut mieux dire. Cela paraît un peu rude à avaler; c’est pourtant parfaitement cohérent, clair, lucide, courageux. On remarquera l’emphase de l’énonciation : la situation en exergue, la présentation comme citation, le renvoi à l’autorité d’un poète, étranger, mystique, selon un montage d’association énonciative en quelque sorte décalée. Ce qui confère une valeur de noème à l’énoncé, l’auréolant d’une gravité de sagesse lointaine, des profondeurs. On remarquera également que l’on a affaire au style de l’énoncé de thèse, hors toute argumentation et toute discussion, hors tout type d’amodiation, avec les marqueurs de caractérisation à la fois intensive et exclusive, d’autant plus efficaces qu’ils sont combinés en un petit espace phrastique : l’emploi du présent de vérité générale, qui sort des vicissitudes et des variations du devenir temporel et situe la portée dans une quasi-éternité; le dispositif actanciel de la non-personne, qui radicalise l’extériorité de l’énonciation et en élimine toute mesure pathétique ou affective; la sélection sémantico-lexicale des supports thématiques (les organes génitaux) et prédicatifs (la beauté) qui fonctionnent en l’occurrence, par leur relation syntaxique en mono-sémantisme strictement dénotatif comme une boule parfaitement ronde, lisse, purement fermée et sans dégager la moindre porosité sémiotique; l’assimilation implicite, à la manière d’un coup de poing, d’un jugement de qualité à une sorte d’incarnation métonymique et antonomastique de l’origine absolue de cette qualité (sont la beauté). Pas même la plus légère bourre rhétorique ou morphosyntaxique, excepté le seul outil les, ce qui est bien le strict minimum vu la structure du français moderne. Extrême condensation formelle pour une extrême condensation d’effet» (pp. 98-100).
Ce passage est un peu long, mais il valait la peine de le citer en entier. C’est, en effet, un morceau d’anthologie. Il a fort peu de chances de passer à la postérité, mais il le mériterait, car c’est sans doute une des pages les plus grotesques de la littérature universelle. Constatons tout d’abord que Georges Molinié n’a manifestement pas pris la peine de vérifier que William Blake avait bien écrit : «Les organes génitaux sont la beauté». Il était trop reconnaissant à Jean-Marie Gleize de lui avoir fait découvrir cette merveilleuse citation pour avoir envie d’y regarder de plus près. Pour ma part, je ne me souvenais pas d’avoir rencontré cette phrase chez William Blake et je ne l’aurais sans doute pas oubliée si cela avait été le cas. Je me suis donc reporté à mon édition des Poèmes de William Blake, celle de Louis Cazamian dans la collection bilingue Aubier-Flammarion. Si je n’ai pas trouvé ce que j’aurais dû trouver, à savoir : « The genitals are the Beauty», j’ai trouvé, il est vrai, «the genitals Beauty». Mais, outre que ce n’est pas tout à fait la même chose, cette formule n’est pas l’espèce de monolithe que nous présente Georges Molinié; elle n’est pas le solitaire étincelant qui l’éblouit. Elle figure, en effet, avec trois autres formules similaires, dans un des Proverbs of Hell du poème The Marriage of Heaven and Hell. Le voici : «The head Sublime, the heart Pathos, the genitals Beauty, the hands & feet Proportion». Ce n’est évidemment pas très clair, comme c’est assez souvent le cas avec William Blake. Louis Cazamian traduit de la façon suivante : «La Sublimité pour la tête, le pathétique pour le cœur, la Beauté pour les sens, la Proportion pour les mains et les pieds». Cela voudrait donc dire que les organes génitaux sont en quête de beauté comme la tête l’est de sublimité, le cœur de pathétique, les mains et les pieds de proportion, ou que la beauté est le domaine des organes génitaux, comme le sublime est celui de la tête, le pathétique celui du cœur et la proportion celui des mains et des pieds. Mais cela reste assez obscur : on ne voit pas très bien notamment pourquoi la proportion serait spécialement associée aux mains et aux pieds».
Quoi qu’il en soit, il reste que William Blake associe effectivement «beauté» et «organes génitaux». Cela ne nous autorise pas à lui faire dire que «les organes génitaux sont la beauté», mais on peut, bien sûr, en conclure qu’il les trouvait beaux. Et alors ? C’est son opinion, mais on peut ne pas la partager. William Blake est assurément un poète, un véritable poète, mais c’est un esprit passablement fumeux, pour ne pas dire quelque peu tordu. Ses jugements sont donc sujets à caution.
Certes, aucune opinion ne saurait être considérée comme parole d’évangile, mais, s’il est un homme dont le jugement, sur le sujet de la beauté, mérite plus que tout autre d’être pris en considération, c’est bien Léonard de Vinci. Or, non seulement il ne trouve pas que les organes génitaux sont beaux, et encore moins qu’ils sont la beauté même, mais il juge au contraire qu’ils sont laids, il juge qu’ils sont même très laids, il les juge franchement hideux, comme nous l’apprend son biographe Edmondo Solmi : «L’atto del coito et le membra a quello adoptante, scriverà Leonardo con ardita espressione, sont di tanta bruttura, che, se non fusse la bellezza de’ volti et li ornamenti delli opranti et la sfrenata diposizione, la natura perderebbe la spezie umana» (1). Freud a cité ce texte dans Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci (2), de même que Georges Bataille, qui, non content de partager le jugement de Léonard, considère que tout le monde fait de même : «Personne ne doute de la laideur de l’acte sexuel», et parle de «l’animalité hideuse des organes» (3). Étiemble partage apparemment ce sentiment, lui qui écrit dans Blason d’un corps : «De toutes les blessures que nous apporte la vie, les moins guérissables intéressent la région de notre corps qui participe à la fois aux excrétions et à la volupté (d’où je conclus incidemment que ton dieu, infiniment bon et puissant tel que tu le définis, aurait pu imaginer pour notre espèce une solution plus ménagère de nos nerfs, et nous épargner cette confusion des organes qui nous ravale au niveau des chiens, dont les amours publiques sont si décourageantes ou des poules et de leur cloaque)» (4). Freud, quant à lui, ne nous livre pas son opinion personnelle sur le sujet, mais, comme Georges Bataille, il constate que la plupart des gens les trouve laids : «Il est remarquable que les organes génitaux eux-mêmes, dont la vue a toujours un effet excitant, ne sont pourtant presque jamais jugés beaux, en revanche un caractère de beauté semble s’attacher à certains signes distinctif sexués secondaires» (5). Georges Molinié est très embarrassé par ce texte de Freud, texte qui émane d’un homme qui a dû souvent recevoir sur ce sujet les confidences de ses patients. Il choisit donc de croire que ceux-ci n’ont pas osé exprimer leur véritable sentiment : «Qui peut, qui oserait, sans provocation, sans effet redouté d’impudeur, dire qu’il trouve les organes génitaux beaux ? Mais qui ne le ressent pas, qui ne l’avouerait pas dans l’intimité de la relation érotique ?» (pp. 105-6).
Georges Molinié prétend que personne n’ose dire qu’il trouve les organes génitaux beaux par peur d’être soupçonné de lubricité. C’est, bien sûr, parfois le cas, mais, si la grande majorité des gens ne disent pas qu’ils sont beaux, c’est tout simplement parce qu’ils ne les trouvent effectivement pas beaux. Ce n’est pas parce qu’ils ont peur du qu’en-dira-t-on. S’il y a quelqu’un que la perspective d’être accusé d’impudeur ne devait pas beaucoup effrayer, c’est bien Georges Bataille. S’il avait trouvé les organes génitaux beaux, il n’aurait donc certainement pas hésité à le dire. Il n’est aucunement nécessaire d’être bégueule pour estimer que les organes génitaux ne sont pas beaux. Georges Molinié prétend que c’est la pudeur qui nous empêche de dire qu’ils sont beaux. Mais qu’est-ce qui nourrit le sentiment de pudeur, sinon d’abord et surtout la conscience de la laideur des organes sexuels ? S’ils étaient beaux, s’il étaient très beaux, s’ils étaient la beauté, loin d’avoir honte de montrer les siens, on serait heureux et fiers de les exhiber, et, loin d’être offusqués par leur vue, on se réjouirait de pouvoir contempler ceux des autres. S’il en était ainsi, on s’expliquerait mal pourquoi, à l’exception des tribus primitives, tous les peuples ressentent la nécessité de cacher à la vue les organes génitaux. Au lieu de devoir rester cantonnés dans des réserves, les nudistes se promèneraient librement partout où le climat le permettrait.
À en croire Georges Molinié, l’intimité de la relation érotique constituerait, sur ce sujet, le grand moment de vérité. On peut pourtant penser que ce n’est sans doute pas la situation qui permet le mieux d’assurer, sur quelque sujet que ce soit, la lucidité et l’objectivité du jugement. C’est rarement le moment que l’on choisit lorsqu’on a besoin de réfléchir sérieusement à un problème. L’intimité de la relation érotique n’est guère à aucune autre chose. On y oublie volontiers tout le reste. Les préoccupations proprement esthétiques passent au second plan comme passent au second plan, pour tous ceux qui se livrent à des pratiques telles que la sodomie ou l’anulingus, les soucis de l’hygiène la plus élémentaire. L’attirance que peuvent, dans une telle situation, exercer les organes génitaux relève d’une explication d’ordre hormonal plutôt qu’esthétique.
Mais Georges Molinié ne voudra jamais admettre que la plupart des gens ne partagent pas, au moins secrètement, son point de vue sur les organes génitaux. Portons donc la discussion sur un autre terrain, celui de l’histoire de l’art qui semble tout entière vouloir démentir sa thèse. Car, si les organes sexuels étaient vraiment beaux, s’ils étaient le beau, s’ils étaient le parangon, le modèle absolu de la beauté, alors on devrait ressortir de tous les musées soûlé de vagins, de pénis et de testicules. Ce n’est assurément pas le cas et ceux qui aiment à voir représentés les organes sexuels ont intérêt à fréquenter les latrines publiques plutôt que les musées.
Si Georges Molinié avait raison, le tableau le plus célèbre au monde, celui qui attire le plus grand nombre de visiteurs, ne devrait pas être La Joconde, mais L’Origine du monde. Les gens qui vont au Louvre pour la première fois se dirigent tout droit vers La Joconde comme je l’ai fait moi–même, il y a bien longtemps. Mais ceux qui vont pour la première fois au Musée d’Orsay ne se précipitent pas pour aller se planter devant L’Origine du monde et beaucoup ignorent d’ailleurs que le tableau se trouve là. Dans le tableau de Courbet, le sexe de la femme qui est allongée nue sur un lit, les cuisses écartées et dont on ne voit rien au-dessus des seins ni en dessous des cuisses, est assurément le centre du tableau; c’est incontestablement lui qui attire les regards. On peut le déplorer ou s’en réjouir, mais le fait est qu’avant Courbet aucun peintre, du moins un peintre connu, n’avait, semble-il, jamais fait un tel choix. Et personne non plus ne semble aussi l’avoir imité à l’exception, assez récemment (2008), de John Currin dans un tableau directement inspiré de L’Origine du monde intitulé After Courbet, et qui n’a apparemment pas soulevé un grand enthousiasme dans le monde des amateurs d’art. Notons enfin que, dans les autres nus féminins de Courbet (La Femme dans les vagues, Le Sommeil, Femme allongée sur un lit, Jeune Baigneuse), qu'il est permis de préférer à L’Origine du monde, le sexe reste caché.
Et il en est de même dans un très grand nombre de nus féminins, soit que, pour masquer le sexe, le peintre ait recours à la chevelure, comme dans La Naissance de Vénus de Botticelli, à une main, comme dans la Vénus d’Urbino et la Vénus endormie du Titien ou l’Olympia de Manet, ou, le plus souvent, à un linge ou à une étoffe, soit enfin que la position du corps, de dos ou de côté comme dans Le Déjeuner sur l’herbe de Manet, ne permette pas de voir le sexe. Il reste, il est vrai, qu’il y a de très nombreux tableaux dans lesquels le peintre n’a pas cherché à masquer le sexe ni par la position du corps ni par quelque obstacle que ce soit. Mais alors ou bien l’on ne voit rien du tout à l’emplacement du sexe que le peintre a complètement gommé, comme dans la Vénus Anadyomène ou La Source d’Ingres, ou bien, le plus souvent, on ne voit qu’un triangle sombre, généralement très discret, voire à peine perceptible, comme dans La Maja nue de Goya. Au total, si, de tout temps, les peintres se sont particulièrement employés à célébrer la beauté du corps féminin, ils ne semblent pas avoir considéré que le sexe en faisait partie.
On peut faire globalement les mêmes remarques en ce qui concerne les tableaux de nus masculins. Certes, quand ils sont représentés, les organes sexuels sont plus visibles que sur les nus féminins, mais cela tient évidemment à la nature des choses. Mais, pas plus ceux qui peignent des nus féminins, les peintres qui peignent des nus masculins ne semblent s’intéresser vraiment au sexe de leurs modèles. Si les organes sexuels étaient la beauté, Cézanne aurait sans doute choisi de peindre des couilles plutôt que des pommes et on se serait extasié sur leur merveilleux modelé, sur l’exquise délicatesse des contours, sur l’infinie poésie de la pilosité. Dieu merci, il a préféré les pommes. Les innombrables tableaux de saint Sébastien cachent toujours le sexe du martyr. On dira, bien sûr, qu’il s’agit, en principe, d’un sujet religieux, même si chacun sait que ces tableaux sont d’abord et surtout des études de nus. Quoi qu’il en soit, comme les peintres de nus féminins, les peintres de nus masculins, ou bien cachent le sexe de quelque façon que ce soit, par une étoffe, une feuille de vigne ou par la position du corps, ou bien, s’ils choisissent de le représenter le font avec beaucoup de discrétion. Dans leurs tableaux, loin de relever la tête, les sexes se font tout petits et cherchent manifestement à se cacher comme celui de L’Apollon de Neuilly de Jean Darty qui semble être d’une extraordinaire timidité.
Les statuaires grecs qui ont tellement exalté la beauté du corps masculin, n’ont certes pas dissimulé les organes sexuels mais ils les ont toujours représentés eux aussi, avec une louable discrétion. Certains le regrettent comme Dominique Fernandez qui décrit en ces termes la statue du «Faune Barberini» qui se trouve à la glyptothèque de Munich : «C’est un homme nu, pâmé sur le dos contre un rocher, les jambes très écartées, la tête renversée entre ses avant-bras. Torse et membres puissants, muscles bien dessinés. Organes sexuels importants, proportionnés à ce corps vigoureux, ce qui n’est pas le cas des autres statues grecques, dont le pénis et les testicules beaucoup trop petits montrent bien les limites où Athènes contenait le culte du corps masculin» (6). Puisque Dominique Fernandez n’a jamais caché son homosexualité, il est permis de suggérer qu’en l’occurrence le regret qu’il exprime n’est pas véritablement d’ordre esthétique. Les hormones peuvent rendre les organes sexuels attirants; elles ne sauraient les rendre beaux.
L’histoire de l’art ne contredit pas la thèse de Georges Molinié seulement par le fait que les artistes qui ont célébré la beauté du corps humain, ont ou bien masqué le sexe ou ne l’ont représenté qu’avec une extrême discrétion : elle la contredit aussi, et de manière peut-être plus radicale encore, par le fait que les artistes qui ont choisi de peindre la laideur et de privilégier les sujets les plus répugnants et les plus hideux possible, ces artistes-là ont, eux, ont souvent considéré que les organes sexuels étaient des ingrédients, sinon absolument indispensables du moins fort utiles, pour obtenir le puissant sentiment de dégoût qu’ils voulaient créer. Comme Egon Schiele, Lucian Freud ou Jean Rustin, ils ont affectionné les nus de vieillards les moins ragoûtants et dont ils n’ont bien sûr pas manqué de mettre les sexes en valeur. Concluons donc sur ce point que, loin de conforter l’opinion de Georges Molinié, l’histoire de l’art serait plutôt de nature à donner raison à ceux qui pensent que, sur le plan esthétique, les organes sexuels de l’homme constituent, avec le derrière des singes, une des créations les plus discutables de la nature.
L’histoire de l’art apporte ainsi à la thèse de Georges Molinié le démenti le plus radical. On pourrait donc s’en tenir là. Mais bien que je ne sois pas philosophe, Georges Molinié non plus d’ailleurs, et que, contrairement à lui, je ne me sente guère capable de me prononcer sur la nature du beau, je ferai encore observer que les analyses des philosophes qui ont traité de ce sujet ne semblent guère aller dans le sens de Georges Molinié. Certes, et l’on ne s’en étonnera pas, dans la Critique du jugement, si Kant n’a cru devoir s’interroger sur la valeur esthétique des organes sexuels. Mais sa conception du beau qui, contrairement à l’agréable, nous procure une satisfaction purement contemplative et totalement désintéressée (7), semble bien mal s’accorder avec la thèse de Georges Molinié qui d’ailleurs le reconnaî
28/03/2014 | Lien permanent
Les étranges contresens d'un grand érudit, Georges Couton, par René Pommier

07/01/2010 | Lien permanent
111 d'Olivier Demangel
 111 est un assez étrange, improbable et fort maladroit mélange entre quelque récit post-apocalytique dont l'aboutissement est le dernier roman de Cormac McCarthy, La Route, le très bizarre, assez osé (du moins à l'époque de sa publication) et onirique Le Fils de l'homme de Robert Silverberg et l'étonnant et énigmatique film de Nicolas Winding Refn, Valhalla Rising sorti en 2009, le tout grossièrement maçonné à la truelle d'une envisageable Anthropologie politique pour les nuls. Une sorte de Sa Majesté des mouches au rabais, un Délivrance dont le réalisateur aurait oublié de couper 300 pages inutiles de scénario, encombré de références tellement discrètes qu'elles clignotent en plein soleil, soit une mise en scène pataude et ridiculement didactique de quelques-uns des thèmes majeurs de Giorgio Agamben écrivant sur la condition humaine propre aux camps d'extermination nazis, qu'Éric Chevillard encense dans une tribune strictement paraphrastique parue dans le Monde des Livres, ce qui ne nous intéresse pas et ne saurait même pas nous étonner, tant un lecteur insignifiant est la conséquence logique d'un mauvais écrivain.
111 est un assez étrange, improbable et fort maladroit mélange entre quelque récit post-apocalytique dont l'aboutissement est le dernier roman de Cormac McCarthy, La Route, le très bizarre, assez osé (du moins à l'époque de sa publication) et onirique Le Fils de l'homme de Robert Silverberg et l'étonnant et énigmatique film de Nicolas Winding Refn, Valhalla Rising sorti en 2009, le tout grossièrement maçonné à la truelle d'une envisageable Anthropologie politique pour les nuls. Une sorte de Sa Majesté des mouches au rabais, un Délivrance dont le réalisateur aurait oublié de couper 300 pages inutiles de scénario, encombré de références tellement discrètes qu'elles clignotent en plein soleil, soit une mise en scène pataude et ridiculement didactique de quelques-uns des thèmes majeurs de Giorgio Agamben écrivant sur la condition humaine propre aux camps d'extermination nazis, qu'Éric Chevillard encense dans une tribune strictement paraphrastique parue dans le Monde des Livres, ce qui ne nous intéresse pas et ne saurait même pas nous étonner, tant un lecteur insignifiant est la conséquence logique d'un mauvais écrivain.Nous nous ennuyons assez fermement durant toute la première partie du roman, méthodique et monotone description des maladies, de la saleté, des pratiques plus ou moins cruelles d'une foule d'hommes (d'êtres, plutôt) sans nom, sans langage, sans amour, sans passé ni avenir discernables, qui marchent sans s'arrêter, sans but dirait-on, sur une terre désolée, observée par une poignée de femmes et d'hommes qui se tiennent à distance de celles et ceux dont ils consignent depuis des années les mœurs frustres, archaïques, révoltantes. La seconde partie du roman d'Olivier Demangel décrit la rencontre entre cette foule puante et errante et une autre horde de femmes et d'hommes tous aussi sales et déguenillés, leurs combats incessants mais ritualisés, cruels dans leur animalité, jusqu'à une étrange fusion sacrificielle, puis la découverte, par les errants, de celles et ceux qui sont chargés de les observer sans être vus, missionnés par la ville de S., dont nous ne saurons rien (cf. p. 81 et 163), et enfin leur méthodique extermination, jusqu'à la surrection d'un couple ô combien symbolique, qui clôturera de ridicule et grandiloquente façon ce livre écrit, nous apprend l'auteur, durant une dizaine d'années.
 Nous nous sommes ennuyés durant la première partie, mais enfin, la sécheresse sociologique, clinique même, avec laquelle Olivier Demangel décrit par le menu, parasites compris, ces êtres dont nous ne savons pas qui ils sont, d'où ils viennent ni bien sûr où ils vont (encore que : «S'ils semblent aller n'importe où, ils ne vont donc pas nulle part», utile précision, p. 19), peut, à la longue, constituer une forme de style, même absent, même taillé dans un silex des premiers âges, farouches comme nous le savons depuis notre enfance. Nous nous sommes ennuyés tout le long de la première partie, et nous avons baillé durant la seconde, car cette sécheresse stylistique de bon aloi, du reste bien adaptée à l'histoire racontée ou, diront les esthètes, à l'absence de toute histoire véritable, sombre alors dans une rédaction laborieuse, soupe indigeste où surnagent quelques forts voyants croutons frottés à l'ail des théories d'Agamben sur la souveraineté et la vie nue (celle-ci explicitement indiquée entre guillemets, cf. p. 27), la nécessaire violence, bien évidemment sacrificielle (et qui ose prononcer, ne serait-ce que penser au terme de sacrifice se voit immédiatement cornaqué par René Girard, moqué par l'excellent René Pommier !) qui doit fonder toute société pré-humaine et, selon toute apparence, post-humaine dans notre livre.
Nous nous sommes ennuyés durant la première partie, mais enfin, la sécheresse sociologique, clinique même, avec laquelle Olivier Demangel décrit par le menu, parasites compris, ces êtres dont nous ne savons pas qui ils sont, d'où ils viennent ni bien sûr où ils vont (encore que : «S'ils semblent aller n'importe où, ils ne vont donc pas nulle part», utile précision, p. 19), peut, à la longue, constituer une forme de style, même absent, même taillé dans un silex des premiers âges, farouches comme nous le savons depuis notre enfance. Nous nous sommes ennuyés tout le long de la première partie, et nous avons baillé durant la seconde, car cette sécheresse stylistique de bon aloi, du reste bien adaptée à l'histoire racontée ou, diront les esthètes, à l'absence de toute histoire véritable, sombre alors dans une rédaction laborieuse, soupe indigeste où surnagent quelques forts voyants croutons frottés à l'ail des théories d'Agamben sur la souveraineté et la vie nue (celle-ci explicitement indiquée entre guillemets, cf. p. 27), la nécessaire violence, bien évidemment sacrificielle (et qui ose prononcer, ne serait-ce que penser au terme de sacrifice se voit immédiatement cornaqué par René Girard, moqué par l'excellent René Pommier !) qui doit fonder toute société pré-humaine et, selon toute apparence, post-humaine dans notre livre.Une lecture un peu plus subtile prétendrait, à juste titre d'ailleurs, que l'intérêt du roman d'Olivier Demangel ne réside pas dans le fait de savoir si l'action décrite suit un cataclysme dont il ne nous est rien dit, ce qui est sans doute fort probable (1), mais dans celui de parvenir à comprendre que, en décrivant par le menu, jusqu'à satiété même, la vie infâme de cette troupe de semi-hommes ou presque-hommes ou bien alors post-hommes, c'est la condition humaine tout entière, telle que l'a réalisée le siècle passé dans sa nudité meurtrière, qu'évoque l'auteur. Cette lecture est la bonne, mais à vrai dire même Éric Chevillard la privilégie, ce qui doit bien vouloir signifier qu'elle n'était pas très difficile à déchiffrer, au vu des poteaux de couleurs criardes qu'Olivier Demangel dispose un peu partout, au cas où le lecteur s'aviserait de faire fausse route interprétative, et emprunterait un itinéraire qu'il n'aurait pas dûment balisé.
Les défauts n'étaient pas absents de la première partie mais ils restaient, à tout le moins, assez discrets, malgré un recours constant à un vocabulaire appartenant au registre de l'anthropologie du sacré, voire de la religion. Ces êtres sont des brutes, certes, mais des brutes à prétentions religieuses (cf. pp. 17, 20), et rituelles (cf. pp. 10), comme nous ne tarderons pas (enfin si, nous tarderons) à le découvrir dans la seconde partie, qui pousse cette logique jusqu'à son acmé et, faut-il le préciser, jusqu'au ridicule. Nous y reviendrons plus loin, j'ai moi aussi le droit d'emprunter quelques détours et de prendre mon temps, après tout.
Employé à toutes les sauces ou peu s'en faut (2), le vocabulaire religieux est tout de même, plus d'une fois, tenu à l'écart voire rejeté par l'auteur car, moins qu'une réalité, il s'agit pour Olivier Demangel d'évoquer la seule possibilité de cette dernière, la lente déhiscence d'une conscience d'homme, de presque-homme qui ne sait rien du bien ni du Mal, mais lève les yeux au ciel (3), preuve sans doute qu'il n'est pas totalement abruti, ou bien qu'il a lu René Girard : «Mais il n'y a en eux ni dans leur attitude, le moindre élément qui indique qu'ils soient l'objet d'une punition, même d'une punition dont nous ne comprendrions pas les motifs, qu'ils soient dans l'expiation d'une faute quelconque, ou encore que leur marche soit une procession dont le motif soit la supplication d'un pardon, et rien non plus, car l'hypothèse pourrait avoir du sens, qui permette de suggérer leur élection. Ils ne savent pas, s'ils l'ont jamais su, ce qu'est le mal, ni ce qu'est le bien. Ce qu'ils font, ils le font, et cela suffit. Il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Ils sont le bien. Ils sont le mal. Ou plutôt ils ne sont ni le mal ni le bien. Tout le fond de leur être est gris» (pp. 21-2), gris oui mais pas n'importe lequel je vous prie, gris nuance de camp d'extermination et, pourrions-nous ajouter, sans pourquoi, comme la rose du mystique rhénan. Je ne suis même pas ironique en écrivant ces mots car, lorsqu'un auteur me force la main ou plutôt le regard, j'emboîte sa logique et la mène à son comble s'il le faut, qui fera sourire ou rire, ou bien bailler, sentiments involontaires provoqués par la lecture de 111. L'exagération didactique d'un auteur est un vilain défaut qu'il est plus que facile de transformer en boomerang démonstratif.
Sans relâche, Olivier Demangel nous répète que les êtres qu'une poignée de femmes et d'hommes (12 initialement, comme qui vous savez bien sûr, puis 11, formant «la troisième communauté d'observateurs de la lande», p. 26) observent minutieusement, sont incompréhensibles, leur marche étant sans but, leurs actes par-delà le bien et le mal donc, le groupe ne devenant rien, mais, seulement, étant (cf. p. 76) : «De la même manière qu'il est réputé impossible de penser l'espace et le temps, parce que leurs limites ne sont pas représentables, de la même manière il est impossible de penser leur marche, parce que ses limites, son origine, sa fin, le territoire même où elle se déroule ne sont ni perceptibles ni conceptualisables» (p. 75).
Plus loin, c'est Aristote qui est convoqué sans être nommé, par le biais de l'évocation d'un «premier moteur immobile» : «C'est pourquoi il n'y a chez eux ni faute, ni culpabilité, ni remords : bouger et ne pas bouger sont des états qui leur conviennent autant qu'à la pierre» (p. 135), référence assez inutile qui ne sera pas moins inutile (ou utile) que l'intrusion du fantastique vers la fin du roman (cf. p. 265).
Nous parvenons ainsi, après 140 pages monotones durant lesquelles Olivier Demangel aura tout de même réussi à planter son décor, à vrai dire fort sommaire, et à nous décrire sa troupe de créatures errantes jusqu'à satiété et, ne l'oublions pas, à nous suggérer que ladite troupe pourrait bien avoir quelque rapport avec celle, misérable au possible, des camps d'extermination nazis (4), nous parvenons enfin à la seconde partie, plus condensée que la première.
C'est dans cette seconde partie que l'auteur abat ses cartes anthropologiques si je puis dire et, assez grossièrement et sans plus aucun souci de l'atmosphère étrange et mystérieuse qui caractérisait la première partie, ne s'embarrasse d'aucune subtilité et dissémine tous les termes qui lui feront obtenir une bonne note (mais uniquement de la part des mauvais lecteurs) à sa rédaction poussive. J'en donne quelques-uns, piochés dans un seul ou bien plusieurs volumes de la fameuse collection Que sais-je ?, à moins que l'auteur n'ait décidé de lire, durant ces dix années de rédaction de son roman, les principaux ouvrages d'Émile Durkheim, Marcel Mauss, James George Frazer, Max Weber, Claude Lévi-Strauss, et, bien sûr, le plus célèbre d'entre tous, cité par tous les ânes de France et de Navarre, René Girard. Cela donne, heureusement en accéléré : «naissance d'une pensée symbolique» (p. 185), «souveraineté marquée par la désignation ou l'autoproclamation d'une reine, chef du pouvoir sur sa meute» (p. 204), la thématique de la souveraineté, de sa naissance dans une meute semblant constituer, du reste, la principale préoccupation d'Olivier Demangel, qui ne cesse d'y revenir (cf. pp. 206, ) mais encore «catharsis» (p. 208), «sacrifice» (p. 217), «rituel» (p. 226), «pouvoir sur le monde» établi par «le premier homme» (p. 231), «cité sociale hybride» (p. 256, l'auteur souligne) et, bien sûr, consécration ultime de ce galimatias socio-anthropologisant, la si fameuse «théorie du bouc émissaire» (p. 257).
J'aurai fini cette critique peu amène (si peu amène qu'elle enfreint la règle sacro-sainte du premier roman devant toujours être épargné par les lecteurs, on se demande bien pourquoi !) d'un livre aussi laborieux et insipide qu'un texte à thèse en évoquant la dernière subtilité narrative d'Olivier Demangel, qui décide de faire rencontrer deux groupes distincts de ces créatures sans pensée (mais qui finiront par en avoir une), sans langage (mais qui finiront par en avoir un), sans conscience sacrée ou religieuse (mais qui finiront par en avoir une), sans savon (mais qui finiront par...) et de les faire se massacrer, à grand renfort de cruauté primitive ou primale, de pénis coupés, de femmes violées et d'hommes égorgés ou bien l'inverse, éviscérés, brûlés, et, conséquemment, en affirmant qu'il est bien évidemment impossible de décrire une telle horreur mais, surtout, en montrant que la poignée d'observateurs, elle aussi méthodiquement exterminée, se confond de plus en plus avec les créatures qu'ils observaient : «Nous voilà chassés par des êtres sur lesquels, il y a quelques jours encore, nous avions toute-puissance, droit de vie et de mort» (p. 251). Avec l'obstination méthodique que nous lui connaissons désormais, Olivier Demangel ne va cesser de mettre en scène ce parallélisme aussi subtil que le reste de sa démonstration, et nos observateurs en seront eux aussi vite réduits au dépouillement de l'homme nu, revenus à l'animalité, oui, mais à l'animalité susceptible de faire naître une conscience souveraine chez autrui : «Nous pensons de moins en moins, nos sentiments s'évaporent. Dans notre tête, nous voulons manger, boire, fuir, et nous savons que demain, une autre lutte commencera pour ces mêmes raisons, tout recommencera à zéro» et, quelques lignes plus bas, un tonitruant et hélas pas conclusif «Nous devenons ce qu'ils étaient» (p. 259). Notre groupe d'exterminateurs en haillons commence, par la violence symbolique et tout un tas de meurtres sacrificiels que les si maigres ressources du langage nous empêchent de décrire (cf. p. 289) selon Olivier Demangel, à acquérir une pensée digne de ce nom, quoique primitive, donc sauvage, donc cruelle, donc symboliquement riche, donc girardienne : «Alors de la pensée les vestiges d'une intelligence arrogante se dressent, opiniâtres, ravagés par la nécessité d'être en vie, cette nécessité qui nous fait oublier que nous sommes hommes, et femmes, animaux sans doute, peut-être bien pour la première fois lucides, malheureusement, sur ce que nous avons passé des années à chercher, et que nous ne pouvions comprendre qu'en le devenant à notre tour» (pp. 259-60).
Est-ce la chute, enfin ? Hélas non, car, nous le savons, Olivier Demangel aime que sa leçon ne souffre aucune ambiguïté, au cas où nous n'aurions pas compris que, finalement, depuis le début même, nous, nous les arrogants, nous les observateurs fiers de leurs techniques d'observation et de leur savoir sociologique, anthropologique et médical, nous les nantis et, pourquoi pas, les gardiens du parc humain, sommes des créatures aussi viles que celles qui ont été décrites par lesdits observateurs, comme s'il s'agissait d'animaux. Devenues, à tout le moins, des animaux cruels mais doués d'une pensée (cf. p. 262) capable de faire émerger «un système de gouvernement» (p. 263), ayant formidablement accéléré «les mécanismes de l'évolution sociale» (p. 276) pour les besoins d'un scénario de documentaire esthétisant, pourchassant des observateurs qui sont eux-mêmes devenus des bêtes sans pitié mais qui se sont tout de même mis ou remis à prier et croire en Dieu (cf. p. 273) et, ô béate révélation, ont pu assister «à la naissance d'une société» (p. 282), nos créatures n'étaient que le prétexte d'une parabole laborieuse, qui tient pour une fois en quelques mots : «Oui, nous voudrions qu'ils soient exterminés. Les populations pauvres, errantes comme elles, avec leur violence archaïque, leur sauvagerie inexplicable et écœurante (5), n'ont pas et ne peuvent avoir leur place sur cette terre» (p. 290). La messe (qui est un sacrifice répété, commémoré, comme le sait peut-être l'auteur) est dite, et tous les grands cœurs pleurant sur la situation des Juifs, des Roms, des migrants et de toutes les minorités pourchassées en ce bas monde sentiront tressaillir leur corde compassionnelle, si délicatement pincée par Olivier Demangel !
Mais ce n'est fini, pas encore, il manque, pour clôturer ce rébus qui sera au programme des cours de l'année prochaine de l'EHESS si Olivier Demangel se débrouille bien ou si Éric Chevillard insiste vraiment et nous répète tout le bien qu'il pense de ce livre, un final en apothéose herméneutique. Non, ce n'est pas fini, pas encore, voyons, le sermon simpliste n'a pas livré ses dernières richesses, puisqu'il faut à toute force nous faire comprendre que c'est le sacrifice de la troupe d'observateurs qui a permis la naissance d'une «souveraineté collective» (p. 296), communauté future qui ne tardera pas à considérer, du moins faut-il le supposer, qu'elle est née en martyrisant «onze dieux sacrifiés de leur panthéon primitif» (p. 309) et que, fondée sur cette violence initiale, plus aucune ne devra être acceptée mais bien plutôt, comble de la sottise, c'est bel et bien le «mot araméen qui signifie Amour» (p. 316) qui devra signifier la naissance d'une nouvelle ère de paix. Araméen et pas sumérien ou amérindien, cela doit sans doute vouloir signifier quelque chose, n'est-ce pas ?
Araméen ou primo-caucasien, l'énigme se creuse car, bientôt réduite à un seul de ces observateurs qui, comme il se doit, ne cesse de se rapprocher de la condition primitive de ceux qu'il a observés et devient, comme il se doit aussi, «partie prenante de cette horreur» (p. 295), la troupe des sacrifiés, comme celle des sacrificateurs, finit par s'éteindre, non sans observer l'ultime naissance d'un couple on le devine (il est facile de tout deviner, avec Olivier Demangel) fermement procréateur, et qui, gorgé d'horreur mais fort heureusement repu des principales notions de l'anthropologie politique et appuyant sa descendance sur l'impératif de l'Amour araméen, ne pourra bâtir qu'une société aussi prometteuse que l'arbre ayant grandi et verdi en une seule nuit (p. 318).
Notes
(1) Plusieurs indices nous sont donnés qui laissent penser qu'une catastrophe a eu lieu, dont cette troupe de créatures errantes est peut-être la conséquence, aux pages 38 ou encore 125 : «Nulle trace de plomberie ou de dents en or, comme il va de soi, ce qui prouve s'il le fallait leur inexistant artisanat et le fait qu'il est difficile, voire impossible, de les relier à des communautés passées». Ailleurs, nous en apprenons davantage : «Cela prouve que notre population, si l'on peut parler ainsi, n'était peut-être à l'origine qu'une communauté humaine parmi les autres. Comme s'il s'était produit ensuite quelque événement, dont nous ne savons rien, mais dont on pourrait savoir quelque chose s'ils venaient à en témoigner un jour» (p. 131).
(2) Bornons-nous à relever quelques termes issus d'un champ lexical double, à la fois sacré et religieux et même, nous le verrons, spécifiquement christique, parmi une multitude d'autres comme : «aura» et «créature surnaturelle» (p. 34), «l'esprit des flammes», «le dieu des âtres, leurs Lares dérisoires» (p. 42), «la providence» (p. 57), «la mise à mort du prophète» (p. 76), «linceul» et «voix qui semblera annoncer sa rédemption» (p. 82), «un messie» montrant le chemin à suivre mais que personne ne suit (p. 86), «le don d'un Veni foras quelconque» (p. 89), «celui qui fit, en d'autres temps, traverser la Mer Rouge à un peuple certes moins dépourvu que le leur» (p. 99), «un culte au dieu du feu» (p. 133), «la persistance, chez eux, de certains rites qui pourraient témoigner d'un reste de sacré dans leur communauté» (p. 134) ou encore l'«arche d'alliance» (p. 300), sans oublier le «buisson des lois» (p. 306) qui, comme tout buisson vétérotestamentaire, se doit de brûler (cf. p. 304). Le Christ est nommément évoqué aux pages 174 et 282, dans une scène qui est un monument de ridicule.
(3) Plusieurs fois répétée, la scène décrit
13/10/2015 | Lien permanent
Cacographes

Le Dictionnaire de l'Académie (François Raymond, Supplément au Dictionnaire de l'Académie française, Éditions Librairie G. Barba, 1836), donne du terme cacographe cette définition : «Auteur qui écrit mal les mots d'une langue. Un cacographe. — Il est aussi adjectif. Un écrivain cacographe».
 Michel Onfray ou la dignité des braguettes, par Francis Moury.
Michel Onfray ou la dignité des braguettes, par Francis Moury. Pierre Marcelle déconstruit.
Pierre Marcelle déconstruit. Pierre Assouline, plume pichrocoline.
Pierre Assouline, plume pichrocoline. Saint Assouline ou le verbe passé à la soupline.
Saint Assouline ou le verbe passé à la soupline. Pierre Assouline et sa république bananière.
Pierre Assouline et sa république bananière. Comment lit le mauvais critique : Pierre Assouline face à Paul Celan.
Comment lit le mauvais critique : Pierre Assouline face à Paul Celan. Résurrection du cadavre de la littérature : Olivier Larizza et William Marx en médecins légistes.
Résurrection du cadavre de la littérature : Olivier Larizza et William Marx en médecins légistes. Tzvetan Todorov en péril ou Tartuffe onaniste.
Tzvetan Todorov en péril ou Tartuffe onaniste. Pierre Assouline, analphabète et illettré.
Pierre Assouline, analphabète et illettré. Pierre Assouline : la douceur de votre commerce l'enrichit.
Pierre Assouline : la douceur de votre commerce l'enrichit. La bouche pleine de mots de Pierre-Emmanuel Dauzat.
La bouche pleine de mots de Pierre-Emmanuel Dauzat. Patrick Kéchichian, pamphlétaire ouaté.
Patrick Kéchichian, pamphlétaire ouaté. Arnaud Viviant.
Arnaud Viviant. Pierre-Antoine Rey dit Cormary, écrivant ne sachant pas écriver, 1.
Pierre-Antoine Rey dit Cormary, écrivant ne sachant pas écriver, 1. Pierre-Antoine Rey dit Cormary, l'écrivant qui se répand, 2.
Pierre-Antoine Rey dit Cormary, l'écrivant qui se répand, 2. Fichu(s) Derrida.
Fichu(s) Derrida. François Rastier, caputoparvificateur, 1.
François Rastier, caputoparvificateur, 1. François Rastier, déontologue pour rire, 2.
François Rastier, déontologue pour rire, 2. François Rastier, microgonadoclaste, 3.
François Rastier, microgonadoclaste, 3. Monique Gosselin-Noat, universitaire universelle.
Monique Gosselin-Noat, universitaire universelle. Philippe Sollers, qu'on ne présente plus.
Philippe Sollers, qu'on ne présente plus. Georges Molinié, prince des cacographes.
Georges Molinié, prince des cacographes. Phallus farfelus, par René Pommier.
Phallus farfelus, par René Pommier. La Sorbonne présidée par un grotesque, Georges Molinié, par René Pommier.
La Sorbonne présidée par un grotesque, Georges Molinié, par René Pommier. Salade freudienne, par René Pommier.
Salade freudienne, par René Pommier. Le Sur Racine de Roland Barthes, par René Pommier.
Le Sur Racine de Roland Barthes, par René Pommier. À quoi sert Josyane Savigneau ?
À quoi sert Josyane Savigneau ? François Meyronnis : De la masturbation considérée comme un des beaux-arts, 1.
François Meyronnis : De la masturbation considérée comme un des beaux-arts, 1. François Meyronnis : De la masturbation considérée comme un des beaux-arts, 2.
François Meyronnis : De la masturbation considérée comme un des beaux-arts, 2. François Meyronnis : De la masturbation considérée comme un des beaux-arts, 3.
François Meyronnis : De la masturbation considérée comme un des beaux-arts, 3. François Meyronnis : De la masturbation considérée comme un des beaux-arts, 4.
François Meyronnis : De la masturbation considérée comme un des beaux-arts, 4. Brève attaque du vif de François Meyronnis.
Brève attaque du vif de François Meyronnis. L'avenir de la littérature de Frédéric Badré.
L'avenir de la littérature de Frédéric Badré. Didier Jacob, producteur de navets certifiés Nouvel Observateur.
Didier Jacob, producteur de navets certifiés Nouvel Observateur. Bernard Quiriny, critique intègre.
Bernard Quiriny, critique intègre. Éric Chevillard, la banalité faite homme, 1.
Éric Chevillard, la banalité faite homme, 1. Éric Chevillard, la banalité faite homme, 2.
Éric Chevillard, la banalité faite homme, 2. Georges Corm, européiste transi.
Georges Corm, européiste transi. Deux levers et un coucher de soleil : Chateaubriand, Flaubert et Lévi-Strauss.
Deux levers et un coucher de soleil : Chateaubriand, Flaubert et Lévi-Strauss. Michel Crépu, sollersien malgré lui.
Michel Crépu, sollersien malgré lui. Marie NDiaye (et Christophe Borhen, menteur).
Marie NDiaye (et Christophe Borhen, menteur). Jan Karski de Yannick Haenel ou le faux témoignage.
Jan Karski de Yannick Haenel ou le faux témoignage.
 Andréas (alias Alexandre Gambler) et Gérard Guest, penseurs de père en fils.
Andréas (alias Alexandre Gambler) et Gérard Guest, penseurs de père en fils. Laurent Binet, un écrivant face à l'Histoire.
Laurent Binet, un écrivant face à l'Histoire. Jean-Luc Nancy, lecteur approximatif de Croce.
Jean-Luc Nancy, lecteur approximatif de Croce. Mathias Enard : Zone, 1 et 2.
Mathias Enard : Zone, 1 et 2. Mathias Enard : Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants.
Mathias Enard : Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants.
10/04/2012 | Lien permanent
La France Orange mécanique de Laurent Obertone

Léon Bloy, Propos d'un entrepreneur de démolitions [1884], in Œuvres de Léon Bloy, t. II (Mercure de France, 1964), p. 77.
 À propos de Laurent Obertone, La France Orange mécanique (Éditions Ring, 2013).
À propos de Laurent Obertone, La France Orange mécanique (Éditions Ring, 2013).Le succès de librairie de l'ouvrage de Laurent Obertone* est l'un des nombreux signes d'un pays profondément malade.
Malade de son insécurité, comme le pensent les thuriféraires du constat, implacable, et des thèses, pour le moins tranchées, exposés par l'auteur ? Malade à force d'être pressurisé par l'étouffoir idéologique qui, depuis des lustres, continue de gauchir la réalité en niant des évidences pourtant criantes, hurlantes, et qui finiront bien par faire exploser le récipient hermétiquement clos sur des personnes qui ne peuvent plus supporter les balivernes lénifiantes de nos édiles et docteurs en pureté qui ont, comme de petits papes laïcs, le pouvoir d'excommunier celles et ceux qu'ils qualifient d'hérétiques ?
Malade de son insécurité, certes, niée par quelques imbéciles et idéologues en déroute, et que, pour ma part, je n'ai jamais remise en question dans sa réalité brutale, laissant la parole à plusieurs personnes dont je ne partage pas forcément les présupposés politiques et philosophiques ni même l'analyse (comme Alexandre Del Valle, Germain Souchet, Francis Moury ou encore Jean-Gérard Lapacherie). Du moins leurs analyses sont-elles assez solidement étayées, ce qui, à défaut de constituer une vérité révélée, représente un gage de sérieux et la base d'une véritable discussion, comme celle qui s'engagea pendant une fameuse et très polémique série initiée par Francis Moury et intitulée Bellum civile qui me semble, à la relire, malgré ses outrances assumées par les intéressés, être beaucoup plus claire, pertinente et stimulante que le texte de Laurent Obertone.
Notre pays, répétons-le, est malade. Malade de la négation de la réalité. Malade de l'abrutissement des consciences, pourchassées lors de véritables ratonnades verbales, où les malheureux contrevenants à la rigide doxa sont passés au tabac des accusations moralisatrices, que dénonce d'ailleurs l'auteur avec la dernière énergie. Ainsi, bien que la préface du livre de Laurent Obertone, rédigée par Xavier Raufer, soit toute proche de l'insignifiance, elle ne s'est pas trompée en annonçant les trois étapes par lesquelles les thèses de l'auteur allaient être, sont, désormais, disqualifiées (cf. p. 8). À ce titre, ma propre note présentera au moins l'avantage, du moins je l'espère, d'échapper à cette disqualification en trois étapes (l'indignation, la fine bouche, les attaques ad hominem) aussi sommaire que convenue, du reste depuis longtemps exposée, mais dans un tout autre domaine que celui d'Obertone puisqu'il s'agit de la critique d'art (et de littérature), par un Jean-Philippe Domecq ayant bataillé contre Philippe Sollers et sa ridicule soldatesque. Procéder de la sorte, par une mise à l'index du livre qui dérange, c'est bien évidemment faire croire que le texte rejeté plus que critiqué pourrait se révéler dangereux, ce qu'il n'est en aucun cas, tant il manque de sérieux.
La France est encore malade de la nullité intellectuelle de ses hommes politiques, de l'impuissance coupable d'un État en quasi-faillite, de son incapacité à former des générations aptes voire dignes de comprendre ce qu'elles voient, écoutent et, dans le meilleur des cas, lisent ou plutôt, désormais, déchiffrent.
Notre pays est malade de la perte de toute référence à un arrière-pays (au sens que donne Yves Bonnefoy à cette expression) symbolique qui a, jadis plutôt que naguère, fait sa puissance et surtout son rayonnement artistique et littéraire.
La France est malade d'une perte de sa propre souveraineté, y compris symbolique et spirituelle, qui fit la prééminence, durant des siècles, d'un pays désormais saigné à blanc par l'incurie tranquille des gouvernements socialistes (et François Hollande peut à bon droit être considéré comme le parangon de l'insignifiance, Monsieur Homais accédant aux plus hautes fonctions de l'État) et la peur, à peine plus agitée et elle aussi tranquille, bonhomme, la peur (mais de qui ou de quoi, grands dieux ?) des gouvernements de droite, qui n'ont jamais été aussi pressés, avec Giscard, Chirac et même Sarkozy, de reprendre le crédo socialiste et surtout de l'appliquer.
Tant de maux affligent notre pays que c'est miracle qu'il soit encore, vaille que vaille, debout !
Notre pays est surtout malade d'une situation devenue je le crains inextricable, où les apôtres et les exécrateurs (ces deux termes ne sont point trop forts, au vu des réactions que j'ai pu lire) de l'ouvrage de Laurent Obertone peuvent, à peu de choses près, être renvoyés dos à dos. Les exécrateurs se trompent et, en guise de diable, je ne vois qu'un auteur presque gêné de constater que son nom est indissociablement lié à une polémique, bien évidemment strictement germanopratine. Les apôtres se trompent eux aussi et, en guise de Christ, je ne vois qu'un journaliste ayant fait parler de lui, comme on dit dans les campagnes (ou ce qu'il en reste), avec une pointe de mépris railleur pour les gars de la capitale.
Les exécrateurs du livre d'Obertone se trompent lorsqu'ils affirment que notre pays, pas plus qu'un autre pays développé, n'est ou ne serait gangrené par une violence de plus en plus flagrante et gratuite (c'est la thèse d'Obertone, qui évoque une ultra-violence, terme impropre s'il en est, car il n'y a pas d'au-delà de la violence, nous y reviendrons, mais une racine, qu'Obertone se garde bien de mettre à nu).
Ils se trompent encore, mais du moins sont-ils cohérents avec leurs petites habitudes staliniennes, lorsqu'ils fouillent, comme le fait Mediapart, dans le passé de l'auteur, pour, en révélant, du moins le supposent-ils, des aspirations vaguement stylistiques noyées dans des textes impubliables (et impubliables, d'abord, parce qu'ils sont mauvais), annuler la portée d'un texte présent, signé, du moins le prétendent-ils une fois de plus, par la même personne.
Nul besoin de savoir si, ancien blogueur, Laurent Obertone a été l'ami pseudonymique ou déclaré de quelques paumés extrémistes à comiques prétentions littéraires, politiques ou, simplement, journalistiques, pour affirmer que son livre est, en un seul mot qui ne manquera pas de décevoir ou fâcher les apôtres (qui me traiteront, au hasard, de remplaciste ou de Judas) et les exécrateurs (tout marris de constater que je partage le constat posé par le livre d'Obertone), décevant.
Les apôtres du livre d'Obertone se trompent lorsqu'ils portent aux nues un texte censé révéler l'atrocité de la situation française, où l'ultra-violence est reine, les politiques forcément incompétents et ridiculement impuissants, accablés par le prurit du laxisme, voire d'un angélisme pustuleux qu'ils n'en finissent pas, comme l'idéologue antédiluvienne Christiane Taubira vouée à toutes leurs gémonies, de gratter (voir les chapitres 5 et 4 de l'ouvrage qui, comme les autres, procèdent par un empilement d'exemples dont certains, qui le nierait ?, donnent le frisson).
Nul besoin de constater que l'ultra-violence est le fait d'individus le plus souvent (restons prudents) d'origine extra-européenne (mais aussi intra, avec la question pour le moins embarrassante des Roms, évoquée pp. 278 et sq.) mais devenus Français comme vous et moi, et qui n'obéissent à aucune loi sinon celle du plus fort, donc à la loi de l'argent, sauvageons que Laurent Obertone nomme ironiquement des rhinocéros (lesquels sont utilement secondés par des hippopotames ou des éléphants, cf. p. 113).
Nul besoin de craindre, selon la camusienne prophétie du Grand Remplacement, que ces individus, si ça continue, boutent hors de leur propre pays les bons Gaulois à moustache (camusienne) et yeux bleu (l'ayant pourtant vu de près, je n'ai jamais pu déterminer la couleur véritable des yeux de Renaud Camus : ils doivent être transparents) et égorgent à longueur de journée des moutons et de bons catholiques, du moins ce qu'il reste des seconds, que nous pourrions peut-être, réflexion faite, confondre avec les premiers, nul besoin, donc, d'affirmer valables et mêmes en partie réelles ces craintes, pour répéter que le livre de Laurent Obertone est, en un seul mot qui va de plus en plus fâcher, et que je souligne comme pour le faire exprès, décevant, voire, tout simplement, mauvais.
Je dois d'ailleurs immédiatement remarquer que le fait d'être mauvais est sans doute beaucoup moins grave que celui d'être faux mais, comme je n'ai, à la différence des spécialistes et de ceux qui, n'ayant aucune compétence particulière, n'en discutent pas moins de tous les sujets imaginables, aucun chiffre à opposer à ceux que Laurent Obertone nous donne et confirme longuement en répondant aux critiques, ma foi, je ne puis que me taire.
Un chiffre n'est rien, fût-il astronomique (et tous les chiffres en provenance de l'ONDRP que nous communique l'auteur sans les croiser avec d'autres sources, sont astronomiques), s'il n'est sous-tendu par une réflexion digne de ce nom à laquelle il confère une solidité argumentative, en plus d'exemples frappants. Comme le dit un des protagonistes questionné par Obertone lui-même, «On peut tout faire dire aux chiffres» (p. 144). Quoi qu'il en soit, n'importe quel citoyen français peut se faire une idée de l'insécurité estimée, en France, au moyen d'un site tel que celui-ci ou bien celui-là.
La réalité de la violence, elle, est tout simplement, par définition, hors de portée de nos plus fins instruments de mesure, qui jamais ne parviendront à rendre compte non seulement de tous les cas réels, avérés, de violences commises sur des personnes, mais aussi du sentiment d'insécurité qui, à la différence de ce qu'a déclaré tel angelot asexué devenu mystérieusement Premier ministre, ne peut se confondre, encore moins se substituer à la violence réelle.
Dans le livre de Laurent Obertone, tous les exemples sont frappants, et pour cause, puisqu'ils ont sans doute été choisis pour frapper les esprits qui, hagards ou dégoûtés une fois qu'ils auront fini de lire ce livre, se diront que, vraiment, là, ça suffit, il faut faire quelque chose si on ne veut pas devenir des étrangers dans notre propre pays.
Ces chiffres contestables (comme tous les chiffres), cette multitude d'exemples d'atrocités commises en France, qui m'ont fait immédiatement penser au compte rendu précis des centaines de meurtres de femmes tels que 2666 en accumule l'horreur dans un chapitre saisissant, échouent dans leur intention, qui était, du moins je le suppose, de conforter les thèses de Laurent Obertone.
Ils ne confortent absolument rien, et tournent à vide dans la monotonie de l'ultra-violence ainsi mise en scène et dévidée, d'une manière toute houellebecquienne, c'est-à-dire anodine, sans jamais hausser le ton (il reste toutefois, dans ce domaine, des efforts à accomplir pour que Laurent atteigne la nihiliste sérénité de Michel) et, parce qu'ils remplissent le vide d'un livre autrement à peu près insignifiant ou peu s'en faut, ils font, bien davantage que celui de l'extrême droite, le jeu des plus intolérants laxistes dont s'honore notre pays, ces laxistes haineux qui, si on ne les arrêtait pas, ne craindraient pas de punir, pour l'exemple, les victimes.
Pourquoi ? Parce que ce livre peut être critiqué depuis son paratonnerre (l'implosion, probable sinon certaine, de la France, suggérée tout au long du texte) jusqu'à sa cave (la présence, massive, d'une population d'origine immigrée, cause probable voire certaine de l'ultra-violence), sans qu'une seule brique de l'édifice laxiste ne soit déplacé de l'épaisseur d'un cheveu.
J'ai dit que ce livre était à peu près insignifiant. J'aurais pu affirmer qu'il l'était complètement, si je n'avais quelque respect pour les nombreuses victimes, bien réelles, d'une violence devenue endémique, ainsi que pour les rédactions de jeunes écoliers, qui, en tirant la langue parce qu'ils se concentrent de toute leurs forces, rendent à leur professeur de sciences naturelles une copie où ils auront préalablement dévoilé les plus hauts mystères philosophiques, tout en saupoudrant leur prose de noms (sans jamais directement sourcer leurs vagues platitudes) tels que Charles Darwin (évoqué, ironiquement, p. 311) ou Konrad Lorenz.
Voici le résultat auquel Laurent Obertone parvient, qui n'est rien de plus, à mes yeux, qu'un devoir poussif de sciences naturelles, disons digne d'un élève de sixième : «La sécurité préoccupe les mammifères depuis la nuit des temps. Elle se matérialise par l'angoisse, par la peur de ce qui peut éventuellement nous arriver, dans un environnement que nous ne maîtrisons pas, ou face à des individus que nous ne connaissons pas» (p. 21).
À quel jeune âge un de mes maîtres m'a-t-il repris en affirmant que la pire façon de commencer une rédaction résidait dans l'usage de ces marqueurs de sémantisme vide qu'étaient des expressions comme depuis la nuit des temps ? Ce devait être en classe de septième je crois. Laurent Obertone n'a donc qu'une année de retard, pardonnons-lui ce genre de coupable négligence au vu, m'objectera-t-on, de la gravité du sujet qu'il évoque.
Continuons de suivre l'évolution de l'aisance rédactionnelle du jeune Obertone, à présent qu'il vient de rendre son devoir de philosophie dont le sujet était, je vous le donne en mille, la violence : «Pourquoi ne pas les frapper [les femmes] ? Tout simplement parce que ce sont les femelles qui choisissent les mâles (sélection sexuelle) dans l'intérêt évolutif de l'espèce toute (sic) entière. Les mâles doivent faire en sorte d'être choisis sur des critères biologiquement rassurants (leur force, leur beauté, leur santé, leur pouvoir, leurs ressources, leur aptitude à séduire, etc.). L'option «taper sur la femelle» n'est pas évolutivement stable. Donc elle n'existe pas» (p. 89).
Parce que je suis un catholique, donc un homme pétri des douces vertus de la charité, je ne m'attarderai pas sur le degré zéro de l'écriture obertonienne, dont nous pourrions, ne serait-ce que dans ce seul huitième chapitre (intitulé, aussi pompeusement que faussement, Aux sources du mal), multiplier les exemples (1), pour évoquer la faiblesse de la pensée qui sous-tend, justement, de tels propos.
De deux choses l'une : soit Laurent Obertone a décidé, volontairement, de s'adresser à des imbéciles grâce à des phrases creuses que les imbéciles pourront, moyennant quelque effort tout du moins, parvenir à comprendre dès la deuxième ou troisième lecture. Soit Laurent Obertone exprime-là, par le biais de sa langue la plus pure, sa pensée la plus originale, et je vous laisse en tirer les conclusions nécessaires sur le prétendu caractère irréfutable de son livre, ou, tout simplement, sur son intérêt.
Par charité également, nous éviterons de trop moquer l'usage, récurrent chez les cancres comme l'a amplement démontré René Pommier dans ses textes savoureux et imparables, des pseudo-thèses de René Girard, du moins de la pseudo-thèse la plus fameuse de ce penseur pour comptoir, celle du bouc émissaire qui, traduite en langage obertonien, donne ce résultat : «Savez-vous ce qu'est un bouc émissaire ? Ce n'est pas uniquement un prétexte pour culpabiliser les Occidentaux, lorsqu'ils sont électoralement de mauvaise humeur. Le bouc émissaire est essentiel à la construction identitaire. Nous avons tous un bouc émissaire, voire plusieurs. Les groupes de bonobos aussi ont toujours un bouc émissaire, un souffre-douleur, qui, tel un paratonnerre, concentre l'agressivité du groupe et participe de sa cohésion. Le bouc émissaire est le premier pas vers la naissance d'un autre groupe, l'autre groupe est le premier pas vers la naissance d'une autre espèce» (p. 97).
Approfondissons notre lecture de ce chapitre qui, à bien des égards, peut être considéré comme le cœur de l'argumentation de l'auteur et qui tiendrait en une phrase obertonienne de la sorte : la violence existe depuis la nuit des temps et nous ne pouvons l'éradiquer, ce n'est donc pas le problème, qui réside bien davantage dans le fait que, depuis un certain événement, «des idées nouvelles ont émergé. Les hommes seraient égaux. Les puissants seraient donc des coupables, les faibles des victimes. C'est la morale des faibles, dont parlait Nietzsche, qui a renversé la morale biologique. Cette nouvelle morale étant basée sur l'envie, elle n'a pas manqué de partisans...» (p. 93).
Autrement dit, c'est l'idéologie révolutionnaire, héritée, d'extraction lointaine, des postulats chrétiens qui, en promouvant massivement, par les moyens les plus expéditifs dans bien des cas, l'idée de l'égalité des hommes, a favorisé l'émergence d'un groupe d'hommes (vraiment ?) ou plutôt, comme les appelle Laurent Obertone, de rhinocéros. Ces derniers, quels que soient leurs délits, seront systématiquement excusés par la classe politique qui, de droit
24/03/2013 | Lien permanent
Éric Marty, les Juifs, Léon Bloy et quelques autres

09/03/2004 | Lien permanent
Facebook, perversion ou libertés ?, par Thierry Guinhut

06/03/2011 | Lien permanent
Péguy point final de Benoît Chantre

 La Répétition de Sören Kierkegaard.
La Répétition de Sören Kierkegaard. Charles Péguy selon Jean-Noël Dumont : l'axe de détresse.
Charles Péguy selon Jean-Noël Dumont : l'axe de détresse. À propos de Benoît Chantre, Péguy point final (Éditions Le Félin, 2014).
À propos de Benoît Chantre, Péguy point final (Éditions Le Félin, 2014).Inutilement sollersienne, donc inconsistante et se prêtant à des jeux de mots ineptes (1), parfois aussi franchement énigmatique que pseudo-poétique (2), la préface que Benoît Chantre donne à son livre dont le souhait est de «faire sentir la pensée propre à l'écriture de Péguy» et de montrer une seule chose, «Que l'histoire peut être jugée, sauvée par un acte d'héroïsme» (p. 14) mais aussi de «creuser plus profond, pour parvenir à la source, recourir à l'origine» (p. 21), cette préface me semble rendre peu justice aux différents chapitres qui composent le livre.
Ces chapitres, en dépit des différentes thématiques qu'ils évoquent (l'histoire, la manière de l'écrire, la façon de la retrouver, la lutte contre les historiens à prétentions scientifiques, l'Affaire Dreyfus bien sûr et le lien avec Jean Jaurès, etc.) ont pour point commun de tisser un écheveau, souvent subtil, parfois ridicule lorsque René Girard est lourdement cité (3), autour d'un unique motif, kierkegaardien en diable, qui est celui de la reprise ou répétition, telle que Charles Péguy en organise le motif dans sa propre écriture, répétitive, elliptique au sens où nous ne tournons pas en rond mais progressons imperceptiblement, lancinante, en un mot admirable.
 Il s'agit, pour Benoît Chantre, d'incarner ce retour (du peuple, mais aussi de l'événement historique, cf. pp. 28 et 31, de la vraie lecture, de l'héroïsme véritable) par le biais «du nouveau style» que l'écrivain «cherche à fonder en 1905», soit lors de la publication de Notre patrie ou, comme l'écrit Péguy lui-même, de mettre en écriture «un mouvement qui prend en soi son point d'appui, qui part de soi-même et rejaillit de soi, qui attaque toujours, qui tient une perpétuelle offensive, qui altère délibérément, qui change. La réalité» (pp. 32-3). Que s'agit-il donc de faire advenir et, question directement liée à cette dernière, «Qu'est-ce qui fonde une écriture ?» Benoît Chantre écrit : «Telle est la question à laquelle Péguy aura tenté de répondre. L'émergence, au cœur de son texte, d'une patrie retrouvée est plus qu'une résistance à une menace de guerre : c'est aux racines mêmes de l'historicité républicaine que le texte puise ici» (p. 33). Quelques lignes plus bas, Benoît Chantre précise son propos, Charles Péguy ayant selon lui tiré les leçons de l'échec des Universités populaires qui prétendent faire la classe au peuple : «Péguy chercha moins à dire quelque chose qu'à faire émerger au cœur de son texte ce qui lui donne lieu d'écrire, cette patrie qui est sienne, instance légitimante de son discours; mais nôtre aussi, puisque c'est à sa mouvance qu'il nous appelle, nous autres lecteurs, à participer» (p. 34, l'auteur souligne). C'est donc «la patrie» qui, «entendue comme l'unité contagieuse de l'auteur et du lecteur, est le mouvement de sens qui traverse le texte» (p. 35). De fait, «la prose, apparue dans l'écriture et s'excédant dans la lecture, n'était pas un simple effet de littérature, mais une grâce désireuse de faire battre l'histoire à sa mesure», même si la suite du propos de Benoît Chantre sonne comme du Philippe Muray devenu abscons : «L'accord contagieux, le courant de mémoire esquissé dans l'advenue festive du style, soudain transformé dans l'événement de la lecture, n'a pas cessé de travailler la prose» (p. 53). Disons, plus clairement, plus simplement, que Péguy est un écrivain et qu'il manifeste son style par et dans son écriture, écriture qui condense et illustre sa vision d'une histoire réellement incarnée, d'une patrie qui est, d'abord, le texte.
Il s'agit, pour Benoît Chantre, d'incarner ce retour (du peuple, mais aussi de l'événement historique, cf. pp. 28 et 31, de la vraie lecture, de l'héroïsme véritable) par le biais «du nouveau style» que l'écrivain «cherche à fonder en 1905», soit lors de la publication de Notre patrie ou, comme l'écrit Péguy lui-même, de mettre en écriture «un mouvement qui prend en soi son point d'appui, qui part de soi-même et rejaillit de soi, qui attaque toujours, qui tient une perpétuelle offensive, qui altère délibérément, qui change. La réalité» (pp. 32-3). Que s'agit-il donc de faire advenir et, question directement liée à cette dernière, «Qu'est-ce qui fonde une écriture ?» Benoît Chantre écrit : «Telle est la question à laquelle Péguy aura tenté de répondre. L'émergence, au cœur de son texte, d'une patrie retrouvée est plus qu'une résistance à une menace de guerre : c'est aux racines mêmes de l'historicité républicaine que le texte puise ici» (p. 33). Quelques lignes plus bas, Benoît Chantre précise son propos, Charles Péguy ayant selon lui tiré les leçons de l'échec des Universités populaires qui prétendent faire la classe au peuple : «Péguy chercha moins à dire quelque chose qu'à faire émerger au cœur de son texte ce qui lui donne lieu d'écrire, cette patrie qui est sienne, instance légitimante de son discours; mais nôtre aussi, puisque c'est à sa mouvance qu'il nous appelle, nous autres lecteurs, à participer» (p. 34, l'auteur souligne). C'est donc «la patrie» qui, «entendue comme l'unité contagieuse de l'auteur et du lecteur, est le mouvement de sens qui traverse le texte» (p. 35). De fait, «la prose, apparue dans l'écriture et s'excédant dans la lecture, n'était pas un simple effet de littérature, mais une grâce désireuse de faire battre l'histoire à sa mesure», même si la suite du propos de Benoît Chantre sonne comme du Philippe Muray devenu abscons : «L'accord contagieux, le courant de mémoire esquissé dans l'advenue festive du style, soudain transformé dans l'événement de la lecture, n'a pas cessé de travailler la prose» (p. 53). Disons, plus clairement, plus simplement, que Péguy est un écrivain et qu'il manifeste son style par et dans son écriture, écriture qui condense et illustre sa vision d'une histoire réellement incarnée, d'une patrie qui est, d'abord, le texte.S'il s'agit, en somme, de redonner un sens pleinement vécu, temporel, charnel, à l'événement historique, en figurant un parricide par et dans l'écriture qui, paradoxalement, ne se défait jamais tout à fait de son origine (4). Benoît Chantre conclut ce chapitre point formidablement clair, avouons-le, par cette affirmation : «Telle est bien l'expérience inédite à laquelle nous aboutissons : partant en guerre contre le monde moderne et une certaine manière criminelle d'écrire l'histoire, tentant par là une audacieuse sortie de l'histoire, le style de Péguy se gomme lui-même – disparition répétée au cœur de l'écriture – devant un Autre radical» (pp. 56-7).
Le deuxième chapitre de l'ouvrage, intitulé L'âme charnelle, évoque Clio. Dialogue de l'histoire et de l'âme païenne, un très grand texte posthume publié en 1972 par Marcel Péguy. Benoît Chantre note, à propos de l'écriture si caractéristique de Péguy, cette remarque fort juste, qui nous permet, comme je le disais, de retrouver l'image dans le tapis qu'est la figure de la répétition ou de la reprise : «La lenteur de la phrase péguyenne fait tomber les uns après les autres les réflexes du lecteur moderne, habitué depuis Descartes à un certain ordre des raisons : l'origine (d'une phrase, d'une pensée, d'une œuvre) dure ici dans le temps pour rappeler que, sans ce souci de l'origine, le temps et l'histoire perdent leur consistance, bégaient ou balbutient, oublient ce qui les fonde, mènent à la catastrophe» (p. 62, l'auteur souligne). De fait, ajoute Chantre, ce sont sans aucun doute tous les textes de Péguy qui peuvent être considérés comme «une longue méditation» de ce point d'origine, l'écriture péguyenne éduquant «à ce retour qui seul peut relancer le temps, remettre l'histoire en mouvement», proposition claire, du moins utile, ce qui n'est pas le cas de cette autre, inutilement moderne au sens le plus étriqué de ce terme qui me fait immanquablement penser aux tripotages textuels de Genette ou du scribouillard infâme qu'est Georges Molinié : «Deux textes s'écrivent donc ensemble, un texte descendant, celui que Péguy me donne à lire, et un texte remontant, celui de l'interprétation que je suis intimé d'en risquer» (p. 65). Il est en effet plus simple de se contenter d'affirmer, comme du reste ne manque pas de le faire Benoît Chantre, que l'événement «de la lecture est une origine retrouvée qui perdure, retissant autour d'elle de nouvelles relations» (p. 68), ou même, et voici la clé du beau titre de cet ouvrage : «Ce que «veut la grammaire», mais aussi la syntaxe, c'est-à-dire la structure horizontale et verticale, syntagmatique et paradigmatique de la phrase péguyenne, c'est aboutir à un point final qui soit aussi un point d'origine» (p. 84, l'auteur souligne), et c'est là encore une figure de la répétition.
C'est dans le troisième chapitre de son ouvrage, intitulé Reprise politique parlementaire qui traite de la relation complexe entre Charles Péguy et Jean Jaurès que Benoît Chantre, évoquant le Deleuze de Différence et répétition, rappelle que l'écrivain peut être considéré, avec Kierkegaard et Nietzsche, comme l'un des trois grands philosophes de la répétition.
Selon Benoît Chantre, Charles Péguy estime «que seul un recommencement de l'Affaire pourrait relancer le socialisme en France; qu'il n'y a donc pas chez lui de refus a priori du politique, mais une pensée politique fondée sur une certaine idée de la reprise, précisément, du recommencement, de la répétition», Jaurès, en somme, répétant mal, lui qui «aiguille le socialisme vers un destin seulement parlementaire» (p. 103), alors que Péguy, au contraire, tente de retrouver l'énergie originaire du dreyfusisme avant qu'il ne s'abîme dans la politique des «justifications constantes» et qu'il n'ait oublié d'illustrer et de servir ce qu'il fut à l'origine, une «promesse de régénération morale» et sans doute, aussi, spirituelle, Péguy tentant donc, dès sa rupture avec Jaurès, de «résister au mouvement qui emporte de jour en jour l'Affaire vers sa registration» (p. 106).
Cette résistance contre le mouvement, apparemment implacable, qui fait dévier la politique de sa finalité philosophique et même, nous le savons, mystique, Charles Péguy l'organisera contre Jaurès mais aussi contre ses ennemis, l'un des plus farouches étant Charles Maurras, contre lequel Péguy estimait qu'il était le seul ayant «la plume assez dure» pour réduire le patron de l'Action française qui attaqua de façon ignoble comme toujours, nous rappelle Benoît Chantre, Bergson faisant son entrée à l'Académie (cf. p. 108).
Charles Péguy, dans son combat, n'est toutefois pas seul puisque, derrière Dreyfus, «il y a Bernard-Lazare» et, «derrière Bernard-Lazare, il y a Jésus : la vraie répétition revient en amont de ce qu'elle répète, et frôle une sortie du temps» (p. 109) écrit justement Chantre, à condition toutefois de rappeler que cette sortie du temps n'est rien d'autre qu'une miraculeuse possibilité de reconquête du temps, comme La Répétition de Kierkegaard l'illustre.
Dès lors, recommencer, selon Benoît Chantre, «n'est pas ici trahir, mal répéter, mais réaffirmer de l'intérieur ce qui fait l'essence de l'événement chrétien, rentrer à nouveau dans cet événement, en descendre ou en remonter le cours à sa guise» (p. 114), puisque le visage de Bernard-Lazare est devenu, aux yeux de l'écrivain, celui du Christ (cf. p. 115), la mystique relançant en somme la politique, lui donnant un élan vital, l'incarnat de tout le poids de la chair humaine point totalement encore submergée par la registration, ou ce que nous pourrions appeler, parodiant un publiciste narcissique et xénophobe à la mode du café de comptoir, le Grand Registrement.
Le quatrième et dernier chapitre, intitulé Le jugement de l'histoire pose la thèse selon laquelle la «répétition péguyenne» qui «relaie, dans l'écriture, l'exigence révolutionnaire de justice enfin réalisée» ou plutôt, dirions-nous, devant être réalisée, «ne fait donc qu'un avec ce travail de dépassement et de remise en mouvement du droit : elle porte les exigences de ce dernier à l'infini» (p. 123). Ainsi, la défense de Bernard-Lazard, le fait de lui «redonner sa juste place», de faire et refaire son portrait durant de longues années (1903-1910), c'est aussi écrire «le récit historique de celui qui donna sa vie pour défendre une victime en particulier, puis toutes les victimes de l'histoire», c'est donc «révéler celui qui donna sa vie pour révéler des innocents» (p. 135), ceux-là même qui n'hésitèrent pas à se jeter sur l'ennemi du front et à être stoppés nets d'une balle dans la tête.
Notes
(1) «Génie ? G nié plutôt. Faites clignoter la consonne dans ce nom, gens exilés, et il vous donne un pays. Personne n'y avait pensé. C'était pourtant là tout proche, comme une lettre volée», pp. 11-2, l'auteur souligne. Une page plus loin, nous trouvons : Race de la gloire, grâce de la Loire. Clignotement d'une lettre, de l'Être même au sein du temps, qui le fatigue, l'étire, l'accélère ou le freine» (p. 13).
(2) «Charles Péguy, immobile à grands pas, fait clignoter dans son nom la solution du problème. Ce qui manque aux proses modernes, à celle de Renan, de Taine, de Lavisse, de Seignobos – chapeaux noirs, chapeaux melons, cannes-épées –, à leur écriture incertaine, tout embarrassée de sa métaphysique, à ces cuirasses ignorantes du véritable amour, c'est une assise, un paysage qui se dérobe sans cesser de soutenir, un pays «trouvé du premier jet», nous dit Péguy, maintenant que ça marche, qu'une autre vitesse, un autre sagesse, est enclenchée, une géodésie, donc, une géologie, une longue généalogie épuisant la race au fil du temps, la fatiguant, lui faisant rendre son dernier souffle» (pp. 17-8), ou encore «Si la race monte dans la prose qui la laisse advenir, c'est pour que la grâce vienne d'elle-même, à son heure, rebondir sur ce mouvement, et tout transfigurer» (p. 19). On croirait même lire les inepties du cacographe François Meyronnis en lisant une telle phrase : «La machine répétitive s'emballe alors dans un mouvement spiralé, qui visse dans le ciel» (p. 19).
(3) Références, quelque peu forcées à notre humble avis, à René Girard que nous ne pouvions que fort logiquement trouver sous la plume de celui qui préside l’Association Recherches Mimétiques. C'est dans le chapitre 3 que ces rapprochements sont développés, Benoît Chantre évoquant, à propos de la relation Péguy / Jaurès, une anticipation frappante «sur l'analyse que René Girard fera de la «médiation externe» dans Mensonge romantique et vérité romanesque (p. 90), l'auteur poursuivant en affirmant que la «relation de Péguy à Jaurès est plus qu'une relation intellectuelle et politique, plus aussi qu'une relation affective [...] : elle est une relation mimétique, engageant tout l'être individuel et social de Péguy» (p. 93). La conclusion de l'ouvrage reprend le charabia journalistique de René Girard en évoquant la «crise mimétique essentielle» à l’œuvre dans la problématique péguyenne affirmant que «les Anciens ne reviendront pas», et que «les Modernes peuvent mener au pire», l'entre-deux étant occupé par celui que Bergson appela «les héros de la morale ouverte» (p. 143).
(4) «La monstrueuse paternité de l'historien moderne, déplacée dans le mouvement de la prose péguyenne en un schéma ternaire, est ainsi retournée, dans l'acte de la lecture, en une tout autre paternité; d'écran historique, le texte transformé par son lecteur, renvoie à une paternité mouvante, se fait l'icône de la danse trinitaire : le roi (et l'auteur) se retirent dans l'advenue de l'historien démocratique (et du lecteur), qui eux-mêmes en appellent à l'assistance de celui qui s'est retiré pour les laisser advenir» (pp. 55-6).
08/05/2014 | Lien permanent
Fin de partie : TOUT VA BIEN
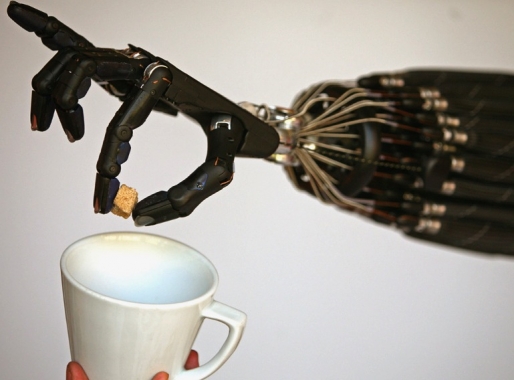
01/04/2004 | Lien permanent
Ce qui vit de la matière...

«Je ne Vous ai pas connu alors, – ni maintenant.
Je n'ai jamais prié quand j'étais un petit enfant.
Ce soir pourtant je pense à Vous avec effroi.
Mon âme est une veuve en deuil au pied de votre Croix ;
Mon âme est une veuve en noir, – c'est votre Mère
Sans larme et sans espoir, comme l'a peinte Carrière.
Je connais tous les Christs qui pendent dans les musées ;
Mais Vous marchez, Seigneur, ce soir à mes côtés.»
Blaise Cendrars, Les Pâques à New York.
«Ce qui vit de la matière, écrivait Karl Kraus dans Pro Domo et Mundo, meurt avant la matière. Ce qui vit dans la langue vit avec la langue.» Il me semble dès lors que j'affirme une pénible banalité en faisant constater que toutes ces bouches cariées, chuchotant autour du cadavre du Saint-Père, vivent d'une vie moins certaine, admirable, immortelle, que cette dépouille, blanchie comme un os et passée on dirait à l'émeri de la souffrance, du Verbe.
Et que dire d'un pays, le nôtre, à tel point coupé de toute grandeur, de tout souvenir, de tout rêve de grandeur, de tout frôlement du sacré, de tout frisson du divin qu'il est capable, grattant fidèlement son prurit deux fois centenaire, de s'émouvoir que son pouvoir politique rende un dernier hommage, pourtant fort modeste si on le compare à ceux rendus par des pays qui sont a priori moins chrétiens que le nôtre, à celui qui fut, aussi (d'abord, disent les mauvaises langues, faisant mine d'oublier la longue tradition de la théologie politique pratiquée par l'Église), à celui qui fut un immense dirigeant, et un dirigeant immense, justement parce que le Saint-Père n'a pas craint de redonner au Politique sa majuscule péguyste, mot, notion et réalités majusculés qu'un Chirac et tant d'autres de ses suiveurs perclus de trouille s'amusent à galvauder un peu plus chaque jour ?
J'écoute les ondes et j'enrage de mon impuissance, de ne pouvoir freiner, ne serait-ce qu'une seule seconde, l'inéluctable progression de cette gigantesque marée de merde qui finira bien par nous noyer. Je me demande parfois si nous ne sommes pas déjà des noyés, déjà des morts, la presse seule, ces milliers de phrases sales proférées par des cadavres nous donnant l'illusion de la vie alors que, pauvres épaves abandonnées même des bivalves, nous nous décomposons lentement dans quelque Sargasse infernale.
J'écoute le vacarme médiatique et j'ai honte de ces édiles borgnes, ces petits pions festifs, gaucholâtres d'une sous-culture merdeuse et s'offrant au vit le plus scorbuteux pourvu qu'il soit tolérant, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Christophe Girard et j'ai honte, oui, j'ai honte de toute la procession miteuse de ces gardiens de la sainte orthodoxie laïcarde, FNESR, FSU, Unsa-Éducation et tant d'autres qu'il ne vaut même pas la peine de nommer, de peur de les arracher au néant.
Nous avions oublié notre baptême. Nous lui crachons dessus à présent. C'est lui qui va nous maudire, maudire notre nation jadis aînée, maudire notre trouille, maudire notre faiblesse qui est peur, c'est lui qui va nous maudire, nous le sommes déjà, maudits, c'est lui, non pas notre baptême, reçu que nous le voulions ou pas mais notre oubli, notre crachat.
05/04/2005 | Lien permanent

























































