Rechercher : pommier girard
L’Architecture de Marien Defalvard ou le roman de l’anthropologie dogmatique ?, 1, par Baptiste Rappin

 Marien Defalvard dans la Zone.
Marien Defalvard dans la Zone.«Disons que j’essaie de fabriquer une architecture (ou d’écrire une langue ?) à la mesure de mon imagination – une langue (une architecture ?) qui soit le discours de mon imagination passé dans les hiéroglyphes français.»
(Defalvard, 2021, p. 131).
«Inventer le jardin, construire l’édifice ou le moteur d’avion, mettre en scène toute chose, c’est l’opération même que nous appelons écrire, avec ce qu’elle comporte de secret, au sens premier de ce terme latin : séparer.»
(Legendre, 2021, p. 33). Les références seront données en fin d’article.
Introduction : La croisée des chemins
 Il n’y a guère de doute : L’Architecture est bien un roman qui prend «le contre-courant de la cascade unanime» (Defalvard, 2021, p. 112), comme en témoigne au premier chef la réception plus que modeste, étique pour tout dire, que les supports officiels du journalisme littéraire, à moins que ce ne soient les supports littéraires du journalisme officiel, lui offrirent lors de sa sortie en début d’année 2021. Qu’un tel livre, dans les pages duquel le lecteur savoure une impeccable maîtrise de la langue française, dans les lignes duquel il découvre un style flamboyant qui parvient à réunir en un unique chapelet une luxuriance de répétitions, de reprises, de redondances, d’incises et d’enchevêtrements de propositions, aille à l’encontre du mouvement général de simplification de la langue, ne saurait à vrai dire surprendre. Mais le plus étonnant, pour nous qui ne faisons pas profession de critique littéraire, est que la puissance de L’Architecture ne se limite pas à ces considérations littéraires, elle est également et pleinement philosophique, théologique, anthropologique.
Il n’y a guère de doute : L’Architecture est bien un roman qui prend «le contre-courant de la cascade unanime» (Defalvard, 2021, p. 112), comme en témoigne au premier chef la réception plus que modeste, étique pour tout dire, que les supports officiels du journalisme littéraire, à moins que ce ne soient les supports littéraires du journalisme officiel, lui offrirent lors de sa sortie en début d’année 2021. Qu’un tel livre, dans les pages duquel le lecteur savoure une impeccable maîtrise de la langue française, dans les lignes duquel il découvre un style flamboyant qui parvient à réunir en un unique chapelet une luxuriance de répétitions, de reprises, de redondances, d’incises et d’enchevêtrements de propositions, aille à l’encontre du mouvement général de simplification de la langue, ne saurait à vrai dire surprendre. Mais le plus étonnant, pour nous qui ne faisons pas profession de critique littéraire, est que la puissance de L’Architecture ne se limite pas à ces considérations littéraires, elle est également et pleinement philosophique, théologique, anthropologique. Nous n’entreprenons point ici un inventaire complet : mais notons tout de même que l’on rencontre au fil des pages, à côté des Chateaubriand, Stendhal Montherlant, Bourget, Gracq et Borges qui forment des références littéraires que l’on pourrait dire «classiques» ou à tout le moins attendues dans le cadre de cet exercice, Pascal et les jansénistes, Jules Michelet, Karl Marx, Friedrich Nietzche, Martin Heidegger, Simone Weil, René Girard, Jean Baudrillard, etc., bref inventaire qui donne un aperçu du matériau philosophique qui forme l’ossature conceptuelle de L’Architecture. Il nous semble toutefois qu’une présence hante les pages du roman – qu’il serait très certainement plus pertinent de qualifier de «journal littéraire et philosophique», tant l’intrigue passe au second plan, éclipsée par la gigantesque fresque historique et sociale à laquelle se livre Defalvard – de son début à sa fin : il s’agit de l’œuvre de Pierre Legendre dont les rares apparitions explicites, nous en avons relevées en tout et pour tout cinq dans l’ensemble de l’ouvrage, masquent le caractère structurant de l’anthropologie dogmatique pour et dans L’Architecture (1).
Il est alors, de ce point de vue, particulièrement heureux que les Éditions Ars Dogmatica aient publié les mémoires de Pierre Legendre au mois de mars 2021, soit deux petits mois après L’Architecture. L’avant dernier des jours, sous-titré «Fragments de quasi mémoires» n’est autre que le récit, dans lequel le lecteur reconnaît l’écriture ramassée et fulgurante de l’historien du droit, son génial sens de la formule et de la métaphore, de «sa volonté d’échapper aux machins académiques» et de son «long voyage vers les racines du malaise» (Legendre, 2021, p. 11) non seulement de l’université mais également, et avant tout, de la civilisation occidentale. Dès lors, l’occasion était trop belle et la tentation irrésistible : il nous fallait proposer une lecture croisée de ces deux ouvrages en prenant pour fil directeur, c’est évident, le motif de l’architecture.
Le motif de l’architecture
Le décor de L’Architecture n’est autre que la ville de Clermont-Ferrand, capitale de l’Auvergne et ville de tradition industrielle et universitaire. C’est en premier lieu et principalement sous l’angle de la catastrophe, voire de la fin des temps, que se présente le motif de l’architecture chez Defalvard : «La catastrophe était survenue, voilà ce que me présentait l’architecture, depuis le début, depuis l’orée de mon arrivée, de ma survenue dans ce lieu; la catastrophe se montrait dans la ruine volontaire, dans la destruction volontaire, dans tout cet espace minitieusement, désirablement ruiné, rendu présentable pour toutes les forces négatives, temporelles, pour toutes les pulsions affichées sur les banderoles au fronton des municipalités» (Defalvard, 2021, p. 34). Assurément, l’auteur n’appartient pas à la cohorte des lanceurs d’alerte qui ne cessent de sonner le tocsin dans l’espoir d’éviter les drames – écologiques, économiques, sociaux, politiques, culturels, migratoires – qui menacent de submerger la société et la nation françaises; non, pour Defalvard, la catastrophe est derrière nous, elle a déjà eu lieu, et elle se donne à voir de façon privilégiée, d’un point de vue phénoménologique, dans la réussite de la planification d’une «désarchitecture», dans le succès de la programmation technoscientifique de la dégradation de l’architecture, c’est-à-dire, au fond, dans le triomphe de l’urbanisme. Et cette dévastation d’être aussitôt mise en relation avec la possible expression de pulsions, assimilées à des forces négatives : précieux indice qui derechef met en exergue le fait que l’architecture ne saurait naïvement se réduire à des considérations de matière et de forme, mais se trouve être le lieu privilégié d’une économie psychique et symbolique qui reste à décrire.
Mais quel est, plus précisément, le signal de cette catastrophe ? Ou la nature de cette architecture catastrophée ? «C’est une architecture, mettons de la façon la plus claire, du socialisme réalisé, du socialisme achevé, parachevé, abouti, accompli – mais ceci pas au sens idéologique : plutôt au sens médical, pharmaceutique, postchrétien ou préchrétien, administratif, charitable […]» (Defalvard, 2021, p. 39-40). Un socialisme achevé, contrairement à ce que l’on pourrait croire de prime abord, ne s’accomplit pas dans la réalisation de ses promesses idéologiques, par exemple dans l’abolition de la propriété et la collectivisation des moyens de production; il se réalise bien plutôt dans la mise en place d’une prophylaxie déployée à l’échelon collectif, dans le déploiement d’une thérapeutique ou d’une médication qui ne vise plus à soigner l’individu mais le collectif si ce n’est l’humanité. De ce point de vue, le socialisme achevé tient bien plus de l’utopie saint-simonienne, qui au primat des hommes d’affaires et des ingénieurs associe un nouveau christianisme inspiré de «la Sainte Expérience» des Quakers en Pennsylvanie (Rappin, 2018), qu’au raisonnement dialectique et scientifique, mécanique pour tout dire, de Marx. De sorte qu’une architecture socialiste parvenue à son point exquis, c’est-à-dire celle de la ville de Clermont-Ferrand, parvient à célébrer l’apothéose de «l’horreur de la fraternité réalisée« (Defalvard, 2021, p. 40) à travers un «sacrifice esthétique complet» (Ibid.).
Cependant, le narrateur, architecte de métier, ne baisse pas pour autant les bras et lance un défi à son époque : «J’étais décidé à proposer ceci : une architecture catholique, un gallicanisme parfait, qui nie absolument tout ce qui pouvait se tramer dans la trame médiocre de nos existences individuelles. J’étais décidé à proposer une consomption du Moi; à ériger […] un édifice public qui puisse dire, de quelque côté qu’on le regarde, que le Moi était haïssable« (Defalvard, 2021, p. 70). Puisque l’architecture ruinée libère les pulsions et les forces négatives, puisque la fraternité réalisée de l’urbanisme socialiste ne vise qu’à gommer toutes les aspérités pour ne laisser subsister que des individus égaux, alors la restauration de l’architecture ne saurait emprunter une autre voie que celle de la consomption du Moi, c’est-à-dire d’un scellement des pulsions cadenassées par une normativité millénaire ressuscitée : celle du catholicisme romain du narrateur, que l’on suppose être également celui de l’auteur, et dont le rapport à la laideur forme justement, selon son aveu même, le cœur de l’ouvrage : «Je voudrais revenir encore une fois à ce qui doit faire, devrait faire, ferait idéalement l’armature de ce livre : les rapports du catholicisme romain, de la mentalité chrétienne en général (des vertus théologales, par exemple : foi, espérance, charité) et de l’antiesthétique, du refus proclamé de la beauté comme valeur ou vertu, et de la laideur désirée comme surplomb moral» (Defalvard, 2021, p. 260).
On verra plus bas que le catholicisme constitue un important point de friction entre le roman de Defalvard et la pensée de Legendre. Il n’en reste pas moins que ce dernier fait de l’architecture l’un des motifs essentiels de son œuvre, désormais riche de dix Leçons, de plusieurs autres ouvrages ainsi que de multiples conférences. Nous en avons déjà donné une vue d’ensemble dans un autre article (Rappin, 2019) et, par voie de conséquence, braquerons dans le présent texte l’objectif sur L’avant-dernier des jours, tout en proposant, ici ou là lorsque nous le jugerons pertinent, quelques éclairages complémentaires issus d’autres sources.
L’architecture chez Legendre, donc; elle représente pour ainsi dire l’ambition même de l’œuvre du juriste : «Mes écrits sont le relevé du système de représentation constitutif de l’architecture invisible qui permet d’identifier l’Occident dans l’ensemble mondial […]» (Legendre, 2021, p. 176). Cependant, force est de noter que c’est à travers le thème de la «structure» qu’apparaît le motif de l’architecture. Comme s’il était stratégique de soustraire la structure au structuralisme pour lui donner une portée qui la rapprocherait plus de l’architectonique dans la tradition métaphysique que des lois de la structure sociale dans l’anthropologie de Claude Lévi-Strauss. Lisons plutôt : «Ce qui échappe, mais demeure sous statut de non-su, d’insoupçonnable, ou carrément d’interdit au savoir, c’est l’ordre généalogique du Monde de l’homme en tant que structure. J’insiste sur ce mot : "structure"» (Legendre, 2021, p. 78). La généalogie de l’espèce humaine : tel me semble bien être le cœur de l’anthropologie dogmatique qui fait de ce constat élémentaire mais lourd de conséquence son point de départ, à savoir que l’homme est l’animal qui, pour se reproduire, a besoin d’une raison de vivre. Or, cette organisation de la généalogie mérite d’être appréhendée du point de vue des édifices civilisationnels, c’est-à-dire selon sa structure fiduciaire. Que faut-il alors entendre par «structure» ? Legendre répond : «La notion dogmatique de "structure ", au sens que mon labeur a promu – selon la littéralité latine : une construction –, s’enrichit alors du contact en quelque sorte naturel avec la rigueur de l’architecture et les intuitions sensuelles de la peinture ou de la mise en scène» (Legendre, 2021, p. 116). On s’aperçoit ici que l’architecture n’est qu’une des multiples façons de rendre la notion de «structure» intelligible – et on y rapportera ici les termes d’édifice ou de construction qui témoignent d’une forme de rigueur logique donc implacable – et que la composition et l’arrangement, présents aussi bien en peinture qu’en musique, en forment un complément plus souple, plus charnel. C’est la raison pour laquelle le théâtre, en tant que tableau vivant, en tant que représentation en acte, forme la deuxième métaphore privilégiée pour appréhender la structure de la généalogie.
Une autre citation, issue d’un ouvrage précédent, approfondit encore la définition et la portée de la structure en dressant le pont entre l’architecture et le théâtre d’un côté, et le monde des institutions de l’autre : «Le terme "structure ", que j’emprunte au vocabulaire de l’architecture, est utilisé ici selon son étymologie latine, au sens d’arrangement, disposition, assemblage de construction. Transposé dans le domaine des institutions, il signifie que les grands édifices normatifs de l’humanité doivent être compris comme étant soumis à des règles d’élaboration et d’équilibre, mais aussi comme susceptibles de s’inscrire dans des discours de mise en scène et de style aussi multiples ou diversifiés que les peuples, les histoires, les langues, etc. auxquels ils se rattachent» (Legendre, 1999, p. 194). Les civilisations et les sociétés, les communautés et les cultures ne procèdent assurément pas de la génération spontanée, il semble plus que hasardeux de déterminer a priori leur trajectoire historique; en revanche, elles se soumettent à des règles de composition, à des impératifs institutionnels qui forment l’objet d’étude de l’anthropologie dogmatique conceptualisée par Legendre.
Et, puisque l’homme, l’anthropos, est l’animal langagier par excellence, puisqu’il est animal qui manie le logos autant que le logos le manie, alors il s’ensuit, par conclusion d’un raisonnement déductif dont les prémisses sont exposées ci-dessus, que la Société est construite comme un Texte, qu’elle est un assemblage de textes, ou, selon l’image privilégiée de Legendre, un palimpseste : «Tout mon attirail de concepts, dont le principal est la notion de "structure", – au sens latin premier de construction –, et plus précisément de "structure ternaire", conquise par l’expérience clinicienne, appelle un labeur soumis à une condition sine qua non : comprendre avant tout que la Société est construite comme un Texte« (Legendre, 2021, p. 99). Et le droit qui structure les États modernes, provenant des «deux Piliers du Fiduciaire : Rome impériale, Révélation chrétienne« (Legendre, 2021, p. 280), de ne pas échapper à cette loi structurale : «[…] l’édifice juridique est une construction de discours, il est soumis à l’ordre langagier du discours» (Legendre, 2021, p. 79).
L’anthropologie dogmatique dans L’Architecture
 L’architecture forme incontestablement le point de jonction de L’Architecture et de l’anthropologie dogmatique; nous analyserons, dans les pages qui viennent, comment Defalvard s’empare de l’œuvre de Legendre, nous y départagerons les éléments de fidélité et les élans d’infidélité, et nous remarquerons surtout comment cette mise en mots catholique de la pensée de l’historien du droit vient tordre celle-ci au point d’en détourner voire d’en remettre en question les principales catégories. Mais, dans l’immédiat, place à l’inventaire : tournons les pages de L’Architecture et observons-y la présence lancinante du vocabulaire et des concepts forgés par Legendre.
L’architecture forme incontestablement le point de jonction de L’Architecture et de l’anthropologie dogmatique; nous analyserons, dans les pages qui viennent, comment Defalvard s’empare de l’œuvre de Legendre, nous y départagerons les éléments de fidélité et les élans d’infidélité, et nous remarquerons surtout comment cette mise en mots catholique de la pensée de l’historien du droit vient tordre celle-ci au point d’en détourner voire d’en remettre en question les principales catégories. Mais, dans l’immédiat, place à l’inventaire : tournons les pages de L’Architecture et observons-y la présence lancinante du vocabulaire et des concepts forgés par Legendre. Nous le disions déjà plus haut : le nom de «Legendre» apparaît à cinq reprises dans le récit littéraire et philosophique de Defalvard. La première occurrence se situe à la page 104, soit au tiers de l’ouvrage, sur un mode mineur : «Son site historial, aurait dit Legendre». La deuxième intervient une dizaine de pages plus loin, et relate le passage d’un article du Monde, à une époque, 1997, où un penseur de l’envergure de Legendre pouvait encore écrire dans ce journal. Defalvard cite à cette occasion un extrait qui rappelle l’impératif théâtral de la condition humaine et tire le corollaire de son effacement : l’individu démontable et réparable (Defalvard, 2021, p. 115). La troisième citation, qui s’étale sur plus d’une page, fait état de la découverte de Legendre par le narrateur, entre les murs de la bibliothèque du fond de Jaude (médiathèque de Clermont-Ferrand Centre). Interviennent ici, en plus des développements sur la représentation, des considérations sur le Père, sur le Texte, sur le Dogme, sur l’institution, de telle sorte que cet extrait donne à lire un véritable condensé de l’anthropologie dogmatique (Defalvard, 2021, p. 137-138). La quatrième occurrence a lieu à l’occasion d’une courte et délicieuse sentence de Legendre, selon laquelle «la France est une Union Soviétique qui aurait réussi» (Defalvard, 2021, p. 140). Reste encore une dernière allusion, accessible aux seuls initiés de la pensée de Legendre : «[…] "personne ne rêve à la place d’un autre", aurait dit le mentor hiérarchique du Cotentin, celui des scapulaires rabattus et des vieux serments de Gratien oubliés […]» (Defalvard, 2021, p. 230). Ces cinq mentions, quatre directes et la cinquième allusive, associées pour deux d’entre elles à des citations significatives, permettent d’une part de constater la présence du juriste dans le roman de Defalvard, et d’autre part d’affirmer que l’auteur de L’Architecture possède une connaissance solide de l’anthropologie dogmatique. Mais sont-ce là des raisons suffisantes pour prétendre que la seconde structure la première de part en part ? Assurément non.
Mais voici l’essentiel, voici le plus profondément constitutif : au-delà du simple constat de la présence de Legendre, c’est la présence lancinante du vocabulaire et des concepts de l’anthropologie dogmatique qui interpelle le lecteur familier de l’œuvre de l’historien du droit. Et, de ce point de vue, il devient hors de doute que L’Architecture puise une grande part de son inspiration dans cette puissante pensée.
Procédons dans l’ordre d’évidence, et de façon non pas exhaustive mais toutefois suffisamment massive pour justifier notre thèse. La famille lexicale qui permet, sans l’ombre d’un doute, de rattacher L’Architecture à la pensée de Legendre, est celle issue de Dogma, qui donne les noms de «dogme» et «dogmatisme», ainsi que l’adjectif «dogmatique». Defalvard utilise le terme, avec ou sans majuscule, aux pages suivantes : 54, 68, 94, 98, 111, 186, 202, 222, relevé très certainement lacunaire mais amplement suffisant à notre démonstration. En écho au thème de l’architecture traversé par le fil directeur de la catastrophe, c’est sur le registre de la perte ou des «renoncements» (Defal
15/09/2021 | Lien permanent
L'Incorrect, un modèle de consanguinité cloacale. Quand des nains servent la soupe à d'autres nains, les louches doivent

 Suffirait-il d'aller gifler Romaric Sangars pour arranger un peu la gueule du journalisme français ?
Suffirait-il d'aller gifler Romaric Sangars pour arranger un peu la gueule du journalisme français ? Les Verticaux.
Les Verticaux. Conversion de Romaric Sangars : en route sur le chemin de la Croix-aux-Ânes.
Conversion de Romaric Sangars : en route sur le chemin de la Croix-aux-Ânes. Vivre, penser et surtout écrire comme Jacques de Guillebon suivi d'un addendum.
Vivre, penser et surtout écrire comme Jacques de Guillebon suivi d'un addendum. Nous sommes encore les enfants de nos pères.
Nous sommes encore les enfants de nos pères. D'un exorcisme pas très spirituel pratiqué sur Philippe Muray par Jacques de Guillebon.
D'un exorcisme pas très spirituel pratiqué sur Philippe Muray par Jacques de Guillebon. L'anarchisme chrétien de Jacques de Guillebon et Falk van Gaver.
L'anarchisme chrétien de Jacques de Guillebon et Falk van Gaver. Contamination de Sarah Vajda : Mouchette fiancée de Ian Curtis.
Contamination de Sarah Vajda : Mouchette fiancée de Ian Curtis.L'Incorrect, le magazine de toutes les droites sans tête même si leur cou aborde de beaux colliers de perles, prétend renouveler la presse française et rompre avec la tradition bien ancrée du renvoi d'ascenseur à sensation, celui qui inflige des accélérations de 9 G aux malheureux qui osent y monter, mais leur permet cependant de gagner quelque place enviable. Ce mécanisme peu complexe de piston doit expliquer je pense l'origine de l'expression, ignoble et reprise par tous les ânes, d'ascenseur social. Au sein de L'Incorrect, chacun est le liftier placide et même amical de l'autre, car tous ces Yrieix Denis, Laurent James bien connu des égoutiers angevins, Matthieu Baumier et Gwen Garnier-Duguy, n'ont qu'un but, monter en grade, devenir le n+1 de celui qui, bientôt, ne sera qu'un n-1 malchanceux ou ayant les dents moins longues.
Parce que Jacques de Guillebon est un imposteur d'un talent qui ne souffre la moindre contestation, y compris sous la forme exquisément subtile d'un sermon de Jésuite, il ne pouvait que s'inspirer de ce que font d'autres journalistes au-dessus de tout soupçon, comme le piétrissime Étienne de Montety patron du Figaro (dit) littéraire, homme sans culture ni style fût-il microscopique, mais qui sait tout de même saluer avec une volonté touchante de plaire les plus grands de nos mauvais écrivains français vivants, surtout lorsqu'ils sont sollersiens de plus ou moins stricte obédience.
Je ne reviens pas sur le minutieux démontage de ces petits et grands renvois d'ascenseur propres à la presse et à l'édition françaises, tellement peu discrets à dire la vérité qu'ils seraient bien capables de nous faire vomir et qui à vrai dire ont fait vomir plus d'une fois leur auteur, le consciencieusement implacable Damien Taelman.
Dans le dernier numéro de L'Incorrect, le cinquième déjà c'est fou comme nos petits lapins, en broutant de l'herbe réactionnaire, se reproduisent, nous pouvons assister, sans toutefois que le versicolore tableau nous soit gâché par l'ombre du plus petit étonnement, à une ébouriffante démonstration de consanguinité cloacale maximale ou, en des termes plus mesurés mais sentant frais et bon le tripotage d'organes sanieux fussent-ils christologiques, d'entreléchage à scène ouverte, ou plutôt, à presse dilatée. En effet, Jacques de Guillebon, qui n'est autre que le rédacteur en chef de ce magazine censé renouveler la presse de droite et même la presse française dans sa globalité, et ne me tentez pas car je pourrais bien écrire : la presse mondiale, bref, Jacques de Guillebon que Sarah Vajda n'a point encore surnommé le Bon Guillebon comme elle a surnommé, Sangars, Romaric le Beau, sert la soupe à son cher frère en vocation parousique, le très vertical Romaric Sangars donc qui paraît-il écrit comme il pisse, prie et même dort, debout, droit comme un i, converti qu'il est de la dernière heure, donc tout raidi de s'être «rapidement senti en accord avec [s]a démarche littéraire elle-même» (extrait de l'entretien paru dans L'Incorrect, p. 61). Il est toujours important, surtout lorsqu'on est un fat, d'être en accord avec soi-même, car il serait franchement dommage de perdre, en le négligeant, son premier et probablement seul public : soi-même, et quelques séminaristes qui, en s'endormant, doivent imaginer quelque méphitique incube venu les tenter sous l'aspect de Beau Romaric.
 Notre martial Romaric le Beau, notre d'annunzien Sangars la Farce, s'assouplira bien sûr, en banal esthète qu'il est, insignifiant rimailleur soliloquant quelques rinçures lettristes que ledit évangélique Bon Guillebon a conduit vers les voies de l'autel comme nous l'apprenons dans Conversion et, plus prosaïquement, vers son siège de patron des pages Culture de L'Incorrect, car les voies du Seigneur sont décidément impénétrables, y compris même pour les êtres démontrant leur capacité à ployer une échine qu'ils ont de toute façon admirablement souple. C'est dans ce même entretien que Jacques et Rémi rendent grâces à Richard (Millet) d'avoir écrit son dernier livre, et c'est dans ce même entretien au-dessus de tout soupçon de copinage que nous découvrons que Romaric le Beau, Sangars le Vertical est également un penseur de grande profondeur, capable d'affirmer, remarquable facilité journalistique, que «la littérature est le moyen le plus pertinent pour réussir ses échecs», ou que, consternante banalité, son retour au christianisme est un mouvement identitaire «au sens large : car la quête de l'autre est une quête de soi», ou encore que «le christianisme intègre tout, sauf le mal qui est un défaut d'existence», bêtise stratosphérique et peut-être même émpyréenne qui nous montre que, tout profond penseur qu'il est, nourri de Thibon et de Dantec c'est dire, mais n'ayant visiblement pas ouvert un livre de l'Aquinate, Romaric le Beau a besoin de quelques cours du soir de catéchèse pour être au niveau d'un premier communiant, ce qu'il est d'ailleurs, et restera visiblement jusqu'à la fin de ses jours. Au cas où certaines personnes ne sauraient pas lire, L'Incorrect a même prévu la version sonore de son passionnant entretien avec Romaric. Le propos est toujours aussi désespérément plat, mais qu'importe, puisqu'il y a fort à parier que les lecteurs des textes de Sangars ne se soucient pas vraiment de savoir que ce qu'il raconte, au mieux, est indigent. Voyons, si avec une telle couverture médiatique Conversion ne se vendait pas à 300 exemplaires, ce serait à désespérer de l'intelligence des Français, n'est-ce pas cher Léo Scheer ! Notons tout de même que jamais les lecteurs de ce livre n'évoquent ce qu'il est : un livre donc, c'est-à-dire un texte écrit. Voyez ainsi comme un certain Patrick Wagner, pour la chronique de Livr'Arbitres dans Présent, ne fait que broder sur la quatrième de couverture, sans jamais aborder l'écriture proprement dite de Sangars, qui n'est certes pas désagréable, mais ne parvient tout de même pas à masquer la nullité du propos, ce qu'aurait pu à tout le moins atténuer un style digne de ce nom.
Notre martial Romaric le Beau, notre d'annunzien Sangars la Farce, s'assouplira bien sûr, en banal esthète qu'il est, insignifiant rimailleur soliloquant quelques rinçures lettristes que ledit évangélique Bon Guillebon a conduit vers les voies de l'autel comme nous l'apprenons dans Conversion et, plus prosaïquement, vers son siège de patron des pages Culture de L'Incorrect, car les voies du Seigneur sont décidément impénétrables, y compris même pour les êtres démontrant leur capacité à ployer une échine qu'ils ont de toute façon admirablement souple. C'est dans ce même entretien que Jacques et Rémi rendent grâces à Richard (Millet) d'avoir écrit son dernier livre, et c'est dans ce même entretien au-dessus de tout soupçon de copinage que nous découvrons que Romaric le Beau, Sangars le Vertical est également un penseur de grande profondeur, capable d'affirmer, remarquable facilité journalistique, que «la littérature est le moyen le plus pertinent pour réussir ses échecs», ou que, consternante banalité, son retour au christianisme est un mouvement identitaire «au sens large : car la quête de l'autre est une quête de soi», ou encore que «le christianisme intègre tout, sauf le mal qui est un défaut d'existence», bêtise stratosphérique et peut-être même émpyréenne qui nous montre que, tout profond penseur qu'il est, nourri de Thibon et de Dantec c'est dire, mais n'ayant visiblement pas ouvert un livre de l'Aquinate, Romaric le Beau a besoin de quelques cours du soir de catéchèse pour être au niveau d'un premier communiant, ce qu'il est d'ailleurs, et restera visiblement jusqu'à la fin de ses jours. Au cas où certaines personnes ne sauraient pas lire, L'Incorrect a même prévu la version sonore de son passionnant entretien avec Romaric. Le propos est toujours aussi désespérément plat, mais qu'importe, puisqu'il y a fort à parier que les lecteurs des textes de Sangars ne se soucient pas vraiment de savoir que ce qu'il raconte, au mieux, est indigent. Voyons, si avec une telle couverture médiatique Conversion ne se vendait pas à 300 exemplaires, ce serait à désespérer de l'intelligence des Français, n'est-ce pas cher Léo Scheer ! Notons tout de même que jamais les lecteurs de ce livre n'évoquent ce qu'il est : un livre donc, c'est-à-dire un texte écrit. Voyez ainsi comme un certain Patrick Wagner, pour la chronique de Livr'Arbitres dans Présent, ne fait que broder sur la quatrième de couverture, sans jamais aborder l'écriture proprement dite de Sangars, qui n'est certes pas désagréable, mais ne parvient tout de même pas à masquer la nullité du propos, ce qu'aurait pu à tout le moins atténuer un style digne de ce nom.Romaric Sangars aime rendre la pareille à celles et ceux qui l'ont obligé : en langage chrétien, cela s'appelle faire l'aumône, aimer son frère (et bien sûr sa sœur) en Christ même si, dans cet œcuménique intention, aucun bénéfice d'aucune sorte n'est escompté ni même toléré. C'est bien simple : hormis le pape François suivi de près par Jacques de Guillebon, Beau Romaric est le catholique le plus charitable du monde, en tout cas de Paris. Ainsi, il s'entretient, sur le site le plus incorrect de France, avec Lakis Proguidis qui n'est autre que le patron de L'Atelier du roman, où nous apprenons, au comble de la stupéfaction cela va sans dire, que Romaric a signé une bafouille sans intérêt, précisément dans le numéro 79 de ladite revue. De grâce, que l'on ne vienne pas me dire que c'est par envie que je pointe ces copinages pas même discrets : tout d'abord, j'ai plus d'une fois écrit dans cette revue et, ensuite, je fais mienne la remarque du magnifique D'Annunzio affirmant que l'envie est «le vice capital des imbéciles car c'est le seul des sept qui ne procure aucune joie». Comment envier un écrivant à ce point peu sûr de son talent que la grande totalité de ses petits copains, qu'il saura bien récompenser d'un sucre ou de quelques mots dans L'Incorrect, est obligée de clamer sur tous les tons ?
Ainsi encore, Beau Romaric n'hésite jamais à dire tout le bien qu'il pense des ouvrages au lyrisme de sanisette de Richard Millet, ce guerrier de papier qui édite désormais ses livres idiots comme des slogans chez Léo Scheer, lequel lui a fait l'honneur de le mettre à la tête de sa Revue littéraire, l'un des plus remarquables exemples de titre de revue affirmant exactement le contraire de ce qu'elles est censée proposer. De la même façon, L'Infini de Philippe Sollers se réduit-il au diamètre assez maigre d'un bidet où les amis du Roi ardent des lettres françaises viennent laver leurs pieds sales et leur séant tout barbouillé de mots sollersiens lancés à la face de l'idole qui, pour les remercier, cultive leurs nombreux navets dans sa collection, au beau titre de L'Infini on s'en serait douté, laquelle collection à son tour se réduit à n'être que la flache où tous ces têtards et animalcules tétardisent et se culculent en riant et en prenant grand soin de ne jamais froisser le crapaud-buffle qui trône en son centre.
Il n'est pas moins parfaitement normal que Romaric Sangars pour Conversion et Richard Millet pour Déchristianisation de la littérature aient été le 11 janvier dernier, soit quelques jours à peine après la sortie de ces deux livres, au menu du Cercle Cosaque, ce raout organisé chez Barak, bien connu des happy few désireux de toucher pour de vrai leur idole, lequel raout a été fondé par Romaric Sangars en personne, car les plus grands cultes doivent bien posséder, à leur source, un hiérophante de prestige et même un meurtre théophanique initial, René Girard a bâti sa carrière sur cette thèse. Il y a fort à parier qu'Olivier Maulin, lui-même fondateur je crois, ou, en tout cas, l'un des piliers de ce haut-lieu de la consanguinité vaguement anarchisante et très vaguement droitiste dise dès les tout prochains jours tout le bien qu'il pense (ou ne pense pas, car c'est pareil pour lui, pourvu que l'entreléchage soit bon) de ces deux livres dans les colonnes de Valeurs actuelles, puisqu'une simple recherche sur ledit site nous donne plusieurs occurrences de textes et d'entretiens consacrés au dernier connétable autoproclamé des lettres française, dont l'un, ô divine surprise, a été mené de pied de maître par ce même Olivier Maulin.
Il est vrai que Richard Millet a pris, pour une poignée de moutons permanentés se prenant pour des guerriers de l'Occident menacé par la vermine sarrazine, la dimension d'un véritable Messie, que dis-je là d'euphémistique et de sot ! : Richard Millet, ayant repris les armes de celle qui bouta l'Anglais hors de France, la Pucelle héroïque, peut à bon droit, et dans cette unique acception cela va de soi, prétendre au titre d'héroïque Puceau. Comme Jeanne, Richard entend des voix divines qui lui disent qu'il est le plus grand écrivain français vivant et même qu'il a haché menu du méchant islamiste pendant la guerre du Liban. Richard est persuadé, depuis son boudoir mondain où seul un sablier Made in China peut évoquer le rude désert de ses ancêtres prophètes, qu'il est le Préfigurateur du Christ. Il est bien dommage, me dis-je en parcourant la réclame consacrée à son dernier opus, que l'Inquisition, cette si recommandable institution, n'existe plus, qui aurait su par quels placides moyens contraindre le Preux Richard à dire, pour une fois, la vérité. Passons. Mes propres voix en tout cas, sans doute parce qu'elles sont diaboliques, me soufflent, elles, qu'il n'en est rien, que Richard Millet n'est absolument pas le plus grand écrivain vivant de France, et que ce sont un mort, Guy Dupré, et un vivant, Christian Guillet, qui sont les plus grands écrivains de langue française, et qui le seront encore lorsque Richard Millet publiera son millième livre, ce qui ne saurait beaucoup tarder fort heureusement car si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles de son zélé Serviteur le sont beaucoup moins : il s'agit de recouvrir Paris et même la France d'une couche de livres vains et putrides, chantant le goût des femmes laides, le beaufisme d'un Gérard Depardieu ou d'un Bernard Menez censé dévoiler des trésors théologico-politiques et la consomption d'une nation autrefois grande qui persiste à ne pas reconnaître le talent milletien.
Ce sont deux respectables organes éditoriaux qui ont fait rayonner la Bonne Parole de ce nouveau Jean Baptiste annonçant la consolante parousie : les éditions fondées par Pierre-Guillaume de Roux et qui portent le même nom que leur fondateur, mais aussi, et c'est infiniment plus surprenant quand on connaît le parcours de l'intéressé venant de la gauche la plus abjectement cynique, la gauche à grosses bagues et à soirées dites fines, les éditions fondées par Léo Scheer.
Richard Millet a édité beaucoup (trop) de livres chez le premier, portant le nom illustre de son père, et est en passe de renouveler voire dépasser son exploit chez le second, qui ne porte à vrai dire aucun nom d'intérêt vague ou même de lignage intéressant, puisque bon sang ne saurait mentir, et inversement bien sûr. C'est ainsi qu'une poignée de commentateurs a participé à un ouvrage collectif dédié à la gloire, espérons-le posthume, du maître, parmi lesquels, ô étonnement, nous retrouvons les habituels Romaric Sangars dont Léo Scheer a édité deux ouvrages, mais aussi Muriel de Rengervé qui a écrit un essai, bien sûr publié par Léo Scheer, tout entier consacré à la récente quoique désastreuse réception médiatique de Richard Millet, ou encore une certaine Paulina Dalmayer qui a dit tout le bien qu'elle pensait du premier roman de Romaric Sangars dans les colonnes de Causeur où Romaric Sangars a d'ailleurs exercé son manque de talent, et un certain Matthieu Falcone, qui lui aussi, décidément, a été unanime avec lui-même pour saluer le premier roman de Romaric Sangars.
Je ne pointe là que les consanguinités les plus visibles, disons les moins incorrectes, car il va de soi que le mécanisme de ces renvois d'ascenseur est parfaitement huilé, puisque nous apprenons avec une réelle surprise que Rémi Lélian, qui n'a pas manqué de dire tout le bien qu'il pensait de Conversion de son ami Romaric Sangars dans les colonnes de L'Incorrect, n'a bien évidemment pas manqué de dire tout le bien qu'il pensait dudit dernier essai de Richard Millet dans ces mêmes colonnes décidément ouvertes à la plus impavide diversité. Je suis toujours estomaqué de constater qu'aucun de ces grands lecteurs de Richard Millet n
30/01/2018 | Lien permanent
L'Ascension de Monsieur Baslèvre d'Édouard Estaunié

 L'Ascension de Monsieur Baslèvre, publié par Édouard Estaunié en 1917, est un roman oublié que l'excellent Charles Du Bos a pu rapprocher de Confession de minuit de Georges Duhamel, écrivant, dans ses remarquables Approximations, qu'il aurait pu s'agir d'un texte presque parfaitement réussi «si la philosophie y [était demeurée] toujours dans l'éloquence des faits eux-mêmes», ajoutant toutefois que c'est une «excellente peinture d'un homme quelconque, mais dont l'ascension précisément consiste en la lente genèse d'une conscience de nature toute morale» (2). Charles Du Bos, d'une sensibilité esthétique aussi rare qu'exceptionnelle, ne fait pas l'erreur de penser que le sommet que Monsieur Baslèvre gravit à son insu, du moins pour une bonne partie de l'ascension, lui réserverait une illumination d'ordre spirituel, voire religieux; le personnage d'Estaunié se dépouille de toutes ses vieilles peaux, mais la béatitude dans laquelle, vivant, il pénètre, n'est pas la joie pure du saint.
L'Ascension de Monsieur Baslèvre, publié par Édouard Estaunié en 1917, est un roman oublié que l'excellent Charles Du Bos a pu rapprocher de Confession de minuit de Georges Duhamel, écrivant, dans ses remarquables Approximations, qu'il aurait pu s'agir d'un texte presque parfaitement réussi «si la philosophie y [était demeurée] toujours dans l'éloquence des faits eux-mêmes», ajoutant toutefois que c'est une «excellente peinture d'un homme quelconque, mais dont l'ascension précisément consiste en la lente genèse d'une conscience de nature toute morale» (2). Charles Du Bos, d'une sensibilité esthétique aussi rare qu'exceptionnelle, ne fait pas l'erreur de penser que le sommet que Monsieur Baslèvre gravit à son insu, du moins pour une bonne partie de l'ascension, lui réserverait une illumination d'ordre spirituel, voire religieux; le personnage d'Estaunié se dépouille de toutes ses vieilles peaux, mais la béatitude dans laquelle, vivant, il pénètre, n'est pas la joie pure du saint.Cette ascension discrète n'a bien évidemment rien à voir, toute laïque qu'elle demeure et quand bien même elle serait auréolée d'une étrange accointance avec le royaume des morts, avec celle, de pure force et de volonté intraitable, de Rastignac dans Le Père Goriot, même si Justin Baslèvre, dont les prénom et patronyme résument, comme on le voit souvent chez tel ou tel personnage de Georges Bernanos, la tranquille médiocrité d'un haut fonctionnaire se contentant de n'exécuter que les tâches qui lui incombent, est lui aussi monté à la capitale depuis son Limousin natal; de fait, le seul à nous deux, maintenant ! qu'il pourrait oser hurler, mais dans sa tête uniquement, aurait le caractère secret et spéculaire de quelque cœur simple, d'une vie minuscule qui, ayant vu un visage de femme qui l'a frappé, se met subitement à vivre ou plutôt revivre, s'élève à une hauteur insoupçonnée.
J'ai évoqué Bernanos et ce n'est pas seulement la caractérisation, par un patronyme ridicule, de la médiocrité d'un personnage, songeons ainsi à Pernichon, qui peut rendre intéressant le roman d'Estaunié car, comme chez le Grand d'Espagne, nous ne percevons, dans L'Ascension de Monsieur Baslèvre, que les linéaments d'un drame de la conscience qui se joue dans les profondeurs, au dernier recès comme l'eût écrit l'auteur de Sous le soleil de Satan ou, bien mieux encore pour illustrer ce rapprochement de sourde fermentation, L'Imposture. Bien sûr, le travail de la grâce, chez Estaunié, semble être infiniment plus fragile que chez Bernanos, et nous avons du reste quelque mal à parler de grâce autrement qu'à titre de métaphore, Albert Thibaudet ayant pu à juste titre affirmer qu'Estaunié cherchait une espèce d'équivalent laïque à cette dernière, une illumination qui n'aurait guère besoin d'une transformation de fond en comble de la personne qu'elle visite et remodèle et retourne sur elle-même, en somme, convertit.
Ce n'est à vrai dire pas la seule façon de rapprocher Georges Bernanos, du moins dans son premier roman publié en 1926, d'Estaunié, comme on a pu citer, à son propos, d'autres romanciers fins psychologues tels que Paul Bourget, René Bazin ou Marcel Prévost : j'ai ainsi noté un tic d'écriture dont ne se débarrassera pas tout de suite Bernanos romancier et qui, dans le roman d'Estaunié, finit par agacer par la petite musique professorale qu'il dégage, comme un résumé ramassant en quelques mots bien frappés l'intérêt d'un cours; cela donne, par exemple : «Si simple et si retirée qu'on l'imagine pourtant, une vie est toujours guettée par le destin» (p. 12) ou encore : «Il suffit d'une secousse légère pour détacher la scorie du lingot et découvrir le métal pur» (p. 134), et tant d'autres occurrences toutes bâties sur le même patron monodique, qui ont pu laisser penser qu’Édouard Estaunié n'était qu'un auteur à thèse.
Tout est médiocre, du moins en apparence, chez Justin Baslèvre aux yeux de qui «la pâte humaine dût être exclusivement consommée sous l'espèce administrative» (p. 11) qui, encore, tire gloire «du fait que, dans sa division, chaque matin les gens s'emboîtaient devant leurs tables comme des parapluies dans les cases d'un vestiaire, y demeuraient leurs six heures rigoureusement et disparaissaient ensuite sans qu'on en sût plus rien jusqu'au lendemain» (p. 28), ce même falot personnage qui, pourtant, avant même de voir le visage de l'épouse, Claire, d'une de ses anciennes connaissances que l'on verra vite gruger son petit monde féminin, comprendra qu'il y a en lui un être qu'il ne soupçonnait pas, résolu à bouleverser sa propre vie (cf. p. 24), tout prêt à l'emporter vers l'inconnu se tenant, tranquille, attendant sa minute, à un coin de rue ou dans l'intérieur bonhomme d'un appartement, comme si tout n'était qu'affaire de tension, de résistance et, finalement, de libération, de largage des amarres vers la puissante houle dont on ne sait trop où elle vous mènera : «On voit aussi des bâtons accrochés à la rive qui, saisis par le courant, se tendent, reviennent à la place primitive et semblent libérés : l'eau pourtant n'arrête pas son cours, et brusquement, à l'heure dite, terre et bois, tout est emporté vers l'inconnu...» (p. 30), conclut ainsi Édouard Estaunié dans l'un de ces passages si décidément didactiques, mais dont le didactisme ne parvient pas tout à fait à gâcher la beauté, et nomme à vrai dire chacun des assauts discrets, presque insaisissables, que l'invisible mène autour des êtres les plus butés.
 Comme dans La Vie secrète datant de 1908, tout est frémissement, non-dit, approche de l'inconnu, secret jalousement gardé, motif dans le tapis aussi, comme l'illustra génialement Henry James et, d'un mot que n'eût point désavoué Gabriel Marcel qui par bien des aspects de sa réflexion rejoint celle d'Estaunié (3), mystère, dans L'Ascension de Monsieur Baslèvre car, «dès qu'on approche un être humain on touche à l'inconnu» (p. 44), car, dès qu'on l'approche, on soupçonne le jeu de puissantes forces qui, bien qu'invisibles, ont «quelque chose de fatal et de puissant comme le remous de la mer», comme s'il s'agissait décidément de prendre de la hauteur, de corps, de parole et d'esprit, en désertant le plancher des vaches, des veaux et même des lièvres auxquels fait songer le ridicule patronyme de notre fonctionnaire, et de la hauteur pour, non pas contempler d'un point de vue privilégié la surface balayée de «brises nonchalantes», mais pour pénétrer dans «un creux de la houle» et ainsi pour y voir, «épouvanté par le déchaînement de force et la puissance de destruction individuelle qu'il recèle» (p. 58), l'essentiel, autre nom du mystère à l’œuvre selon l'écrivain.
Comme dans La Vie secrète datant de 1908, tout est frémissement, non-dit, approche de l'inconnu, secret jalousement gardé, motif dans le tapis aussi, comme l'illustra génialement Henry James et, d'un mot que n'eût point désavoué Gabriel Marcel qui par bien des aspects de sa réflexion rejoint celle d'Estaunié (3), mystère, dans L'Ascension de Monsieur Baslèvre car, «dès qu'on approche un être humain on touche à l'inconnu» (p. 44), car, dès qu'on l'approche, on soupçonne le jeu de puissantes forces qui, bien qu'invisibles, ont «quelque chose de fatal et de puissant comme le remous de la mer», comme s'il s'agissait décidément de prendre de la hauteur, de corps, de parole et d'esprit, en désertant le plancher des vaches, des veaux et même des lièvres auxquels fait songer le ridicule patronyme de notre fonctionnaire, et de la hauteur pour, non pas contempler d'un point de vue privilégié la surface balayée de «brises nonchalantes», mais pour pénétrer dans «un creux de la houle» et ainsi pour y voir, «épouvanté par le déchaînement de force et la puissance de destruction individuelle qu'il recèle» (p. 58), l'essentiel, autre nom du mystère à l’œuvre selon l'écrivain. Bien des fois nous pouvons lire ce genre de phrase : «La soirée dont M. Baslèvre s'effrayait, fut ainsi la plus simple, la moins fertile en incidents que l'on pût imaginer : l'essentiel y demeura souterrain, moins fait de gestes que de résonances intérieures, de paroles prononcées que de mouvements inexprimés» (p. 78), l'intrigue du roman n'ayant bien sûr aucun intérêt, ce dernier demeurant dans ce qui nous est caché de prime abord, puis méthodiquement révélé par une écriture aux vertus cachées, une langue qui ne paye absolument pas de mine pour ainsi dire et que l'on dirait armée d'une force pourtant implacable dans la modestie de ses effets, et capable de forer le métal le plus dur avec plus d'efficacité qu'une foreuse en diamant maniée par un auteur sûr de sa vélocité et de ses effets grandiloquents, montrant d'un signe du menton la formidable profondeur qu'il a pu atteindre. Chez Estaunié, bien au contraire, il s'agit de parvenir à capter, sans même devoir s'y attarder, deux ou trois faits dessinant, «comme des rides, le travail intérieur qui couvait sous les apparences normales» s'il est vrai que : «Pour retracer une évolution ainsi dissimulée, il faudrait, avec des mots sans contour, reproduire des mouvements encore plus impalpables. Le voyage d'un cœur ressemble à une croisière : on y passe d'un hémisphère à l'autre sans que l'horizon change...» (p. 87). Quoi qu'il en soit, sans même que nous ayons bougé plus de quelques mètres d'une scène à l'autre, l'espèce de drame statique auquel nous convie Estaunié nous donne un assez clair aperçu des courants qui parcourent les plus profondes vallées sous-marines, laissant parfois s'échapper, vers la surface, une drôle de créature pâle et presque complètement transparente sur laquelle Estaunié pose un nom connu de tous : quoi, c'était donc cela la jalousie ? C'est donc cela, l'amour ?
Dans cette tâche qui est, autant qu'une ascension, un éveil (4), il serait faux de croire que, sous leur platitude et immobilité apparentes, les choses sont inertes ou muettes; c'est tout le contraire, même, selon Estaunié, comme il le montre plus d'une fois, notamment dans un magnifique début de chapitre où il évoque les maisons parisiennes qui, en raison des êtres qu'elles abritent, s'accordent intimement aux personnalités dont elles ne cessent plus, alors, de rappeler le souvenir : «On reconnaît aux seules heures d'allumage ou d'extinction les maisons de riches et les maisons de pauvres, celles où l'on épargne, et celles où l'on gâche. Au total, chacune révèle l'âme de ses habitants, tant est puissante la pénétration des choses par celui qui s'en sert» (p. 68), comme le montrera du reste la volonté de Monsieur Baslèvre d'acquérir l'appartement, sans rien toucher à son ameublement, où Claire a vécu avec son mari puis est morte si soudainement.
L'attention aux «toutes petites choses», qu'un rayon de lumière «projeté plus tard» mettra en relief «pour faire découvrir rétrospectivement combien elles étaient grandes» (p. 89), n'est que l'autre aspect de la remarquable faculté de concentration d'Estaunié sur ce qu'il importe de révéler, car c'est bien «au plus creux du sillon, sous une terre qui paraît morte, que s'élabore le prodigieux enfantement du blé qui doit lever» (p. 92), sur ce qu'il importe encore de parvenir à entendre et écouter, à retenir, tu, à l'abri des confidences et d'une parole dispendieuse, dans son esprit, et cela qu'importent les mots prononcés puisque, au-delà «des phrases ainsi jetées du bout des lèvres, d'autres phrases dont le sens était perceptible pour eux seuls» (p. 111, il s'agit de Monsieur Baslèvre et de la maîtresse du mari de Claire, Melle Fouille) doivent être lues.
C'est donc dans un décor des plus anodins, certes pas médiocre puisque le romancier parvient à magiquement animer les scènes les plus humbles de la vie parisienne, que se lève l'invisible qui nous déborde de toutes parts, qu'il est impossible de rejeter comme une harassante chimère dès lors qu'on a cru apercevoir son existence, au détour je l'ai dit d'un mot, moins que cela, d'un geste esquissé, d'un silence : il n'y a ainsi «jamais de véritable fin aux aventures humaines et toutes s'achèvent pourtant» (p. 114), l'amour bien sûr ne constituant pas une exception à cette règle puisqu'il est bien certain, comme se laisse à le penser Monsieur Baslèvre, qu'un grand amour muet est certainement «la plus belle fleur qui ait jamais paré une âme humaine» (p. 121), qu'importe qu'elle n'ait éclose que quelques heures et, j'allais même dire : peu importe qu'elle ait eu le temps de laisser échapper sa subtile et éphémère fragrance (5).
 C'est ainsi dans l'absence absolue, la mort de l'être aimé, qu'Estaunié croit saisir la réelle présence qui jamais ne s'altérera, le décor, le paysage, les demeures, les objets permettant, à ceux qui restent, de découvrir avec une certitude et une joie bouleversantes les traces de la morte partout présente, adressant même des signes discrets mais irréfutables, passée toutefois la douleur, véritable sas nous permettant d'accéder au monde supérieur qui ceint le nôtre, douleur dont la «limite excède la conception humaine» (p. 154), mais qui ne renversera pas Monsieur Baslèvre qui, depuis sa rencontre avec Claire, a relevé la tête. C'est au prix d'un dépouillement total, Monsieur Baslèvre n'ayant jamais su, du temps qu'elle était encore en vie, si Claire l'aimait comme lui l'aimait, passionnément, ou même si elle l'aimait, que la présence de l'aimée sera reconquise, cette fois-ci définitivement, mais les étapes de cette dépossession qui est glorieuse reprise ont pu être atroces avant de s'épurer vers la libération finale, qui est, je l'ai dit, moins une consolation qu'une douce certitude d'être en présence même de celle qui a disparu : «Ainsi, pas un lieu où se donner désormais l'illusion d'approcher d'elle : chez lui, pas une photographie. Sans la lettre à laquelle il n'osait toucher, il aurait pu croire que l'aventure n'avait pas existé : à coup sûr, elle paraissait finie et seuls des souvenirs, revenant par grandes ondes, ridaient de loin en loin la surface du temps, tels des cercles sur un lac quand une pierre vient de toucher le fond» (p. 171). C'est ainsi que Monsieur Baslèvre conquiert Claire, et peut jouir de «la beauté de l'aimée purifiée au creuset de l'épreuve et sans cesse grandie», Claire, par-delà sa mort, ayant peu à peu obligé celui qui ne lui aura, tout au plus, qu'une ou deux fois tenu la main, «à comprendre ce qu'est l'amour et quels renoncements l'élargissent en faisant monter l'âme ! comme, guidé par elle, il avait gravi la côte et toujours respiré un air plus vif !» (p. 172).
C'est ainsi dans l'absence absolue, la mort de l'être aimé, qu'Estaunié croit saisir la réelle présence qui jamais ne s'altérera, le décor, le paysage, les demeures, les objets permettant, à ceux qui restent, de découvrir avec une certitude et une joie bouleversantes les traces de la morte partout présente, adressant même des signes discrets mais irréfutables, passée toutefois la douleur, véritable sas nous permettant d'accéder au monde supérieur qui ceint le nôtre, douleur dont la «limite excède la conception humaine» (p. 154), mais qui ne renversera pas Monsieur Baslèvre qui, depuis sa rencontre avec Claire, a relevé la tête. C'est au prix d'un dépouillement total, Monsieur Baslèvre n'ayant jamais su, du temps qu'elle était encore en vie, si Claire l'aimait comme lui l'aimait, passionnément, ou même si elle l'aimait, que la présence de l'aimée sera reconquise, cette fois-ci définitivement, mais les étapes de cette dépossession qui est glorieuse reprise ont pu être atroces avant de s'épurer vers la libération finale, qui est, je l'ai dit, moins une consolation qu'une douce certitude d'être en présence même de celle qui a disparu : «Ainsi, pas un lieu où se donner désormais l'illusion d'approcher d'elle : chez lui, pas une photographie. Sans la lettre à laquelle il n'osait toucher, il aurait pu croire que l'aventure n'avait pas existé : à coup sûr, elle paraissait finie et seuls des souvenirs, revenant par grandes ondes, ridaient de loin en loin la surface du temps, tels des cercles sur un lac quand une pierre vient de toucher le fond» (p. 171). C'est ainsi que Monsieur Baslèvre conquiert Claire, et peut jouir de «la beauté de l'aimée purifiée au creuset de l'épreuve et sans cesse grandie», Claire, par-delà sa mort, ayant peu à peu obligé celui qui ne lui aura, tout au plus, qu'une ou deux fois tenu la main, «à comprendre ce qu'est l'amour et quels renoncements l'élargissent en faisant monter l'âme ! comme, guidé par elle, il avait gravi la côte et toujours respiré un air plus vif !» (p. 172).Ainsi, il semble assez peu important, à la toute fin d'une aventure humaine de toute façon condamnée à s'arrêter tôt ou tard, qu'une ville change, que certains immeubles ou même quartiers entiers soient détruits; certes, «à Paris, les pierres roulent comme les gens et passent avec eux» (p. 174), mais il est possible, par le biais d'une ascension toute intérieure dont Monsieur Baslèvre aura figuré les stations profanes, de se dépouiller de tout, tout ayant été sacrifié, les lieux et les êtres, y compris «la mémoire de Claire»; alors, la cime est atteinte et, après, comme l'affirme Estaunié désireux de donner un visage pour le moins stoïque au mystère grondant, vivant, qui se minéralisera ou au contraire se diluera peut-être faute d'être perpétuellement nourri par autre chose qu'une sorte d'équilibre cosmique, quelque bizarre et probablement intenable point de Lagrange de l'âme (6), et reprendra la place insignifiante qui aura toujours été la sienne, et, après donc, «il n'y a plus que la sérénité des espaces solitaires...» (p. 194).
Notes
(1) Édouard Estaunié, L'Ascension de Monsieur Baslèvre (Le Livre moderne illustré, J. Ferenczi et fils, éditeurs, d'après les bois gravés par Girard, 1938). La première édition de ce roman, chez Perrin, date de 1921. Plusieurs fautes sont à signaler comme : sans et non «sais crises» ( p. 26); tant je vous l'ai dit et non «tant que je vous l'ai dit» (p. 98); mon et non «moi passé» (p. 101); la manquant devant «sincérité de la passion» (p. 120); il et non «li ne quittait pas» (p. 145); une et non «un de ses mains» (p. 151). Une réédition datant de 2000, préfacée par Jacques Jaubert, est disponible aux éditions Mémoire du livre, à laquelle nous renvoyons.
(2) Charles Du Bos, Approximations (Éditions des Syrtes, 2000), p. 593.
(3) Le point de convergence le plus frappant entre Estaunié et Gabriel Marcel est la méditation aussi constante que douloureuse sur la mort, que le premier définit, superbement, en quelques mots, comme étant «du silence, alors qu'on interroge» (p. 177), définition admirable que n'eût point désavouée, je crois, l'auteur d'Homo viator.
(4) Voir En chemin vers quel éveil ? (Gallimard, 1971).
(5) Quelques minutes de recherche nous apprennent que, comme René Boylesve, Édouard Estaunié aura aimé en secret une jeune fille qui en épousera un autre sans avoir eu connaissance de ses sentiments.
(6) Je sais bien que ce n'est pas la conclusion à laquelle parvient Estaunié, car la fin de notre roman parle, bien au contraire, d'une «immense tendresse [qui est] hors d'atteinte, défiant les hasards de l'existence» qui illumine le chemin de Monsieur Baslèvre, puisque «Claire ne le quitterait plus» et que, sûr de l'aimer, étant indifférent au fait de savoir si c'est «elle qui vivait en lui ou lui en elle», il était certain de «lui répondre par une constance égale, et dormeur éveillé n'aurait pu découvrir s'il vivait le rêve ou la réalité !...» (p. 206).
12/01/2023 | Lien permanent
L'Architecture de Marien Defalvard

 Marien Defalvard dans la Zone.
Marien Defalvard dans la Zone.Quand les nains et les caco-nains commentent le tout dernier écrivain de langue française, ou petit traité de lecture en époque alogale
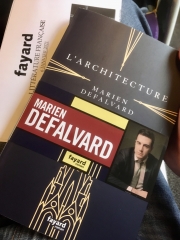 Acheter L'Architecture sur Amazon.
Acheter L'Architecture sur Amazon. Voici quelques jours à peine, un joli chapelet d'andouilles radiophoniques présentant la particularité dâêtre composées de davantage de chaudins de blaireaux plutôt que de gras de porc, dont une parfaite idiote pigeant pour Elle (oui, une femme peut gagner ainsi sa vie, en accomplissant une aussi sale besogne quâécrire pour un magasine comme Elle); oui, une lamentable sous-pigiste, une certaine Ãlisabeth Philippe qui ne sait même pas quâun grand écrivain du nom de Carlo Emilio Gadda a par avance réduit à un peu de cendre refroidie et puante chacun de ses bavardages, peut écrire un monceau dââneries à tropisme de petit flic (et, dès lors, faisant passer pour une enquête digne de ce nom sa consultation de Twitter et de Google) pour LâObs et être payée pour cela, oui, et dâautres, dâautres nains et mégères, tant dâautres se reproduisant, comme les mouches à merde, par génération spontanée sur la carne avariée de la Presse), ou encore, pour continuer à détailler ces exemplaires dâune évolution régressive, dâune dévolution comme disent les Anglais, de lâhomme, le communiste des beaux quartiers Arnaud Viviant, le pseudo-décadent et vrai arriviste poudré Frédéric Beigbeder et je ne sais plus quelle nullité (ah, si, un certain Jean-Claude Raspiengeas, dont le nom est si laborieusement laid à prononcer quâil vous démange la glotte comme un crachat), nullité parfaitement digne d'écrire pour La Croix, tous fiers, en tout cas de leur stupidité bavarde, de leur inculture triomphante, assumée, décomplexée, pornographique, germanopratine, échangèrent donc avec force gloussements, silences entendus de conspirateurs de troquet et mines que l'on devinait interloquées tout autant que complices, sur l'antenne consanguine de France Inter, de consternants truismes que je résumerai en quelques mots : Marien Defalvard est un écrivain passablement compliqué à lire, pas vrai Raoul ?, mais son dernier roman (1), L'Architecture, alors lui, est, je vous le dis tout de go, parfaitement i-l-l-i-s-i-b-l-e et même tout simplement hermétique ! En tout cas, moi, Frédéric, moi, Jean-Claude, moi, Arnaud, moi, Jérôme et moi, Bécassine, je nây ai rien compris !. Quelques jours plus tard, cette fois-ci pour Le Figaro Magazine, Frédéric Beigbeder, omniprésent lorsquâil sâagit dâécrire ou de parler pour ne rien dire et le dire, qui plus est, sans éclat mais avec la nonchalance de celui qui, depuis quâil est né, nâaura jamais exercé dâautre spécialité que celle de branleur, dont il est Docteur honoris causa dâun bon millier de bars parisiens, répétera que Marien Defalvard est un «génie illisible», un propos stupide qui sera pratiquement recopié, mot pour mot, par Christian Authier (qui nâoubliera tout de même pas de saluer les nouveaux livres de ses petits copains Jérôme Leroy et Sébastien Lapaque) pour LâOpinion Indépendante : ces nains sont tellement peu sûrs dâeux-mêmes quâils vont, on le suppose inconsciemment mais je nâen suis pas certain, jusquâà se recopier les uns les autres, en invoquant, dans les cas dâAuthier et de Beigbeder, Lautréamont, comble, pour ces cerveaux en forme de crachoir, de la difficulté, que dis-je, de lâimpénétrabilité littéraire !
Misère de la critique journalistique française bien sûr, ces clowns qui jamais nâont fait rire devant se contenter, faute de moyens esthétiques, littéraires et tout bonnement : intellectuels, dâune accusation dâillisibilité, confondante aberration à la morgue jupitérienne fientée par ces perdreaux aux ailes rabotées avec une autorité de saint Jean proclamant l'ouverture des sceaux au-dessus de la mer d'huile entourant Patmos, et sans doute reçue â mais là encore nous ne pouvons quâimaginer sa mine ahurie â avec un hochement de tête par Jérôme Garcin qui était chargé, en fait de distribution de la parole, de repasser les plats remplis à ras bord dâun potage verbal aussi peu ragoûtant : de la merde, nâest-ce pas, quelle que soit la manière de lâaccommoder, reste de la merde. LâArchitecture est donc illisible selon lâalpha et lâoméga de la critique journalistique, et même, nous dit notre GO mononeuronal, imbattable dans lâimbitable, ce qui, dans la bouche pâteuse de ce Monsieur de Phocas de bac à sable, doit il me semble correspondre à un compliment enrobé dans un mot quâil a le tort de croire bon et qui nâest quâune déjection supplémentaire, cette fois-ci entourée dâune imitation de papier de soie.
Je suis particulièrement frappé, au-delà bien sûr de la crétinerie inimaginable de ces cuistres qui font pourtant office de critiques littéraires sur moult types de supports médiatiques (le plus possible, si possible), par la fausseté de leurs dires, qui ne sont même pas des affirmations mais, tout au plus, de molles hésitations, des flatulences, qu'ils lâchent en tournant autour du trou de toilettes à la turque qui leur sert de cerveau infundibuliforme : disons-le comme nous le pensons, L'Architecture se lit parfaitement, bien plus facilement en tous les cas que de très compacts petits tas de conneries point recyclables comme le sont les livres d'une Cécile Coulon, seule écrivassière à laquelle les journalistes pensent, avant même de songer que le génie de Pascal a jadis irrigué les rues de la ville de Clermont-Ferrand qui, marâtre, détruisit sa maison, lorsqu'ils veulent tenter d'associer l'idée de littérature, celle qu'ils s'en font bien sûr, à l'ingrate cité saccagée des années durant par une municipalité quasiment soviétique, pire que soviétique puisque française, stalinienne donc, ou encore à la région auvergnate, à peu près épargnée par ces salopards salopeurs et même raseurs de patrimoine, dont la folie destructrice eût dû être confinée dans une grande salle capitonnée avec, pour obligation de soins, le visionnage 24 heures sur 24, de documentaires sur la destruction méthodique de villes entières : peut-être y auraient-ils vu quâà trop vouloir faire table rase du passé, câest lâhomme que détruisent ces réformateurs intraitables ? Il a quoi quâil en soit toujours été parfaitement clair à mes yeux que ce ne sont pas les grands textes qui sont durs à lire, voire incompréhensibles, imbitables selon Frédéric Beigbeder, ce nouveau Sainte-Beuve, mais, bien au contraire et au rebours des affirmations les plus sottes, les mauvais, les médiocres, les petits, les nuls, comme ceux dâune autre Auvergnate, Cécile Coulon et de ses innombrables consÅurs, toutes écrinaines et déparant dâautres belles régions françaises, cachant leur totale indigence de baudruche vulgaire et peroxydée dans le cas qui nous occupe sous le vernis d'une insipide simplicité qui ne berne que les sots, certes nombreux, surtout lorsqu'il s'agit de promouvoir de si rondes boulettes de fumier.
Si je voulais continuer à choquer les imbéciles, je m'amuserais même à prétendre que L'Architecture se lit non seulement d'une traite, mais ne m'a causé aucune difficulté particulière, de lexique comme de forme (je veux dire : de structure grammaticale), contrairement à tels autres textes eux aussi réputés «imbattables dans lâimbitable» comme Tristram Shandy de Laurence Sterne, Locus Solus de Raymond Roussel, Gothique charpentier de William Gaddis, Absalon, Absalon ! de William Faulkner, Le Purgatoire de Pierre Boutang ou encore Sous le volcan de Malcolm Lowry, voire Monsieur Ouine de Georges Bernanos, bien souvent considéré comme le roman le plus obscur et difficile, pardon Frédéric, «imbittable», du Grand dâEspagne : ce ne sont du reste pas des textes que nous pourrions qualifier, rapidement, sottement, journalistiquement, d'hermétiques à proprement parler, comme le sont par exemple ceux du si tristement surestimé Pierre Guyotat ou bien, d'un degré bien supérieur à ce dernier, ceux de Maurice Scève (la Délie est nommée, p. 185) ou de Georg Trakl, et que dire de Paul Celan. Ces textes sont difficiles parce qu'ils évoquent la matière même qui les constitue, qui nous constitue, le langage et, l'évoquant, parce quâils le mettent en joue et en jeu, jouent avec lui, s'enfoncent en lui, et ce sera, dans ce concours extraordinairement sélectif, à celui qui parviendra à creuser le plus profond, moins, dâailleurs, pour y trouver du nouveau, selon lâimpératif baudelairien, que pour y retrouver ce que lâon a perdu.
Le saint langage ou la descente dans la fosse de Babel
Exploration des plus épaisses couches du langage, L'Architecture est aussi, d'abord même, au niveau le plus superficiel où barbotent les animalcules à tuba et palmes en plastique mou, un remarquable essai sur la littérature, sur ce qu'est la grande littérature et celles et ceux qui la font aux yeux de l'écrivain. Pour Marien Defalvard, le style se caractérise avant tout sinon uniquement par lâécart, le pas de côté : «non la fusion mais l'inadéquation, l'inappropriation; la singularité qui apparaissait dans les grincements, dans les brisements, dans les points-virgules écaillés, non pas dans l'application heureuse, le succès» (p. 154). Ainsi le texte de Marien Defalvard fourmille d'impressions, de jugements, de rapprochements, le plus souvent étonnants et parfois remarquables, sur des auteurs comme Virginia Woolf, «l'alacrité anglaise qui fait baigner le dernier état de la mélancolie victorienne dans les obus prochains» (p. 161), Shakespeare (surtout par l'évocation de sa pièce la plus noire, Macbeth), que Defalvard, sur les brisées d'Ezra Pound, orthographie à sa façon phonétique et signifiante (soit «Shaxpeare»), mais aussi, bien quâils ne puissent être directement rattachés à la seule littérature, Pierre Legendre ou encore (et encore, et encore, hélas) René Girard, Philippe Muray, dâautres aussi, comme Carlo Emilio Gadda, et son Château dâUdine (cf. p. 28).
Mais ce nâest là que la surface des choses je lâai dit, quelques noms dâauteurs que les journalistes, en pseudo-lecteurs paresseux, prélèveront ici ou là sans jamais comprendre quelle cohérence intime a exigé leur mention, leur apparition au détour dâune phrase quâen apparence rien ne prédisposait à voir germer en tel ou tel bouquet. Tout au plus de quoi écrire un petit article qui, dans le meilleur des cas, saluera lâévidence si affreusement située au rebours de toutes les assurances contemporaines selon laquelle un grand écrivain est aussi, dâabord là encore, un grand lecteur. Dans cette exploration de la littérature et des cavernes et puits sur lesquels elle sâappuie, Marien Defalvard est l'un de ceux qui descend le plus bas, qui, même, parfois, comme l'indique telle image éblouissante, telle comparaison ou métaphore qui ne sont pas simplement remarquables mais géniales en ce sens qu'elles établissent des rapports évidents mais que lui seul aura ainsi signifiés, qui même, donc, parvient à passer derrière, au-delà ou en dessous on ne saurait dire de quelque inimaginable frontière du langage. Ce qui saisit, plus dâune fois, à la lecture de LâArchitecture, câest tel méplat de visage quâon croyait enfoui et qui brille selon un angle inaccoutumé, telle tranchante pointe qui, une fois dégagée la terre autour dâelle, se révélera nâêtre que le sommet le plus pointu dâun édifice inconnu, comme les explorateurs des textes de Lovecraft ou de Machen, en passant le doigt sur un relief aux motifs étranges, ont la sensation bizarre quâils commencent à sâaventurer dans un royaume qui nâest non seulement pas de ce monde mais en aucun cas ne les préservera de rencontres dangereuses, de noires révélations. Comme toujours chez les très grands, il y a, dans la prose de Marien Defalvard, des espèces de trouées qui, dans une mare que nous pensions connaître, ouvrent des puits de profondeur dâun bleu dâoutre-monde.
Voici quelques jours, profitant de sa présence, devenue rare, à Paris, Marien et moi avons longuement discuté en marchant vers la gare d'Austerlitz, et n'avons pas fait qu'aborder W. G. Sebald, qu'il ne tient pas en aussi haute estime que moi, mais l'un de mes textes, dont je ne tire aucune fierté particulière, La chanson d'amour de Judas Iscariote; Marien s'est déclaré surpris que je n'aie pas désiré m'aventurer, de nouveau, dans ces territoires finalement assez peu explorés qui se situent aux confins de la prose et de la poésie, de l'essai et du roman et, parfois aussi, mais ce choix était pleinement assumé, de l'hermétisme. Imaginant, sous la figure de Judas, quelque impossible dernier écrivain ou, pour le dire avec les mots de Marien Defalvard qui lui aussi peut prétendre tenir ce poste de vigie si peu enviable, le dernier homme, le dernier de cordée ou de lignage (cf. p. 88), il me fallait bien tenter de sonder ce que le rapport pour le moins paradoxal que l'apôtre-félon a noué avec le Christ, autrement dit le Verbe incarné pour la théologie chrétienne, forer, à mon tour, après tant d'autres, probablement avant d'autres qui, je le crains, deviendront de plus en plus rares à mesure que le langage s'amenuisera à une novlangue macronienne, il me fallait bien m'enfoncer dans le tuf primordial du langage, produisant un texte pour le coup énigmatique après plusieurs années d'écriture, de réécriture, de polissage, de sertissage des mots. Ah oui, on peut dire, selon le mot qu'aimait citer Bernanos, que je n'ai alors pas tenu une plume pour rigoler ! Marien Defalvard lui non plus, ne tient pas une plume pour rigoler, se souvient peut-être de Jacques Chessex écrivant, dans LâInterrogatoire, quâil ne faut jamais «considérer la littérature comme un jeu, mais se rappeler que tout vrai texte manifeste la Parole dans la parole», ce qui signifie assez clairement quâil vous faut laisser tomber les billevesées sur la prétendue illisibilité de ses textes, car vous pouvez être certains que ce que lui reprochent les sots que jâai mentionnés, et une foule dâautres, connus ou pas, câest justement quâil ne le fait pas, quâil ne sâamuse pas en écrivant, mais alors vraiment pas une seconde, puisquâil rappelle à ces pitres ce quâils ont oublié dans le meilleur des cas ou, plus sûrement, nâont jamais soupçonné : lâécriture et, à un moindre degré, la lecture, sont toutes deux expositions de celui qui les pratique à la corne de taureau évoquée par Michel Leiris dans LâÃge dâhomme. Voyez, au moment de comprendre quâils sâengagent dans une rue où ils risquent de gager leur peau de trouillards, nos bravaches : lâchés sans autre solution que courir aux ferias de San FermÃn, vous pourrez être certains que, dans lâexemple le moins manifeste de débandade radicale, ils tenteront de cacher lâauréole de pisse dont leur peur comique aura poissé leur pantalon. Cette peur, ce relâchement de vessie et même de sphincters, ils lâétalent, à leur façon inconvenante car publicitaire, dans ce quâils écrivent : tous ces imbéciles, en fait, exsudent leur trouille quand ils écrivent.
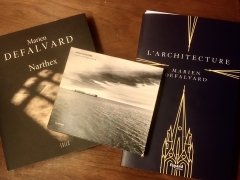 Marien Defalvard ne rigole pas câest une certitude, plus dâun événement, dâailleurs, lui a apparemment passé lâenvie de rigoler, lui dont l'esprit de sérieux passera pour de la prétention; or, de la même manière quâil en va pour les grands textes, les grands auteurs ne sont jamais prétentieux, puisque ce sont ceux qui jouent à paraître ce qu'ils ne sont pas, des écrivains, qui le sont, et au plus haut degré, comme tant d'exemples suffisent à nous en convaincre, de l'indigent Emmanuel Carrère, fils de maman, jusqu'au kouglof verbal sué par Mathias Enard qui se croit le fils de Balzac, ou au mage de pacotille Yannick Haenel confondant une pellicule de peau saponifiée de Philippe Sollers avec le rayonnant aleph dont parle Borges, en passant par tous les animalcules, têtards, plantigrades, etc., sollersiens ou pas, et toute la clique écouillée mais pas moins cacographique des éditions POL, tant d'idiotes intarissables aussi, et puis tous ces écrivaillons n'ayant rien à dire mais, tel un Sylvain Tesson fils de papa, le disant quand même, devant un parterre de crétins et, hélas pour les mâles idéalistes, sâil en reste, d'idiotes à cyprine hypokhâgneuse.
Marien Defalvard ne rigole pas câest une certitude, plus dâun événement, dâailleurs, lui a apparemment passé lâenvie de rigoler, lui dont l'esprit de sérieux passera pour de la prétention; or, de la même manière quâil en va pour les grands textes, les grands auteurs ne sont jamais prétentieux, puisque ce sont ceux qui jouent à paraître ce qu'ils ne sont pas, des écrivains, qui le sont, et au plus haut degré, comme tant d'exemples suffisent à nous en convaincre, de l'indigent Emmanuel Carrère, fils de maman, jusqu'au kouglof verbal sué par Mathias Enard qui se croit le fils de Balzac, ou au mage de pacotille Yannick Haenel confondant une pellicule de peau saponifiée de Philippe Sollers avec le rayonnant aleph dont parle Borges, en passant par tous les animalcules, têtards, plantigrades, etc., sollersiens ou pas, et toute la clique écouillée mais pas moins cacographique des éditions POL, tant d'idiotes intarissables aussi, et puis tous ces écrivaillons n'ayant rien à dire mais, tel un Sylvain Tesson fils de papa, le disant quand même, devant un parterre de crétins et, hélas pour les mâles idéalistes, sâil en reste, d'idiotes à cyprine hypokhâgneuse.Marien Defalvard, lui, comme le prouve chacune des critiques que j'ai consacrées à ses trop rares textes, est un monstre qui va finir par devenir absolument unique, puisqu'il est tout entier composé par le langage. Lui-même le dit, et cette affirmation suit de quelques lignes à peine une distinction entre deux types d'écrivains, ceux qui creusent (Paul Gadenne (2) d'un côté, dont L'Avenue constitue comme un palimpseste et l'horizon si tentateur, à la fois esthétique et ontologique, peut-être même théologique, de L'Architecture, et Nabokov de l'autre, celui des écrivains qui se donnent au monde, vont vers lui, le dévorent en quelque sorte); d'abord, donc, la confession de l'auteur, qui écrit que sa «dépendance aux mots était une dépendance de drogué, la dépendance de l'opiomane ou du cocaïnomane malheureux, qui connaît sa dépendance mais aime à l'éprouver avec une espèce de gratuite répétitive ou de répétition gratuite, et l'éprouve avec une voluptÃ
14/01/2021 | Lien permanent

























































