L'obscurité du dehors de Cormac McCarthy (24/05/2011)

Crédits photographiques : Arif Ali (AFP/Getty Images).
 Cormac McCarthy dans la Zone.
Cormac McCarthy dans la Zone.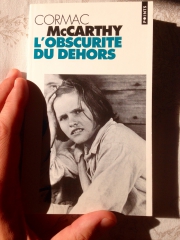 Acheter L'obscurité du dehors sur Amazon.
Acheter L'obscurité du dehors sur Amazon.L'obscurité du dehors nous semble moins impénétrable, dans le deuxième roman, gothique par excellence, de Cormac McCarthy (1), que celle dans laquelle les personnages accomplissent leurs actes sans même les avoir fomentés (cf. p. 118) et, dirait-on, livrent leurs rares pensées, aussi fixes qu'elles sont dépourvues de la moindre afféterie : dans ce livre, comme dans tous les romans de McCarthy, le seul impératif catégorique tient en un unique verbe, qui ne peut se conjuguer qu'au présent, survivre.
Survivre dans un univers envahi par l'obscurité, sans doute l'un des mots les plus utilisés par McCarthy dans cette œuvre, obscurité annonciatrice de chaos et de dissolution, où même la pleine lumière d'un jour d'été, aveuglante, semble remplie de pendus grimaçants (cf. p. 95), de créatures invisibles et de dangers insoupçonnables, comme si, en fait, l'heure la plus chaude de la journée était pleine de ces démons que les vieux textes patristiques qualifiaient de midi pour avertir les marcheurs téméraires de l'importance du danger, lorsque leur ombre était la moins étendue de la journée.
Survivre dans un univers envahi par la violence que propagent trois cavaliers diaboliques (cf. pp. 7, 121) dont nous ne savons rien sinon qu'ils ouvrent le roman en l'entaillant profondément, «s'arrêtant et se regroupant un instant et repartant alignés les uns derrière les autres à contre-jour dans le soleil puis descendant sous la crête de la colline dans un repli d'ombre bleue, la lumière touchant leurs têtes auréolées de fausse sainteté» (p. 7, l'auteur souligne), maléfiques ombres qui courent le monde, pillent, tuent, commettent des atrocités, sur les traces de Culla Holme, comme s'ils symbolisaient quelque antique justice sanglante, dépourvue de la moindre pitié pour celui qui a abandonné dans la forêt le fruit vivant de ses amours incestueuses. Celui-là doit payer et, en fait, ne paiera point, les cavaliers semblant reconnaître, lorsqu'ils le rencontrent, l'un des leurs, auxquels ils laisseront la vie sauve.
Survivre dans un monde où, selon la parole de l'Apocalypse, le frère et la sœur deviennent l'un à l'autre des étrangers, pire même, des ennemis, alors que la nature elle-même, comme dans Là-bas de Huysmans, semble maléfique, du moins pour Culla Holmes dont la vilenie pas même diabolique mais simplement bornée semble avoir contaminé les paysages que, sans but, à la recherche de sa sœur, il traverse. Comme si, en fait, c'était la nature qui servait de miroir à des personnages incapables de sonder leurs propres tréfonds, de rendre compte de leurs actes autrement que par un expéditif et tautologique j'ai fait ce que j'ai fait. Comme Damnation de Tarr, L'obscurité du dehors se conclut sur une fin de non-recevoir, au sens propre des termes, dans un paysage stérile et dévasté dans lequel hurle avec un chien un homme, Karrer, dans lequel un autre, Culla Holme, se demande s'il ne va pas y envoyer vers une mort certaine un aveugle : «Tard dans la journée la route le conduisit dans un marais. Et ce fut tout. Devant lui s'étendait un désert spectral d'où ne dépassaient que des arbres dénudés dressés dans des attitudes de souffrance, vaguement hominoïdes comme des figurines dans un paysage de damnés. Un jardin des morts qui fumait vaguement et s'estompait pour se confondre avec la courbure de la terre. Il tâta du pied la tourbe qu'il voyait devant lui et elle se mit à monter, formant une grumeleuse boursouflure vulvaire qui vous aspirait. Il recula. Un vent fade s'exhalait de cette désolation et les roseaux du marais et les noires fougères au milieu desquels il se trouvait s'entrechoquaient doucement comme des créatures enchaînées» (p. 226).
Survivre dans un monde où chacun des personnages semble littéralement riveté, cloué sur la planche du destin plus que du salut, destin souvent signifié, dans ce roman, par des images ayant trait au déplacement de charrettes qu'aucune force au monde ne serait capable de dévier de leur trajectoire : «Ils allaient dans la chaleur de plus en plus forte du matin d'été, dans un silence que seuls troublaient le claquement régulier de la chique de la vieille femme et le grondement ininterrompu de la charrette, bruit si laborieux et implacable qu'il aurait dû signaler davantage qu'une simple progression sur la surface de la terre» (p. 65).
Survivre dans un tel univers qui nous semble être tout entier le domaine d'un Mal sans visage ou alors affublé d'un masque horrible par le vide même qui le constitue (2), sans visage donc et sans nom (3), serait une chose strictement impossible à accomplir si le romancier ne ménageait, à ses personnages, à la jeune Rinthy Holme (qui ressemble à Mouchette (4), le goût de la perversion volontaire en moins), tout autant qu'à ses lecteurs, quelques havres de paix où faire halte et se reposer, avant de repartir marcher dehors, là où les bêtes rôdent, cherchant qui dévorer, surtout l'enfant abandonné par son père en pleine forêt, que vont recueillir un colporteur et sa compagne, le sauvant ainsi d'une mort certaine, et ce geste tout simple et pourtant prodigieux suffit à leur conférer une dimension quasi surnaturelle : «Quand ils sortirent dans le pâle clair de lune, le colporteur marchant à son côté et elle portant l'enfant totalement emmailloté et invisible, ils avaient quelque chose de furtif, de clandestin, et leurs pas étaient silencieux et silencieuses leurs voix sur la route sableuse où ils marchaient parmi des ombres si rabougries qu'elles semblaient ivres et possédées d'une violence où leurs créateurs se déplaçaient dans une rêveuse irréalité» (p. 26). Lorsque le colporteur finira pendu, le monde ne vacillera pas sur ses gonds, alors que ce crime nous semble aussi abominable que celui du roi par son sujet, Macbeth, meurtre synonyme, dans la pièce de Shakespeare, de retournement parodique de la réalité, puisque le démon marque son ironique présence lorsque fair is foul, and foul is fair.
Survivre au milieu des animaux, non point ceux qui habitent dans les bois obscurs que traversent nos personnages errants, vagabonds pourchassés, faméliques et sordides sur une terre elle-même dévastée, mais ceux qui sont à leur poursuite, à l'instar de cet idiot faisant partie du trio maléfique, qui n'hésitera pas à dévorer un enfant que le barbu aura saigné devant les yeux de Holme, abomination répondant à l'abomination qui a été celle du jeune homme lorsqu'il a abandonné dans les bois l'enfant qu'il a eu de sa propre sœur.
Survivre dans un univers dont la matérialité est trompeuse puisque, dans ce deuxième roman comme dans tous les autres romans de McCarthy, la terre gaste qui porte les êtres frustes, solitaires et sans cesse jetés sur les routes qui sont ses personnages principaux, est le théâtre d'une lutte invisible entre des puissances dont l'homme n'a pas idée mais que, parfois, par certains de ses gestes, par certaines de ses paroles, il peut soupçonner, dans lequel même il peut inscrire, du moins durant quelque temps, la trame scintillante d'une vie qui à bon droit pourra nous sembler rachetée, comme dans le cas du colporteur, à moins qu'il ne faille décidément voir aucune lueur dans ce livre prodigieusement noir : «Quelles sont ces vêpres cacophoniques que joue dans son carillonnement la camelote du colporteur à travers le long crépuscule et sur la route truitée de la forêt, tandis qu’il marche courbé et traqué à travers les venteuses excroissances du jour comme ces vieux proscrits amputés de toute matérialité et sommés de comparaître au paradis ou en enfer, qui hantent à jamais les contrées intermédiaires, sans laisser de trace, anathèmes et incréés ?» (p. 213, l'auteur souligne).
Notes
(1) Cormac McCarthy, L'obscurité du dehors (Outer Dark, 1968, Actes Sud, traduction par Patricia Schaeffer et François Hirsch, 1991 puis Seuil, coll. Points Roman, 1998).
(2) Voici la façon dont le jeune Holme décrit le visage d'un des trois hommes, simplement désigné comme le barbu, avec lesquels il partage un feu et une viande pour le moins suspecte : «Holme avala sa salive et leva de nouveau les yeux sur lui. Sa barbe luisait dans la lumière oblique et sa bouche était rouge, et ses yeux étaient des lunettes pleines d'ombre dans lesquelles il n'y avait que du vide» (p. 160).
(3) Le Mal, s'il n'a pas de visage, n'a pas de nom, comme en témoigne cet étrange dialogue entre Holme et le barbu, où l'on constate que, fidèle à d'autres images religieuses parodiques (cf. pp. 114, 119, 121, etc.), McCarthy fait du Mal et de ses séides des propagateurs du chaos puisque Dieu est celui qui, face à l'homme, commence à lui donner un nom et surtout lui confère le pouvoir, inouï, d'être ce que Nietzsche appelle un nommeur : «Holme, répéta le barbu. Le mot semblait lui laisser un mauvais goût dans la bouche. Il hocha vaguement la tête vers l'homme au fusil. Ce gars-là a pas de nom, dit-il. Il voulait que je lui en donne un mais j'ai pas voulu. Il a pas besoin d'en avoir un. T'avais encore jamais vu un homme qui a pas de nom ?
Non.
Non, dit le barbu. Y a peu de chances.
Holme regarda l'homme au fusil.
Toutes les choses ont pas besoin d'avoir un nom, pas vrai ? dit le barbu.
J'en sais rien. Sans doute que non.
J'suppose que tu voudrais connaître le mien, pas vrai ?
Ça m'est égal, dit Holme.
J'ai dit : J'suppose que tu voudrais connaître le mien ?
Oui, dit Holme.
Les dents du barbu apparurent puis se cachèrent de nouveau comme s'il avait souri. Oui, dit-il. J'crois qu'il y en a beaucoup qui voudraient le connaître» (p. 162). Le Mal, aussi, est décrit, comme dans le premier roman de McCarthy, par une pléthore de comparaisons et de métaphores religieuses, lorsqu'il ne s'agit pas, tout simplement, d'emprunts directs à tel ou tel passage des Évangiles (voir ainsi l'épisode des pourceaux, pp. 202-4) où nous pouvons ainsi lire : «Le gardien [du troupeau de pourceaux] qui lui avait parlé fut projeté devant lui le dos voûté et les mains en l’air, épouvantail désarticulé et déguenillé qui se débattait avec des gestes éphémères dans cette frise de créatures frénétiques de sorte que Holme vit l’espace d’un éclair surgir obliquement de la poussière et du chaos et foncer sur lui deux yeux blancs qui étaient au-delà de l’espoir et une bouche morte qui était au-delà de la prière, portés comme l’ancien apostat de l’Évangile sept fois saisi dans le flot de ses propres invocations du monde souterrain ou comme un héros ballotté grotesque et traqué sur les épaules d’une foule confondue dans son iniquité à la forme même du mal, jusqu’à l’instant où il franchit le bord de l’escarpement et disparut avec son massif cortège de pourceaux» (p. 204).
(4) «Elle se leva et alla à la rivière et lava son visage et le sécha avec ses cheveux. Ayant ramassé le balluchon dans lequel étaient rassemblées ses affaires elle ressortit sous le pont de l'autre côté et repartit le long de la route. Émaciée comme elle était et battant des paupières et ses guenilles flottant au vent on eût dit une créature reprise à la terre par quelque obscur miracle pour être livrée dans son lambeau de suaire et son hésitante matérialité au supplice du soleil» (pp. 92-3).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, l'obscurité du dehors, cormac mccarthy |  |
|  Imprimer
Imprimer