L’Amérique en guerre (19) : 1919 (U.S.A. II) de John Dos Passos, par Gregory Mion (01/12/2020)

Crédits photographiques : Gary Hershorn (Getty Images).
George Steiner, Le transport de A. H.
«Nous avons vu ce qui est sans forme assumer une forme.»
Arthur Machen, Le Grand Dieu Pan.
Le programme du Capital : la guerre de tous contre tous
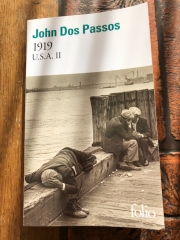 Au centre de la trilogie U.S.A. de John Dos Passos, entre Le 42e parallèle où l’Amérique amorce une logique exacerbée de la réussite individuelle et La grosse galette où l’Amérique ressemble à un monstre de spéculation financière qui court tragiquement à sa perte, se dresse 1919 (1), un roman qui raconte comment la Première Guerre mondiale a excité les ambitions d’un pays qui devait devenir le gendarme de la planète et adopter définitivement l’idéologie aliénante du capitalisme. À travers un foyer de destins où se télescopent des personnages de fiction et de vraies personnes qui ont participé au torrent de l’Histoire, Dos Passos, pourvu de multiples ressources stylistiques allant de la narration classique aux fulgurances du poème en prose, mais empruntant aussi aux domaines du flux de conscience et des modalités journalistiques, revient sur les très convulsives années 1916-1919, sur ce segment de temps durant lequel les États-Unis ont noué des liens d’amitié ambigus avec l’Europe. En effet, l’entrée en guerre des Américains en 1917, quand on lit Dos Passos, concerne moins les attributs d’une intention morale que les moyens dissimulés d’un opportunisme mercantile hallucinant. On le sait du reste : la Grande Guerre s’enracine dans une matrice de concurrence économique et les Américains, attentifs aux enjeux européens, attentifs également à l’affaiblissement du Vieux Continent depuis le casus belli de Sarajevo, ont senti que la mondialisation de ce conflit pouvait servir leurs intérêts. Parfaitement renseigné sur ce contexte – à la fois théoriquement et pratiquement, puisque Dos Passos, alors étudiant en Espagne, s’était engagé comme ambulancier sur le front dès l’été 1917 avant même que son pays ne s’implique officiellement dans la bataille (2) – l’écrivain entend stigmatiser les «profiteurs de guerre» (p. 208) et la manière dont l’argent, à partir du moment où il se compromet dans l’idéologie capitaliste, traduit un amour immodéré de la guerre (cf. p. 510).
Au centre de la trilogie U.S.A. de John Dos Passos, entre Le 42e parallèle où l’Amérique amorce une logique exacerbée de la réussite individuelle et La grosse galette où l’Amérique ressemble à un monstre de spéculation financière qui court tragiquement à sa perte, se dresse 1919 (1), un roman qui raconte comment la Première Guerre mondiale a excité les ambitions d’un pays qui devait devenir le gendarme de la planète et adopter définitivement l’idéologie aliénante du capitalisme. À travers un foyer de destins où se télescopent des personnages de fiction et de vraies personnes qui ont participé au torrent de l’Histoire, Dos Passos, pourvu de multiples ressources stylistiques allant de la narration classique aux fulgurances du poème en prose, mais empruntant aussi aux domaines du flux de conscience et des modalités journalistiques, revient sur les très convulsives années 1916-1919, sur ce segment de temps durant lequel les États-Unis ont noué des liens d’amitié ambigus avec l’Europe. En effet, l’entrée en guerre des Américains en 1917, quand on lit Dos Passos, concerne moins les attributs d’une intention morale que les moyens dissimulés d’un opportunisme mercantile hallucinant. On le sait du reste : la Grande Guerre s’enracine dans une matrice de concurrence économique et les Américains, attentifs aux enjeux européens, attentifs également à l’affaiblissement du Vieux Continent depuis le casus belli de Sarajevo, ont senti que la mondialisation de ce conflit pouvait servir leurs intérêts. Parfaitement renseigné sur ce contexte – à la fois théoriquement et pratiquement, puisque Dos Passos, alors étudiant en Espagne, s’était engagé comme ambulancier sur le front dès l’été 1917 avant même que son pays ne s’implique officiellement dans la bataille (2) – l’écrivain entend stigmatiser les «profiteurs de guerre» (p. 208) et la manière dont l’argent, à partir du moment où il se compromet dans l’idéologie capitaliste, traduit un amour immodéré de la guerre (cf. p. 510).Autrement dit, avec 1919, John Dos Passos décrit l’exigence de se recommander à la guerre, à sa foudre incoercible et crapuleuse, pour que les hommes puissent continuer à idolâtrer la divinité ascendante du dollar américain. Le capitalisme aime la guerre et la paix qu’il fabrique à cet égard n’est qu’une trêve, une accalmie toujours trompeuse pendant laquelle se préparent de nouveaux combats sanglants, de nouvelles dévastations qui feront apparaître au grand jour l’insoutenable existence d’un monde humain défiguré par le système des capitaux, des bourses et des banques. En un sens, la Première Guerre mondiale peut légitimement être considérée à l’image d’un avant-propos des ramifications désastreuses du capitalisme, en l’occurrence comme un mauvais «la» pour la musique initiale du XXe siècle. Par conséquent ne nous y trompons pas malgré la distance qui nous sépare de ces années d’holocauste : la paix actuelle n’est motivée que par un Capital qui refuse pour l’instant toute forme de création ou de destruction, d’où l’impression que nous avons de vivre selon un statu quo axiologique absolument passif et fondamentalement occidentalisé, mais, aussitôt que la nécessité le dictera, aussitôt que l’argent aura besoin d’un détour impératif et qu’il pressera les divers pouvoirs politiques dans cette direction, une autre guerre d’énorme amplitude se déclarera et ravagera encore une fois la Terre. Ne soyons pas dupes d’une situation internationale apparemment sous contrôle. L’absence d’une guerre totale réelle ne signifie pas l’absence d’une guerre totale symbolique où les hommes s’entretuent en nourrissant l’estomac gargantuesque du Capital, ce qui affleure nettement dans les premier et troisième tomes du triptyque U.S.A. , le deuxième étant le lieu même de la guerre suprême en acte.
Il s’ensuit que cet amour capitalistique de la guerre suscite une détestation farouche de tout ce qui pourrait venir contrarier son modèle. Lorsque la Révolution russe éclate au mois de février 1917 à la faveur de la Grande Guerre, elle jaillit comme une antinomie du Capital, comme une espérance d’alternative au cœur d’un monde déjà largement exposé à l’hydre de la finance planétaire. L’énergie révolutionnaire des bolcheviks inspire certains pacifistes ou certains rêveurs qui croient en une mutinerie des soldats (cf. p. 263). Ceux-là estiment que l’humanité est à la croisée des chemins, qu’elle est «à la veille d’événements gigantesques» et que «la guerre n’aura pas été inutile si elle aboutit à une civilisation socialiste nouvelle» (p. 263). Mais l’amour de la guerre à des fins économiques constitue un principe d’isolement qui s’oppose aux velléités communautaires du socialisme. L’individualisme violent attisé par un capitalisme croissant élimine toute possibilité d’amour au-delà d’un amour de la guerre (que celle-ci soit d’ailleurs directe ou indirecte). Le Capital, en tant que tel, incarne la plus petite extension de l’amour dans la mesure où sa passion de l’argent ne peut s’assouvir qu’au moyen d’une multiplication de la discorde. Là où quelqu’un tel que Feuerbach a pu écrire que «plus tu te sacrifies toi-même, plus ton amour est grand et vrai» (3), le Capital, à l’inverse, manifeste un désir de sacrifice d’autrui qui fait dégénérer l’amour dans la médiocrité et le mensonge. En provoquant la guerre partout où il émerge, le Capital plonge les uns et les autres dans ce que Feuerbach appelle le «néant», c’est-à-dire le vide existentiel, la suspension de toute intersubjectivité, ce qui «au monde peut le moins être en commun» (4). Si comme le pense Feuerbach l’homme n’est heureux qu’en accomplissant un faisceau de relations humaines où l’individu se réalise en «[posant sa] vie dans un autre» (5), le Capital, par contraste, déréalise le lien amoureux en hypertrophiant la citadelle de l’ego, anéantissant par la même occasion tous les potentiels de réciprocité généreuse qui pourraient structurer l’humanité. Ainsi, à un niveau très intime de la conscience, ce que perçoivent les enthousiastes de la Révolution russe, ce sont probablement les prémices d’un Grand Soir, la promesse d’une aurore où les tendances égoïstes dominantes seraient spectaculairement renversées. Toutefois nous l’avons dit précédemment et nous le reformulons d’emblée : le Capital ne supporte pas l’innovation ou la contestation dès lors qu’il n’est pas à l’origine des initiatives, et les Russes, quoique convaincants et dignes dans leur sursaut militant, ne parviendront pas à pénétrer les lignes de force de la mentalité américaine. C’est pourquoi la Révolution de 1917 ne demeure tout au plus dans l’œuvre de Dos Passos qu’un sujet de conversation, une excitation passagère, l’amour de soi et de l’argent étant plus important sur le long terme. Cela explique en outre les amours erratiques de bon nombre de personnages américains ou américanisés mis en scène par Dos Passos – ils ne sont pas suffisamment autonomes pour opérer un bouleversement significatif de leur âme. Le paradigme capitaliste ne laisse pas s’approcher de ceux qui l’ont intériorisé la dimension créatrice et destructrice de l’esprit révolutionnaire. Pire encore, le capitalisme n’amplifie son périmètre qu’à la proportion de l’autodestruction de la subjectivité, laquelle, négativement, se mue en objectivation du psychisme et entraîne une satano-praxie universelle. Du soldat qui risque sa vie sur le champ de bataille au riche industriel qui accumule des biens de consommation, il n’y a finalement qu’une différence minime puisque chacun se bat pour la même Puissance, pour les mêmes «gouvernements cannibales» (p. 247).
Dans cette lignée d’hypothèses, le personnage de Ben Compton (cf. pp. 489-522), aspirant homme d’affaires qui voulait venger ses parents humiliés par la pauvreté, puis soudainement repenti à la suite d’une rencontre avec un jeune anarchiste prénommé Nick, ne pouvait que sombrer jusqu’aux mitards d’une prison (cf. p. 522). Le socialisme, à l’orée des années 1920 américaines, n’est rien de moins qu’un crime contre la politique générale. Mais de toute façon, nul regret à avoir, car en se laissant convaincre par le libertaire Nick, en écoutant la supplique de ce garçon qui l’exhorta à devenir un «[grand homme] de la classe ouvrière» (p. 498), Ben Compton devait prouver que sa poitrine était pourvue d’un cœur et qu’il aurait donc tôt ou tard failli dans son entreprise de self-made-man vindicatif. Il serait sans doute même tombé dans le piège le plus rodé du capitalisme, à savoir les femmes, meilleurs ustensiles de la corruption masculine selon Nick, fidèles alliées de l’argent et des oukases du train de vie à tenir pour ne pas subir le déshonneur (cf. p. 498). C’est la raison pour laquelle, indéniablement, les femmes, certaines femmes irréductiblement vénales, sont les trophées de chair de ceux qui ont raflé la mise, et, qui plus est, lorsque la stabilité du monde devient précaire, la femme cupide choisit son camp comme Shirl a choisi deux fois le sien dans Soleil vert d’Harry Harrison. À rebours de ce schéma navrant, Ben Compton, surmené par son parcours inattendu de communiste, connaît l’oppression et la violence (cf. pp. 505-6), électron libre bientôt rattrapé par la patrouille, brisé dans son élan par un capitalisme arrogant qui proclame «l’aube d’une ère nouvelle de coopération internationale au sein de laquelle d’immenses réserves de capitaux se [grouperont] pour œuvrer en faveur de la paix et de la démocratie, contre les réactionnaires et les militaristes d’une part et contre les forces sanguinaires du bolchevisme d’autre part» (p. 536). La synthèse d’un univers mollement démocratique ne saurait mieux être exprimée. Dorénavant la guerre et toutes les formes de sédition ne pourront être promulguées que par les décrets patents ou latents de la démocratie capitaliste occidentale.
Figures de proue ou figures de poupe : quelques hommes qui ont fait l’Histoire (et quelques autres qui ont cru la faire)
La rubrique des «Actualités» rythme la trilogie U.S.A. en scandant des titres ou en restituant des fragments d’articles qui vont du fait divers le plus anodin aux plus brûlantes secousses économiques, mais tous ces événements, dans 1919, du plus banal au plus remarquable, sont chacun sans exception corrélés à la volonté métaphysique du marché de la guerre montante, culminante et faussement déclinante après l’armistice du 11 novembre 1918. L’équivoque n’est pas permise lorsque la presse écrit que «la Bourse de New York est le seul marché de valeurs mobilières encore libre dans le monde», cela au milieu d’un brassage de nouvelles où l’on peut lire que la bataille de Verdun fait rage (p. 9). On devine ici la causalité secrète qui anime le monde, la morphologie scélérate qui se dessine pour la civilisation, l’évidence que le malheur des uns contribue au bonheur des autres. Les ruines accumulées de l’Europe donnent de la suite dans les idées aux intelligences obscènes. L’impérialisme américain se négocie au fur et à mesure que la guerre s’enlise. L’abîme de noirceur qui grossit en Europe motive aux États-Unis une rhétorique étincelante de l’espoir et des projets pharaoniques. Au fond, la suppression progressive de l’étalon de mesure européen implique la démesure de l’ambition américaine, et, à bien y regarder, l’Europe est peut-être moins menacée par sa guerre que par les préméditations qui circulent outre-Atlantique. Là-bas, au pays de l’Oncle Sam, tout est indexé sur le devenir de la guerre et sur les manières de l’exploiter. En amont de leur engagement formel dans le conflit, les États-Unis sont informellement accaparés par les mouvements de la guerre, par les offensives et les replis, par les déclarations fracassantes ou les silences prudents, par les crédits ou les débits des belligérants.
D’ailleurs, contrairement à ce que Montesquieu suggérait quand il affirmait que le commerce était un facteur larvé de paix globale, la guerre, pour les Américains, commande une recrudescence d’opportunités marchandes simultanément à une dégradation accélérée du contexte global tout en appareillant le monde en vue d’une future Pax Americana calculatrice, cynique et belliqueuse. En revanche, là où Montesquieu a vu juste, c’est que la paix introduite par les relations commerciales (ce qui sera le cas dès le lendemain du cessez-le-feu de 1918), si elle évite des tensions immédiatement meurtrières entre des nations mutuellement sous contrat, déclenche des tensions inévitables entre les particuliers pour peu que ces derniers aient assimilé l’ensemble des mœurs qui président au commerce (6). La fin de la Première Guerre mondiale sera par conséquent le début certifié des guerres intestines entre des individus que le capitalisme astreint à l’immoralité : la réussite sociale, parmi un réseau de circonstances capitalistes, se fera désormais par le vice et non plus par la vertu. Ce n’est plus le glaive qui tuera l’ennemi en un combat parfois loyal, mais le coup fourré, la manigance, la ruse la plus hypocrite en un combat systématiquement déloyal. Qui, du reste, aura le courage de s’inscrire en faux contre cette sordide réalité en parcourant les journaux en temps de guerre et en y ponctionnant ceci («le taux de capitalisation a augmenté de 104 % tandis que le taux de croissance atteint 520 %» – p. 85) ou cela («Les Rumeurs de Paix Commencent à Jouer sur le Marché du Fer dans le Sud» – p. 165) ?
Peu à peu, donc, John Dos Passos, au gré des fluctuations de la guerre, nous fait voir une irrévocable mutation des rapports sociaux. L’émulation de bon aloi va faire place à la concurrence acharnée. La Grande Guerre acclimate définitivement le monde à une lente et irrésistible aggravation du capitalisme industriel, étouffant tout sur son passage, escamotant les émotions nobles et favorisant les passions ignobles, allant même jusqu’à détourner l’imagination de ses meilleures fonctions. Aucune échappée belle ne paraît envisageable à l’intérieur de cette prison mentale, d’où, en toute rigueur, l’impossibilité de vivre sereinement une histoire d’amour durable et désintéressée. L’incessante et exponentielle activité du Capital de guerre détruit le gisement le plus précieux de l’humanité et condamne les hommes à une déperdition d’eux-mêmes sans précédent. Toute créativité digne de ce nom a l’air compromise d’abord par les injonctions d’une productivité dédiée à la guerre mondiale, ensuite par les préceptes des milliards de guerres particulières que les hommes se font les uns aux autres. L’époque est quasiment subordonnée à un hédonisme décevant : il faut saisir le plaisir véritable tant qu’on le peut, comme le raconte par exemple Stefan Zweig dans Clarissa en nous montrant l’incommensurable force de désunion de la guerre, se prescrire une improbable digression de volupté, avant que tout ceci ne soit emporté par les ouragans de la folie humaine. Or c’est précisément au cœur de cette tourmente que John Dos Passos s’arrête sur quelques destins réels pour nous en révéler plusieurs aspects, plusieurs traits de caractère spécifiques, le plus souvent accordés au tempo funeste de l’Histoire. En poétisant ces biographies célèbres à l’instar d’un Walt Whitman qui battit la mesure de la guerre de Sécession avec Le tambour bat et les Images du Président Lincoln dans nos mémoires (7), le romancier oscille entre la rhapsodie et le verset, nous livrant des portraits intenses dans lesquels dominent ou bien le sentiment d’une lugubre prédestination, ou bien la faillite du héros clairvoyant.
Dans le rang des lucides héros malheureux qui avaient auguré la décadence du libéralisme et qui partirent en croisade pour affronter le démon de plus en plus immatériel de l’argent, on recense John Silas Reed, la «Tête brûlée» communiste (cf. pp. 20-5), correspondant de guerre, témoin de guerre, argonaute d’une Terre épileptique où il n’est jamais loin des «gars qui [ont] été jetés en enfer» (p. 24), colligeant notes et impressions et finissant par écrire Dix jours qui ébranlèrent le monde, une apologie de la révolution bolchévique enfin venue à bout de l’iconologie tsariste. L’Américain Reed se prend à rêver d’un soulèvement similaire aux États-Unis, d’une purge intellectuelle et corporelle, d’un antidote aux discours dégradants du capitalisme. Horrifié par la «farouche réalité» (p. 24) de la marchandisation galopante des corps et des esprits, John S. Reed fustige les membres émérites du «Harvard Club», lesquels, sans réserve aucune, participent aux «services de renseignements» chargés de «rendre le monde sûr pour le consortium bancaire Morgan-Baker-Stillman» (pp. 24-5). Lui-même élève à Harvard, issu d’une famille bourgeoise parvenue au zénith de son outrance, le séditieux Reed a radicalement coupé le cordon avec ces atmosphères captieuses, dédaigneuses et conformistes, composées de belles âmes ostentatoirement pacifistes mais sous-traitantes des plus infimes officines de la guerre. À contre-courant de ces oisifs dont les gants de velours dissimulent des mains attirées par le Mal absolu, John S. Reed se transforme en indéfectible soutien des travailleurs, s’informant par exemple, épouvanté, des tenants et des aboutissants du massacre de Ludlow (Colorado) où la répression des ouvriers grévistes, le 20 avril 1914, a été sanglante. Et même s’il «attrapa le typhus et mourut à Moscou» (p. 25) en octobre 1920, Reed, possiblement, aura été révulsé par le massacre de Centralia (Washington) le 11 novembre 1919, au cours duquel périt Wesley Everest (cf. pp. 527-533), un bûcheron syndicaliste qui incarna la figure mythique de Paul Bunyan ainsi qu’un avant-goût de ce que devait instruire Ken Kesey dans son inoubliable roman Et quelquefois j’ai comme une grande idée. La commémoration du premier anniversaire de l’Armistice, pour Wesley Everest, redoublée de revendications sociales, s’acheva sur les territoires dont on ne revient plus. Il fut lynché à mort par les commis d’une autorité illégitime sourde à toutes les doléances. Lui aussi, n’en doutons pas, tel John Silas Reed, avait perçu la dérive capitaliste de son pays, de surcroît après avoir expérimenté le pandémonium des tranchées au sein d’une Europe saccagée par les obus et ombragée par le soleil noir d’une idéologie qui ne faisait qu’attendre son heure. Au reste, cette base de militantisme concret ne saurait être complète sans la jonction avec son sommet Joseph Hillström, alias Joe Hill (cf. pp. 487-9), anarcho-syndicaliste originaire de Suède et catapulté aux États-Unis pour y semer le vent de la révolte dans les milieux très conservateurs de l’Utah, finalement vaincu par le mysticisme cruel des Mormons, ceux-ci ayant été inspirés par la trompette soi-disant dorée de l’ange Moroni (cf. p. 489).

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, john dos passos, l'amérique en guerre, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer