Solaris de Stanislas Lem et le Dieu incompréhensible (30/03/2006)
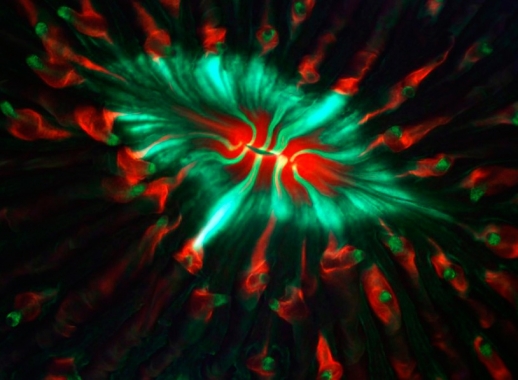
Crédits photographiques : James Nicholson, NOAA NOS NCCOS Coral Culture and Collaborative Research Facility, Charleston, South Carolina (Nikon Small World).
J’ai peine à croire que j’ai pu tant écrire. Je dis cela sans aucun sentiment particulier et, surtout pas, grands dieux non !, de la fierté. C’est même tout le contraire puisque je ne lis certains – en fait la majorité – de mes textes qu’avec un très pénible sentiment de gêne. Je ne puis ainsi parcourir quelques lignes de mon livre sur Steiner qu’avec la plus extrême prudence et encore, je suis bien incapable de poursuivre ce petit jeu bien longtemps, qui consiste à lire le texte d’un fantôme qui ne hante aucune maison abandonnée mais sa propre cervelle… Il est vrai que ce livre étrange est lui-même hanté par un fantôme, bien vivant sans doute et ayant même engraissé depuis qu’il a muré sa promesse kierkegaardienne, jadis prononcée dans un silence qui ne sut certainement pas l’accueillir, dans le meublé douillet d’une Régine Olsen de Guignol lyonnais. Pourtant, la banalité consistant à dire que cette répugnance provient du fait bien compréhensible que, depuis l’écriture de tel ou tel texte, je ne suis plus le même, est une andouillerie que je n’oserais pas même flairer de loin. Je ne crois pas aux recommencements et les idiotes qui, d’un geste devant leur miroir, effacent pour un autre les rides et les plis de souffrance de leur visage repeint à neuf, seront tôt ou tard mordues par des souvenirs plus aigres qu’un renvoi de bile.
Non. Il y a, il doit y avoir autre chose car enfin, si le texte écrit a découvert quelque parcelle de la vérité âprement recherchée, il doit bien être valable, mon Dieu, au-delà de quelques mois, voire années, sans devoir se ratatiner comme un trognon de pomme oublié de tous ou comme cette… cette quoi ? (amande, noisette ou je ne sais quoi d’autre, petit et infiniment desséché) qui n’en finit pas de se momifier dans l’étrange roman d’un auteur aujourd’hui bien oublié, Jean Blanzat, intitulé Le Faussaire. Pourtant, je suis de ceux qui, comme le tueur de Notre Assassin de Roth, pensent que la parole est souveraine, infiniment plus puissante que l’action, sans même qu’il m’ait fallu lire, avec patience et ténacité, Maistre, Hamann, Vico, Boutang (le premier grâce au second), Platon, Rousseau ou, avec Heidegger, le plus majestueux (et très habile recycleur de ceux qu’il a lus) d’entre les logocrates, George Steiner. En fait, la simple lecture de Conrad, de Bernanos ou de Faulkner m’a définitivement persuadé que, en dépit même de son extraordinaire faiblesse, la parole est impérissable, comme je le confiais un peu naïvement je dois le dire en exergue de mon essai sur Steiner, par ces mots douloureux, qu’un crétin professeur de philosophie comprit de travers, affirmant qu’un mort n’est jamais absent : «À Natacha, plus absente qu'une morte, qui mieux que moi sait qu’une parole, de haine ou d’amour, parce qu’elle est l’éternité, est impérissable, et définitive…».
Le texte ci-dessous, brève critique du mondialement célèbre Solaris de Lem, aborde le thème d’une séparation tragique entre deux êtres, thème qui n’est pas à mon sens le plus profond de l’œuvre, celle-ci interrogeant avec une acuité autrement plus redoutable et convaincante le sens d’une présence étrangère et mystérieuse, peut-être divine mais rien n’est moins sûr. Reste que Soderbergh, dans l’adaptation qu’il a proposée de Solaris, a réalisé une œuvre austère et triste, parfois émouvante il est vrai qui, elle, à la différence du chef-d’œuvre de Tarkovski, choisit de privilégier l’énigme de la séparation, d’ailleurs comblée illusoirement à la fin du film, alors que le roman de Lem se terminait, plus prudemment et beaucoup plus finement (seule la littérature atteint je crois à une aussi souveraine suspension des interprétations) sur une bouleversante interrogation, à vrai dire, sur le sens même du miracle pascal : la certitude d’une résurrection ou, pour le dire dans un langage plus philosophique que chrétien et avec Kierkegaard, d’une reprise.
«Nous ne recherchons que l'homme. Nous n'avons pas besoin d'autres mondes. Nous avons besoin de miroirs.»
Stanislas Lem, Solaris.
Solaris est le roman le plus célèbre de Stanislas Lem, le maître polonais de la science-fiction né en 1921. Cet ouvrage, nous en reparlerons, a été superbement porté au cinéma par Andreï Tarkovski en 1972 (1). L’actualité de cette œuvre est d’ailleurs riche puisqu’une nouvelle adaptation cinématographique doit paraître, réalisée et produite par le tandem Soderbergh/Cameron. Sans trop craindre de me tromper, je doute fort que le travail de ces duettistes de la grosse caisse américaine soit autre chose qu’un enfilement rythmé d’effets spéciaux, dont la mise en scène nous fera amèrement regretter la rudesse inspirée de celle du maître russe. Quelques mots de l'histoire tout d’abord, au demeurant assez simple et proche à maint égard du classique d’Arthur C. Clarke, piteusement galvaudé par ses suites racoleuses, Rendez-vous avec Rama. Solaris est un monde nouveau exploré par les hommes, une planète-océan qui gravite autour de deux soleils. Monde nouveau ? Pas tout à fait, puisque, depuis plusieurs décennies, les savants étudient cette planète singulière, ce très mystérieux océan de la taille d'un monde qui est intelligent — sur ce point au moins, tous s'accordent, car il existe plusieurs branches de la solaristique, plusieurs écoles scientifiques de solaristes adorant, comme tous les scientifiques, se chamailler entre eux, fomentant sans relâche des querelles de chapelles —, monde mystérieux qui très sûrement est très intelligent, qui très probablement n'est peut-être même qu'intelligence. Une sorte de cerveau liquide vaste comme un monde, cela ressemble sans doute à ce qu’un observateur comme vous et moi — en l’occurrence Kelvin, le personnage principal de l'aventure, même si Tarkovski accentue le scepticisme du scientifique — nommerait Dieu.
Dieu incompréhensible, mystérieux, impénétrable, bien que jamais l'homme n'ait eu la chance de demeurer dans une telle proximité avec Lui, à sa surface pourrait-on dire : bien sûr, l'intolérable vient de cette cohabitation plus que difficilement supportable entre ce qui est à portée de main (ou d’expérimentation, ou de savoir, ou de prière), et ce qui demeure, malgré l'ingéniosité déployée par les chercheurs pour tenter de communiquer avec Solaris, une énigme. Alors, comme sur le vieux Dieu des Juifs et des Chrétiens, c'est une glose immense qui s'est développée sur le cas Solaris : aucune, bien évidemment, n'a trouvé d'explication satisfaisante au mystère de la planète-océan, ou plutôt, d'explication acceptable par tous car, je l’ai dit, la vérité d'une église, d’une hérésie ou même d’une secte n'est valable qu'à ses propres yeux. Ainsi, dans le roman de Lem comme dans le film de Tarkovski, la communauté scientifique est presque sur le point de renoncer à ses efforts et de mettre un terme à l’observation constante de Solaris par les hommes. Malgré toutes les expériences tentées par la communauté scientifique qui se relaie sur la petite station, nul n’a réussi à établir un contact avec Solaris. La même tentation est perceptible dans Stalker, chef-d’œuvre du cinéaste datant de 1979, lui aussi adapté d’un roman russe de science-fiction : face à l’inconnu dans lequel les trois explorateurs pénètrent, face à la proximité du mystère, du miracle exaucé, le Professeur et l’Écrivain renoncent, reviennent bredouilles de la Zone, capable pourtant d’accomplir tous les vœux, comme le stalker le leur avait promis. Plus grave. Le Professeur, au moyen d’une bombe atomique, n’a-t-il pas désiré détruire la Zone, dont le secret résiste à la plate investigation scientifique ? La question que pose Tarkovski, dans cette œuvre, est donc simple : un monde dans lequel les hommes ont perdu la foi, un monde dans lequel ils se déplacent sans se tenir debout (to stalk évoque ainsi le fait de marcher à pas de loup) est-il encore capable de nous enchanter, au sens premier de ce mot qui évoque la magie banale d’une vie pleine, où la clarté d’une réelle présence ne serait pas le songe creux de quelques fous, où la possibilité de faire mouvoir les objets ne serait pas l’apanage seul d’une petite fille mutante, la fille privée de jambes du stalker ? De la même façon, la parabole qu’est Solaris peut être interprétée comme une incapacité, pour l’homme, de croire en la possibilité, toute proche, du miracle, celui par exemple d’une communication avec le monde-océan, celui qui fait revenir à la vie une personne jadis aimée, à présent disparue.
Sans doute ai-je procédé, en parlant de Dieu, à un raccourci peu fidèle au mystère qu’entretient le roman de Stanislas Lem. En effet, la réflexion sur Dieu n’intervient qu’aux dernières pages de l’œuvre alors que, dans l’œuvre du cinéaste, c’est plutôt la méditation sur la nature des rapports entre les différents personnages qui constitue une voie oblique chargée de signifier la présence du divin. C’est que, comme avec la réflexion théologique, l'important sans doute est moins de tenter de comprendre ce qui est au-delà, de toute façon, de la raison humaine, que de façonner cette dernière par l'exigence supérieurement difficile du questionnement face à ce qui se joue sur Solaris : «l'enjeu ne consiste pas uniquement à pénétrer la civilisation solariste, s'exclament certains scientifiques, il s'agit essentiellement de nous, des limites de la connaissance humaine» (42).
Confronté à ce qu'il ne peut saisir par sa seule intelligence, et qui de toute façon l'interroge dans cette douloureuse incapacité, il reste un seul recours à l'homme : tenter de se comprendre lui-même, percer son propre mystère, et peut-être, alors... «Il vaut peut-être la peine de rester, dit ainsi un des personnages, nous n'apprendrons sans doute rien sur lui, mais sur nous… » (123). Solaris devient ainsi le saint Graal, la clé de l'énigme de l'univers et de l'homme, de l’univers parce qu’il peut justement permettre à l’homme de tenter de se comprendre. L’énigme de Solaris, comme un miroir ténébreux, renvoie alors à l’énigme de l’homme, ignorant de ses propres abîmes (248), étranger en terre étrangère qui s’est élancé vers les étoiles sans même être parvenu à quelque sagesse. Le danger d’une telle démarche est pourtant bel et bien réel car, en confrontant l’homme à son propre miroir, le risque est de réduire le questionnement sur l’absolument étranger à une simple copie anthropomorphique – le monde-océan analysé et compris comme une Terre différente – bien que Solaris offre aussi à celui-ci, à l’évidence, la chance inespérée d'une anamnèse. Ce dernier point est crucial : «La solaristique ressuscite des mythes depuis longtemps disparus ; elle traduit des nostalgies mystiques, que les hommes n'osent plus exprimer ouvertement; la pierre angulaire, profondément enfouie dans les fondations de l'édifice, c'est l'espoir de la Rédemption... » (272).
Le mot est prononcé, il n'est peut-être qu'une fausse piste dans la tentative de compréhension de Solaris, il n'est peut-être qu'une façon dévoyée, pour l'impérieux désir de transcendance qui taraude la créature humaine à présent colonisatrice de l’univers, meurtrière de Dieu il y a bien longtemps, de s'exprimer, une façon nouvelle et inédite de s'enter sur une branche hybride et inattendue, porteuse donc de vigueur, d'espérance, de ce mouvement lent agitant des algues que Tarkovski n’en finit pas de filmer au début de son œuvre. Quoi qu’il en soit, le roman de Lem ne tranche pas et c’est là sa force poétique. Solaris est ainsi le roman de la suspension. Dans tous les sens du terme, ses personnages y flottent, au-dessus de l’océan mais également dans une espèce de seuil magique qui les empêche de décider ou de poser les bonnes questions. Il faut avoir un cœur et un esprit purs, sans doute, avant de s’approcher du sphinx dangereux qui va délivrer l’oracle, avant d’oser entrer dans le saint des saints…
Incompréhensibilité... Énigme... Mystère... Voici les mots qui le mieux rendent compte de l'atmosphère du roman de Stanislas Lem. Un quatrième terme est important, qui constitue à vrai dire, à mes yeux, la clé de l’œuvre, celui de rencontre. Il s’agit là, banalement, du thème premier de la science-fiction, infiniment décliné, même si le roman de l’auteur polonais, comme par exemple le remarquable Babel 17 de Samuel Delany, ne nous invite pas à une réflexion sur le langage, ses limites et ses pouvoirs redoutables. Toute rencontre pose pourtant la question du langage. C'est que Solaris tente, en dépit de l'échec que nous avons pointé, d'établir une communication coûte que coûte avec le petit contingent de chercheurs retranchés sur une base volante ; chacun d'entre eux devient ainsi le témoin d'un événement extraordinaire et désagréable : sa nouvelle rencontre avec un être cher (ou qui le hante), mort depuis des lustres. Le seul problème, mais insurmontable et grotesque, est que ces personnages peuvent être produits en série par le cerveau-océan, qui paraît donc s’amuser monstrueusement. Ainsi Kelvin, comme le physicien Sartorius et le cybernéticien Snaut confrontés à de tels clones tragiques, se retrouve face à face avec une femme qu'il a aimée, Harey, femme qu’il a d’ailleurs probablement conduite au suicide. Très vite, la situation devient intenable, ridicule pour les chercheurs confinés dans leur petite station, que Tarkovski n’a pas voulu glaciale et inhumaine, mais simple, banalement humaine, au rebours donc de l’épure visuelle du Kubrick de 2001, l’odyssée de l’espace : «La planète dominée par un énorme diable, qui satisfait les exigences de son humour satanique en envoyant des succubes auprès des membres d'une expédition scientifique... » (117).
C'est que la peur, sans doute, et la folie, guettent les hommes aux prises avec le Dieu étrange, comme cela se voit dans la superbe nouvelle d'Ursula Le Guin, Plus vaste qu'un empire, dans laquelle les membres d'un équipage sont confrontés aux fantômes d'un monde de cauchemar, miroir immense de leurs frayeurs : «Quelque chose s'amoncelait au-dessus de moi, de plus en plus haut, à l'infini. La nuit, la nuit me transperçait de part en part, la nuit prenait possession de moi, elle m'enveloppait et me pénétrait, impalpable, inconsistante » (142). La folie ? Oui, car deux modèles successifs de la belle Harey, totalement ignorants de ce qui est arrivé à leur prédécesseur, tourmentent Kelvin, l’un et l’autre de ces clones tragiques, ce que Tarkovski a remarquablement compris, exigeant du scientifique une réponse qui est tout autant une introspection dans l’esprit et l’âme du personnage. Est-ce dire que Solaris est une divinité mauvaise ? Non, simplement, comme le pensaient jadis quelques spéculateurs de la Kabbale juive dans leur doctrine du Tsintsoum (qui admet une sorte de retrait de Dieu hors de sa Création, afin que l'homme exerce sur elle sa fantastique liberté), ressemble-t-il à un Dieu imparfait, à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un qui puisse combler son manque intolérable. Kelvin nous le dit : « Un Dieu limité dans son omniscience et dans sa toute-puissance, faillible, incapable de prévoir les conséquences de ses actes, créant des phénomènes qui engendrent l'horreur. C'est un Dieu... infirme, dont les ambitions dépassent les forces» (309). Mais Solaris est-il ce Dieu auquel pense Kelvin ? Non, encore une fois : Solaris — cette hypothèse expliquant alors l'impossibilité de communiquer avec l'océan-monde —, n'est peut-être qu'un enfant au comportement quelque peu extravagant, qui enverrait aux hommes, pour essayer de les comprendre, des simulacres de vie (311). Cependant, face à l'échec d'une multitude de tentatives pour établir un lien rationnel entre l'Homme et Solaris, il nous faut peut-être nous résigner à abandonner cette trop séduisante hypothèse d'un Solaris-Dieu. Car Solaris n'a pas besoin, comme le Dieu imparfait de la Kabbale, du concours précieux des hommes qui le questionnent sans relâche, qui jamais n'abandonnent leur patiente et déroutante recherche : le monde-océan, lorsque les hommes, lassés, auront quitté sa surface liquide, retrouvera sa parfaite tranquillité, reprendra sa course sans but autour de ses deux soleils, comme une espèce d’autiste prodigieux incapable de se libérer du joug de la matière (309), ce que les toutes dernières images de l’œuvre de Tarkovski montrent avec force. Car Solaris encore ne vit pas, n'a pas cette conscience démiurgique que semblent très fortement soupçonner les chercheurs qui l'interrogent. Peut-être a-t-il vécu jadis, mais, à présent et à jamais, il est mort, il n'est plus qu'une goutte bizarre et fantasque perdue dans le Cosmos. Il n'est même pas un Dieu ; écoutons en effet Kelvin affirmer, à propos du monde étrange, que, «au cours de son développement, il a sans doute frôlé l'état divin, mais il s'est trop tôt renfermé sur lui-même. C'est plutôt un anachorète, un ermite du cosmos, pas un dieu... » (311).
Avez-vous jamais essayé de communiquer avec un enfant autiste ? Telle semblerait être, en fin de compte, la question à quoi se résume la parabole qu'est Solaris. Deux points cependant infirment cette idée. Tout d’abord, comme dans le roman de Philip K. Dick intitulé Glissement de temps sur Mars, cette interrogation douloureuse fouaille la racine même de l'homme aux prises avec un Dieu de misérable impuissance. Solaris est riche, je l’ai dit, de cela même qu’il refuse de nous dévoiler. Ensuite, je n’ai pas assez insisté sur un des aspects de cette rencontre entre le personnage principal et la femme qu’il a jadis aimée. Il est évident que cette rencontre échoue, ne serait-ce que par l’étrangeté même, insupportable et scandaleuse, du don fait à Kelvin, incapable d’ailleurs de l’accepter comme tel. Retrouver celle qu’il a chérie et perdue, apprendre de nouveau à l’aimer, il ne parviendra à le faire, en tentant d’oublier celle qu’il a connue, qu’au moment où, une nouvelle fois, Harey disparaîtra. En mourant de nouveau, en se suicidant une nouvelle fois, la belle Harey laissera donc Kelvin aux prises avec le paradoxe absolu, kierkegaardien s’il en est : l’attente et l’espérance folle d’un retour, d’une reprise déjouant les lois rationnelles, pas même la certitude douloureuse d’avoir gâché un don absolu et mystérieux ou plutôt, cette certitude même, intolérable et culpabilisante, ne parvenant pas à briser l’arc follement tendu de l’espérance. Et cependant je vivais dans l’attente, nous dit ainsi Kelvin, car, depuis qu’elle avait disparu, il ne lui restait plus que l’attente (320) et l’espoir fou que lui soit donné celle qu’il a perdue intolérablement, parce qu’il l’a perdue deux fois, parce que, deux fois, il n’a pas su la garder ni la retenir. Le roman se clôt sur cette attente toute bruissante de la certitude du mystère qui ne manquera pas, comme dans le beau roman de Dürennmatt intitulé La promesse, d’éclater d’une façon ou d’une autre alors que le film de Tarkovski, beaucoup plus pessimiste, enferme le spectateur dans le cauchemar du personnage principal, ce qui me semble, de la part du grand cinéaste, être une lecture bien sombre de l’œuvre de Stanislas Lem. Qu’importe même si le monde décrit par ce dernier, face à Kelvin, demeure ce Dieu d’impuissance et de silence qui s’est pourtant joué des certitudes les plus solides de l’homme, qui a été pourtant capable de faire à cet homme un don d’une absolue nouveauté. Finalement, dans son essence religieuse qui est première mais visiblement occultée, Solaris est une parabole de l’espérance.
Bibliographie sommaire :
Solaris de Stanislas Lem (traduit du polonais par Jean-Michel Jasienko, Gallimard, Folio SF, 2002).
Solaris d’Andreï Tarkovski, Artificial Eye, prix spécial du jury du festival de Cannes, 1972. Une nouvelle édition est disponible depuis 2003, éditée par Criterion.
Stalker d’Andreï Tarkovski, Artificial Eye, 1979, d’après le roman d’Arkadi et Boris Strougatski, Pique-nique au bord du chemin, Stalker en version française (Denoël, coll. Présence du futur, 1994).
Note :
(1) En outre, Solaris vient d’être réédité par Gallimard (Folio SF) après avoir paru dans la très célèbre collection Présence du futur chez Denoël. Les pages entre parenthèses renvoient à cette nouvelle édition.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, science-fiction, solaris, stanislas lem, chris foss |  |
|  Imprimer
Imprimer