Les Onze de Pierre Michon et Match aller de Julien Capron (30/10/2009)

Crédits photographiques : Pedro Ugarte (AFP/Getty Images).
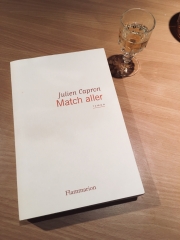 À propos de Les Onze de Pierre Michon [Grand Prix du roman de l'Académie française, ajout du 29 octobre 2009] et Match aller de Julien Capron, ce dernier reçu en service de presse.
À propos de Les Onze de Pierre Michon [Grand Prix du roman de l'Académie française, ajout du 29 octobre 2009] et Match aller de Julien Capron, ce dernier reçu en service de presse.Rappel
Amende honorable de Julien Capron.
En surface du moins, aucun point commun ne rapproche le remarquable second (1) roman de Julien Capron, Match aller des Onze de Pierre Michon, un autre très beau livre. Sous les apparences, c’est pourtant la même sourde inquiétude qui convoque les actes et les pensées des hommes qui, depuis qu’ils ont tué Dieu ou l’ont simplement oublié, ont compris, voire admis qu’il fallait réenchanter le monde, par un tableau évoquant une cène laïque comme Michelet l’a analysé, ou par un texte qui déploie amplement la folie de femmes et d’hommes qui, pour faire revenir sur terre les dieux enfuis, leur consacrent des victimes.
Les dieux, bien sûr, ne reviennent pas, ni peut-être même, dans le livre de Pierre Michon (un livre d’une écriture tendue dont il ne faudrait tout de même pas affirmer qu’elle est celle du plus grand écrivain français encore vivant), ces puissances des premiers âges que Michelet, encore une fois, confondait plaisamment avec l’Histoire. Dans Match aller, pourtant invoqués à grands renforts de macabres mises en scène paraphées d’énigmatiques citations tirées d’Héraclite, les dieux ne daignent pas se montrer ni même faire signe à nos protagonistes. Ni les dieux enfuis comme le révéla la mystérieuse parole entendue par Thamos (2) ni même le dieu dont le Fils s’est incarné, à seule fin nous dit Julien Capron de tendre les bras vers tous les pécheurs (3). De fait, les tueurs de notre roman essaient, en excoriant la chair de leurs victimes d’horrible façon, non seulement de redonner cœur à leurs espoirs malades mais, surtout, d’incarner ce qui n’a plus de consistance : «Le monde décomposé en apparitions, cerné d’objets, qu’il faut tuer et massacrer pour qu’y brille à nouveau la divinité retrouvant, delà les membres, l’espérance d’être corps» (p. 396). Match aller est ainsi, dans sa plus terrible profondeur, le roman de l’incarnation bafouée, qu’il faut à tout prix rejouer pour que le monde cesse de se décomposer sous nos yeux.
 De sorte que nous ne nous étonnerons pas que le roman de Julien Capron accorde tant d’attention aux corps et aux gestes des joueurs de rugby qu’il décrit dans une langue souvent magnifique, ni qu’il rythme son histoire par le déroulement d’un championnat imaginaire, comme Amende honorable était entée sur les horaires de l’ordre de Cluny. Si le jeu est symbole du monde selon Eugen Fink dont Capron s’inspire, monde visible et surtout invisible, il est l’unique théâtre où les acteurs (qui, eux aussi, jouent) peuvent exposer la misère et la gloire de signifier qu’exsude leurs gestes, leur âme livrée au public par tous les suintements et lignes de fissure de leurs corps et visage qui, comme l’éponge de saint Augustin, sont remplis d’esprit et de l’absence des dieux qui n’ont plus aucune réalité charnelle, qui ne dirigent plus nos gestes les plus humbles ou forts.
De sorte que nous ne nous étonnerons pas que le roman de Julien Capron accorde tant d’attention aux corps et aux gestes des joueurs de rugby qu’il décrit dans une langue souvent magnifique, ni qu’il rythme son histoire par le déroulement d’un championnat imaginaire, comme Amende honorable était entée sur les horaires de l’ordre de Cluny. Si le jeu est symbole du monde selon Eugen Fink dont Capron s’inspire, monde visible et surtout invisible, il est l’unique théâtre où les acteurs (qui, eux aussi, jouent) peuvent exposer la misère et la gloire de signifier qu’exsude leurs gestes, leur âme livrée au public par tous les suintements et lignes de fissure de leurs corps et visage qui, comme l’éponge de saint Augustin, sont remplis d’esprit et de l’absence des dieux qui n’ont plus aucune réalité charnelle, qui ne dirigent plus nos gestes les plus humbles ou forts.Nous ne nous étonnerons pas davantage que les Onze eux aussi décrivent le théâtre, non seulement le ténébreux Macbeth qui hante les pages de ce roman mais les immenses scènes naturelles où les protagonistes de la Révolution jouèrent leur pièce atroce. Je cite intégralement ce superbe passage : «Collot, ah Monsieur, Collot, qu’on peut commenter jusqu’à demain; qui était d’Herbois comme Corentin était de la Marche; qui fut homme de théâtre, comédien, dramaturge, quelque chose comme un second Molière; qui écrivit cinquante pièces qui se vendaient bien et se jouaient bien (mais tombaient directement de sa main dans le gouffre), dont Nostradamus; qui buvait comme quatre pour faire venir le verbe et ne pas trop voir que son verbe à lui tombait tout droit de sa main dans le gouffre; qui traduisit Shakespeare et le joua en costume sur une scène exiguë avant de le jouer pour de bon sur la scène de l’univers, c’est-à-dire à Lyon en novembre dans la plaine des Brotteaux où sur ses ordres on amenait devant des fosses ouvertes des hommes attachés par dix, par cent, et à dix mètres de ces hommes il y avait les bouches de canons chargés à mitraille, neuf canons de marine montés de Toulon par le fleuve, neuf canonniers au garde-à-vous la mèche allumée dans novembre, et Collot était là non pas en fraise élisabéthaine mais avec le chapeau à la nation, l’écharpe à la nation, debout, shakespearien, mélancolique, hagard, limousin, peut-être ivre, avec son bras levé avec son sabre au bout comme une baguette de maestro pour commander le feu, et quand Collot baissait le bras le monde disparaissait au profit de l’émoi de neuf canons de marine : c’est plus fort, Monsieur, cela, plus fort et enivrant et peut-être plus littéraire même que toutes les répliques de Shakespeare, on le sent dans le secret de son cœur, malgré qu’on en ait; Collot, donc, bon shakespearien comme il le prouva abondamment quand il fit Macbeth dans la plaine des Brotteaux […]» (4).
Les dieux enfuis, la chair des hommes dorénavant plus galvanisée par l’énergie mystérieuse véhiculée par les éléments et les invocations ou prières qui plient ces derniers à leur puissance, le rideau du théâtre ne se levant décidément pas, quels que soient les fumets immondes offerts aux narines des dieux jaloux, sur ce qui doit nous demeurer caché (5), deux possibilités subsistent, où tenter de fixer dans l’orangeraie du poète la présence enfuie : l’enfance (6) et l’écriture qui, quoi que l’on prétende pour masquer cette évidence, est la tentative la plus radicale et puissante pour vaincre l’infinie solitude de l’homme abandonné des dieux. Nos vies ne sont rien si leurs douleurs et leurs joies ne sont point ordonnées à une fin unique : un grand texte, comme celui de Don Quichotte selon Capron. Pour Michon également, «les hommes filent : et si les hommes étaient faits d’étoffe indémaillable, nous ne raconterions pas d’histoires, n’est-ce pas ? (p. 22). Étrange de constater que l’écrivain est moins celui qui lit le récit des autres que celui qui est apte à démailler les tissus les mieux ouvragés. Julien Capron évoque cette certitude à plusieurs reprises tout au long de Match aller : «Tout le monde a besoin de se concevoir pour être. Impossible en tout cas d’imaginer un énergumène qui vivrait son rôle scène après scène, sans jamais se faire le conte de ses actions, de ses bravoures, des injustices qu’il a affrontées; qu’il ne traque pas le sous-texte de la voix tremblante de madame quand elle n’a pas su expliquer telle absence. Réseaux et trames, qui lui expliquaient pourquoi on a imaginé ces grandes romancières au-dessus qui tissent le destin, prenant la peine, même sur les existences sans public, de coudre un récit qui tienne la route, même si, aujourd’hui, chacun croit rapiécer pour soi, chômage des Parques. Tout le monde n’en cherche pas moins sa fiction, tout le monde n’en brouillonne pas moins sa nécrologie au jour la journée» (p. 442). L’enfance semble même moins puissante au romancier que l’écriture, lorsqu’il s’agit de réunir dans une même trame et geste d’offrande vers les puissances invisibles les faits de toute une vie humaine : «Ce ne sont pas les réactions en chaîne que maîtrisent les ingénieurs qu’on vit, c’est l’harmonie des choses quand elles deviennent une histoire. Là que nous sommes concernés. Don Quichotte. Nous ne voulons pas voir les choses comme elles sont. Nous voulons vivre comme nous croyons voir.
L’âme du monde, face au caché, ce sont les histoires.
Qui protègent les têtes du silence au-dessus.
Même Dieu, si on suit les croyants, qui a voulu nous ouvrir ses bras sur un il-était-une-fois, continué par chaque témoin au relais de l’alliance» (p. 526).
À vrai dire, je crois que Julien Capron, qui est à l’évidence un écrivain de grand talent, soupçonne le pouvoir des mots, y voit peut-être même un sacré au rabais, un de ces langages seconds, comme l’écrivait Merleau-Ponty, un arrière-monde justement, pour le dire avec Yves Bonnefoy, qui d’aucune façon ne peuvent nous assurer que nous touchons la certitude mystérieuse et tremblante de la réelle présence. Les mots, puisqu’ils ne nous servent plus qu’à projeter nos rhizomes dans l’horizontalité de la foule planétaire et de la communication instantanée, ont été vidés de leur antique puissance de conjuration et de leur pouvoir de dresser des tours vers le ciel. Une fois les dieux enfuis, ce sont les mots autant que les corps des hommes qui s’affaissent. Et, si la miraculeuse réelle présence est affaire d’art plutôt que d’hostie en notre monde cassé, alors c’est l’art tout entier qui s’est transformé en leurre, en chimère qui répond à sa façon à la fuite de son créateur en le poursuivant, en hurlant ou en aboyant derrière lui. Pierre Michon écrit ainsi : «Il [Michelet, toujours] y a vu une cène laïque, peut-être la première cène laïque précise-t-il, celle où bravement on sacrifie encore le pain et le vin en l’absence du Christ, malgré cette absence, par-dessus cette absence, car on est devenu plus fort que cette absence; il a vu et bien vu que c’était une véritable cène, c’est-à-dire en onze hommes séparés une âme collective, et non pas une simple collection d’hommes. Et en cela il n’est pas sans raison; tout au plus peut-on lui objecter que, si Dieu est un chien, l’absence de Dieu est une chienne» (p. 130).
Voici les toutes premières lignes du roman de Capron : «Catastrophe fluide, railleuse de nos tailles, avec laquelle la langue le prend d’un autre ton.
Plus de noms plantés comme des drapeaux sur le saillant des choses.
Plus de ces boutons impuissants à en fermer pour jarre la force indomptable.
Non.
Mots tout gonflés de houle,
Verbe zébré d’amures,
La voix humaine, la voix, comme un pavois drapé de tumulte et rumeurs» (p. 15).
Le vocabulaire choisi par Capron est intéressant, comme l’ouverture de notre roman qui nous fait découvrir Volmeneur, le premier port de la République, par le grand large qui le cerne de toutes parts. Une autre trouée nous rappellera que la chair se découvre, dans sa nudité essentielle, moins lorsqu’elle s’enfle, peut-être fallacieusement, des souffles des grands textes que lorsqu’elle est guidée par des êtres élémentaires (7) ou ravinée par la puissance des éléments en furie : «Ce jour-là, Coco vit. Que les choses qui se taisent sous le labeur, la main, ne font qu’attendre l’heure de se venger. Qu’un jour les dieux se disent. Que le temple où ils apparaissent, ce sont les yeux qui figent à jamais la larme où le pays en reflet s’évapore; et les siens, et la peau, ô cette peau où on vécut l’abîme, et le plaisir qui tord, l’amour aux plis de mal» (p. 121).
Le texte de Julien Capron peut, fort superficiellement je le répète, faire songer à un polar dont l’écriture gagnerait parfois à s’inspirer des ellipses des romans de David Peace (et à quelques métaphores ridicules que l’on dirait écrites par un Marc-Édouard Nabe, l’ironie en moins : «Pour l’heure, ils s’aimantaient sans oser lancer entre leurs planètes venues à se graviter la fusée d’un baiser», p. 486). Ce livre confirme également la réelle puissance d’invention que déploie Capron qui n’a pas eu peur de s’immerger dans la création de ce que l’on appelle, avec plus ou moins d’à propos suivant les œuvres convoquées (il y a tout de même fort peu d’élus, Balzac, Dickens, Hardy), un roman-monde, création que je rattacherais pour ma part à la description du mythique comté du Yoknapatawpha de William Faulkner. Ces indications seront reprises telles quelles par les journalistes qui, déjà, ont dû s’inspirer, pour rédiger leurs critiques, de la très piètre présentation donnée par le service de presse de Match aller qui évoque une «épopée sportive». Heureusement, il y a infiniment plus, une quête qui nous est rappelée par cette phrase entre tant d’autres : «Le sens de tout ce qu’on a fait, c’est de rappeler qu’il existe une puissance, qui était le compagnon de chaque homme avant que tout se défigure. Avant que les filles comme Juliette puissent disparaître et que personne n’en ait rien à foutre» (p. 477).
L’incarnation, finalement, est le mystère suprême (8), celui-là même pour lequel Dieu n’a pas craint de livrer son Fils et, sans doute, comme nous le suggèrent Michon et Capron dans deux œuvres magnifiques qui se rejoignent dans leurs profondeurs, d’accorder aux hommes le don de la parole et de l’écriture qui toutes deux tentent de conférer aux choses et aux êtres leur poids de chair et leur voix qui est prière et non plus silence (9).
Notes
(1) Où plutôt, deuxième, puisque l’auteur nous annonce une suite logiquement intitulée Match retour. Précisions que les événements décrits dans ce roman on eu lieu neuf années avant la mort du Sénateur Grabure, donc environ un quart de siècle avant le dénouement d’Amende honorable.
(2) Évoquée dans un magnifique passage : «Le grand Pan est mort. Alors, plus que des choses.
La nouvelle claqua aux rives de Paxi. Ça voulait dire : il n’y aura plus ces forces à portée de main, plus ces dieux qui ressemblaient au monde. Les démons ont reculé derrière les étoiles. Il n’y aura plus de délices au sommet des collines, et plus de maléfice dans l’ombre des contrées; plus de danse appelant le divin dans les chairs, plus d’ivresse où titube l’humain, amputé d’éternel.
On rangea tous les masques où habitait la peur. Où habitaient les désirs inquiétés d’infini.
Alors, ce fut le grand silence posé dans le cœur même. Dessus, seule une parole et deux bras en croix, qui donnent pour espérance une vie aux frontières.
Il y avait eu tant de temples, tant de pur et d’impur, d’interdit et de prescrit, et des signes de cendres sur le front de chaque être.
Puis il n’y avait plus rien que le regard de l’autre qui étoile la nuit, la permission terrible d’être sans panneaux ni flèche.
«Thamos, es-tu là ?»
À la barre du navire, Thamos ne savait pas qui parlait. Il crut que l’univers lui révélait sa voix.
«Quand tu atteindras la crique de cette île, crie aux rives que le dieu du Tout, que Pan est mort.»
Ce qu’il y a dans la terre noire, la zébrure électrique qui fait naître a déserté d’ici.
Une liberté naquit de l’exil des dieux déportés dans les livres.
Reste ce combat pour se modeler une âme, mission pour chacun de défendre et de dire ce que c’est que d’être un homme», Match aller (Flammarion, 2009), pp. 404-5. Toutes les pages entre parenthèses renvoient à notre édition.
(3) «Où était la consolation ? Chez Héraclite qui ne se lassait pas de décréter le brouillage entre nos vues et la vérité inscrite au cœur secret de la nature ? ou dans cette voix qui donne audience à la moindre bonté, au moindre mal, au tribunal final ?», p. 239.
(4) Pierre Michon, Les Onze (Verdier, 2009), pp. 55-6.
(5) «On a fouillé dans la mort.
On a demandé aux dieux de revenir, de se montrer, de sortir de la Terre Noire.
On a repris les sacrifices.
On a tué comme ils ont tué.
Il faut donner aux dieux ce qu’ils veulent.
Si ça ne saigne pas, où reviendraient-ils ?
On l’a fait.
Et peut-être que, maintenant, on va avoir la récompense.
On va voir l’autre côté.
Mais elle est lente, la barque sur les eaux de ténèbres.
Il faut que toute la peau, les os, les jointures, les articulations se déchirent pour que le rideau se lève», p. 482.
(6) «Gonflements d’instants qui ne brillaient pas quand on y était de cet éclair de monde entier, minutes qui n’avaient pas su dire sur le moment qu’elles seraient le visage d’un temps», p. 419.
(7) «Ces formes d’être, reliées aux muettes sources de vivre, cet éclair étranger capté par l’œil d’un chat, cette unité sous le tout révélée quand se déchirent les abris sur parole. L’unique famille d’exister, ce trait du vivant à travers toute créature, malgré le brouillamini des signes. Communauté de battre, naïveté d’être, pauvreté de finir. Et les chiens les escortaient dans la presque tempête sous les hauteurs à face de poignard. […] Et ils avançaient dans la raillerie des échos, guidés vers les enfers par la meute à l’écoute des plis du sol. Troupe de sorciers qui s’étaient sortis indemnes des temps où on supprimait tout ce qui interrogeait ces langages qui débordent de l’enclos, du cultivé, de la prière ; ces langages qui ne nous protègent pas du mal» (p. 467).
(8) Julien Capron écrit ainsi : «Et qu’y pouvait Fénimore s’il comprenait mieux que jamais à cet instant pourquoi toutes les religions avaient eu maille à partir avec le vertige d’incarner, s’il avait vécu dans le regard de son fils toutes ces histoires de dieux qui viennent ici se masquer en nous, démons au combat dans la chair passant comme des vents sur les routes la nuit, faisant claquer leur présence dans nos êtres-drapeaux, qui en tremblent» (p. 396).
(9) «Sur le tableau, des lettres matérialisaient sept femmes disparues. Et d’un coup c’était moins drôle. Parce que les noms sont exactement des morts. Toute chose en un mot touche au silence» (p. 65).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, julien capron, pierre michon, match aller, les onze, éditions flammarion, éditions verdier, valeurs actuelles |  |
|  Imprimer
Imprimer