Le réalisme critique de Schlick, par Francis Moury (19/11/2010)
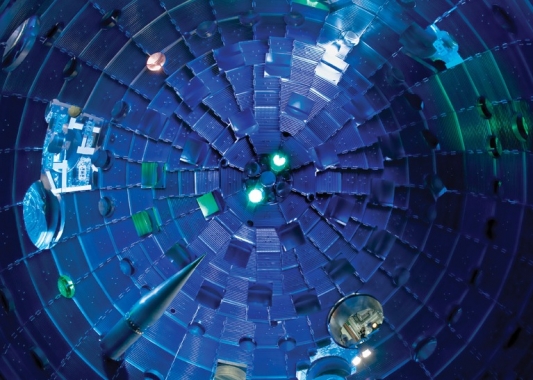
Crédits photographiques : NIF/Lawrence Livermore National Laboratory.
 À propos de Moritz Schlick, Théorie générale de la connaissance (traduction de la 2e édition allemande de 1925, présentation, index rerum, index nominum et notes par Christian Bonnet, un volume de 551 pages, Éditions Gallimard-NRF, coll. Bibliothèque de philosophie, 2009).
À propos de Moritz Schlick, Théorie générale de la connaissance (traduction de la 2e édition allemande de 1925, présentation, index rerum, index nominum et notes par Christian Bonnet, un volume de 551 pages, Éditions Gallimard-NRF, coll. Bibliothèque de philosophie, 2009). LRSP (livre reçu en service de presse).
«Il y a, il est vrai, une difficulté dans cet opérationalisme, difficulté qui est celle même du «positivisme logique» : pour que les concepts aient un sens dans l’application, il faut les confronter à l’expérience immédiate; à cette condition, comme dit Schlick, on pourra transformer les propositions logiques (Sätze) en énoncés sur les choses (Aussage); mais cela est impossible, puisque selon la même doctrine, l’expérience immédiate est par nature incommunicable, donc invérifiable et sans signification. Aussi le physicalisme n’a-t-il pu devenir cohérent qu’en affirmant qu’il n’y avait pas d’expérience immédiate; il n’y a rien de tel dans l’opposition reconnue d’abord par le cercle de Vienne entre connaissance (Erkenntnis) et impression (Erlebnis). Mais comment se résout alors le problème posé ?»
Émile Bréhier, Histoire de la philosophie, Tome II, La Philosophie moderne, fascicule 4, § XVI La Philosophie après 1930, section 3, Les Tendances subjectivistes et leurs critiques (5e édition revue et bibliographie mise à jour par L. Jerphagnon et P.-M. Schuhl, P.U.F. 1932-1968), p. 1019.
«La balle est à courte distance du trou. À un pouce près, je mesure de l’œil cette distance. Je prends soigneusement la ligne. Un piètre joueur de billard réussirait le coup avec une queue. La balle part. Elle dépasse le trou de dix pouces, de quinze… Je rougis, ma main tremble, le cri d’un geai qui passe raille ma maladresse. Mon caddy, qui s’apprêtait à remettre le drapeau, réprime mal un ricanement. J’ai une envie folle de lui envoyer une paire de gifles. Je me contiens et reprends ma ligne. La balle saute littéralement au-dessus du trou. Je renonce.»
Jean Ray, Influence, in Les Contes noirs du golf (Éditions Gérard & Cie, Bibliothèque Marabout, série fantastique n°208, Verviers, 1964), pp. 46-47.
Un fascinant «cas limite» ! Telle avait été notre impression lorsque nous avions lu, vers 1978, le bref et énigmatique paragraphe consacré à Schlick par Bréhier. Son nom n’était pourtant pas cité dans le monumental Index général des noms cités dans ses tomes I et II, couvrant les pages 1023 à 1059 de notre édition de 1968. Nous l’avions rajouté en marge, au stylo, à sa place alphabétique correcte, afin d’être certain de le retrouver rapidement en cas de besoin. Bréhier brossait le portrait d’un Schlick hésitant entre la tendance au concret et la tendance subjectiviste. Laquelle des deux l’emportait finalement ? On se le demandait autant que Bréhier. Ce beau volume Gallimard-NRF de la Bibliothèque de philosophie fondée par Jean-Paul Sartre et Maurice Merleau-Ponty, nous fournit, presque trente ans plus tard, l’occasion de revenir sur cette question.
Nous connaissions bien sûr, étant jeune homme, l’existence du «cercle de Vienne» (inutile de mettre une majuscule au «c» de « cercle» bien que ce soit la mode aujourd’hui : Bonnet en met une mais Bréhier n’en mettait pas et nous préférons la simplicité de Bréhier) et sa qualité de «fondateur» de ce mouvement. Nous avions une vague idée de son rôle dans l’histoire de la philosophie de la logique, comme dans celle de la philosophie des sciences et de la connaissance. Nous devons pourtant avouer que le nom même de Schlick ne nous était pas familier. Par la suite, Maurice Clavelin nous l’avait cité dans ses cours de licence et de maîtrise sur la philosophie de la physique et des mathématiques, mais assez brièvement, nous laissant à nouveau un peu sur notre faim. Notre problème personnel était, dans ces années 1980-1985, de bien comprendre en quoi le positivisme logique du cercle de Vienne pouvait se réclamer du positivisme originel, à savoir celui constitué par Auguste Comte (1). Or, aucun livre de Schlick n’avait été traduit en France dans les années 1980-1985 pour nous aider à approfondir ce lien qui nous intéressait. On disposait de quelques éléments traduits et de quelques études françaises sur la logique mathématique et sur le positivisme logique, mais de Schlick, nihil. Les positivistes comtiens francophones négligeaient assez, pour leur part, l’héritage positiviste logique viennois : ils le considéraient bien davantage comme un avatar phonétique du kantisme et de la critique des sciences que comme un héritier stricto sensu du positivisme. On pouvait en revanche parler des «positivistes spiritualistes» (Félix Ravaisson, Jules Lachelier, Émile Boutroux) avec beaucoup plus de justesse historique. De fait, l’idée même de théorie de la connaissance découle plus directement – bien qu’elle en soit littéralement absente – de la position initiale adoptée par Emmanuel Kant que de celle adoptée par Comte : celle d’une critique de la métaphysique. La différence étant, comme on sait, que Kant ne renonce nullement à l’idée d’une métaphysique (au point que Heidegger a pu écrire en 1929 un livre sur Kant et le problème de la métaphysique) alors que Comte la remplace franchement, dans sa dernière période, par une nouvelle religion qui coiffe organiquement l’ensemble des sciences, à savoir sa très intéressante et curieuse «religion de l’Humanité». Seulement Schlick, convaincu autant que Comte (dont il admire la critique de l’idée de psychologie comme science) de l’inanité de la métaphysique, a une tendance métaphysique : il a lu les Grecs, Descartes, Schopenhauer et Nietzsche. Il est physicien mais s’est d’abord intéressé à l’esthétique et à la morale. Comme Descartes et Spinoza, il a étudié l’optique. Il soutient sa thèse de physique, en 1904 sous la direction de Max Planck, sur La Réfraction de la lumière dans un milieu non homogène. Mais il avoue dans ses Fragments autobiographiques (cités par Bonnet dans l’introduction) qu’il n’est venu à la physique que pour la philosophie. Après s’être tourné vers Épicure, il publie dès 1910 un premier article épistémologique et logique important sur La nature de la vérité selon la logique moderne. Il ne faut donc pas commettre, à propos de Schlick, l’erreur qu’avait commise A. Diès en 1948 à propos de Platon : croire qu’ils ne sont venus à la philosophie que pour en sortir, l’utilisant comme un simple moyen en vue d’une fin qui serait dans le cas de Platon la politique, dans le cas de Schlick la science. Schlick vise au contraire et très classiquement la fondation de toute science possible par l’établissement de prolégomènes métaphysiques qui lui sont, architectoniquement parlant, d’essence supérieure, de même que Platon vise la fondation de toute cité juste à partir de son imitation d’un parfait modèle métaphysiquement fondé.
La première édition de la Théorie générale de la connaissance date de 1918 (rédigée à Rostock sur les bords de la mer Baltique entre 1913 et 1916, parue à Berlin en 1918) et sa seconde édition date de 1925. Il aura donc fallu attendre presque 85 ans – presque un siècle, en somme ! – pour en avoir une traduction française fiable, bien présentée, et dotée d’un appareil critique éclairant. Ce n’est pourtant pas, selon Schlick lui-même, ces deux éditions qui devaient témoigner pour la postérité de sa pensée au stade de sa maturité : il voulait en donner une troisième édition car il en était arrivé à considérer cette théorie comme «primitive et immature» (lettre de Schlick à Albert Einstein du 14 juillet 1927, citée par Bonnet dans son introduction, p. 23) mais son assassinat le 22 juin 1936 sur les marches de l’Université de Vienne par un de ses étudiants ne lui en laissa pas le loisir.
La Théorie générale de la connaissance est divisée en trois parties : La Nature de la connaissance, Problèmes de la pensée, Problèmes de la réalité. Qu’on n’espère pas les comprendre sans avoir auparavant lu Platon, Aristote, certains penseurs médiévaux, certains penseurs modernes et certains penseurs contemporains de Schlick qui critique, par exemple, très vigoureusement Henri Bergson. Il faut en outre savoir que Schlick occupait à Vienne la chaire auparavant tenue par Ernst Mach. Pourtant le novice peut parfaitement s’y risquer tant la pensée est claire et limpide, et tant la traduction maintient dans notre langue cette clarté et cette limpidité. Schlick est en effet l’exemple d’un penseur synthétisant les problématiques de ses prédécesseurs sans les dissoudre ni les annihiler, sans les travestir ni les modifier pour les besoins de sa cause. Plus précisément, Schlick est à la recherche du moyen-terme, un moyen-terme qui soit le plus sûr et le plus commode à la fois, permettant de valider à la fois l’expérience et la connaissance, la nature et l’esprit. Il refuse de tenir pour l’une ou l’autre exclusivement : il veut tenir les deux ensemble dans un même mouvement. Il aboutit, dans la Théorie générale de la connaissance, à un réalisme critique proche du monisme, éclairé par une «méthode des coïncidences» permettant de faire coïncider deux singularités, séparées d’habitude. Schlick veut réconcilier le monde physique et le monde psychique. Les problèmes de l’intuition pure, de la connaissance animale du monde ou de celle de l’homme primitif par rapport à l’homme moderne, de la vérification des inductions, de la causalité en physique, l’amènent à débattre tout naturellement de la question de l’inconscient psychologique, de l’univocité du signe, de la coordination équivoque ou univoque des signes et des concepts, de l’axiomatique de Hilbert. La validité ontologique du monde – qu’il souhaite fonder – repose d’abord sur de tels travaux techniques et logiques.
Schlick admira Wittgenstein. Un peu trop, selon ses propres amis qui lui reprochaient de s’effacer en sa faveur alors que, assez souvent, certaines des idées de Wittgenstein avaient d’abord été énoncées par Schlick lui-même ! Schlick fut, par ailleurs, accusé de psychologisme par les logiciens, de conceptualisme par les intuitionnistes, de relativisme et de scepticisme par les réalistes, de nihilisme… par les nazis autrichiens. La manière dont on résume son système sous les termes de «réalisme critique» est à la fois juste et savoureuse car éminemment dialectique. On sait que le criticisme kantien s’oppose au réalisme aristotélicien qu’il ne faut surtout pas confondre, pour sa part, avec le réalisme abstrait du platonisme, celui des essences. Mais dans le cas de Schlick, il y a une certaine ambivalence relativement au sens du mot «réalisme» et une certaine ambivalence relativement au sens de l’adjectif «critique». La définition est donc très bien choisie, à condition de développer toute sa richesse possible. Ce n’est pas ici le lieu d’en débattre en détails, mais donnons tout de même quelques indications succinctes. Pour Aristote comme pour Schlick, le concret est bien la chose même d’abord : ce rouge que je perçois, et pas d’abord l’idée du rouge. Mais l’idée de rouge n’est pas rien non plus. Tout le problème repose sur la signification des termes constituant un tel jugement de fait («je perçois une couleur rouge») tel que la logique d’Aristote nous l’a théoriquement transmis. L’idée ou la pensée sont, pour Schlick, des réalités tangibles dont la valeur de réalité ne remet pas en cause la pesanteur et le sens du monde des objets, et l’inverse est tout aussi vrai. Schlick qui veut tenir la balance égale entre réalisme et idéalisme, considère donc l’intuition comme une réalité, différente de la connaissance et qui ne peut s’y substituer mais possédant sa valeur cognitive propre, même s’il s’agit d’une forme inférieure de connaissance. Lisant de telles indications, le lecteur non prévenu pourrait penser que la ratiocination est décidément une constante de l’histoire de la philosophie, dans la mesure où, de Platon à Husserl et à son contemporain Schlick, on peut dire qu’on n’a jamais terminé la discussion du Théétète sur la perception ! Mais il faut bien comprendre – on ne le peut que par l’étude de son histoire – que ce n’est pas la même discussion qui se répète, en dépit de l’usage de certains termes identiques : c’est la même et c’est une autre à la fois.
Il y a, en outre, quelque chose d’inédit, de discrètement pathétique, voire d’inévitablement tragique qui affleure du fond de cette suite de raisonnements sereinement techniques et rationnellement distribués dans ce traité d’une admirable rigueur. Tandis que Schlick critique (à tort selon nous mais d’une manière passionnante) le rôle de la mémoire dans le système cognitif élaboré par Descartes, et qu’il critique le sens même de la critique humienne de la causalité, son univers est progressivement, objectivement, investi par la mort et la violence. Ce pur produit raffiné et cultivé de l’empire austro-hongrois – entre deux articles de philosophie de la connaissance, il publie en 1930 des Questions d’éthique – au sens où Laurent Schang l’entendait (2) est universitaire pendant la Première guerre mondiale, et finit assassiné à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Certes ce fut le destin de tous les penseurs européens de l’entre-deux guerres mondiales. Mais Schlick fut assassiné par un de ses propres étudiants («antisémite déclaré» Bonnet dixit) qui le rendait « responsable de ses déboires». On aimerait en savoir plus car la formulation de la note, assez laconique, ouvre sur l’infini du possible. On savait déjà, depuis qu’on avait visionné et critiqué le téléfilm Wittgenstein (Grande-Bretagne et Japon, 1993) écrit et réalisé par Derek Jarman, que la vie privée des positivistes logiques pouvait réserver des surprises. On devient franchement curieux dans le cas de Schlick. Ironie plus noire encore, la propre philosophie de Schlick est tenue, nous y avons déjà fait allusion supra, par les journaux nazis autrichiens pour la première responsable de son assassinat, en raison du «nihilisme» qu’elle aurait véhiculé. Schlick plus nietzschéen que Nietzsche selon ses thuriféraires au premier degré ? Le «réalisme critique» de Schlick se tient, on le voit, doublement sur le fil du rasoir : en histoire de la philosophie, il est l’héritier direct du rasoir d’Ockham (3), et en histoire générale, il fut contemporain de la montée du nazisme.
Souhaitons pouvoir un jour disposer des œuvres complètes chronologiques de Schlick traduites en français, et pouvoir découvrir ainsi ses œuvres esthétiques et morales qui ne doivent pas être d’un moindre intérêt, en tout cas qui n’étaient pas d’un moindre intérêt à ses propres yeux. Car décidément, on ne peut pas se contenter de définir Schlick par sa seule qualité de fondateur du «cercle de Vienne» : ce livre et l’introduction de Bonnet nous en donnent confirmation. Et ils nous confirment aussi que Bréhier avait eu raison d’hésiter lorsqu’il s’agissait de définir Schlick du point de vue de l’histoire de la philosophie. Le positivisme logique de Schlick n’est en effet, à présent qu’il nous est mieux connu qu’à l’époque de Bréhier, ni univoque, ni unilatéralement définissable. Sa richesse, qui reste encore à découvrir dans sa totalité, l’en préserve.
Notes
(1) Carnap estimait, selon Karl Popper, que la plupart des philosophes des sciences partagent l’idée comtienne selon laquelle la physique est le paradigme des sciences. Mais cette conception n’est valable que dans le cas où la question de la chose n’a plus de raison d’être, dans le cas où le réalisme et le positivisme se confondraient, et où leur opposition métaphysique disparaîtrait. L’universel n’est de nature logique ni chez Aristote ni chez Comte, pas davantage de nature cosmologique : les niveaux de réalité sont soigneusement distingués chez l’un comme chez l’autre. Les liens possibles entre les individus raisonnables sont de nature morale et politique, poétique aussi. Il semble donc que, compte tenu de ces différences, Schlick ait été nettement plus comtien que Carnap.
(2) Laurent Schang, Otto de Habsbourg, celui qui a dit «nein», in Cancer ! - Gueules d’amour (Éditions Mille et une Nuits, 2003), pp. 97-133.
(3) Pierre Alféri, Guillaume d’Ockham le singulier (Éditions de Minuit, coll. Philosophie, 1989), a étudié les relations étroites entre la pensée d’Ockham et les thèses de Schlick et de Wittgenstein. Voir sa page 260, par exemple, en dépit du fait qu’il demeure une distance certaine entre l’empirisme et le nominalisme d’Ockham d’une part, le positivisme logique du cercle de Vienne d’autre part. Sans oublier les différences non moins certaines existant entre les membres du cercle.
Lien permanent | Tags : philosophie, moritz schlick, théorie générale de la connaissance, édiions gallimard |  |
|  Imprimer
Imprimer