La Grande forêt de Robert Penn Warren (16/02/2011)

Crédits photographiques : Goran Tomasevic (Reuters).
 Robert Penn Warren dans la Zone.
Robert Penn Warren dans la Zone. Acheter La Grande Forêt sur Amazon.
Acheter La Grande Forêt sur Amazon.Quelle est la puissance qui gouverne les pages de La Grande forêt (1), un roman de Robert Penn Warren publié en 1961 ? Cette puissance n'est pas Dieu puisque, comme l'explique au héros de notre roman, Adam Rosenzweig, l'un des anciens amis de son père décédé, le riche Aaron Blaustein, Dieu s'est retiré du monde (2).
Sans Dieu pour gouverner nos existences, point de salut bien sûr, non seulement spirituel mais aussi temporel, puisque Sa volonté est incarnée par une puissance elle-même souveraine, tout du moins qui le deviendra une fois le Dieu oublié, mort ou éclipsé.
La puissance vicaire ne peut donc être, toujours selon ce même puissant personnage se faisant l'interprète du romancier, que l'Histoire.
Histoire incompréhensible, absurde même (cf. p. 93), dont les phrases sont illisibles (cf. p. 174), dont les voies torves jamais mieux ne seront illustrées que par cette phrase, terrible, que le vieux Aaron Blaustein prononce devant celui, Adam, qui lui fait se souvenir de son fils, mort sur le champ de bataille de la guerre de Sécession qui fait rage, et auquel il proposera de devenir son nouveau fils en le prenant sous son aile : «Savez-vous ce que c'est que l'Histoire ? [...] C'est l'ensemble des épreuves que les gens sont obligés de traverser afin que les choses tournent comme elles auraient tourné de toute manière» (p. 61).
Et c'est bien dans cet élément, parfaitement absurde que le jeune Adam, flanqué d'une difformité qui le fait souffrir, lui fait honte et l'empêchera finalement de s'engager afin de combattre pour la libération des Noirs, va plonger (sans pourtant jamais connaître, à proprement parler, l'expérience d'une véritable bataille) pour en ressortir transformé.
C'est que, malgré son prénom à la symbolique pour le moins transparente, malgré le fait que, bien des fois au cours de notre roman, de subites intuitions d'une pureté possible le laissent suffoquant et malade de nostalgie (cf. pp. 68 ou 92) sur la grève du monde où l'a déposé, malicieusement, la vague hasardeuse de l'Histoire, Adam n'est pas du tout un innocent, une qualité qui sera pourtant celle, croit-il, de simples soldats voire de canailles contemplant le spectacle vulgaire et hideux d'une prostituée en train de se faire fouetter (3), ceci afin de faire respecter la discipline dans un camp d'armée où Adam est devenu, avec deux autres personnages que nous retrouverons plus loin, vivandier.
De fait, Adam semble moins avoir été expulsé de quelque paradis anté-historique dont il aurait gardé le souvenir douloureux qu'il ne me paraît être le fruit absolument banal d'un démiurge qui est le nôtre depuis qu'il est le seul à mener les affaires du monde. Et, comme tous les faibles, Adam préférera donc se tenir à une saine distance de la puissante vague du kaïros grec plutôt que de se laisser submerger par elle : les notations sont nombreuses où Penn Warren nous décrit son personnage comme n'ayant qu'une seule et unique aspiration : essayer de «ne plus rien savoir du monde...» (p. 155) alors même que cette volonté est une chimère, puisque le monde vous enserre de ses mille tentacules.
Pourtant, la tare secrète d'Adam, le dard planté dans sa chair si l'on veut, semble bel et bien avoir une origine qui déborde de toutes parts le seul cadre historique puisque la pensée la plus secrète de notre personnage n'est autre que la honte, qu'il serait ridicule d'imputer à son pied-bot, tant elle semble littéralement envahir, comme un océan putride rempli de choses informes, chaque recoin de son être, mais aussi s'étendre au reste du monde et des hommes.
Quelle est l'origine de la honte ? Ce mystérieux sentiment de sa propre indignité, cette volonté de détruire et dégrader ce que l'on a soi-même construit, image d'une vie simple qu'il s'agit pourtant, à tout prix, de briser, de souiller ? Ainsi, «Certains hommes éprouvaient le besoin de souiller, de dégrader ce qui avait été leur abri et leur fierté. Ici et là, en dépit des règlements d'hygiène, on pouvait voir un soldat se soulager dans ce qui avait été son logis, et parfois, après, il s'arrêtait songeur, sombre, tristement étonné, comme s'il ne comprenait pas les motifs de son acte» (p. 156).
L'Histoire seule en partage. Mais, face à l'absurdité de cette dernière qui semble décidément indifférente à nos destinées, la honte, universelle, en unique juge de nos paroles et de nos actions, surtout lorsque comme pour Aaron la vérité de l'expérience de guerre la plus intime, la possibilité de tuer un autre homme et de mesurer son propre courage physique, est refusée au héros (cf. p. 173), du moins jusqu'aux toutes dernières pages de notre roman.
En fait, pratiquement, à l'échelle individuelle des différents personnages du roman de Penn Warren, la honte est le visage même de l'Histoire, si Dieu, le mobile suprême (cf. p. 59) de tous nos actes, n'est plus là pour qu'on puisse, au moins, lui adresser ses suppliques et prières (4) afin qu'Il nous pardonne. Comme dans Absalon, Absalon !, comme dans tant d'autres grands romans (ceux de Dostoïevski, ceux de Kafka, ceux de Gadenne), la honte est le moteur véritable de l'action : j'évoquai le labyrinthique et magistral Absalon, Absalon ! de Faulkner, et il n'est sans doute pas inutile de rappeler que Thomas Sutpen se souviendra toute sa vie de la façon cruelle dont il fut accueilli par un riche planteur, alors qu'il n'était qu'un enfant. Devenu adulte, il n'aura de cesse de tenter de laver l'affront en édifiant Sutpen's Hundred, sa magnifique maison, et en essayant dans le même geste d'inouïe volonté de devenir le maître d'une puissance d'ordre (du moins a-t-il rêvé d'instaurer cet ordre par sa seule prodigieuse volonté diabolique) dont il ne restera plus rien qu'un rire de dément trouant les ténèbres de sa demeure abandonnée depuis des années, rire se répercutant sans fin dans l'incompréhension et la honte éprouvées par les narrateurs.
De la même façon, Adam Rosenzweig, sans toutefois parvenir à déployer la force démiurgique de Sutpen, parce que, à la différence de l'impavide personnage de Faulkner, il est un doux (ou du moins il croit l'être) et finalement un craintif, à moins qu'il ne soit qu'un lâche (cf. p. 151) ou un homme complètement insignifiant (cf. p. 143), voudra, en essayant de s'engager dans l'armée combattant les rebelles confédérés, laver l'affront de cette minute où il vit et entendit son père, Leopold, en train de mourir, affirmer à son propre frère (et donc oncle d'Adam) que sa jeunesse aventureuse, où il fit le coup de feu sur les barricades, n'avait été qu'une erreur et une offense aux yeux du Seigneur, puisqu'il avait préféré de façon impie, à Dieu, les hommes.
Il y a une autre raison, la judéité même du personnage, vécue au travers du regard, souvent moqueur et méprisant, des autres, au fait qu'Adam ne cesse d'éprouver ce sentiment, crucifiant, d'être frappé d'indignité : nul lecteur sérieux n'aura manqué de soupçonner les nobles raisons pour lesquelles le pauvre Juif infirme qu'est Adam Rosenzweig veut à tout prix aider les Noirs, afin de les libérer, croit-il naïvement, de leur propre indignité. N'a-t-il pas eu honte du sentiment (pitié puis dégoût lorsqu'il a compris de quoi et de qui il en retournait) qu'il a éprouvé en pénétrant dans New York et en contemplant longuement le cadavre d'un Noir, atrocement mutilé et pendu à un lampadaire ? N'aide-t-il pas pourtant le déserteur Mose Talbutt/Crawfurd à apprendre à lire ? N'est-ce pas juste avant de jeter l'horrible insulte à ce même Mose qu'il connaît une bernanosienne minute de joie satanique (cf. p. 164), «comme si lui-même, nous dit Penn Warren, s'était trouvé sur le point de remplir toute la nuit et d'être pour la première fois totalement lui-même» (p. 164) ? Au contraire, n'éprouve-t-il pas de l'envie, mais une envie saine, à l'endroit du Noir, à ses yeux le seul de qui l'Histoire elle-même avait besoin de se faire pardonner (cf. p. 166), l'esclave, de par sa condition, pouvant être à bon droit déclaré hors de celle-ci, donc libre, innocent ? Pourtant, plus d'une fois, il se surprend à le regarder avec haine, comme durant ce bref instant où il aperçoit le sourire du Noir qui contemple le spectacle répugnant durant lequel une putain se fait fouetter. Il l'a même battu (cf. p. 139), ce Noir qui finira par se sauver après avoir tué son patron, le vieux Jed, et en laissant la vie sauve à Adam, qui l'a pourtant insulté et même frappé. D'identique façon, un désir éperdu de pureté précédant ou suivant la volonté de nuire, c'est ce même Adam qui, par son attitude, peut-être parfaitement innocente à ses propres yeux, révélera à cette putain venue lui offrir ses services la certitude, intolérable aux yeux de la femme, de sa propre indignité (cf. p. 145).
Exaltation et abjection, sentiment exclusif de sa propre misère (comme le rappelle la pensée de Pascal placée en ouverture du roman) et volonté, coûte que coûte, d'aider l'autre dont les motifs de vous aider ne sont franchement pas très reluisants, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsqu'ils sont exposés au grand jour : Mose avoue ainsi à Adam qu'il l'a sauvé de la noyade uniquement parce que, si Adam s'était mis à crier qu'on le secourût, il aurait attiré l'attention des autres malheureux avec lesquels il était enfermé dans une cave se remplissant peu à peu d'eau et que, dans ce cas, la tâche de l'esclave s'en fût trouvée singulièrement compliquée...
Rien ne résiste, aucune intention si bellement colportée par la légende, aucun haut fait ne peuvent tenir face à la volonté monstrueuse de Penn Warren de sonder les reins et les cœurs. Ce sont en fin de compte les mots du bourru Jed Hawksworth, l'homme qui révélera à Adam les raisons profondes et véritables de son geste en apparence courageux ayant consisté à tenter d'innocenter devant un tribunal un Noir, ce sont ces mots qui peuvent nous donner une des raisons expliquant la honte qui est celle d'Adam. La scène qu'évoque le vieux Jed peut se résumer facilement : son père a tiré gloriole du fait que sa femme, la mère de Jed, était la cousine du colonel Johnston F. Harris, l'homme ayant accusé un Noir. Devant la maison de justice débordant de personnes venues assister à l'audience, le père de Jed a tenté d'enflammer les esprits en affirmant que la Justice devait se placer du côté de l'honnête homme, le cousin de sa femme, le Blanc bien sûr, ce même colonel accusateur de son esclave. Certains de ces spectateurs ont applaudi le discours du père de Jed, d'autres non, constat qui lui tire ce commentaire ironique et désabusé : «Eh bien, je vais te le dire [...]. S'ils n'ont pas applaudi, c'est parce qu'ils avaient honte de voir mon père lécher les bottes du colonel Johnston F. en public. Ils avaient tellement honte qu'ils pouvaient plus applaudir» (p. 120). Jed poursuit, affirmant (p. 121) : «On avance dans la vie et tout se passe comme si on savait pas à qui on en est redevable. Et de quoi, exactement, on lui est redevable. Peut-être que je devrais remercier les gars qui ont pas applaudi le colonel. C'est eux qui, en n'applaudissant pas, m'ont rendu honteux d'être le fils de mon père. C'est eux qui, en n'applaudissant pas, m'ont poussé à entrer dans la salle du tribunal.»
Qui pourrait juger de l'intention véritable ayant poussé un homme à agir ? Qui, pour s'arroger le pouvoir de sonder les reins et les cœurs ?
Finalement, l'on ne déteste l'autre que parce que, au fond de ses actes les plus apparemment motivés voire mécaniques, gît une honte qui ne peut pas manquer de nous renvoyer celle qui est la nôtre, comme dans un miroir déformant, et ce mécanisme de la honte concerne, bien sûr, un autre sentiment ignoble, la lâcheté, mais que le roman de Penn Warren auréole d'une lumière que l'on croirait presque douce : «Il se demanda s'il était trop lâche pour affronter la souffrance. Lâche de cette lâcheté subtile et raffinée qui le poussait à reculer devant la souffrance d'autrui parce que cette souffrance se répercutait en lui avec trop de force» (p. 152).
La leçon, aussi cruelle soit-elle, possède toutefois un caractère autrement impérieux, que Jed Hawksworth n'a pas manqué de souligner à Adam : On avance dans la vie et tout se passe comme si on savait pas à qui on en est redevable. Et de quoi, exactement, on lui est redevable. Ainsi, Adam devra bien admettre que c'est Mose, le Noir lubrique, le déserteur et le meurtrier de son propre patron, Jed Hawksworth, qui lui a pourtant sauvé la vie alors qu'il allait mourir noyé dans une cave de New York que les Blancs habitant la ville ont remplie d'eau afin de faire périr les Noirs qu'ils ont pourchassé durant des jours d'émeutes sanglantes.
Finalement, c'est dans cette folle et incompréhensible circulation entre les hommes et leurs actes (très bien symbolisée par l'image de ces bottes que les vivants volent aux morts avant que les premiers ne soient eux-mêmes tués par des vivants qui s'empareront de leur bien volé) que réside peut-être le secret que Robert Penn Warren a voulu poursuivre et tenter de fixer l'espace d'une seconde ou d'une ligne dans son roman. Car, si tous les hommes que le naïf Adam rencontre sur sa route sont à des degrés divers hantés par quelque cauchemar et l'enferment lui-même dans leur ronde maléfique (5), cette vision de l'enfer d'une forêt en flammes (cf. p. 225), la certitude absolue, plénière, de l'indignité de leurs actes et même de leur vie tout entière, la honte intarissable enfin et la conquête de la dignité qui leur fait désirer la mort d'autrui et même leur fait commettre l'irréparable, cette communauté des maudits est aussi, par un retournement derrière lequel il faut peut-être voir une main supérieure à celle de l'Histoire derrière laquelle Il se cache, la communauté de celles et ceux qui osent encore attendre et espérer leur délivrance, preuve qu'ils ne sont pas assez profondément enfoncés dans le Mal pour ne point oser fixer la lumière et, même, saluer la beauté du monde (6).
C'est d'ailleurs quelques instants avant de découvrir sa propre vérité sans cesse suggérée mais jamais donnée (7), unique possession «afin d'être prêt à mourir» (p. 194) dans le feu du combat qu'Adam a la certitude que tous les actes commis par les hommes, et les siens d'abord, même ceux qu'il a cru n'être que bienveillants (cf. p. 187), sont non seulement profondément liés les uns aux autres mais sans doute parfaitement interchangeables : «Une étrange exaltation le visita. Il se sentit trembler au bord d'une révélation. Une révélation, songea-t-il soudain, qui n'avait rien à voir avec Mollie-Bon-Temps [la prostituée dont il a été question], sauf dans la mesure où Mollie faisait partie du monde. Car cette révélation mettait en jeu le monde. Le monde pris dans son ensemble. Non pour inciter à le fuir mais pour aider à en découvrir la nature. Adam se sentit sur le point de formuler, avec des mots, la vérité entrevue» (p. 186).
Cette révélation glaçante coïncide, généralement, avec la mort du héros. Penn Warren se contente de faire d'Adam un nouvel homme, un homme libéré de ses chaînes parce qu'il a accepté, tout à la fois, son indignité et la puissance gagnée de ses propres mains, ayant en somme reconquis la pureté perdue, arrachée à sa propre chair par tous ceux qui lui ont menti et même qui l'ont trahi (8).
Ayant compris que «la vérité ne se dérobe jamais», qu'elle rejoint finalement la leçon désabusée que le vieil Aaron Blaustein lui avait livrée (cf. p. 61), que «seuls les traîtres à la vérité se retrouvent trahis et uniquement par leur trahison» (p. 226), Adam est désormais libre de sortir de la grande forêt en flammes dans laquelle il s'est enfoncé pour y chercher l'image de lui-même qu'allait lui renvoyer le destin, puisqu'il garde désormais à l'esprit la certitude de la présence de toutes celles et de tous que la plus implacable nécessité ou Dieu ont placés sur sa route, et la mémoire «de ce qu'ils avaient souffert parce qu'ils étaient des hommes et qu'ils étaient faillibles» (Ibid.).
C'est peut-être parce qu'Adam a compris que tous les hommes, bons ou mauvais, bons et mauvais, sont pétris de la même faiblesse devant l'extraordinaire minute qui révèle leur insupportable misère et leur grandeur qu'il remettra près du cadavre les bottes que le soldat lui avait pourtant dérobées avant que, de colère, de honte et de joie enfin acceptée de se savoir guéri de sa souffrance, il ne le tue.
Adam est un homme libre parce qu'il a finalement accepté de faire sienne l'unique, paradoxale et écrasante liberté qu'un monde régi par l'Histoire est capable d'offrir à ses instruments ou ses fils.
Notes
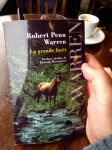 (1) Sous le titre, tout de même plus riche en symboles que celui choisi par les traducteurs Jean-Gérard Chauffeteau et Gilbert Vivier pour Stock dans la collection Bibliothèque cosmopolite, de Wilderness : A Tale of the Civil War. Je signale que le roman vient d'être réédité par Points dans la collection Signatures. Affublé d'une préface à peu près correcte de Laurent Mauvignier, le texte du roman, probablement saisi par un quelconque logiciel et à l'évidence point relu, est truffé de fautes. En voici quelques-unes : lame au lieu de l'âme (p. 14), un point manque à l'avant-dernière ligne de la page 49, Les gens qui ont maltraité les Noirs avaient immobile (p. 70), n'importe la forme que cette pensée eût pu prendre (p. 83), il manque un point à la deuxième ligne de la page 159, un curieux unioniste incendié à la page 160, un comique il aurait décroché du mûries (p. 162), un ciel rougeoyait, déversait au lieu de rougeoyant (p. 179), il y avait moins départies de cartes ou de dés (p. 181), un magnifique J'aurais pu apprendre à monter à chevai (p. 200), trouaient le ténèbres (p. 208), juste à temps pourvoir l'inconnu (p. 216), Puis, sans transition, sapeur disparut (p. 256), ce qui nous laisse supposer la présence de pompiers dans le roman de Penn Warren. Dois-je continuer cette morne litanie, qui est la preuve de la paresse (car cet ouvrage n'a pas été relu ou, s'il l'a été, c'est une véritable honte) et du manque de respect pour le lecteur dont témoignent de plus en plus la plupart des éditeurs français ?
(1) Sous le titre, tout de même plus riche en symboles que celui choisi par les traducteurs Jean-Gérard Chauffeteau et Gilbert Vivier pour Stock dans la collection Bibliothèque cosmopolite, de Wilderness : A Tale of the Civil War. Je signale que le roman vient d'être réédité par Points dans la collection Signatures. Affublé d'une préface à peu près correcte de Laurent Mauvignier, le texte du roman, probablement saisi par un quelconque logiciel et à l'évidence point relu, est truffé de fautes. En voici quelques-unes : lame au lieu de l'âme (p. 14), un point manque à l'avant-dernière ligne de la page 49, Les gens qui ont maltraité les Noirs avaient immobile (p. 70), n'importe la forme que cette pensée eût pu prendre (p. 83), il manque un point à la deuxième ligne de la page 159, un curieux unioniste incendié à la page 160, un comique il aurait décroché du mûries (p. 162), un ciel rougeoyait, déversait au lieu de rougeoyant (p. 179), il y avait moins départies de cartes ou de dés (p. 181), un magnifique J'aurais pu apprendre à monter à chevai (p. 200), trouaient le ténèbres (p. 208), juste à temps pourvoir l'inconnu (p. 216), Puis, sans transition, sapeur disparut (p. 256), ce qui nous laisse supposer la présence de pompiers dans le roman de Penn Warren. Dois-je continuer cette morne litanie, qui est la preuve de la paresse (car cet ouvrage n'a pas été relu ou, s'il l'a été, c'est une véritable honte) et du manque de respect pour le lecteur dont témoignent de plus en plus la plupart des éditeurs français ?(2) «Pardonnez-moi, je n'avais pas l'intention de faire de l'ironie. Mais quand on cesse d'adorer Dieu, il ne reste qu'une seule chose à quoi se raccrocher : l'Histoire. Je suppose que je crois en l'Histoire puisqu'il faut bien croire en quelque chose. Mais sans doute n'ai-je pas suffisamment de sagesse pour que ma croyance en l'Histoire me retienne de faire de l'ironie», p. 56.
(3) «Pendant que le cri montait, il resta immobile, les yeux fermés, et il pensa que seuls ceux qui possèdent une innocence extraordinaire ont le pouvoir de regarder l'univers en face. Il ouvrit les yeux et regarda ses compagnons. Ils contemplaient le spectacle, ils attendaient. Tous, pensa-t-il, ils avaient tous une innocence qu'il ne connaîtrait jamais. Leur innocence était plus forte que tous les crimes qu'ils pourraient commettre» (p. 153). Ainsi Adam voit-il encore, derrière les traits rebutants d'un soldat qu'il déteste, ceux de l'enfant qu'il a été, cf. p. 124. La même image revient plusieurs fois dans notre roman, comme à la page 173 ou 209, où Adam se souvient d'un des très rares souvenirs de paix vécus avec sa mère : «Assis dans l'ombre du chariot, Adam se sentait étrangement désincarné et pur. Comme autrefois, un matin, quand il était petit garçon, après une longue maladie. Ce matin-là, il y avait bien des années, il s'était éveillé avec la sensation d'être purifié, de dériver dans les airs, léger comme une plume, et durant un bref instant, assis dans l'ombre du chariot, tandis que le soleil dardait ses rayons sur la clairière, il fut suffoqué de bonheur à l'évocation de ce souvenir si longtemps oublié. Sa mère... Sa mère s'était approchée du lit, elle lui avait posé une main sur le front, en le regardant de ses beaux yeux sombres, et ces yeux trahissaient une telle tendresse qu'il s'était senti accablé de remords à l'idée d'être indigne d'un aussi grand amour» (p. 209).
(4) Et Adam, plusieurs fois, essaie de prier sans y parvenir, cf. pp. 159 et 162.
(5) «[...] ils me haïssent parce que je suis comme eux. Puis : Moi, je les hais parce que je suis comme eux» (p. 175, l'auteur souligne).
(6) «Il [Adam] pensa que le monde était rempli de splendeur» (p. 181). Notons que ce constat se produit une fois que le personnage a décidé de poursuivre sa route seul, en s'enfonçant dans une forêt où il pourra, enfin, se battre et même tuer un soldat confédéré.
(7) Cette procrastination est même le moteur du roman de Penn Warren qui écrit : «Il pensa : Je ne parviens pas à savoir quelle pensée s'agite en moi. Je la devine, mais je ne sais pas ce que c'est» (p. 207, l'auteur souligne).
(8) «Donc, au fond, conclut-il, Jedeen Hawksworth avait dû mourir à sa place. Alors, il se demanda si finalement chaque homme n'est pas sacrifié à la place d'un autre. Il ne put répondre à sa question. il ne pouvait sonder toute la profondeur de cette pensée. Son regard y plongeait simplement comme dans un puits obscur au fond duquel luirait une petite lumière, à la surface de l'eau» (p. 221).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, arthur penn warren, la grande forêt |  |
|  Imprimer
Imprimer