Le Chemin des morts de François Sureau (02/09/2013)
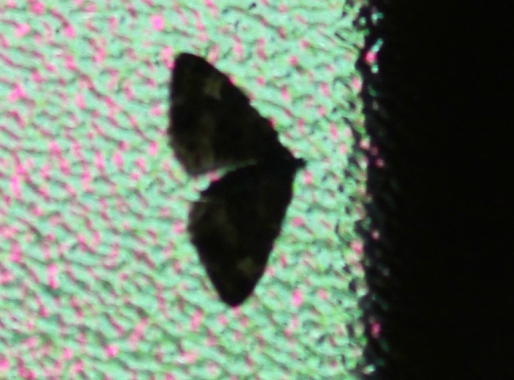
Photographie (détail )de Juan Asensio.
 Inigo ou la liberté absolue, de François Sureau, par Élisabeth Bart.
Inigo ou la liberté absolue, de François Sureau, par Élisabeth Bart. La chanson de Passavant et Sans bruit, sans trace de François Sureau, par Élisabeth Bart.
La chanson de Passavant et Sans bruit, sans trace de François Sureau, par Élisabeth Bart. Le très court récit intitulé Le Chemin des morts est une nouvelle d'une écriture impeccable qui met en scène une guerre secrète, inavouable du reste ou plutôt, la période qui précède immédiatement une guerre, elle aussi secrète : «Les années quatre-vingt sont loin et me font penser à l'avant-guerre, mais à une avant-guerre que nulle guerre n'aurait conclue, et qui aurait simplement changé de cours», écrit ainsi l'auteur, dans les toutes premières lignes de son texte (1), évoquant une espèce de conflit idéologique pas moins violent que bataille d'homme, la situation de la France confrontée aux répercussions politiques du terrorisme basque.
Le très court récit intitulé Le Chemin des morts est une nouvelle d'une écriture impeccable qui met en scène une guerre secrète, inavouable du reste ou plutôt, la période qui précède immédiatement une guerre, elle aussi secrète : «Les années quatre-vingt sont loin et me font penser à l'avant-guerre, mais à une avant-guerre que nulle guerre n'aurait conclue, et qui aurait simplement changé de cours», écrit ainsi l'auteur, dans les toutes premières lignes de son texte (1), évoquant une espèce de conflit idéologique pas moins violent que bataille d'homme, la situation de la France confrontée aux répercussions politiques du terrorisme basque.L'extrême retenue de l'écriture de François Sureau, que l'on dirait non pas revenu de tout mais capable de contempler sans les maudire les années vécues pleines d'erreurs et de succès, n'en condamne pas moins l'immobilisme électrique (2) pourrait-on dire, d'une époque affichant ostensiblement son mépris de l'enracinement (3) et pourtant étouffée sous une chape de plomb tout de même moins pesante que celle qui faillit étouffer l'Italie victime des Brigades rouges et de la guerre occulte que se livrèrent alors différentes puissances par le biais des services secrets occidentaux et de la trame inextricable de commanditaires torves dirigeant les marionnettes meurtrières de l'opération Gladio. D'une certaine façon, c'est parce que la France suivant la Seconde Guerre mondiale était tout entière idéologique, ayant enterré l'action véritable sous des couches de discours et de slogans et parqué les dernières forces vives d'un pays naguère grand derrière les larges murs de l'accusation de passéisme, de réaction ou, pis, de fascisme, qu'elle échappa relativement (si on compare sa situation avec celles de l'Allemagne ou, je l'ai dit, de l'Italie) aux attentats sur son sol. Ces années 80, celles qui les précédèrent furent toutefois irrespirables.
Si l'écriture de François Sureau peut être rapprochée de la transparence admirable, digne d'une parabole, d'un Paul Gadenne dans Baleine, c'est plutôt dans la lecture symbolique de l'Histoire telle que Léon Bloy la déploya dans ses principaux ouvrages que nous devons rechercher une parenté philosophique avec cet écrivain : dans Le Chemin des morts, l'empire des vivants, le règne du visible, semble moins étendu que celui de l'invisible, le royaume des morts, d'ailleurs rappelé par la légende basque ayant donné son titre au livre : «Chaque maison, chaque famille a [son chemin des morts, l'auteur souligne]. Ils ne se confondent pas. Si bien qu'au-dessus des routes et des sentiers du village, ou au-dessous d'eux, ou à côté comme on voudra, il y a d'autres chemins, invisibles, formant une toile dont l'église est le centre» (p. 30), l'architecture invisible qui conforte celle dans laquelle nous inscrivons la banalité de nos gestes quotidiens étant encore rappelée par l'auteur lorsqu'il évoque ses marches dans Paris, celui de «Breton et de Flamel, près de la tour Saint-Jacques» (p. 31).
Pourtant, bien que le narrateur, en sa qualité de juriste affecté à la commission des recours des réfugiés, ne participe pas directement à l'Histoire, parfois sanglante, de ces années plombées, il en voit les ravages sur le visage des femmes et des hommes dont, avec ses collègues, il doit décider la pleine appartenance à la nation française. L'histoire que nous conte dès lors François Sureau, celle d'un certain Javier Ibarrategui qui demande à la France de le protéger parce qu'il craint d'être liquidé par les milices paramilitaires secrètes mises en place pour lutter contre l'ETA à laquelle il a adhéré, oblige plus ou moins directement les gardiens du droit de choisir leur camp ou plutôt, de choisir quel sera le chemin des morts qu'ils emprunteront.
Jamais ils ne sauront s'ils ont emprunté le bon (cf. p. 53), même si le narrateur estime que, lui, s'est trompé, puisque l'homme sur le dossier duquel il a dû statuer a été effectivement assassiné comme tant d'autres par les tueurs de l'État espagnol et que, du reste, la «faute a des pouvoirs que l'amour n'a pas» (p. 54), bien que le narrateur espère qu'à l'heure où il mourra, ce sera cet homme et pas un autre, celui qu'il n'a pu ou voulu sauver, qui se trouvera, pour l'attendre et peut-être lui pardonner, de l'autre côté de la frontière.
C'est peut-être cette certitude qui permettra, qui sait, de redonner à feue la France un peu de cette violence et de gratuité (cf. p. 27) rappelant les «lost violent souls» dont T. S. Eliot regrettait la disparition, violence et gratuité que l'auteur prête, à tort à notre sens, aux tournures d'esprit de ces années-là, mais cette renaissance concerne, tout autant que l'au-delà du texte dont par définition nous ne savons rien, une aventure métaphysique qui par essence ne peut concerner que celui qui mourra, et qu'il verra peut-être, si les yeux des morts leur permettent de voir autre chose qu'un passé s'écoulant sans fin, l'éternelle redite de leurs méfaits et de leurs fautes, de leurs petites lâchetés d'hommes creux.
Notes
(1) François Sureau, Le Chemin des morts (Gallimard, 2013), p. 11.
(2) «Le manège français tournait depuis cinquante ans, avec ses chevaux de bois fatigués, aux têtes de résistants, de collaborateurs, de flics et de trotskystes : on pouvait désormais en descendre et partir à l'aventure" (p. 14). Bien évidemment, nul besoin de préciser que les chemins de l'aventure, fussent ceux de l'aventure maoïste ou tranquillement hippie, sont tous barrés et ne mènent, bien davantage que nulle part, pas très loin, sinon dans le large fauteur de quelque directeur de quotidien bien-pensant comme Libération ou Le Monde : «Il y avait de l'électricité dans l'air, écrit ainsi François Sureau, l'argent, les énergies individuelles, l'impatience de toutes les règles anciennes, mais le monde ne s'était pas remis en mouvement. [...] Les opinions d'alors, celles de mes jeunes collèges et celles de mes élèves, étaient violentes et gratuites, comme c'est souvent le cas en France. Cette tournure d'esprit jetait ses derniers feux et nous n'en savions rien» (p. 27).
(3) Cf. p. 29.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, rentrée littéraire 2013, françois sureau, le chemin des morts, éditions gallimard |  |
|  Imprimer
Imprimer