Les Émigrants de W. G. Sebald (25/04/2014)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 W. G. Sebald dans la Zone.
W. G. Sebald dans la Zone.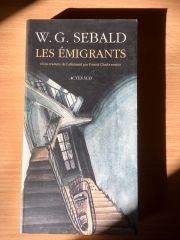 Acheter Les Émigrants sur Amazon.
Acheter Les Émigrants sur Amazon.À mesure que nous lisons les quatre récits qui composent Les Émigrants publiés en 1992 en Allemagne et traduits en français en 1999 (1), nous nous enfonçons dans une étrange matière qui n'est pas uniquement composée de souvenirs, et nous procure donc cette délicieuse autant que troublante sensation de vertige toutes les fois que le passé semble revivre, rutilant de gemmes étrangères, faites d'une autre matière, non point celle, friable et tendre, de la nostalgie ou peut-être même d'une banale mélancolie, mais plutôt celle, que l'on devine dure et aussi tranchante qu'une arrête de roche affleurant le sol meuble, qui nous laisse deviner, sous l'apparence placide des choses et la douce ordonnance qu'adoptent les êtres qui leur sont conjoints, une réalité dangereuse, apparaissant par le truchement du rêve, d'une sensation bizarre, de la décrépitude physique autant que morale des personnages qu'évoque Sebald, quand il ne s'agit pas de la lente détérioration des lieux, après tout eux aussi mystérieusement contaminés par les pensées de celles et ceux qui les ont traversé l'espace de quelques heures ou de toute une vie.
Dans le premier récit qui compose l'ouvrage, le Dr Henry Selwyn désigne ainsi à l'auteur un potager en ruine, mais aussi des «serres victoriennes» et des «espaliers proliférant en tous sens», car ce n'est pas seulement «cet endroit abandonné à lui-même depuis des années qui est sur le point de disparaître», mais aussi la nature qui, «privée de nos soins, gémit et croule sous le poids de ce que nous lui imposons» (p. 16), et qui est menacée par la «destruction et l'anéantissement constamment à l’œuvre dans la vie» (p. 59). C'est aussi sous le poids de ce que nous semblons lui imposer que notre esprit se rétracte et parfois même subit l'une de ces crises si communes dans les textes de Sebald (cf. p. 25) pendant lesquelles, parfois durant des décennies entières, les images de tel ou tel épisode du passé s'effacent de la mémoire, avant d'y revenir douloureusement (cf. p. 30), provoquant de nouveau une crise qu'il s'agira de tenter de soigner en se mettant à la recherche du souvenir perdu, à vrai dire presque perdu mais pourtant capable, comme un cadavre depuis longtemps oublié, de revenir à la surface de la terre une fois que les glaces l'ont libéré de leur emprise (cf. p. 34), sortant dès lors de sa prison et gisant «au bord de la moraine», comme «un petit tas d'os polis, une paire de chaussures cloutées» (p. 35), ou encore comme tel souvenir de Paul Bereyter, l'excellent professeur des premières années d'études de Sebald, qui devient de plus en plus fréquemment l'objet des préoccupations de l'auteur, sans que nous sachions véritablement pour quelle raison (cf. p. 40).
Il faut alors tenter, «bien tardivement», précise Sebald, quitte à interrompre des recherches «sur l'expédition de Bering en Alaska» (p. 45) dont nous ne saurons rien, d'approcher de la personne (cf. p. 41) qui a mystérieusement surgi dans son esprit, quitte à mener sur lui une véritable enquête, seule capable de prémunir l'auteur contre «des débordements de sentiments» qui lui paraissent «blâmables et contre lesquels [il entreprend] de retranscrire ce [qu'il sait] réellement et ce [qu'il a pu] apprendre» de lui (p. 42) même si, bien sûr, les limites entre l'objectivité et la subjectivité ici mises en relief sont très vite démenties par l'auteur lui-même, à qui il semble «que les morts reviennent ou bien que nous sommes sur le point de nous fondre en eux» (p. 60), les morts, surtout ceux qui, comme Paul Bereyter, se suicident en s'étendant le long d'une voie de chemins de fer, ne cessant jamais de nous molester et de nous interroger, l'homme pressentant confusément que ces chemins de fer «menaient à la mort» (p. 78) comme ils avaient mené à une mort certaine des centaines de milliers de Juifs que, dans le texte suivant, le très beau Ambros Adelwarth, nous retrouvons, du moins leurs ancêtres qui n'ont donc pas connu l'Extermination, entassés par dizaines de milliers dans le Bowery et «tout le Lower East Side», qui jusqu'à la Première Guerre mondiale a constitué «le quartier privilégié des immigrants» (p. 101), préfiguration, en somme, de ce «bord des ténèbres» dont parle l'oncle Kasimir, et de fait, remarque Sebald, «on eût cru que derrière nous le continent avait sombré et que plus rien d'autre n'émergeait du désert liquide que cette étroite bande de sable s'étirant du nord au sud» (p. 108) sur laquelle s'est photographié le parent de l'auteur. Chez Sebald, tout se tient, les vivants et les morts, les souvenirs et leur occultation, les lieux et ceux qui y ont vécu, l'apparente tranquillité d'une vie et les gouffres d'horreur qu'elle recèle.
Mais le passé, pourtant diablement tenace puisqu'il exsude de la moindre ligne de Sebald et semble imprégner ses textes d'une trouble phosphorescence, constitue la trame même sur laquelle les moindres gestes et paroles de ses personnages se détachent pour acquérir une aura fantasmatique, mais le passé est ce qu'il importe, en le convoquant, de mettre à distance, peut-être en employant la curieuse ruse par laquelle le grand-oncle Adelwarth s'extirpe de sa propre chair la graine maudite : «Comme même la plus infime des réminiscences, remontées très lentement par lui de profondeurs visiblement insondables, était d'une étonnante précision, j'en suis venue [dit tante Fini] peu à peu, en l'écoutant, à la conviction que s'il possédait une mémoire infaillible, il n'avait presque plus la capacité de souvenir qui lui aurait permis de renouer avec cette mémoire» (p. 121). Ainsi, plus «l'oncle Adelwarth racontait, plus il était désespéré», il n'est donc pas étonnant qu'il sombre «dans une dépression si profonde qu'en dépit du très grand besoin qu'il avait de pouvoir se raconter, il fut hors d'état d'articuler quoi que ce soit, la moindre phrase, le moindre mot, à peine le moindre son» (p. 123), ce qui ne le fera pas hésiter devant la marche à suivre, l'entrée volontaire dans un centre de soins baptisé Ithaca, l'un de ceux qui y travaillèrent, le Dr Abramsky, évoquant devant Sebald le traitement inhumain qui était réservé aux pensionnaires de cet endroit aujourd'hui abandonné, infesté de souris, personne, vraisemblablement, n'imaginant, ne pouvant imaginer «l'ampleur des souffrances et des malheurs qui se sont accumulés ici», et dont ce même Dr Abramsky espère «qu'ils finiront par se diluer en même temps que se décompose cet extravagant palais de planches» (p. 132), ne cessant même de rêver à l'écroulement (cf. p. 135) de cette espèce de Maison Usher dans laquelle le grand-oncle de Sebald s'est volontairement enfermé, afin «d'annihiler en lui le plus radicalement et le plus irrémédiablement possible toute capacité de réflexion et de souvenir» (p. 137). Les textes de Sebald se dressent, toujours, à leur façon énigmatique et subtile, fragile sans doute, d'une malicieuse modestie, contre l'écroulement, le silence devenu mutisme, le langage qui perd ses moyens face à un excès de souffrance ou bien une expérience cataclysmique laissant les survivants hagards au milieu des ruines.
La destruction est présente, elle ne nous a jamais du reste quittés, et c'est elle que Sebald voit à l’œuvre lorsqu'il se rend à Deauville en 1991 puisqu'il s'avère aussitôt que «ce lieu de villégiature jadis légendaire, à l'instar de tous les sites que l'on visite aujourd'hui dans quelque pays ou sur quelque continent que ce soit, était en complète décrépitude, ruiné par la circulation automobile, le commerce des petits boutiquiers et cette rage de destruction qui gagne sans cesse autour d'elle d'une manière ou d'une autre» (p. 140), mais c'est pourtant à Deauville que Sebald est visité par un long rêve où il retrouve la figure énigmatique de son grand-oncle, jamais très longtemps séparé de son ami Cosmo, l'un et l'autre évoqués lors d'un périple en Terre sainte consigné dans un calendrier de poche de l'année 1913, les deux voyageurs revivant sous nos yeux par le truchement des brèves notations consignées par Adelwarth dans son carnet, alors qu'ils voyagent dans une terre qui, bien que gorgée d'une lumière unique, peut-être miraculeuse, semble frappée par une antique malédiction (cf. p. 168), comme nous le constatons à Jérusalem qui fit aux deux voyageurs une très mauvaise impression, et provoqua même un souvenir désagréable, ce souvenir apparaissant à celui qui fit tout pour les chasser «comme une forme de bêtise» : «On a la tête lourde, on est pris de vertige, comme si le regard ne se portait pas en arrière pour s'enfoncer dans les couloirs du temps révolu, mais plongeait vers la terre du haut d'une de ces tours qui se perdent dans le ciel» (p. 174) et sur laquelle travailla peut-être un des autres parents de Sebald, l'oncle Kasimir (cf. p. 104), ce qui lui permit de voir la curieuse vie d'Ambros.
C'est le dernier récit, intitulé Max Ferber, qui nous donne le plus d'indications sur l'art d'écrire de W. G. Sebald, qui semble être intimement lié à une souffrance, qu'il s'agisse du moment même de l'écriture ou des événements qu'elle relate. Ainsi, se souvenant de son arrivée dans la ville de Manchester qui semble n'être plus qu'une «nécropole ou un mausolée» (p. 180) victime de «quelque avarie générale» (p. 190), Sebald remarque que c'est la contemplation d'un étrange appareil, baptisé teas-maid qui l'a «raccroché à la vie à une époque où, étreint par un sentiment de délaissement pour [lui] incompréhensible» (p. 184), il aurait très bien pu s'en éloigner définitivement.
Quoi qu'il en soit, l'écriture de Sebald est tout aussi longue (cf. p. 265) dans sa gestation que douloureuse (2), et son lent processus de cristallisation autour d'une figure ou d'un geste oubliés se rapproche du spectacle qu'il contemple dans une saline, alors que l'auteur, regardant les «eaux ruisselantes», ne peut du reste séparer le spectacle des «réflexions sur les processus longs, complexes et selon [lui] impénétrables, responsables, par concentration de la solution saline, des formes les plus étranges qui soient, de pétrifications, de cristallisations qui en quelque sorte imitent la nature, et aussi la transcendent» (p. 270).
L'écriture de Sebald ressemble aussi à la façon qu'a Max Ferber de dessiner : «Quand il se décidait enfin, après avoir peut-être rejeté quelque quarante variantes ou pour mieux dire les avoir bannies à coups de gomme dans le papier et recouvertes d'autres esquisses, à se dessaisir d'un tableau, moins par conviction de l'avoir achevé que cédant à un sentiment de lassitude, on croyait avoir devant les yeux un portrait issu d'une longue lignée d'ancêtres aux visages gris, surgis de leurs cendres pour continuer à hanter sans fin le support malmené» (p. 193).
Cette longue décantation par laquelle un visage surgit en laissant voir tous les traits d'ancêtres qui le composent semble elle-même n'être que l'une des variantes de la chaîne prodigieusement subtile et tortueuse qui unit les personnages que Sebald évoque, et nous ne sommes ainsi guère surpris que Max Ferber ait logé à la Palatine Road n°104, «autrement dit dans la maison où en 1908 avait vécu, comme quiconque pouvait le savoir à la lecture de divers écrits biographiques, un jeune homme de vingt ans se destinant à des études d'ingénieur du nom de Ludwig Wittgenstein» (p. 198), comme si un «sentiment de fraternité qui transcendait sa propre époque et celle de ses ascendants» (p. 199), constituait la toile véritable sur laquelle se détachaient l'ensemble des faits et gestes, passés, présents et à venir, des personnes aux destinées de qui Sebald s'attache, la souffrance morale étant donc «pratiquement infinie» (p. 202) à la différence de la souffrance physique, qui forme le milieu invisible où se tiennent tous les actes, toutes les pensées et aussi tous les souvenirs, dont les pérégrinations secrètes les tiennent cependant éloignés, du moins pour quelques années, des esprits, avant que ceux-ci ne fondent sur leur proie (cf. p. 203), semblant s'être reconstitués après s'être effilochés (cf. p. 210).
Ainsi, il est clair que le temps n'est qu'une illusion ou plutôt, très bellement défini, qu'il «n'indique rien d'autre que les fluctuations de l'âme» (p. 214) et qu'il faut donc poursuivre le travail engagé, «en l'espèce celui du souvenir, jusqu'à ce que son cœur se brise» (p. 228), de récit en récit, d'abord celui de Max Ferber, puis celui de Luisa Lanzberg, la mère de Ferber, en retrouvant tous ces beaux noms juifs, «si liés au pays et à la langue dans lesquels ils vivaient» (p. 263) et dont les Allemands étaient, selon Sebald, jaloux, puisqu'il s'agit toujours, en somme, d'évoquer l’œuvre patiente et méthodique, infernale, de la destruction : «Quelles qu'aient été les mesures que je pris», nous confie ainsi Max Ferber, consciemment comme inconsciemment, «pour m'immuniser contre la souffrance vécue par mes parents et la mienne propre, et quelle qu'ait été par moments ma capacité à sauvegarder mon équilibre psychique au fond de ma retraite, le malheur de ma jeunesse et de ma période de formation s'était si profondément enraciné en moi qu'il a pu resurgir plus tard, produire des fleurs malignes, tisser au-dessus de ma tête cette voûte de feuillage vénéneux qui a tant assombri et obscurci mes dernières années» (p. 226) et, luttant contre elle, rappeler à la vie ce que «l'abêtissement, l'amnésie des Allemands, l'habitude avec laquelle tout avait été rendu propre» (p. 265) ont tenté d'effacer : l'immonde et, parfois, rarement, la lumineuse souffrance des hommes.
Notes
(1) Les Émigrants (Die Ausgewanderten, 1992, traduit de l'allemand par Patrick Charbonneau, Actes Sud, 1999). Les pages entre parenthèses, sans autre précision, renvoient à cette édition.
(2) «Dans les mois de l'hiver 1990-1991, je travaillai, aux rares moments de loisir dont je disposais, soit la plupart du temps de nuit et pendant ce qu'il est convenu d'appeler les fins de semaines, à l'histoire de Max Ferber racontée ci-dessus. Ce fut une entreprise extrêmement pénible, qui des heures et des jours durant n'avançait pas et même, fort souvent, reculait, où j'étais constamment en proie à des scrupules de plus en plus tenaces et de plus en plus paralysants. Ces scrupules tenaient autant à l'objet de mon récit auquel je croyais, quoi que je fisse, ne pas rendre correctement justice, qu'à une mise en question de la possibilité de toute écriture» (p. 270).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, w. g. sebald, les émigrants, éditions actes sud |  |
|  Imprimer
Imprimer
