Je ne vous quitterai pas de Pascal Louvrier (17/03/2015)
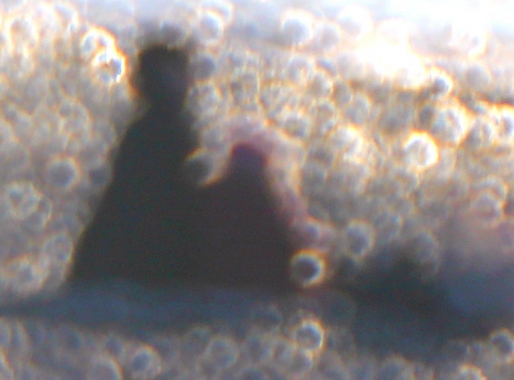
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 À propos de Je ne vous quitterai pas de Pascal Louvrier (Allary Éditions, 2015).
À propos de Je ne vous quitterai pas de Pascal Louvrier (Allary Éditions, 2015).LRSP (livre reçu en service de presse).
 Le titre du premier roman de Pascal Louvrier, Je ne vous quitterai pas, crépusculaire et parfois déchirant, diablement maîtrisé, très efficacement écrit, elliptique jusque dans sa façon de nous révéler (ou de les inventer) des secrets, tourmenté comme un ciel de tempête déchirant cette mystérieuse et tragique côte sauvage que Jean-René Huguenin aima tant, n'a pas besoin d'être trop longuement expliqué. Il évoque, bien davantage que la certitude d'une vie éternelle et la croyance, tout de même faisandée dans l'esprit de celui qui prononça ces mots en 1994, aux forces de l'esprit, le règne des fantômes qui ne cessent jamais de murmurer et qui, dans le roman de Pascal Louvrier, se font compacts, lourds et claquants comme des galets de plage. Nous vivons plus que jamais dans ce murmure incessant qui est celui de la France spectrale, dévorée par ses vieux démons eux-même privés de toute énergie mais qui rejouent leur épopée ridicule et souffreteuse sur les tréteaux pourris des clowns bavards Soral et Dieudonné, une France épuisée, à bout de force, désespérée même. Dans ce monde tout entier fuligineux, gris, où une parole elle-même grise menace de nous recouvrir de la monotone ondée du sous-langage, quelques livres, comme celui de Pascal Louvrier qui n'est tout de même pas un béjaune, ni même un faiseur mais un artisan au sens noble du terme, ont «le gris flamboyant» (p. 229).
Le titre du premier roman de Pascal Louvrier, Je ne vous quitterai pas, crépusculaire et parfois déchirant, diablement maîtrisé, très efficacement écrit, elliptique jusque dans sa façon de nous révéler (ou de les inventer) des secrets, tourmenté comme un ciel de tempête déchirant cette mystérieuse et tragique côte sauvage que Jean-René Huguenin aima tant, n'a pas besoin d'être trop longuement expliqué. Il évoque, bien davantage que la certitude d'une vie éternelle et la croyance, tout de même faisandée dans l'esprit de celui qui prononça ces mots en 1994, aux forces de l'esprit, le règne des fantômes qui ne cessent jamais de murmurer et qui, dans le roman de Pascal Louvrier, se font compacts, lourds et claquants comme des galets de plage. Nous vivons plus que jamais dans ce murmure incessant qui est celui de la France spectrale, dévorée par ses vieux démons eux-même privés de toute énergie mais qui rejouent leur épopée ridicule et souffreteuse sur les tréteaux pourris des clowns bavards Soral et Dieudonné, une France épuisée, à bout de force, désespérée même. Dans ce monde tout entier fuligineux, gris, où une parole elle-même grise menace de nous recouvrir de la monotone ondée du sous-langage, quelques livres, comme celui de Pascal Louvrier qui n'est tout de même pas un béjaune, ni même un faiseur mais un artisan au sens noble du terme, ont «le gris flamboyant» (p. 229).Fantôme, fantômes même pourrions-nous dire, tant l'homme s'est amusé à brouiller les pistes, de François Mitterrand, hélas, hélas, hélas le dernier homme politique français à peu près digne de ce nom, sur le cadavre duquel auront grouillé tant de larves de mouches à merde, socialistes ou pas, dont le personnage principal du roman, Jacques Libert, a été le conseiller le plus intime, secret et, surtout, celui qui lui sera resté à jamais fidèle, par-delà la mort bien sûr puisque, dans le roman de Pascal Louvrier, le monde des vivants est constamment entouré par celui des morts, amoureusement ou horriblement imbriqué avec lui. Il est du reste difficile de savoir si le président n'est finalement pas le personnage le plus vivant de notre roman, à l'exception peut-être de Morain, tout pressé de reconquérir le pouvoir à la Mairie de Dieppe, intéressant second rôle qu'il aurait peut-être fallu complexifier davantage.
Fantôme de celle qui fut la femme de l'écrivain de l'ombre, la très belle Laure, conduite au désespoir et à l'alcoolisme par le sadisme d'un pervers narcissique (l'expression, si commune désormais, est lâchée quelque part dans le roman, elle n'aurait pas dû l'être, même si Pascal Louvrier la remettra dare-dare dans sa niche), et aussi parce que Libert lui reproche de n'avoir pu sauver leur fils. Laure qui finira par quitter son mari pour aller rejouer la geste pseudo-révolutionnaire de l'Italie des années de plomb, Libert, lui, malade et hanté par son souvenir, l'abjection qu'il a méticuleusement, patiemment servie à celle qu'il a pourtant follement aimée mais qui n'est jamais restée qu'elle-même, une bourgeoise étriquée, couchant d'une certaine façon depuis vingt-deux ans avec une morte (cf. p. 99), ne cessant de songer à ce qu'il lui a fait subir, avant qu'elle ne chute, saoule, du haut d'une falaise, ne parvenant pas à faire taire le cri de sa femme, comme le narrateur de La Chute (et Albert Camus lui-même, nous dit l'auteur, cf. p. 214) ne parviendra jamais à faire taire le cri du corps tombé dans le fleuve, et ne cessera de méditer son passé, moderne Vieux Marin tout pressé de se confier et de s'accuser. Libert, lui, ne tentera pas de s'absoudre ni même de jouer au juge-pénitent, et c'est une balle qui emportera la moitié de sa tête toute pleine de ses fantômes, concluant la trajectoire fulgurante de cet homme moins noir qu'obscur, et volontairement obscur : «Quelque chose de froid et de désespéré émanait de lui, quelque chose de paradoxal aussi, comme une pointe de lucidité perverse dans le regard d'un ange» (p. 66).
Fantôme, enfin, d'une histoire de France que Pascal Louvrier nous présente comme étant finie, elle-même fantomisée, évaporée, ce dont nous nous doutions à vrai dire depuis la mort de celui qui, à défaut d'une véritable vision historique du pays, et même s'il «incarnait la désobéissance à l'ordre libéral bourgeois» (p. 170) selon Libert, pouvait se targuer d'une culture littéraire qui l'enracinait dans sa plus haute présence, son immortalité intellectuelle et artistique : Sarkozy, l'homme sans culture, en effet, mais avant lui Chirac, l'homme les ayant toutes donc n'en ayant aucune, et après lui le pitre hollandais, l'homme qui cultive le bon mot et quelques harpies d’État, tous les innombrables animalcules ayant gravité ou gravitant autour de ces marionnettes, «hommes corrompus» (p. 123), ombres d'ombres dolentes moins affectées par le Mal et la «notion de péché» (p. 172) que par leur illusion, ont «tombé le masque» : ils «sont en permanence dans le déni. Le verbe n'habitera plus les futurs présidents», l'écrivain, du reste, étant mort «dans l'ordre social» (p. 53) et sans doute aussi dans l'ordre symbolique, au moins aussi important, sinon plus important que le premier. Il n'y a donc plus, comme chez François Mitterrand selon Libert, «la présence, l'incarnation du Verbe» (p. 159), c'est fini, la grâce s'est absentée (cf. p. 190) ou bien comme l'aura selon Walter Benjamin s'est enfuie au loin, sans se retourner, elle, et le symbole des socialistes, cette «rose au poing», ne pourra décidément plus être comprise comme «le plan d'une église» (p. 167), pour la simple et bonne raison que cette lecture abellienne de la réalité n'intéresse plus personne.
Tout n'est pas perdu, car, pour l'homme qui a beaucoup écrit, il reste encore à lire, c'est-à-dire déchiffrer les caractères fulgurants du destin. C'est du reste sur le «visage racé» de Libert que s'inscrit «l'histoire violente de sa vie» (p. 51) et de celle de la France que Mitterrand a connue, façonnée, du moins l'a-t-il cru, histoire que l'écrivain ayant raté (heureusement, pas vrai Lydie Salvayre ?) le Goncourt a vécue en étant aux côtés du président énigmatique une partie de sa vie, comme c'est à cause de «la blessure secrète du péché qui ne cicatrise jamais» que le style se tend «à l'extrême» (p. 71) et que «les mots qui surgissent savent de nous des choses que nous ignorons d'eux» (p. 109). Les fantômes ne cessent de murmurer et, comme tous les envoûteurs, quoique discrets mais pas moins opiniâtres, ils ont maille à partir avec le langage exténué de notre époque, ici très finement mis en scène dans son combat invisible contre une fuite, un mouvement de ciel, une cavalcade de nuages chassés par le vent d'une de ces journées claires de Haute-Normandie que n'illuminera pourtant aucune trouée de lumière. Tout est fini, tout pourrit, comme la maison de Libert qui va s'écrouler tôt ou tard, comme celle de Usher, et qui s'écroulera à sa façon symbolique, lorsqu'il apprendra, encore d'un mort (et quel mort ne cessant de travailler la mémoire des vivants), que Laure lui a donné, aussi, une fille, elle sacrément vivante, et qui s'écroulera bien sûr lorsque Libert se suicidera, n'avouant pas tout à sa fille, notamment ce qu'il a écrit dans une scène d'amour aussi sèche que désespérée, car tout, en somme, finit par sombrer dans le trou noir de la volonté du président, insatiable comme un ogre, infatigable psychopompe des énergies et des volontés humaines : «Et si vous le trahissez, il ne vous bannira pas, car il sait que vous ne pourrez échapper à cette loi physique d'attraction qui n'est décrite nulle part. Il vous laissera tourner autour de lui, sans vous regarder, jusqu'à l'épuisement» (p. 117).
Je ne vous quitterai pas agit comme un sortilège amère, corrosif, allusif (1), dans sa discrète mordacité, alors même que la réclame journalistique évoque un roman pourtant riche en révélations, réelles ou phantasmées. L'écriture sèche, parfois brutale de Pascal Louvrier, écriture abrasive qui en tous les cas ne pose pas et ne fait pas la mariole, comme celles, ampoulées jusqu'à l'obésité obséquieuse, de tant d'autres de ces écrivaillons gommeux pour midinette cinquantenaire, provoque une délicieuse sidération du lecteur lorsqu'il découvre, par une phrase, une description (et celles de Pascal Louvrier, pourtant épurées, parfois cinglantes comme l'est le geste d'un peintre sûr de sa technique, sont belles et, surtout, ne s'oublient pas, cf. p. 232), que le texte creuse la réalité qui l'entoure d'une profondeur insoupçonnable. Cette profondeur où se nichent l'écriture et le royaume de nos morts est par exemple figurée par ce tombeau tout simple, secret, émouvant, de l'enfant à peine connu, le «plus anonyme des êtres humains dans le plus puissant lieu de France» (p. 147), cadeau sépulcral d'un président revenu d'entre les morts (2), rejouant perpétuellement sa liberté par la rupture (cf. p. 255), à celui qui a perdu son fils Clément et qui ne peut se résoudre à se séparer de son petit corps, peut-être parce que, comme tant d'autres hommes affamés de pouvoir et comprenant que celui-ci n'est, comme le reste, plus que tout le reste, qu'une illusion, mais celle-ci plus dévoratrice que les autres, l'enfance, l'esprit d'enfance, «l'authenticité révolue» «remontait soudain» (p. 247), de quel passé légendaire désormais aboli sous la croûte de l'usure, des mensonges, des actes ignobles, des pensées interdites, de la gloire si maigre des hommes de pouvoir, remontant soudain «vers le bleu bouillonnant du ciel» comme l'Arbre de Jessé, très ancienne figuration de la filiation du Christ, «alors qu'il est si difficile de vivre ici-bas en se tenant debout» (p. 286) et que Louise, «jeune femme paumée» (p. 280) qui peut-être deviendra peut-être une femme avec l'aide de Morain, comme l'homme dont elle deviendra le témoin des derniers jours, est seule face au silence de Dieu et de ses prophètes, sans père, sans mère, sans frère ni sœur, sans piété peut-être, ou alors une piété tronquée, arrachée à sa racine, seule.
Notes
(1) «Il écrivait «une odeur de sable mouillé», et cela suffisait. Chaque lecteur se trouvait projeté sur la plage de ses souvenirs, le plus souvent celle de son enfance» (p. 228).
(2) «Il avait peur d'être repris par les nazis. Il avait peur en permanence. C'était comme si cet homme marchait vers le peloton d'exécution et qu'il était sauvé à la dernière seconde. Il a triomphé de cette épreuve initiatique. De cette ordalie. Cette longue marche traumatisante l'a métamorphosé» (p. 237).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, pascal louvrier, je ne vous quitterai pas, françois miterrand, allary éditions |  |
|  Imprimer
Imprimer