Le ciel de Cambridge. Rupert Brooke, la mort et la poésie de Philippe Barthelet (03/05/2015)
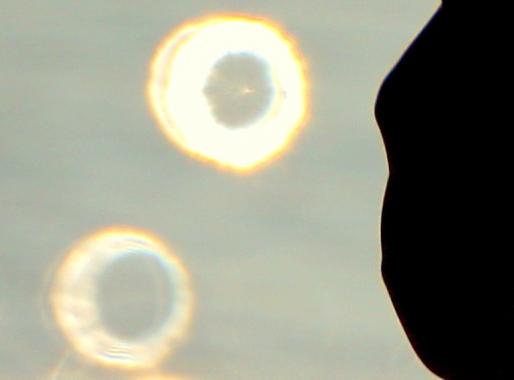
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 À propos de Philippe Barthelet, Le Ciel de Cambridge. Rupert Brook, la mort et la poésie (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2015).
À propos de Philippe Barthelet, Le Ciel de Cambridge. Rupert Brook, la mort et la poésie (Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2015).LRSP (livre reçu en service de presse).
«Alone above the Night, above / The dust of the dead gods, alone», écrit Rupert Brooke qui porta si haut, non, qui incarna plutôt si admirablement les plus nobles vertus qui font d'un homme autre chose qu'un de ces «half-men», ces moitiés d'hommes «contre lesquels, écrit Philippe Barthelet dans ce superbe petit livre, [Rupert Brooke] part en guerre, non pour les combattre mais pour partir, partir en guerre comme on part pour un pays désormais lointain», ces moitiés d'hommes qui «sont le contraire des poètes» (p. 89, l'auteur souligne), qui pullulent dans notre société, et contre lesquels l'auteur décoche quelques belles flèches qui, aussi furtives qu'on le voudra ou s'en lamentera, ne loupent jamais leur cible : la bêtise, la fadeur intellectuelle, le réductionnisme aberrant des critiques et des mauvais lecteurs, bien souvent confondus, le matérialisme de brute épaisse dans lequel nous sommes tombés, plus vite que nous ne pensions pouvoir tomber, de toute la hauteur de notre chute formidable, et l'insignifiance aussi, nouvelle idole de notre époque pressée, fuyante, hagarde : «Le postulat d'insignifiance qui gouverne la critique fonctionnaire, postulat «scientifique» qui donne la mesure des «légendes dorées» et de leur «ridicule», légendes à réduire, ridicule à dénoncer, «masques» du poète à arracher, la biographie elle-même se charge de le mettre en pièces; la biographie, ou pour mieux dire
 les faits tels qu'ils ont eu lieu et se sont inscrits dans la réalité vivante, les choses telles qu'elles furent et non telles que les voudrait cette manie réductrice qui n'est rien d'autre que la mort de l'intelligence. Les nihilistes sont des faussaires, en particulier ces nihilistes de cabinet, par l'absurdité qu'ils présument dans tout ce qu'ils expliquent. Tant de petites mains acharnées à réduire, abaisser, diffamer (au sens héraldique d'enlever les parties nobles) qui infestent l'université depuis un demi-siècle, qui pensent – si l'on ose, s'agissant d'eux, employer ce verbe – comme on règle des comptes, selon cet étrange mystère de la détestation qui les anime : pourquoi s'acharner sur des auteurs qui leur sont tellement contraires, qui ne leur ont rien fait – sinon précisément parce qu'ils ne leur ont rien fait, et que toute la grâce poétique du monde ne les pourrait guérir du complexe de Procuste ?» (pp. 38-9).
les faits tels qu'ils ont eu lieu et se sont inscrits dans la réalité vivante, les choses telles qu'elles furent et non telles que les voudrait cette manie réductrice qui n'est rien d'autre que la mort de l'intelligence. Les nihilistes sont des faussaires, en particulier ces nihilistes de cabinet, par l'absurdité qu'ils présument dans tout ce qu'ils expliquent. Tant de petites mains acharnées à réduire, abaisser, diffamer (au sens héraldique d'enlever les parties nobles) qui infestent l'université depuis un demi-siècle, qui pensent – si l'on ose, s'agissant d'eux, employer ce verbe – comme on règle des comptes, selon cet étrange mystère de la détestation qui les anime : pourquoi s'acharner sur des auteurs qui leur sont tellement contraires, qui ne leur ont rien fait – sinon précisément parce qu'ils ne leur ont rien fait, et que toute la grâce poétique du monde ne les pourrait guérir du complexe de Procuste ?» (pp. 38-9).Comment, d'ailleurs, la critique universitaire, voire la simple recherche biographique (1), par essence desséchante ou, tout bonnement, asphyxiante, pourrait-elle être utilement convoquée, alors même que la vie «ne suffit pas, [puisqu']elle ne peut soutenir la poésie» (p. 13), la poésie étant une «réalité sensible» (p. 25) et non une légende ou bien pire, un recueil de textes où le lecteur dressera sa facile grille de figures de style ? Il se peut même, nous suggère l'auteur, que la poésie écrite ne soit que «la plus petite partie de la poésie, par quoi l'on voudrait donner le change à sa douleur» (p. 29), et qu'elle ne soit jamais affaire de vieillards, et d'esprits jeunes tout remplis de préoccupations de vieillards, car les «humanités sont inséparables de ce moment de l'adolescence où tout se dit, ou tout peut se dire; cet âge admirable, admirablement sévère où il est permis de penser sans cuistrerie, en face des siècles et de tout ce qui a été écrit de plus noble, qui a été écrit pour cet âge précisément : Lucain est mort à vingt-cinq ans, à quoi bon lire La Pharsale ensuite, sinon pour la caducité et la poussière ?» (pp. 35-6).
Évoquer Rupert Brooke, si intégralement poète, même s'il est difficile, pour nous Français de comprendre l'enthousiasme, qui s'exerce bien au-delà d'un cercle de happy few, qu'il continue de déclencher en Angleterre, ne peut donc être pour Philippe Barthelet qu'un exercice de style, mais bien sûr au bon sens de cette expression (2), et aussi une attention, souvent pleine d'humour, aux beautés et rigueurs, aux belles rigueurs de notre langue qu'il illustre par une écriture à la française, tirée au cordeau, aussi minutieuse qu'attentive à la proportion harmonieuse entre les masses. Légèreté, rapidité, donc, puisqu'il s'agit de recomposer la trajectoire du bolide comblé de dons, depuis Cambridge qu'il fréquenta, tout comme Byron (celui-ci de 1805 à 1808), jusqu'à l'île d'Achille, Scyros, où s'écrase le météore, l'écriture de Barthelet s'adapte à son sujet, se fait légère, allusive, plus pressée que lorsqu'il s'agissait d'évoquer Ernst Jünger le si agile.
N'oublions pas de saluer Barthelet traducteur, puisqu'il n'hésite pas à citer dans leur langue les vers magnifiques du jeune poète, et à les traduire dans la foulée, son texte gagnant ainsi en fluidité, comme attiré par le pôle de la mort, qui organise selon l'auteur la vie, et même la destinée, puisque Brooke est poète, de celui qui admira Marlowe, Milton, Keats et Byron, auquel il conforma de si noble façon sa propre vie : «Ce que Byron cherchait en Grèce, the land of the honourable death, la terre où mourir dans l'honneur, Rupert Brooke, sans le chercher, le trouvera à Scyros» (p. 129).
Sans le chercher, c'est le moins que nous puissions dire, puisque le jeune homme y mourra, d'une crise de dysenterie, le 23 avril 1915, et sera enterré le soir même dans un bosquet d'oliviers, Winston Churchill, Premier Lord de l'Amirauté, publiant trois jours plus tard son éloge funèbre dans le Times. La légende pourra dès lors naître et se répandre comme une traînée de poudre de par le monde, ce monde que le poète chante inlassablement, selon Philippe Barthelet, le chant du poète ajoutant «au monde son éclat» (p. 125), en augmentant la réalité, vie et poésie indissociablement liées puisqu'un poète «se devance par ses vers» (p. 113), la poésie n'étant que la vie augmentée, rédimée, et qu'importe que Rupert Brooke, dans sa fulgurance même, ne soit finalement que le figurant trop fugace et absolument parfait d'une comédie lettrée à laquelle plus personne ne croit, pas même peut-être Philippe Barthelet sous sa fine et mélancolique ironie, trop fin lettré pour ignorer que c'est la malchance peut-être plutôt que le Dieu des poètes et des héros qui a permis à Rupert Brooke d'ajointer la courbe de son destin à celles de ces intercesseurs qui «live on high», «vivent en haut» et, tout comme lui, n'ont jamais cherché qu'à «leave the sick hearts that honour could not move», quitter «les cœurs malades que l'honneur n'émeut pas» (p. 83).
Notes
(1) «Qu'est-ce qu'un poète ? L'auteur d'une centaine de sonnets, chansons, pièces diverses, tout ce qu'il est convenu d'appeler une «œuvre», ou bien la merveille d'une vie indissociable d'un chant ? La biographie est une facilité, et partant, un contresens : d'autant que nous l'entendons, à la moderne, comme la somme la plus exhaustive possible de toute espèce de contingences. Sur cette pente démasqueuse, on en vient vite à considérer quelqu'un comme le produit, voire le résidu, de son milieu ou de son époque, en le réduisant à ce qu'il a de commun avec tous ceux qui ne sont pas lui. Ce quadrillage psychosociologique permet de réjouissantes inepties, comme l'invention des «générations» d'écrivains ou d'artistes, qui s'engendreraient sous l’œil de la critiques, chargée de superviser le bon ordre de ces engendrements. Émile Zola et Léon Bloy sont tous deux de la même génération...» (p. 134).
(2) Tant Philippe Barthelet est persuadé que la «poésie est le mouvement naturel qui rend les mots à eux-mêmes» (p. 74).
Lien permanent | Tags : littérature, poésie, critique littéraire, rupert brooke, philippe barthelet, éditions pierre-guillaume de roux |  |
|  Imprimer
Imprimer