L’Amérique en guerre (20) : La Grande forêt de Robert Penn Warren, par Gregory Mion (05/01/2021)

Crédits photographiques : Andrees Latif (Reuters).
 L'Amérique en guerre.
L'Amérique en guerre. Robert Penn Warren dans la Zone.
Robert Penn Warren dans la Zone. Sur La Grande forêt.
Sur La Grande forêt.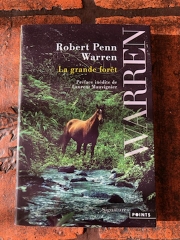 «Quoiqu’un homme ait vu constamment jusqu’ici le jour et la nuit se succéder, cependant il n’est pas pour cela en droit de conclure qu’ils se succéderont toujours de même, ou qu’ils se sont ainsi succédé de toute éternité. L’expérience ne fournit aucune conclusion universelle.»
«Quoiqu’un homme ait vu constamment jusqu’ici le jour et la nuit se succéder, cependant il n’est pas pour cela en droit de conclure qu’ils se succéderont toujours de même, ou qu’ils se sont ainsi succédé de toute éternité. L’expérience ne fournit aucune conclusion universelle.»Thomas Hobbes, De la nature humaine.
La guerre imaginée puis lentement manifestée
Paru en 1961, exactement un siècle après le début de la guerre de Sécession, La Grande forêt (1) de Robert Penn Warren nous remémore quelque peu La conquête du courage (2) de Stephen Crane. En effet, à travers ces deux romans importants mais relativement tombés dans l’oubli, la forêt joue un rôle psychologique déterminant sur fond scabreux de guerre civile. Le jeune Henry Fleming, dans le livre de Crane, trouve provisoirement refuge au cœur de la forêt pour éviter le combat, et Adam Rosenzweig, sous la plume tranchante de Penn Warren, fantasme sur les profondes et belliqueuses forêts de la Virginie à l’intérieur desquelles il pourrait tourner la page de sa jeunesse timide et s’accomplir en tant qu’homme engagé. L’un et l’autre se cherchent, se questionnent, se réfléchissent en de fulgurantes introspections, et la même guerre les jette dans l’irrésistible courant de l’Histoire où leurs derniers parapets de vertu ou d’idéalisme vont être emportés. D’abord effrayé à l’idée de mourir, Henry Fleming va tutoyer l’expérience mystique de la rédemption en s’agrégeant aux rythmes naturels de la forêt, puis la guerre et ses mauvaises influences le subjugueront jusqu’à la dissolution de lui-même au sein de la folie humaine. Quant au postulant à l’héroïsme Adam Rosenzweig, tout frais émoulu de sa Bavière natale, issu d’une «misérable petite ville perdue» au fond du Vieux Continent germanique (p. 14), vierge de toute relation sexuelle alors qu’il approche de sa trentième année, il décèlera dans la forêt tant convoitée non pas les éléments d’une perfection morale, mais les réalités objectives d’une imperfection universelle qui redéfiniront ses conceptions éthérées de l’existence, à commencer par l’image qu’il se faisait de sa digne personne et qu’il croyait pouvoir maintenir au-delà de tout soupçon.
Il n’est du reste pas inutile de préciser que ce brillant classique américain de la littérature de guerre s’ouvre sur le paysage montagneux de l’Allemagne et se referme sous la canopée des États-Unis, quelque part entre les arbres autoritaires d’une forêt indéfinie de Virginie, après qu’un océan franchi et un périple vers le Sud enfiévré auront permis à Adam Rosenzweig de faire advenir une version de lui-même davantage avertie sur les contradictions et les limites de l’humanité. Sa volonté de partir rejoindre le front de la guerre civile américaine est motivée par le décès de son père Leopold, au printemps 1863, à savoir ce paternel au «noble cœur» (p. 60) qui a connu l’effort de guerre à Rastatt, ce paternel juif, en outre, qui avait fini par se détourner de Dieu pour embrasser la fraternité des hommes, hors de tout principe édicté par la Loi religieuse de son obédience (cf. p. 13). C’est aussi ce père spirituellement contrarié qui a enseigné à Adam que l’on pouvait «mourir pour la liberté» (p. 12), et ces mots empreints d’un certain romantisme, assurément, ont fait du chemin dans la tête du fils admiratif, inspiré par cet exemple de dévouement à l’égard d’un idéal absolument fédérateur. À l’instar de son père, Adam veut participer au grand mouvement de la justice, être partie prenante de cette énergie libératrice qui délivre les peuples du mors de la politique, se fondre activement dans la Providence qui élimine la possibilité du pire et qui rétablit l’ordre légitime. Il y a dans ce désir de justice un levain de messianisme qui donne à Adam l’allure d’un candide apôtre du Christ n’ayant pas encore pris la mesure des aspects ou des constituants obstinément impurs de l’humanité. Là où son père, im Laufe der Zeit, a probablement séparé la vision religieuse de l’expérience humaine, Adam, par confusion et par enthousiasme typiques de la jeunesse, associe malgré lui le Ciel et la Terre et exprime son intention de rallier le Nouveau Monde comme on sonnerait le tocsin d’une Croisade médiévale. Son oncle, d’ailleurs, lui signifie que son idée est «insensée» (p. 17), que cette guerre américaine n’est pas la sienne et qu’il vaudrait mieux ne pas se mêler à ce massacre qui leur est drastiquement étranger. Mais les convictions d’Adam, arrimées aux faits d’armes de son père, l’incitent à seriner que les Américains, en ce moment crucial de l’Histoire, sont «des hommes qui se battent pour la liberté» (p. 17). Cela contraste douloureusement avec la Bavière à laquelle il ne prête pas ce bel appétit de la liberté, cette belle résolution de briser les chaînes. De surcroît, Adam souhaite apporter une rectification à l’attitude finale de son père, lequel, durant les derniers mois de sa vie, a plus ou moins renié l’élan vital de ses actions de naguère (cf. p. 21).
Plus intimement, plus viscéralement, la frénésie justicière qui s’empare d’Adam s’explique aussi par une malformation du pied qu’il veut surmonter en prouvant sa capacité à combattre. Affublé de ce pied-bot, Adam se rêve en Héphaïstos boiteux, en aspirant à l’excellence divine qui pourra faire oublier un épouvantable défaut par une indéniable supériorité, tel ce forgeron mythique dont le talent a conçu le bouclier d’Achille et tant d’autres merveilles nécessaires au prestige de la Grèce. Mais les fantasmes de vaillance et de gloire seront vite balayés par la moquerie et la rigueur du recrutement militaire sur le bateau qui le transporte vers le land of the free et le home of the brave (cf. pp. 22-31), reléguant l’intrépide Adam Rosenzweig à de nouvelles routes destinales. L’Amérique, ainsi, ne lui apparaît plus comme la voie toute tracée d’une quête idéale. Elle se redessine plutôt comme une rosace d’éventualités, surgissant sous les traits pittoresques de la baie de New York, sans la verticalité célinienne et ce pacifisme espéré qui étourdiront le Bardamu du Voyage au bout de la nuit, car, pour Adam Rosenzweig, il est inenvisageable de se départir de la rumeur de guerre, de cette virilité qui gronde au loin, au Sud, avec son cortège d’hommes turbulents qui «[chargent] et [meurent] dans la fumée des combats» (p. 31). Il faudra qu’il invente un moyen de se rendre là-bas, vers le Sud hallucinogène, qu’il puisse y mettre le pied, son pied difforme qui l’a empêché de débarquer avec les multitudes immigrantes et sacrificielles. En ce mois de juillet 1863, donc, le voilà descendu parmi l’effervescence citadine, aux antipodes de ce qu’il se figurait en anticipant les champs de bataille et les jungles sudistes occupées par l’ennemi rebelle. Il foule d’un pied incertain et invalide cette Amérique tout juste survivante de Gettysburg, et, sur un journal daté du 10 juillet 1863, abandonné à l’indigence des rues, il peut lire que «Lee et ses mercenaires de l’Esclavocratie ont été repoussés et [que] Washington est sauvée» (p. 42), que l’Union est renforcée, que l’Amérique avance d’un bon pas vers la liberté reconquise. Aussitôt après, telle une nuance administrée à ce discours partisan, tel un furieux retour de flamme, Adam voit le premier Noir de sa vie et cet homme est un cadavre, un pendu balafré qui eût suffoqué François Villon (cf. pp. 44-5). Ce qui le frappe, du reste, c’est son absence de compassion, sa faillite de miséricorde, et cela vient d’emblée corriger ses velléités de Sauveur (cf. p. 46). La confrontation avec le réel est susceptible de bouleverser toutes les architectures de l’idéalisme et Adam, devant ce macchabée suspendu à la corde de son martyre, prend conscience que la tâche ne sera pas simple et que la guerre, peut-être, n’est pas qu’une question de canons, de baïonnettes et de généraux endiablés se livrant à des prouesses stratégiques.
Et la guerre, effectivement, gît déjà parmi les foules racistes, parmi les vociférations des expéditions punitives, au sein même du territoire soi-disant préservé de l’Union (cf. pp. 47-51). Ce sont des émeutes d’illuminés qui refusent la logique de la conscription moins par militantisme antimilitariste que par souci de laisser pourrir le conflit, de laisser une chance aux confédérés de remporter la mise suprême et de ressusciter sur la terre d’Amérique la complète captivité des Noirs et l’entière suprématie des Blancs (cf. p. 66). Ce sont des factieux sanguinaires, des dissidents promus par l’injustice, et, de leurs couteaux qui eussent parachevé la brûlante démence d’Abraham, ils tailladent les peaux noires dans la nuit new-yorkaise, visant les organes vitaux, contribuant à ce génocide qui ne dit pas son nom. Ce climat de terreur et de violence contagieuse s’adjuge quasiment les ultimes lucidités d’Adam, mais celui-ci, sauvé par le désordre des circonstances davantage que par sa raison, se retrouve éjecté de la rue déchaînée, soudainement prisonnier d’une cave d’où il sera tiré des eaux montantes par un Noir que le destin bientôt remettra sur son chemin (cf. pp. 52-3). Cet épisode de violence, au cas où l’on aurait besoin de le signaler, a montré à Adam les fêlures secrètes de l’homme et la manière dont on peut basculer, malgré qu’on en ait, du côté des ténèbres contre lesquelles on se croyait immunisé. Si le pire n’est jamais sûr, la tentation du pire, elle, ne cesse en revanche de tourmenter jusqu’aux âmes les plus endurcies de vertu et d’archétypes du souverain Bien.
Rapatrié chez Aaron Blaustein, un vieil ami juif de son oncle installé aux États-Unis depuis quarante ans, Adam se remet de ses émotions nocturnes. Le commerçant Blaustein s’est enrichi considérablement, il a profité des opportunités inhérentes au Nouveau Monde, mais, en contrepartie de ce libéralisme poussé à l’extrême, comme si le paroxysme des échanges avait occultement conduit à la crispation légale concernant l’esclavage et in fine à la guerre civile, il a perdu son fils Stephen lors de la terrible bataille de Chancellorsville, au printemps 1863, tué par les troupes du redoutable Stonewall Jackson (cf. p. 71). Et comme Adam le découvrira plus tard, au hasard d’une nécrologie rapportant la mort du négociant juif (cf. pp. 174-5), cette perte atroce, en sus d’avoir jeté le vieux Blaustein dans une affliction qu’aucune fortune ne pouvait guérir, a également provoqué la suicide de sa femme, la mort volontaire de cette mère insupportablement anéantie par le brutal décès de son enfant. Au fond, ce moment passé avec Blaustein ressemble à la confession d’un mourant, aux paroles d’un homme qui se confie à demi-mot sur le plus grand échec de sa vie, c’est-à-dire sur le fait d’avoir réussi dans un pays dont chaque progrès individuel, chaque succès retentissant, était en train de mener selon toute probabilité à la catastrophe nationale de la guerre civile, sans que cela n’induise ne serait-ce qu’un vague instant le scepticisme des entrepreneurs, des bâtisseurs d’empires, voire des arrivistes aux dents très longues. Que le commerce et son esprit retors de concurrence puisse amener la guerre intestine par-delà ses propensions à favoriser une paix superficielle, c’est là ce que John Dos Passos s’acharnera à écrire dans son œuvre majeure, et c’est là, malheureusement, ce que le cacochyme Aaron Blaustein a l’air de vouloir dire au neveu de son vieux copain demeuré en Europe, cet ami demeuré fidèle à la Loi de la religion, exempt de toute espèce d’appât du gain et de toute gloire temporelle. De tout cela, en outre, Aaron Blaustein a tiré une réflexion semi-consolante sur l’Histoire et son invincible pouvoir de prédestination des êtres et de modelage des nations : «C’est l’ensemble des épreuves que les gens sont obligés de traverser afin que les choses tournent comme elles auraient tourné de toute manière» (p. 72).
Les idéaux progressivement reformulés et fatalement congédiés : ce que la guerre dit des hommes
Au lieu d’être immédiatement soldat, faute d’être pourvu d’un pied conforme aux attentes du service minimum, Adam Rosenzweig, recommandé par le potentat Blaustein, se contente d’incarner le boutiquier ambulant, le ravitailleur de régiments sous les ordres de l’irascible Jedeen Hawksworth, assisté de Mose Talbutt, le Noir qui l’a repêché de la cave et dont le décousu récit des mésaventures suscite la pitié qui lui avait tantôt manqué devant le corps du pendu. Sans souci des présentations interminables ou des précautions oratoires, Mose Talbutt, en dépit des humeurs ambiguës du patron Hawksworth, affirme haut et fort à Adam que «le plus riche de tous les nègres, c’est celui qui arrive à s’enfuir de chez son propriétaire et à se planquer» (p. 80). Cette affirmation bouscule Adam et tend à aiguiser le dessein de sa lutte pour la liberté. Il semble ainsi que se battre pour la liberté doive nécessairement être synonyme de se battre pour la libération des Noirs. La résolution du problème noir, si tant est qu’il faille le nommer de la sorte, devrait précipiter la cessation des hostilités et le retour d’une paix sereine. Ce que voudrait Adam, à défaut d’être un agent de terrain qui s’oppose hardiment aux rebelles, c’est être à tout le moins un agent de la réforme des mentalités, un engagé pour l’égalité des peuples. D’ailleurs on peut se demander à juste titre si la judaïté d’Adam, corrélée à toutes les anthologies de la persécution, ne procède pas d’un renforcement inconscient de son engagement pour les Noirs, pour cette «race [de] supplicié[s]» (p. 82). Quoi qu’il puisse en coûter de risques et d’impopularité, Adam ne peut continuer son périple américain en ne faisant rien pour changer l’insécurité permanente des Noirs, de même qu’il ne pourra dormir tranquille tant que l’avenir des Noirs, ici, rimera avec un futur de mort assurée.
Ce changement de perspective se fortifie d’autant plus qu’Adam est le témoin dépité de l’instabilité intellectuelle qui empoigne Hawksworth, un abolitionniste divisé, hanté par un passé traumatisant, détestant les confédérés mais oscillant entre un instinct de justice et une sémantique ségrégationniste de saison. Cette antinomie résume assez fidèlement la discorde qui ébranle à la fois les individus et la nation tout entière, comme si la somme des divisions particulières établissait les preuves de l’inexistence d’une patrie unie, les membres de l’Union étant eux-mêmes astreints à de mystérieuses ambivalences (cf. p. 189). Mais cela n’empêche pas Adam de persévérer dans ses récents projets d’irénisme, dans son devoir de réconciliation des victimes et des bourreaux, surtout lorsqu’il aborde pour la première fois les espaces naturels, la wilderness qui constitue l’intitulé original du roman (3), pénétrant au cœur de la nature solaire et verdoyante de Pennsylvanie (cf. pp. 86-8), au cœur de ces bois et forêts majestueux qui offrent l’impression d’un deus pictor, comme si l’on se glissait dans un divin tableau d’Albert Bierstadt ou d’Asher Brown Durand, parmi les végétations imperturbables d’Amérique et les panoramas d’ataraxie. Ce sont donc les sereines forêts de Pennsylvanie qui initient Adam à une perception davantage approfondie de ce pays dévasté, une perception presque chamanique et sédative en cet instant, méconnaissant pour l’heure l’incompressible réalité de ce qui s’est produit non loin de là, à Gettysburg, au début de l’été 1863, et méconnaissant également les réels antagonismes qui se déroulent au Sud. C’est pourquoi ces prolégomènes de paysages sylvestres trompent passagèrement les représentations d’Adam, et ce n’est qu’en se rapprochant subrepticement de la Virginie, en s’acheminant vers cet exorde sudiste où la guerre fait rage, que l’iconographie mentale du Bavarois trentenaire s’affermit, s’obscurcit, augurant les bois menaçants du Old Dominion State (cf. pp. 101-2), à l’endroit où Meade voudrait pulvériser les rebelles, dans l’œil du cyclone, dans cette grande forêt de flamme et de vacarme où Adam suppose opiniâtrement qu’il rencontrera la vérité – sa vérité (cf. pp. 221 et 229). Et ainsi, peu à peu, au fur et à mesure qu’Adam poursuit son odyssée commerçante, la forêt de Virginie se dresse en lui et au-devant de lui comme un monstre, comme une gorgone qu’il faudra vaincre, et ses visions forestières tantôt paradisiaques se muent en évocations infernales, solidaires de cette «selva oscura» qui amorce L’Enfer de Dante (4), satanique forêt «où le général Lee [est] tapi comme une bête sauvage, blessée peut-être mais remplie de férocité, de froide exaltation et de ruse patiente, attendant dans la nuit de la Virginie, comme au fond d’une grotte» (p. 124).
Ici encore, comme c’est le cas pour tant de grands livres qui dialoguent entre eux, et parce qu’il est impensable de ne pas songer à ce type de parallèle, Adam s’oriente vers la Virginie comme Joseph Conrad oriente le lecteur vers l’ineffable Kurtz dans Heart of Darkness. Le précipice européen de la colonisation, tel qu’il est symbolisé par l’insoutenable cynisme de Kurtz, se redistribue chez Penn Warren comme un genre de préfiguration littéraire diabolique de ce que dénonce Conrad pour la fin du XIXe siècle, l’oppression des congoïdes, durant la guerre civile américaine, n’étant que le vicieux reflet anticipé du Congo asservi par Kurtz. Dès lors, pour Adam, nul retour en arrière n’est concevable, et à partir de là, à partir de cet aperçu psychique des tombeaux arborescents de Virginie, ses différents idéaux se fragilisent. L’interlude au charnier de Gettysburg (cf. pp. 126-142), passage obligé pour Jedeen Hawksworth et pressant devoir de mémoire pour tout un chacun, fait voir à Adam l’amalgame des cadavres des deux camps, l’unio mystica de ces morts que la vie avait désunis, les contraignant à d’infâmes divorces. Il entend aussi parler de la bravoure des sudistes, de ce respect silencieux que l’on doit à ces hommes qui ont avancé sous la mitraille envers et contre toute lâcheté (cf. p. 139), quand bien même les drapeaux de la rébellion ne seront à jamais que les «étendards rouges de la trahison, des combats et de la rapine», brandis par des sous-fifres hallucinés, certes, mais brandis aussi par des hommes de la trempe de James Johnston Pettigrew (p. 131). Tout cela, sans aucun doute, accélère la maturité philosophique d’Adam et le prépare à comprendre quelque chose de décisif sur la nature de l’humanité, quelque chose qui ne lui sera dévoilé qu’à la toute dernière page de cette aventure, par le truchement d’une renversante simplicité.
Enfin parvenu en Virginie après plusieurs étapes significatives, Adam s’intègre à la vie des quartiers généraux, déambule dans l’enfilade infinie des baraquements, assumant ses charges de colporteur et se prenant pour la sentinelle de tous ces braves soldats (cf. pp. 149-152). Il a par conséquent le sentiment d’apporter sa pierre à l’édifice de la libération, de même qu’il maintient son office d’émancipateur des Noirs en familiarisant Mose Talbutt à la lecture (cf. p. 164). Aussi, en ce printemps spécifique de 1864, Adam Rosenzweig éprouve un regain d’espérance, agréablement surpris d’entendre des chants de Prière et de Justice en provenance de la soldatesque aux abois (cf. p. 182). Mais ce répit apparent est de courte durée car des combattants bavards se réfèrent ostensiblement au topos des rebelles, à cette fameuse «grande forêt» analogue à tous les dangers de mort (cf. p. 184), là où l’inquiétant Robert Edward Lee s’est malicieusement fixé. La proximité de l’ennemi est désormais si évidente qu’il n’est plus possible pour Adam de se protéger dans un quotidien de sérénité ou de fluctuations émotionnelles manœuvrables. Son monde et ses repères basculent du côté de la guerre et tous les centimètres qu’il est à présent susceptible d’accumuler en direction du Sud, ce seront autant de tensions supplémentaires et croissantes qui viendront l’étreindre de telle ou telle façon, autant de Charybde et Scylla qu’il faudra dompter. Or, conformément à ce souffle méphitique fructifiant, en accord avec cette recrudescence des ténèbres, les points d’appui existentiels s’effondrent comme si la guerre, à proportion de la promiscuité qu’on entretient avec elle, devait forcément corrompre tout ce qu’elle fertilise négativement de son engrais noir. C’est donc là, parmi les tourbillons de la vie militaire, qu’Adam Rosenzweig apprend que Mose Talbutt se nomme en vérité Mose Crawfurd, que c’est un fieffé déserteur, qu’il a une lettre D tatouée au fer rouge sur le haut de la cuisse, écho avilissant de la lettre écarlate racontée par Hawthorne, et, ce faisant, ce fuyard ne l’a peut-être pas soustrait de la cave inondée pour des raisons si pures que cela (cf. pp. 191-205). La duplicité de Mose Crawfurd, en outre, traduit l’infatigable roublardise dont il faut se doter si l’on veut survivre – en tant que Noir – à la guerre que ce pays fait inlassablement aux Noirs. Cette révélation, aussi effarante soit-elle pour Adam, lui montre d’autres silhouettes innommables du contexte de ces années sécessionnistes. Elle déblaie par ailleurs le terrain d’un assassinat crapuleux et donne toute latitude aux interprétations les plus pessimistes (cf. pp. 206-210) : le corps sans vie et mutilé de Jedeen Hawksworth, allégé de son argent économisé puis associé à la subite disparition de Mose Crawfurd, ouvre la porte à l’hypothèse d’un crime vindicatif et opportuniste, transgressant toutes les vertus qu’on avait pu volontiers prêter à l’homme de couleur qui sut approvisionner la sympathie d’Adam. Faut-il pour autant s’arrêter à ce niveau élémentaire de pensée ? Nous préférons distinguer ici la loi viscérale plutôt que la loi rationnelle : quand on est à ce point acculé à un état de survivance, que ce soit au front de la guerre ou au front d’une société qui nous hait mortellement, il n’y a parfois pas d’autre solution que celle du larcin ou de l’homicide, de l’astuce ou de la fourberie. En des temps aussi troublés, tous les coups sont permis – no holds barred.
Ceci étant assimilé, Adam, vaille que vaille, se greffe au déplacement des troupes et tente de se parer de courage, envieux de ces jeunes hommes animés de toutes les ardeurs d’une guerre qu’ils estiment juste (cf. pp. 210-2). Et quoique son itinéraire, modestement et graduellement, se joint davantage à ceux qui reviennent de la guerre plutôt qu’à ceux qui y retournent, Adam, par le jeu du détour ou de l’intermezzo pendant lequel se réaffirment ses intentions, continue tout de même de progresser vers ce qu’il est, vers son Apocalypse personnelle (cf. p. 241), vers la «grande forêt» où certes «[l’on] se perd facilement» (p. 249), mais où l’on se trouve aussi superlativement. Puis le voilà brusquement arrivé, sans plus aucune transition, là, au milieu de ce «vert lyrique» des feuilles dont l’amassement suspendu aux branches tortues «[suffit] à intercepter le puissant flot de lumière qui se [déverse] au-dessus des arbres» (p. 255). La joie le submerge comme s’il était touché par la grâce. Plus que jamais, il ressent l’imminence de cette vérité qu’il est venu chercher outre-Atlantique (cf. p. 256), fût-ce dans les conditions périlleuses de la guerre. Mais le combat forcené du champ de bataille est aussi le signe du combat loyal que l’on doit mener avec soi-même, et, selon toute vraisemblance, plus dur est le défi que l’on vise, meilleure sera la découverte que l’on fera sur les gisements intimes qui sont les nôtres. Il faut être prêt à lever le voile sur la vérité qui nous possède et à mourir séance tenante (cf. p. 261), de même qu’il «faut parvenir à savoir s’il existe une vérité en ce monde» (p. 260), une vérité quasi définitive de l’homme. Cette vérité, du reste, elle s’invite en même temps que huit «fous», huit «épouvantails» qui font irruption dans la quiétude vécue par Adam (cf. pp. 263-4), sorte de multiplication par deux des Cavaliers de l’Apocalypse. Il s’agit d’octuplés rebelles, mais ces excités pourraient très bien être aussi des déserteurs, des profiteurs de la guerre, des marginaux affamés. Ils dévalisent le chariot de nourriture d’Adam et l’un d’entre eux, ensuite, le déchausse de ses bottines et lui assène des coups nerveux en avisant l’obscénité de son pied déformé (cf. pp. 266-7). Cette scène de dépouillement renvoie Adam aux dispositions abyssales de son prénom : mis à nu par les rebelles, il se retrouve adamite, dévêtu de ses anciennes certitudes et en quelque sorte rhabillé par la réalité brute qu’il avait jusqu’à présent esquivée. Il ne sera épargné que par l’impromptu jaillissement des soldats de l’Union (cf. pp. 268-9), chassant ou neutralisant ces aliénés loqueteux, ce qui fait monter en Adam, telle une montée de bile, «un violent écœurement moral» (p. 269). Pire encore, afin de sauver une vie, Adam se voit impulsivement devenir l’assassin d’un homme (cf. p. 270), confronté à la même épreuve que celle que doit endurer Andreï Roublev dans le film éponyme de Tarkovski.
Tuer un homme, en l’occurrence, est-ce là ce dont il fallait s’acquitter pour devenir soi-même un homme et affecter les manières du courage qui sanctifient la virilité suprême ? Est-ce là un aboutissement positif du fait même que ce meurtre de guerre a permis à la vie du Juste de se prolonger ? À vrai dire, rien, absolument rien ne peut garantir à Adam que le soldat qu’il a sauvé d’une mort certaine est un homme plus juste que ne l’était son assaillant. D’où, consécutivement à son geste homicide, la pensée de «l’effroyable justice qui [règne] en ce monde» (p. 272), cette injustice omniprésente et caractérisée par l’omnipotence d’un matérialisme historique propre à la guerre, cette impossibilité, au fond, de s’extraire d’une morale de l’ambiguïté dûment étudiée par Simone de Beauvoir (5), à savoir que dès qu’il s’agit d’accomplir un acte de libération, quel que puisse être cet acte, il sera mécaniquement suivi d’un coefficient d’assujettissement. Là où les hommes se libèrent ou en libèrent d’autres, inéluctablement, ils en condamnent d’autres parce que la liberté se réalise toujours à ce prix et n’admet aucune homogénéité universelle, nous obligeant à restituer à certains leur dignité de sujet humain tout en utilisant une fraction de l’humanité comme moyen pour ce faire. Et il se peut que les choses soient même plus simples, plus tragiquement simples et triviales, en cela qu’Adam, une fois le choc un peu retombé, se dit qu’il a finalement tué un homme moins parce qu’il fallait en faire vivre un autre, mais parce que le pied de sa victime, contrairement au sien, était un pied tout à fait normal, un pied bon pour le service – fit for work (cf. pp. 274-5). Cet aveu est-il donc moins coupable que les agissements des huit rebelles détraqués ? Adam Rosenzweig a-t-il plus de valeur que ces guerriers sudistes que l’opinion du Nord fustige ? Ainsi la vérité achève de s’esquisser et se formule avec la force d’une évidence : tous ces hommes, eux aussi bien qu’Adam, n’étaient que des hommes et en ce sens «étaient faillibles» (p. 280). Aucun homme ne saurait se prétendre meilleur ou plus imperméable au Mal qu’un autre lorsque l’Histoire exerce une telle puissance de torsion des âmes. Que ce soit Leopold Rosenzweig, Mose Talbutt redevenu Mose Crawfurd, Jedeen Hawksworth ou ces huit soldats dissidents fébriles, tous autant qu’ils sont, Adam Rosenzweig y compris, tous ont été tordus par l’Histoire, broyés par d’invincibles élans qui doivent nous encourager à révoquer instamment nos jugements, à nous purifier de nos aveuglements, comme le feu, à la fin, s’apprête à purifier cette «grande forêt» qui fait davantage figure d’allégorie que de marqueur géographique précis (cf. pp. 277-280).
Notes
(1) Robert Penn Warren, La Grande forêt (Éditions Points, coll. Signatures, 2017). Traduction de Jean-Gérard Chauffeteau et Gilbert Vivier.
(2) Retraduit avec le titre L’Insigne rouge du courage par Pierre Bondil et Johanne Le Ray (Éditions Gallmeister, 2019).
(3) Wilderness : A Tale of the Civil War.
(4) Dante, L’Enfer (chant I).
(5) Simone de Beauvoir, Pour une morale de l’ambiguïté.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, l'amérique en guerre, la grande forêt, robert penn warren, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer