La Terre chinoise de Pearl Buck, par Gregory Mion (26/04/2021)

Crédits photographiques : Charlie Riedel (AP).
Saint Augustin, Les Confessions.
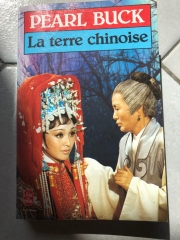 Connue pour avoir passé une partie de son enfance en Chine et pour avoir appris l’anglais en deuxième langue après le mandarin, il n’est guère étonnant que Pearl Buck ait fait revivre dans bon nombre de ses romans l’Empire du Milieu. Sa toute première œuvre, Vent d’est, vent d’ouest, s’appuie sur cette mémoire de la Chine et elle est assez vite suivie par La Terre chinoise (1) qui légitime définitivement son auteur au début des années 1930. En France, la traduction de La Terre chinoise est assurée en 1932 par le talentueux Théo Varlet qui obtiendra pour cette belle entreprise une distinction de l’Académie Française. Récompensé en outre par le prix Pulitzer, ce livre sera complété par deux autres titres qui établiront une trilogie (2). Puis en 1938, après une intense décennie créatrice, Pearl Buck reçoit le Prix Nobel de Littérature, la propulsant tout à la fois dans une vie de créativité et de philanthropie ininterrompues. De nos jours, hélas, Pearl Buck ne semble être au mieux qu’un nom vaguement significatif, un mythe lointain égaré au fond des encyclopédies, et tandis que la littérature s’abîme dans la promotion accélérée d’une fausse monnaie qui insulte l’ordre juste au quotidien, il nous paraissait important de consacrer du temps à une femme qui en consacra beaucoup pour les autres.
Connue pour avoir passé une partie de son enfance en Chine et pour avoir appris l’anglais en deuxième langue après le mandarin, il n’est guère étonnant que Pearl Buck ait fait revivre dans bon nombre de ses romans l’Empire du Milieu. Sa toute première œuvre, Vent d’est, vent d’ouest, s’appuie sur cette mémoire de la Chine et elle est assez vite suivie par La Terre chinoise (1) qui légitime définitivement son auteur au début des années 1930. En France, la traduction de La Terre chinoise est assurée en 1932 par le talentueux Théo Varlet qui obtiendra pour cette belle entreprise une distinction de l’Académie Française. Récompensé en outre par le prix Pulitzer, ce livre sera complété par deux autres titres qui établiront une trilogie (2). Puis en 1938, après une intense décennie créatrice, Pearl Buck reçoit le Prix Nobel de Littérature, la propulsant tout à la fois dans une vie de créativité et de philanthropie ininterrompues. De nos jours, hélas, Pearl Buck ne semble être au mieux qu’un nom vaguement significatif, un mythe lointain égaré au fond des encyclopédies, et tandis que la littérature s’abîme dans la promotion accélérée d’une fausse monnaie qui insulte l’ordre juste au quotidien, il nous paraissait important de consacrer du temps à une femme qui en consacra beaucoup pour les autres. Pour le dire en deux mots et pour commencer à déblayer le terrain des idées, La Terre chinoise relate l’ascension matérielle d’un paysan et sa chute spirituelle concomitante, approximativement rachetée par un amour de plus en plus contrarié pour le travail des champs. Il ne fait du reste aucun doute que même dans la Chine du XIXe siècle toute réussite dans l’argent constitue la cause d’une nécessaire défaite dans le sacré. Ce que gagnera donc l’agriculteur Wang Lung en économies florissantes, il le paiera en dilapidation de la sagesse et en tristes répercussions sur sa famille. Plus l’arbre généalogique de Wang Lung s’agrandira, plus les branches de ses petits-enfants pousseront loin des racines de leurs dévoués aïeux, moins l’amour de la terre sera présent et moins les valeurs fondatrices d’une fraternité agreste auront de l’influence sur le chapelet des héritiers corrompus. Ce que le père aura conquis tout en préservant un fragile attachement pour la morale de ses ancêtres, les enfants, peu à peu, l’affranchiront et le fixeront aux jupitériennes ambitions des propriétaires terriens qui ne se rendent même plus sur leurs domaines agricoles, trop pressés de compter, de dépenser et de vénérer l’argent qui fait oublier d’où l’on vient et peut-être aussi où l’on va. Que de distance mesure-t-on alors entre le Wang Lung de l’aube et le Wang Lung du crépuscule, entre le pauvre jeune homme qui s’apprête à se marier (cf. p. 11) et le vieil homme riche qui va mourir en subissant un ultime désaveu de sa progéniture (cf. p. 491) ! D’une extrémité à l’autre de cette longue vie, on repère la digne constance du travailleur parfois vaincu par l’oisiveté ou les mauvaises tentations, désorienté par les possibilités de l’abondance financière, mais également la lente et indéniable décomposition mentale qui s’empare d’une descendance méprisant totalement la magie de la terre et le cycle éternel de ses fécondations.
Probablement qu’il faudrait parler d’un échec éducatif malgré la fierté de Wang Lung d’avoir envoyé certains de ses garçons à l’école. En effet, ce que l’école aura enseigné à ses fils, c’est, ni plus ni moins, la quantité primordiale de savoir pour que les possédants continuent d’exploiter les dépossédés. Insidieusement et fatalement, l’école, quelle qu’elle soit, à quelque époque et à quelque contrée qu’elle appartienne, contribue très souvent à maintenir les inégalités et à sélectionner socialement les individus qui auront pour mandat de perpétuer l’oppression générale des plus faibles, usant de ce bon droit qui est en réalité l’abus d’une force institutionnelle. C’est d’ailleurs en devenant plus riche que Wang Lung a pu scolariser la chair de sa chair, comme si l’argent l’avait incité à faire entrer ses enfants au sein d’un programme qui apprend non pas la beauté du savoir mais le savoir qui fera fructifier l’argent déjà épargné, déjà investi à tel ou tel niveau de la dévorante machine capitalistique. En accomplissant cela, de toute évidence, Wang Lung ne s’est pas rendu compte qu’il faisait pénétrer ses rejetons dans un engrenage vicieux où les vertus d’antan sont aussitôt disqualifiées par la regrettable association du savoir et du pouvoir.
Au départ, pourtant, presque rien ne laissait présager que la pénurie existentielle de Wang Lung se métamorphoserait en plénitude négative. Fils de paysans et disciple avoué de la terre, Wang Lung a toujours éprouvé un sentiment d’infériorité à l’égard des gens de la ville, redoublé de surcroît par une présence axiomatique de l’injustice sociale. Son horizon matrimonial en est directement affecté : la femme qui lui est promise est une esclave qu’il n’a jamais vue et qui sera simplement chargée de prendre la suite de sa mère décédée six ans plus tôt (cf. p. 11), avant que les enfants qui sortiront du ventre de cette aliénée, à leur tour, ne prennent le relais des corvées de la vie rurale (cf. p. 12). Ce dont Wang Lung a besoin, ce n’est pas d’une femme qui lui procurerait le moindre plaisir, mais d’une femme prête à travailler et à engendrer, d’un corps réduit aux pures fonctions mécaniques et reproductrices. On lui a du reste maintes fois répété que les activités de plaisir sont réservées aux riches de ce monde et que les autres, tous les autres sans exception, doivent connaître l’incessante rengaine du déplaisir. Par conséquent, d’un côté se trouvent les paresseux nantis, aussi gros que des dieux, puis, de l’autre, se chiffre la masse des ouvriers agricoles, surveillés par des proto-capitalistes qui précipitent l’avènement du travail salarié, c’est-à-dire le travail de toute une vie qui va se substituer perfidement au travail occasionnel (3). Menacé par l’œil croissant du Capital en une région que l’on imagine étrangère à ces pratiques, Wang Lung, peu à peu, extériorisera ce qu’il a longtemps intériorisé, acquérant par la force du poignet – mais aussi à la faveur de la chance – les douteux moyens d’asservir son prochain après avoir vécu l’asservissement d’une condition défavorable. De là émerge l’ambiguïté de sa filiation à la terre : s’agit-il pour lui d’un amour qui sauve ou d’un amour qui condamne ? Les deux facettes alternent quand l’argent s’affirme et tantôt Wang Lung se réhabilite par la terre, redevant une âme juste après avoir commis l’injustice ou après avoir eu des pensées avilissantes, tantôt il se perd en augmentant la surface de ses propriétés, imitant par vengeance ou par médiocrité l’attitude des grands persécuteurs d’une aristocratie chaque fois décadente, indigne du panthéon des vieilles divinités chinoises. À bien des égards, sitôt que l’argent monte à la tête de Wang Lung, la piété l’abandonne, et sitôt que l’argent reflue, il revient à la débonnaire modestie de celui qui entretient de petites statuettes censées favoriser les récoltes. Et malheureusement, l’alternance de ces conduites se désaxe le plus souvent au profit de l’argent, jusqu’au sursaut final qui marque la révolte du bon sens contre le péché de cupidité, l’insurrection d’un mourant contre le désastre moral qu’il a transmis à ses enfants.
Dans la conformité de ces choses, celle qui est choisie pour devenir la femme de Wang Lung se voit négociée pour «deux anneaux d’argent plaqués d’or» et «des boucles d’oreille» de la même matière (p. 19). Elle a jusqu’ici été au service de la maison Hwang, une sorte de vaste palace détenu par une famille prospère en revenus mais dégénérée en comportement. C’est en outre la «Vénérable Maîtresse» de la maison qui introduit cette esclave avec une condescendance inouïe, la remettant à son acheteur comme on échangerait un objet quelconque. La pauvre captive se prénomme O-len et répond à la physionomie d’une «femme de carrure hommasse, plutôt grande, proprement vêtue» (p. 30), disposée à corréler sa vigoureuse laideur aux labeurs les plus pénibles. Elle confirme également le préjugé qui veut qu’une femme laide ne puisse épouser qu’un homme dépourvu. Cependant, à rebours de cette phénoménalisation du discrédit social, l’on aperçoit dans le regard de cette misérable de vingt ans une «confuse tristesse» sédimentée par de «petits yeux d’un noir terne» (p. 33). L’inexpressivité du visage (cf. p. 33) est d’une certaine manière dédommagée par l’expressivité approfondie de ces yeux, par ce regard où gît le dépôt discret d’une existence humiliée, dédaignée, abusée par l’arrogance d’une caste immodérément consternante. Les yeux d’O-len suffisent donc à traduire la timide manifestation d’une grâce maximale qui vient contrebalancer les signes ostentatoires d’une disgrâce proverbiale. Elle est tout entière la subtile contradiction de ses anciens maîtres et elle incarnera pour Wang Lung le mât d’un insubmersible bateau de sérénité, prolixe par ses silences, influente par sa retenue et divine par sa capacité à supporter l’insupportable. Il ne serait pas exagéré d’évoquer une figure biblique, une aura de sainteté, ce qui se justifie admirablement par la fertilité d’O-len qui donne à Wang Lung les enfants qu’il espérait, un quintette de gamins et de gamines s’amorçant par deux garçons (cf. pp. 56-8 et 82), se prolongeant par une simple d’esprit (cf. p. 93), puis s’achevant par des jumeaux dizygotes (cf. p. 222). Dans l’ordre sacré de la vitalité, O-len se ressaisit de ce dont on l’a dessaisie dans l’ordre profane de l’existence culturellement hiérarchisée. À défaut d’avoir eu les formes physiques et les capitaux métaphysiques qui promettent des triomphes sur toute la multitude difforme et prolétaire, O-len profite d’une féminité puissamment adaptative, aussi précieuse dans les champs de son mari qu’elle le fut dans les appartements de ses croulants seigneurs. Ses actes sont en ce sens titulaires d’un minimum de causalité qui aboutit à un maximum d’efficacité, à tel point qu’on lui accorderait volontiers un don d’ubiquité en raison de son aptitude à être au four et au moulin sans révéler la moindre espèce de frénésie. Cela se vérifie par exemple eu égard à sa propension à être durant la même journée la mère qui accouche en solitaire et la femme qui participe ardemment aux moissons comme si de rien n’était.
De la ville à la campagne, O-len n’a pas perdu un muscle de sa vertu, «servante fidèle et muette» (p. 46), ayant l’air sans passé, parfaitement intemporelle, semblable à un fragment d’éternité par le biais duquel passent et repassent les vivantes fondations du monde. Elle est soudée à la rotation des astres, aussi fervente que le soleil et que la lune, altière dans sa façon de se détacher des contingences de la culture pour mieux se rattacher aux nécessités de la nature. Toutefois l’orgueil de sa force olympienne la rattrape à la naissance du premier enfant, lorsqu’elle désire que le nouveau-né soit bien accoutré, bien mis, afin qu’elle aille par la suite le montrer à la maison Hwang où elle a connu tant d’affronts (cf. pp. 51-2). Sa patience féconde se mue ici en impatience inutile, en revanche provisoire, ce qui la renvoie passagèrement à son statut de «prosaïque et vulgaire créature» (p. 235), lestée de ces bas instincts justiciers qui divaguent sur la possibilité de changer la monture psychique des bourgeois. L’important n’est pas de paraître à égalité de considération avec le bourgeois, lequel sera toujours obscène et indigne de vivre, mais de s’élever à la considération du royaume des dieux. Mais rarement O-len sera sous l’emprise d’une envie de représailles, et, à l’inverse de Wang Lung, elle ne quittera presque jamais la transcendante nation des âmes saintes qui oublient l’immanente démangeaison des âmes tracassées par l’affairement des imbéciles. C’est précisément cela que Wang Lung n’aura pas su voir avec assiduité : le charisme de sa femme, le bonheur d’être accompagné par un modèle de sobriété qui lui a décelé «la joie de vivre» (p. 41) et «la volupté de la paresse» domestique (p. 42), tout en le revigorant pour le dur travail de la terre. Il eût dû se souvenir que son épouse était l’incarnation de l’abondance qui pourvoit à toutes les indigences, que les pharaoniques seins d’O-len, gorgés de lait nutritif, étaient le symbole du ruissellement le plus étincelant (cf. p. 61).
Alors, de jour en jour, l’impression du visible le moins honnête gagne du terrain dans la conscience de Wang Lung, au détriment d’une perception de l’invisible où O-len joue un rôle crucial. Ce qui vient toucher la rétine de Wang Lung et se fondre irréversiblement dans son cerveau vindicatif, c’est l’augmentation de son rendement et par conséquent l’accroissement de sa richesse sonnante et trébuchante. Il n’évalue la présence de sa femme qu’à l’instar d’une occasion strictement pécuniaire et puisque les résultats de ses récoltes sont superbes, son sentiment d’infériorité se dissipe, son assurance amplifie, basculant dangereusement du côté d’un élan de supériorité impie (cf. p. 67). Déclamant que «la terre est la chair et le sang de chacun» (p. 76), son discours se gonfle d’une emphase intempestive et porte Wang Lung à des appétits démesurés. Dès qu’il engrange les dividendes de ses récents afflux de moissons, il achète une parcelle de la terre des Hwang, se disant que cette transaction le hisse au niveau des patrons et qu’il récupère en quelque sorte la part des pauvres, réparant par ailleurs les torts de jadis envers O-len (cf. p. 76). Mais toute la question est de savoir si Wang Lung est demeuré pauvre de cœur en étant devenu riche de raison instrumentale. Un cœur simple et flaubertien ne l’aurait pas transporté vers la maison des Hwang pour leur payer le prix mécréant d’une fraction de terre. Ce n’est là qu’une banale circulation des biens qui va d’une famille de parvenus à une famille sur le point de parvenir. Or l’authentique pauvre de cœur ne peut accepter les spéculations de ce genre, et si Wang Lung avait été celui qu’il fut quand il ne possédait que son hoyau et ses modestes semailles, s’il avait su apprécier les pieuses réserves d’O-len, il eût d’emblée compris toute l’obscénité de cette gloutonnerie, toute la catastrophique psychologie du propriétaire qui opprime les vénérables martyrs de la pauvreté. À la rigueur, il aurait fallu que Wang Lung achète pour aussitôt restituer, pour rendre aux pauvres de la ville et des champs ce que la loi des hommes leur a illégitimement volé. Au lieu de cela, Wang Lung, en allant au bout de ce commerce initial, met le doigt dans un irrémissible engrenage qui l’éloigne instantanément de toute gloire et le contraint à un asservissement de lui-même qui est pire que l’asservissement de l’ordinaire paysannerie. Avant cela, il était content de lui, fier de sa petite terre, après cela, il vivra l’enfer du désir invincible, l’insatisfaction chronique du tonneau des Danaïdes. Ce n’est que par intermittence, nous l’avons souligné, que Wang Lung recouvre ses esprits et s’avise qu’une axiologie fondée sur l’avoir ne peut décemment subsister en comparaison de ce qui relève de l’être.
Puis, comme un cheveu sur la soupe, un revers des dieux, ou du moins ce que Wang Lung aurait dû sérieusement interpréter comme tel, s’abat sur la région et plonge tout un peuple dans la famine (cf. pp. 96-107). Notre homme, on le devine, s’afflige de cette conjoncture calamiteuse et se laisse aller à la facilité du blasphème (cf. pp. 108-9). Il refuse de concevoir une punition décrétée par un Ciel justement courroucé, préférant maudire des dieux inutiles qui n’apportent que l’infortune à leurs créatures et surtout à lui. Tant que ses affaires florissaient, Wang Lung voulait bien se plier à l’usage du culte, mais à partir du moment où les choses n’ont plus tourné rond, il a subitement diffamé les traditions religieuses. Ce reniement constitue la preuve de son embourgeoisement, l’indice de son assimilation de la trivialité, à moins qu’il ne vérifie que ses croyances n’étaient que des contraintes camouflées en obligations, des pantomimes d’honnêteté inhérentes à celui qui n’a pas l’occasion d’être malhonnête et impuni. Quoi qu’il en soit, Wang Lung constate l’inexorable tarissement de son garde-manger, et, bientôt, l'extrémité du contexte le pousse à sacrifier son buffle pour ne pas mourir de faim. En périphérie, les rumeurs ne sont pas meilleures que la réalité qui le frappe : on cite l’ensauvagement des citadins qui en seraient réduits à manger les chiens errants, et, par complément, on discute des gens de la campagne qui n’auraient plus que de l’herbe et de l’écorce à sucer pour soulager leurs ventres vides (cf. p. 111). Des cas d’anthropophagie, aussi, en viennent logiquement à être mis sur la table des supputations (cf. p. 112). Au milieu de ce marasme, O-len ne tremble pas, endurant l’accouchement d’un nourrisson mort-né, d’une «pincée d’os et de peau» (p. 116), peut-être envoyée dans l’univers des anges par une mère qui savait qu’un enfant ne survivrait pas aux conditions d’une terrible famine (cf. p. 117). Et c’est encore O-len, courageuse et persuasive, qui renvoie les affamés à leurs pénates, sensiblement touchée et touchante, comprenant que ces gens ne sont «pas méchants, excepté quand ils ont faim» (p. 106). En tout cela, O-len supplée aux débandades de Wang Lung, prenant la place d’un chef de famille dont la déraison impénitente et le «complet désespoir» (p. 117) ne sont plus du tout en mesure de tenir les rênes de leur exploitation agricole. C’est elle aussi, enfin, qui négocie le machiavélique opportunisme de l’oncle de Wang Lung, lequel n’est apparu que pour vampiriser les dernières gouttes de sang de son neveu aux abois (cf. pp. 123-4).
Fuyant le râle de la Chine famélique, Wang Lung et les siens se dirigent vers le midi urbain, expérimentant la déférente mendicité des indigents. En marge de cette Sodome méridionale qui pourrait être une Memphis faulknérienne déplacée dans l’Empire du Dragon, hantée par ses roulures et ses tauliers fanatiques, Wang Lung tracte un pousse-pousse pendant que sa femme et ses enfants tendent une main fébrile à la charité des piétons. Les voilà tombés dans une misère qui contraste avec les ascensions d’hier, astreints au ramassage des miettes, à l’inflation et à l’indifférence, assujettis «aux lisières de la grande cité voluptueuse et opulente» (p. 152), tels des sorcières et des sorciers assignés à la légendaire bordure des forêts. Le spectacle permanent de la somptuosité mal acquise les encourage à tout mettre en œuvre pour rallier au plus vite leurs terres abandonnées. Tous autant qu’ils sont, ils expriment la criante allégorie de l’inégalité parmi les hommes, le résultat d’une monstrueuse tromperie de la civilisation qui semble se limiter à entretenir l’absence délibérée d’une correcte répartition des richesses. D’où l’éclair de lucidité de Wang Lung, se disant que les vraies richesses ne sont pas somptueuses mais frugales, gisant dans la terre et ce que l’on en fait, dans la félicité de pourvoir à la sustentation des faibles tout en s’accommodant des secrètes girations de la nature (cf. p. 172). S’ensuit une troublante découverte sociale : ce n’est pas tant les dieux qui s’acharnent subjectivement sur les hommes que ces derniers qui se détruisent eux-mêmes, les uns s’accaparant tous les biens tandis que les autres, les plus nombreux, sont accablés de tous ces monopoles infâmes (cf. p. 176). À tel ou tel interstice de son entendement bouleversé, Wang Lung augure les fantasmes de la valeur d’échange et les vérités désavouées de la valeur d’usage, l’absurdité d’un monde où la bourgeoisie a éventuellement remporté le guerre idéologique en faisant croire aux prolétaires qu’il est davantage respectable d’avoir un diamant dans la poche au désert plutôt qu’une gourde remplie d’eau (4). Cette confusion des valeurs entraîne ainsi des révolutions qui n’en sont pas : le pauvre ne désire plus vraiment renverser le riche pour modifier le paradigme de l’injustice, mais il désire prendre sa place afin d’avoir sa part du gâteau, si bien que le Capital se nourrit de toutes les strates de l’humanité et s’infuse dans toutes les consciences comme un opium indolore.
En outre, ce n’est pas une volonté de changer le monde qui pique Wang Lung au vif et le force à partir de cette maudite cité dépravée, mais un soudain déferlement de violence parmi lequel lui et sa femme tirent subrepticement leur épingle du jeu (cf. pp. 191-4). Le retour à la terre septentrionale est synonyme de renouveau : nouveau buffle, nouvelles semences et le cœur en fête (cf. pp. 195-7), avec, en prime, l’effroi du bonheur tant le renversement de la malchance est rapide (cf. p. 202). Mari et femme ont ramené du Sud des monnaies d’échange exceptionnelles et ne sont pas loin à ce titre de ressembler à de parfaits profiteurs de guerre. Toutefois les intentions d’O-len ne sont pas proportionnelles à celles de Wang Lung. Si O-len a saisi sa chance, elle l’a fait moins pour alimenter un narcissisme de propriétaire qu’en vue de créer un rayon de bien-être autour d’elle. D’autre part, O-len n’a jamais eu de position prééminente, elle a constamment été dans l’ombre de Wang Lung, en quoi il serait faux d’admettre que son rôle pourrait tout à coup évoluer. À l’inverse de son époux et de tant d’autres, O-len ne se berce pas d’illusions sur ce qu’elle est, en l’occurrence une femme tirée d’une maison d’esclavage à dessein de reformuler la substance de sa servitude. Parce qu’elle est femme et seulement femme, de surcroît femme de la Chine âprement pastorale, O-len n’a aucune espèce de miracle à attendre. Reste qu’elle n’est pas sainte par défaut mais par nature et son salut ne cesse de grandir au fur et à mesure qu’elle s’affermit dans sa résignation généreuse. Il n’y a pas d’élément susceptible de corrompre cette âme éligible au santo subito, et ce ne sont sûrement pas un âne, des cochons et toute une arche de Noé acquise par Wang Lung qui feront bouger un atome de cette auguste forteresse, ni des associés stipendiés dont l’accumulation des contrats donne à présent toutes les apparences d’une exploitation resplendissante. Un clair-obscur se consolide ainsi entre O-len et Wang Lung, et le lumineux mutisme de la femme met en exergue la ténébreuse fanfaronnade de l’homme, qui multiplie les déclarations et les cogitations fracassantes, soutenant que certains riches n’ont pas pu affronter les soubresauts de l’Histoire faute d’avoir préservé un lien affectif avec leurs terres (cf. p. 216). La chose est quasiment risible quand on sait que Wang Lung a déguerpi de ses terres dès l’instant où l’Histoire s’est corsée, de même qu’il y est revenu par l’entremise d’un coup de dés qui n’a aucun rapport avec un amour invétéré des champs.
Aussi, pour Wang Lung, la conjonction de l’argent et d’une paresse adventice réveille ses chairs concupiscibles et le mène au sein d’une maison de tolérance (cf. pp. 252-261). Depuis le début il n’a jamais été question d’utiliser O-len autrement qu’à l’instar d’un utérus prolifique et d’un vague objet de délivrance glandulaire. Désormais, la richesse venant et s’installant, il est impératif que Wang Lung ratifie la basse opinion qui veut qu’un nabab ait une femme préposée à la maison et une femme préposée à l’hédonisme. C’est pourquoi il s’éprend de Lotus, une fille de joie maigrelette, à l’opposé exact d’O-len. Elle ne tarde pas à envoûter ce croquant arriviste en l’allégeant de ses économies comme la neige fond au soleil. On ne saurait mieux illustrer que l’argent pulvérise la vertu, qu’il rend également hérétique (cf. p. 335), sans parler du fait que le désir accidentel écrase maintenant le besoin essentiel, la boulimie hallucinatoire l’emportant haut la main sur le pragmatisme de la terre.
Le destin est rude pour O-len lorsqu’elle voit que Wang Lung édifie Lotus au rang de seconde femme (cf. p. 275), au rang d’une cocotte divertissante, et l’on ne sait en contrepartie si les rédemptions de ce mari passionné auprès de sa «bonne terre» (p. 396) peuvent un tant soit peu compenser la totalité de ses trahisons. L’appel tellurique discontinu suffit-il à expier la relative mais insistante continuité de l’appel mandarinal ? Ses premières amours terrestres peuvent-elles le soigner de ses amours empruntées pour le bruit de l’argent et les gémissements simulés d’une putain d’Asie pseudo-archangélique ? Un mouvement émancipateur ou cathartique eût été réel si l’industrie de Wang Lung avait derechef connu la débâcle, mais cette fois rien n’y fera, et pas même l’inattendue résurgence de son oncle maléfique ne contribuera au vacillement de ses consécrations de négrier (cf. p. 346). En réplique à ce summum de dévergondage, O-len accentue sa tempérance et son opiniâtreté, bataillant dignement contre les douleurs d’une maladie (cf. pp. 349-351). Délaissée, elle ne laisse pas tomber Wang Lung et ses enfants, et cette ahurissante décence allume un feu de remords à l’intérieur de son mari. Par conséquent s’esquisse l’impossibilité de détrôner O-len, le caractère foncièrement irremplaçable de cette femme qui «[crée] du bien-être pour eux tous» (p. 352) sans que personne n’en fasse cas. Mais comme tous les êtres humains d’ineffable qualité, c’est au moment de les perdre que leur nécessité apparaît ostensiblement, splendide et tragique. C’est pourquoi la mort d’O-len, suivie de près par la mort du vieux père de Wang Lung (cf. pp. 368-373), ponctue la disparition d’une âme dûment enracinée à la Chine immortelle, adhérente à la terre nourricière, unie à l’humus fondamental où le continuum de la vie ne souffre pas des ruptures arbitraires de la ville. Principe de vie élevée et de nativités supplémentaires, principe de sagesse innée, O-len, une fois trépassée, insinue l’écroulement de toute l’armature ontologique de Wang Lung. Ne végète pour celui-ci que la dimension ontique de l’existence, la précarité de ce qui n’a pas de profondeur, entrecoupée par ses aboiements sporadiques où nous l’entendons pitoyablement célébrer les ressorts de la probité rustique.
Après quoi, et en toute cohérence avec l’inestimable perte d’O-len (apparue en disparaissant), le présomptueux Wang Lung achève sa mutation bourgeoise en conquérant la location de la maison Hwang vidée de ses épaves humaines, devenant de la sorte tout ce qu’il haïssait autrefois. Sa vision des pauvres en est considérablement altérée : «maintenant qu’il possédait de la terre et qu’il avait de l’argent et de l’or cachés en lieu sûr, il méprisait ces gens qui grouillaient de toutes parts, et il se dit en lui-même qu’ils étaient sales et il se fraya un chemin parmi eux en relevant le nez et en se retenant de respirer à cause de la puanteur qu’ils exhalaient» (p. 402-3). Son dégoût de l’insolvable détresse, inéluctablement, se transmet jusqu’à l’un de ses fils (cf. p. 424) et macère chez les autres descendants comme une mauvaise graine diversement active, à l’exception d’une fille innocente dont la tournure mentale retardée l’exonère de tout paganisme. Aussi faut-il nuancer les réussites de cette famille «qui a fait ses preuves» (p. 416) car les succès prosaïques vont de pair avec les échecs moraux selon un ensemble de dogmes balzaciens qui convient très bien à notre sujet. Fier de ses accomplissements (cf. p. 458), témoin de la troisième génération qui élargit cette dynastie de transfuges (cf. pp. 414-6), Wang Lung n’est pas non plus insensible à la dégradation du climat moral et ses excursions erratiques sur ses terres, malgré qu’il en ait, ne sont que des palliatifs assez vains (cf. p. 409). Il n’a pu empêcher la discorde parmi ses fils, les jalousies et les querelles de nantis, pas davantage qu’il n’a su modérer pour l’un d’entre eux l’appétence militaire de la guerre, comme si c’était là un expédient pour continuer différemment le malheur semé par l’argent (cf. p. 477). Et ultimement, lorsqu’il pressent l’avènement du dernier souffle, Wang Lung rejoint durablement ses champs et ses perspectives bucoliques, prêt à se mélanger à la terre, à redevenir poussière (cf. p. 489), désaffecté du branle-bas des polémiques et des comptabilités d’affairiste. C’est là son baroud d’honneur, sa clairvoyance rapatriée, mais tout cela est cruellement invalidé par la réaction de ses fils qui se passe de commentaires superflus : alors que le père insiste pour que les terres ne soient pas vendues, alors que le vacillant paternel établit un lien de causalité entre la vente d’une terre et la déperdition d’une famille, les garçons, par-dessus les flageolantes épaules de leur aîné, troquent un sourire d’entente cordiale qui désaccorde tout ce que le vieillard aura essayé d’accorder quand sa tête n’était pas sous l’emprise de l’argent. En tous les cas, si Marx avait dû commenter cette dissolution, il aurait probablement admis que Wang Lung s’est d’abord affirmé comme un irréfutable pôle de tragédie et qu’il s’est ensuite détérioré en farce (5).
Notes
(1) Pearl Buck, La Terre chinoise (Le Livre de Poche, 1987).
(2) Les Fils de Wang Lung et La Famille dispersée.
(3) Cf. Friedrich Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique.
(4) Cf. Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations.
(5) Cf. Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, pearl buck, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer