L’Amérique en guerre (23) : Les nus et les morts de Norman Mailer, par Gregory Mion (30/06/2021)

Crédits photographiques : José Luis Gonzalez (Reuters).
 L'Amérique en guerre.
L'Amérique en guerre.«J’ai connu la douleur d’être chef de bataille»
Charles Péguy, Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc.
«Donc dans la terreur de ces derniers jours de la chère et vieille Amérique comme du meurtrier Occident oublieux du Christ, hanté par le Christ, voici que je reviens à moi […]»
Walker Percy, L’Amour parmi les ruines.
Ceux qui proposent et ceux qui disposent : les loups et les agneaux en temps de nihilisme accéléré
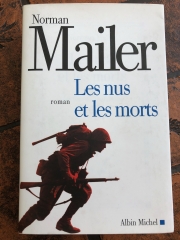 N’ayant pas pu échapper à l’enrôlement durant la Seconde Guerre mondiale, Norman Mailer a connu les Philippines et le Japon, d’abord comme patrouilleur en territoire ennemi et ensuite comme cuisinier. C’est en écrivant presque tous les jours à sa femme Beatrice qu’il a fondé le matériau de son roman Les nus et les morts (1). Publié en 1948, le livre consacre tout de suite cet écrivain de vingt-cinq ans qui deviendra une vigie de l’Amérique, toujours aux aguets d’une hypocrisie morale, d’un effondrement politique ou d’un événement survoltant. Ce que Mailer a voulu montrer dans cette somme initiatique de sept cents pages, c’est la nudité de l’homme qui a perdu le fluet vêtement de la civilisation, la désillusion récurrente du monde occidental qui croit posséder les moyens de faire le Bien alors qu’il est dominé par une illusion de raffinement, de savoir et de progrès. C’est du reste Freud, en 1914, qui s’affligeait déjà de la confondante renaissance de la barbarie, de ce retour du refoulé pour ainsi dire, à une époque où l’on croyait avoir vaincu les germes les plus enracinés de la violence (2). Or la Grande Guerre a douloureusement révélé que les performances intellectuelles de l’humanité n’étaient que des chimères et que les hommes, aussitôt qu’une opportunité de brutalité se présente, sont toujours prêts à régresser vers la pire part d’eux-mêmes. Et avant la dégénérescence de 1914, avant la coalition maléfique des puissances militaires, des forces industrielles et des sophismes d’État, Nietzsche a d’une certaine manière fixé l’avenir épouvantable de l’homme occidental qui ne sera qu’un agent du nihilisme, en l’occurrence un détracteur de la vie et un halluciné de l’arrière-monde, un endormi redoutable, un être dangereusement docile prêt à nier l’évidence de la sensibilité, la flagrante densité du réel, pour préférer des idoles hors-sol (3). Tout cela, tous ces tréfonds d’une culture désabusée, Normal Mailer le ressaisit en nous exhibant l’homme nu qui a continué de décliner, l’homme désemparé devant le désastre de la guerre, devant le cruel point d’interrogation de la civilisation qui s’autodétruit (cf. p. 22). Et ce faisant, Mailer nous donne une configuration de l’homme ayant atteint la nuit inquiétante de l’esprit, le crépuscule éternel, plus dénudé que jamais dans cet ombilic de ténèbres où la vie nocturne des soldats raconte sans détour le noir qui s’est implanté à l’intérieur d’eux-mêmes (cf. p. 113).
N’ayant pas pu échapper à l’enrôlement durant la Seconde Guerre mondiale, Norman Mailer a connu les Philippines et le Japon, d’abord comme patrouilleur en territoire ennemi et ensuite comme cuisinier. C’est en écrivant presque tous les jours à sa femme Beatrice qu’il a fondé le matériau de son roman Les nus et les morts (1). Publié en 1948, le livre consacre tout de suite cet écrivain de vingt-cinq ans qui deviendra une vigie de l’Amérique, toujours aux aguets d’une hypocrisie morale, d’un effondrement politique ou d’un événement survoltant. Ce que Mailer a voulu montrer dans cette somme initiatique de sept cents pages, c’est la nudité de l’homme qui a perdu le fluet vêtement de la civilisation, la désillusion récurrente du monde occidental qui croit posséder les moyens de faire le Bien alors qu’il est dominé par une illusion de raffinement, de savoir et de progrès. C’est du reste Freud, en 1914, qui s’affligeait déjà de la confondante renaissance de la barbarie, de ce retour du refoulé pour ainsi dire, à une époque où l’on croyait avoir vaincu les germes les plus enracinés de la violence (2). Or la Grande Guerre a douloureusement révélé que les performances intellectuelles de l’humanité n’étaient que des chimères et que les hommes, aussitôt qu’une opportunité de brutalité se présente, sont toujours prêts à régresser vers la pire part d’eux-mêmes. Et avant la dégénérescence de 1914, avant la coalition maléfique des puissances militaires, des forces industrielles et des sophismes d’État, Nietzsche a d’une certaine manière fixé l’avenir épouvantable de l’homme occidental qui ne sera qu’un agent du nihilisme, en l’occurrence un détracteur de la vie et un halluciné de l’arrière-monde, un endormi redoutable, un être dangereusement docile prêt à nier l’évidence de la sensibilité, la flagrante densité du réel, pour préférer des idoles hors-sol (3). Tout cela, tous ces tréfonds d’une culture désabusée, Normal Mailer le ressaisit en nous exhibant l’homme nu qui a continué de décliner, l’homme désemparé devant le désastre de la guerre, devant le cruel point d’interrogation de la civilisation qui s’autodétruit (cf. p. 22). Et ce faisant, Mailer nous donne une configuration de l’homme ayant atteint la nuit inquiétante de l’esprit, le crépuscule éternel, plus dénudé que jamais dans cet ombilic de ténèbres où la vie nocturne des soldats raconte sans détour le noir qui s’est implanté à l’intérieur d’eux-mêmes (cf. p. 113).Les soldats que décrit Mailer sont des Américains de conditions sociales variées, nettement distingués entre officiers privilégiés et sous-fifres déshérités, débarqués sur une petite île du Pacifique à dessein de repousser les belligérants japonais. Baptisée Anopopéi, l’île mise en œuvre par la littérature du primo-romancier le plus retentissant des années 1940 réclame une assonance avec Pompéi, comme s’il s’agissait du théâtre d’une catastrophe naturelle pour peu que l’on veuille bien considérer que la guerre est inséparable des hommes, qu’elle les suit comme une ombre et qu’elle survient aussi nécessairement que survient l’éruption d’un volcan. Mais avant que les troupes n’accostent sur cette terre insulaire, il y a l’angoisse, l’insomnie, la peur du lendemain où l’on sait le risque de mourir sur la plage, tué par une faction nippone embusquée (cf. pp. 3-4). Les conscrits de l’Oncle Sam redoutent la soudaineté ainsi que la répétition acharnée des attaques adverses, et, sachant cela, beaucoup se demandent a posteriori «où sont ceux qui dorment en paix ?» (p. 128). Le sommeil est léger, quasiment torturant, pour ces hommes dont le corps a été recruté en vue du sacrifice et la raison anesthésiée par les mauvaises rengaines patriotiques. Ils ont appris à tout craindre, à tout anticiper, à cause de la masse des règlements qui a détruit l’instinct de contemplation en fortifiant l’instinct de méfiance (cf. pp. 11-2). Pour ces membres hétérogènes de l’armée des États-Unis, du commandement jusqu’aux bas-fonds où opèrent les troufions, la moindre fleur qui détonne, le moindre bruit parasite, la moindre anatomie qui se profile sont des dangers potentiels, des symptômes à prendre au sérieux si l’on veut prolonger son existence. Ils réagissent en fonction d’un paradigme d’ultra-vigilance qui les détermine à percevoir leur environnement direct ou indirect tel qu’on les a dûment préparés à en faire l’expérience. Cela prend d’ailleurs la même valeur que la notion de paradigme scientifique élaborée par Thomas Kuhn (4) : nous ne percevons le monde qu’à la façon dont nous sommes prédisposés à le percevoir eu égard au modèle théorique en vigueur, et s’agissant des unités militaires, elles éprouvent le monde selon une épistémologie polémique, comme si toutes les apparences étaient corrélées à une essence sinon mortelle, du moins résolument agressive.
On comprend dès lors la contraction des ventres et le tourment psychique endurés au moment où le «bombardement naval d’Anopopéi» s’amorce à quatre heures du matin, à l’aube émergeante puis submergée d’obscurité récidiviste, pendant la «fausse aurore des tropiques» (p. 17). Ici, parmi la flotte de guerre avisant l’île à conquérir, «la nuit, déchiquetée et immense, fut saisie de convulsions démoniaques» (p. 17). Cet assaut préliminaire confirme l’imminence du débarquement, la perspective d’une matinée qui sera peut-être la dernière, le resserrement des impressions sensibles qui augurent des silhouettes fatales malgré la limpide majesté de ces latitudes. Les soldats entassés dans les canots d’abordage s’interrogent sur la probabilité d’affronter un feu nourri et sur ce qu’il adviendra une fois que les ridelles frontales de leurs embarcations se seront abaissées pour les laisser courir jusqu’à la plage (cf. p. 26). Aussitôt exposés à l’île, ils seront la proie des Japonais, cibles mouvantes dépaysées, bidasses à peine renseignés sur ces lieux uniquement appréhendés par les ressources limitées de la cartographie et des briefings habituels. L’un d’entre eux, en outre, sera pris de confusion et de panique, terrifié par les tirs d’obus (cf. pp. 32-4). Il se nomme Hennessey et il se souille d’effroi, courant et gesticulant irrationnellement sur la grève, massacré par un «éclat de shrapnel». Plus tard, un retour de courrier adressé à ses proches sera tragiquement tamponné de la froide mention «destinataire tué à l’ennemi» (p. 241), pauvre victime résorbée dans la fosse commune allégorique des monuments For The Fallen, futur patronyme éventuellement gravé sur de nouvelles pierres tombales qui serviront à commémorer ceux qui ont abusivement offert leur vie «in the cause of the free» (5).
Ce schéma sacrificiel recommence inlassablement de conflit en conflit, vaste tromperie, exaspérante filouterie, né d’un maniement du langage officiel qu’on expédie dans les consciences influençables et qui postule une vertu censée s’accomplir (celle du bon soldat au service de sa patrie) en dépit d’une continuité générale du vice (celui de l’État capitaliste qui veut poursuivre ses intérêts secrets). Le phénomène s’est accru à la proportion des instruments mobilisés pour façonner les mentalités en leur suggérant la haine de quelques nations étrangères, réputées idéologiquement attentatoires aux archétypes en usage, de même que s’immisce dans ces mentalités corruptibles l’obligation de respecter à la lettre les directives d’un pouvoir infantilisant. Aussi Bertrand Russel, en amont de nos préoccupations et de ce que raconte Mailer, était-il aux premières loges de ces jeux de dupes dès le début de la Grande Guerre, avertissant son prochain et toute personne dotée de bon sens contre la rhétorique diplomatique, la complicité de la presse et l’opportunisme des industriels de l’armement, tout cela favorisant un climat de soupçon, une circonstance phobique au sein des multitudes malléables qui sont formatées à l’envi pour des embrigadements ultérieurs (6). Par la suite, les techniques de propagande et d’atomisation des consciences vont encore s’affermir, aboutissant aux résultats que l’on connaît et jetant l’humanité dans une autre guerre mondiale au mépris des avertissements de jadis, nonobstant les leçons qu’on aurait pu enfin tirer de l’Histoire. Le langage, durant l’entre-deux-guerres, subira des mutilations inédites et mettra face-à-face des nations identiquement contaminées par la vacuité du verbe et par une tendance mégalomaniaque démultipliée, autant de choses qu’avait prévues l’inénarrable Karl Kraus et sur lesquelles reviendront Victor Klemperer, Elias Canetti et Hannah Arendt, pour ne citer que les plus saillants parmi les éveillés. On aura tellement dévoyé les langues vivantes qu’on les aura transfigurées en langues de la mort, en langues perverties, n’ayant nulle honte à disqualifier l’apologie de la vie au profit d’un désir de mort, amenant les foules à préférer l’impensable – leur hypothétique disparition pour satisfaire les grâces endiablées des idéaux étatiques.
Ceux qui sont manipulables au point de vouloir mourir au lieu de vouloir vivre, ce sont ceux qui ont posé un pied fébrile ou irréfléchi sur l’île d’Anopopéi, à savoir les hommes du général Edward Cummings. Ils sont six mille fantoches et ils sont chargés d’anéantir au plus vite les phalanges du général Toyaku, lequel joue au chat et à la souris avec son équivalent américain. D’abord maltraitées par l’artillerie japonaise, essuyant l’effet de surprise, les troupes américaines se précipitent par la suite vers la jungle, vers cette forêt vierge (cf. p. 39) qui a tôt fait de se découvrir comme un «obstacle formidable» (p. 40), un «no man’s land» hostile et cauchemardesque (p. 84). Cet écosystème infernal annonce bien sûr le Vietnam dans l’esprit du lecteur et la plupart des descriptions rivalisent également avec les espaces comminatoires autrefois captés par Joseph Conrad, tantôt dans Cœur des ténèbres forcément, tantôt dans l’éblouissante trilogie d’Almayer : «La jungle les enserrait de toutes parts, sombre et susurrante; elle les recouvrait de ses bruits et de ses fragrances et de la grasse émanation de sa moisissure. Les odeurs asphyxiantes de ferment, de putréfaction, de nécrose, l’âcre exhalaison de ce qui pousse et croît, obstruaient leurs sens et les mettaient à un doigt de la nausée» (p. 421). Ce pandémonium végétal, d’une épaisseur inhumaine à travers laquelle il faut aménager des voies carrossables en s’aidant de machettes, soumet les soldats à une discipline épuisante et au supplice du découragement, sans parler de leurs déséquilibres sensoriels. Le sentiment de l’absurdité est parfois tel qu’il n’est pas inutile de se formuler une question qui dérange (cf. p. 118) : qu’est-ce que cela changerait à la course du monde si cette jungle demeurait la propriété des Japonais ? Probablement rien, cela va de soi, mais les hommes engagés, malgré leurs réticences et leurs intuitions, ne parviennent pas à se libérer de ces consignes insensées tant ce que l’on exige d’eux les aliène, les dépossède littéralement de ce qu’ils sont – des êtres soi-disant doués de raison. Leur travail ressemble à cet égard moins à une œuvre d’édification qu’à un pur labeur de désintégration de la subjectivité. Tous autant qu’ils sont, lorsqu’ils se trouvent confrontés aux périls de la jungle, ces hommes ne conservent que leurs fonctions biologiques et un vernis d’activités sociales ou de réflexes urbains (les discussions psychotiques, les beuveries improvisées, l’identification des grades). Ils incarnent la progressive déchéance de leur dimension humaine en se radicalisant du côté de la dimension animale. Ils ont cru ardemment aux discours nationalistes, à l’éloquence martiale, à la liesse qui accompagne en principe les déclarations de guerre, à cette rigoureuse mystique de la guerre que le philosophe Alain avait parfaitement aperçue derrière le rideau de l’horreur et qui n’est en définitive qu’une mystification plus horrible encore (7). De la guerre, en somme, on ne peut retirer quoi que ce soit d’exemplaire et certainement pas une exaltation d’ordre sacré. Absolument toutes les passions de la guerre ne sont que des instants éphémères voués à se dégriser dans la permanence du blasphème.
De surcroît, la logique de la mort ne peut résister longtemps à la comparaison de l’évidence vitale, d’où, itérativement et comme par contrepoids successifs aux égarements de l’intelligence, le souvenir des «grands bonheurs» qu’on a perdus en survivant dorénavant parmi le grand malheur de la guerre (p. 51), le vague à l’âme des simplicités familiales remémorées (cf. pp. 96 et 416), la «terrible nostalgie» (p. 238) qui est finalement «nostalgie de l’Amérique» (p. 633) et donc mal du pays. Cela dit toutes ces réminiscences, invariablement, désespérément, se compliquent et deviennent précaires sous l’influence des éléments naturels inhospitaliers, quand la jungle et l’orage s’allient quelquefois, subordonnant les hommes à des spectacles de désolation apocalyptique : «l’eau formait de grandes mares qui s’élargissaient sans cesse, étendant des tentacules comme autant d’énormes amibes qui avalaient la terre» (p. 90). Le Léviathan biblique n’est pas loin, rôdant ici et là, menace réelle et symbolique davantage significative que la menace japonaise, spectre qui eût dû s’emparer de la forfanterie des généralissimes américains pour éviter les deux bombes atomiques de 1945.
À ce titre, il est important désormais de s’intéresser justement au général Cummings afin d’expliciter les mécanismes de l’arrogance des chefs et de la soumission des inférieurs, mécanismes qui conduisent à la catastrophe. Quelle que soit l’issue de la guerre, en dépit de son caractère mythiquement purificateur, régénérateur ou virilisant, elle n’est jamais – comme l’a vu Nietzsche – que ce qui rend les vainqueurs médiocres et les vaincus méchants (8). Dès les premiers mouvements stratégiques, assortis de moyens matériels intimidants, il ne fait pas vraiment de doute que les États-Unis de Cummings (Roosevelt) finiront par mettre le Japon de Toyaku (Hiro-Hito) hors d’état de nuire, les expropriant de l’île aussi bien que de l’aventure existentielle. Est-ce que cela est néanmoins suffisant voire légitime pour constituer un motif de satisfaction ? La victoire américaine prévisible est-elle ce dont l’humanité a fondamentalement besoin ? Plus que sur la manière de gagner, au-delà des considérations de tactique ou d’iniquité des forces en présence occasionnellement équilibrées par la jungle, Mailer, subtilement, se concentre sur les racines psychologiques de cette campagne insulaire dirigée par Edward Cummings. En s’attardant sur le personnage de Cummings, on obtient alors une radiographie plus ou moins fidèle de ce qui préside à l’action universelle de l’Amérique et construit l’hypothèse d’une médiocrité outrancièrement vaniteuse.
Tel qu’en lui-même la guerre de la zone Pacifique le décèle, le général Cummings inspire autant de respect que de crainte, amalgamant des comportements tyranniques et orgueilleux avec des fulgurances intuitives et des accès intempestifs de compassion. D’une mémoire éléphantesque et d’un génie militaire incontestable (cf. p. 103-4), il se définit volontiers comme un intellectuel de l’armée, comme un penseur qui se bonifie au fur et à mesure des missions (cf. p. 78). Féru du jeu d’échecs (cf. p. 165), cet amour de l’échiquier traduit son amour des planisphères et des manœuvres offensives, complété par ailleurs d’un vif et regrettable tropisme de manipulation qui pourrait être de la perversion narcissique (cf. pp. 284-8). Et partant de là, tandis que le général Cummings se dépêche de valider un ascendant sur le général Toyaku, il affirme pernicieusement sa capacité à tendre des pièges : «Je suis cette petite dame qui permet au gigolo de pousser bien loin sous sa jupe avant de lui sectionner le poignet» (p. 152). La trivialité de la phrase, d’emblée, se voit contrebalancée par des bourrasques de pédanterie (cf. pp. 161-2). Aux dires de Cummings, un supérieur doit constamment rabaisser son vassal s’il souhaite préserver dans ses rangs une infaillible obéissance, de sorte à ce que les grossièretés du dominant soient spontanément excusées par le dominé. Il a relativement ruminé et digéré son catéchisme de Machiavel en soutenant qu’il est plus décisif d’être craint que d’être apprécié, tout comme il est l’artisan d’une lutte des classes au sein même des unités médicales, s’arrangeant pour que les officiers bénéficient de traitements de faveur pendant que les subalternes doivent subir l’opprobre des soins négligés, traités à l’instar de chiens galeux ou de sinistres simulateurs (cf. pp. 325-342). À cela s’ajoute un impératif d’austérité : tous les soldats doivent être assujettis à des conditions de vie altérées au prétexte que plus ils connaîtront un genre d’ascétisme concret, plus ils seront performants dans les échauffourées, convertissant leurs frustrations en colères létales à l’encontre des antagonistes. Parallèlement à ces bizarreries qui ne sont que les postures d’un homme plein de morgue, Cummings revendique l’aspect crucial d’une masse, l’entrain d’une titanesque cohorte serrée de troufions courroucés, lestés d’un armement dernier cri. Il n’est probablement pas exagéré d’imaginer la joie que lui procure la réalisation de ses fantasmes théoriques, lesquels se résument à faire de la guerre une «concentration de puissance» (p. 162) destinée à corroborer le règne croissant de la technique moderne. Ce à quoi le général Edward Cummings aspire, en fin de compte, c’est à la dégradation de l’homme en homme-machine, en cerveau artificiel prométhéen, en simple intermédiaire de la force mécanique extensible à l’infini (cf. p. 523). Or cela n’est possible que si deux dispositifs coïncident : d’une part la grandiloquence guerrière et d’autre part le développement du complexe militaro-industriel. Dans les deux secteurs, l’ambitieux Cummings a le bras long, non seulement parce que ses facultés discursives ne démentent pas la tournure d’un orateur, mais aussi parce qu’il est attentif à tout ce qui est susceptible de rassasier le Béhémoth des marchands de canons.
Aussi ne sera-t-on pas étonné d’apprendre que Cummings, dès son plus jeune âge, a été masculinisé par son père (cf. pp. 372-393). Pour lui, maintenant métamorphosé en général de la plus autoritaire armée de la planète, une vie peut tout à fait en valoir plus qu’une autre, surtout si les adjoints et les seconds couteaux s’avèrent efféminés, sous-diplômés ou rebelles par inattention de leurs galons inférieurs (aussi n’est-ce même pas la peine d’évoquer le statut ontologique des ennemis pour cet entendement présomptueux). En tant que représentation archétypale d’un «énoncé spécifiquement américain» (p. 372), Cummings valorise l’effort, la sacro-sainte méritocratie, refusant de concevoir que sa réussite pourrait dépendre d’un écheveau de circonstances favorables. À l’école militaire, il a suscité l’antipathie et il s’est taillé une réputation non usurpée de Périclès. Il a prématurément appris à forger des réseaux d’influence, à instrumentaliser des hommes et à bachoter la nuit, à la fois créature noctambule et spécimen rare de la vie diurne. Inépuisable et mégalomane, Cummings se veut une conscience panoptique, omnisciente, affamé de décréter comme le dieu d’une Olympe américaine et n’étant heureux qu’en éprouvant une sensation de puissance illimitée (cf. p. 523). Cet appétit du pouvoir suprême s’est très tôt consolidé pendant les tranchées de 14-18 où Cummings fut le tout frais témoin des dynamiques humaines dirigées par de prestigieux officiers. En voyant la soldatesque obéir aux ordres, en observant les reptations et les attaques des recrues, le brillant postulant aux plus hautes fonctions de l’armée a eu le goût des responsabilités et l’arrière-goût d’une folie des grandeurs. À l’image de beaucoup de carriéristes grisés par les aberrations de la guerre, Cummings, à l’endroit le plus intime de sa psyché, ne désire que l’excitation du «fracas hurlant d’un obus», c’est-à-dire «le feu et le tonnerre sortis de la main de l’homme» (p. 521), l’impression d’être un potentat que l’on ne peut renverser et qui peut tout renverser.
Pour toutes ces raisons, lorsque ses combinaisons de vieux renard s’enlisent, lorsque la fatigue des troupes touche un point culminant après des travaux de voirie herculéens au milieu de la jungle (cf. p. 275), l’infatué commandeur Edward Cummings, une fois n’est pas coutume, a peur de perdre son autorité, sa suprématie tant recherchée (cf. pp. 291-2). Sa divinisation personnelle vacille et la paresse de ses hommes – qui est en réalité une acmé de lassitude – reflète à ses yeux un sacrilège envers lui. De là procède l’amplification du conflit qui l’oppose au lieutenant Robert Hearn, lequel est non seulement déçu des élites militaires, mais de surcroît révulsé par la situation qui se trame sur l’île d’Anopopéi. Son désenchantement quelque peu romantique est en outre passivement synthétisé par la flore environnante : «le vilain vert de la jungle […], la délicate rosace des cocotiers contre le ciel, l’aspect jaune, charnu, chancreux de toute chose, – tout cela se combinait pour nourrir son dégoût» (p. 70). Entre le dépité Robert Hearn et le plastronneur Edward Cummings, les tensions prolifèrent et le premier n’hésite pas à provoquer le second, à lui tenir tête, à réfuter les douteuses dialectiques suprématistes. C’est pourquoi Robert Hearn maintient que cette guerre n’est qu’un «coup de dés impérialiste» (p. 293) en vue d’exploiter le continent asiatique avant les Japonais. À en croire les convictions du lieutenant Hearn, tout cela n’est qu’une invasion, une extravagance, un caprice qui utilise les arguments de la diplomatie pour imposer à une partie du monde le système occidental orchestré par les États-Unis. Quant à Cummings, il alimente la thèse d’un «processus d’énergie historique» (p. 294), d’une sorte de souffle dévastateur, de pneuma électif qui traverserait le poumon métaphysique des bâtisseurs d’empire. Il justifie ce disant la vitalité exponentielle de l’Amérique et son aptitude à s’inscrire dans un avenir qui ne sera que l’Histoire du pouvoir, en l’occurrence les annales des nations les plus omnipotentes au-dessus desquelles trônera la bannière étoilée (cf. p. 297). On a ici affaire à une version caricaturale de la volonté de puissance nietzschéenne qui oublie que la puissance pour la puissance est vaine et que toute velléité de commander doit d’abord s’appliquer à soi-même (car l’homme n’a pas à être une déchéance ou un point d’anéantissement mais une transition dans le multiple de la vie). Et de toute façon, tout est caricature chez Cummings, tout est grossissement, extension, dilatation, déferlement de l’ego et des pensées les moins nuancées, portrait grotesque et parodique du chef originaire d’un pays lui-même travesti en gendarme universel totalement matamore.
Le contraste ne peut donc qu’être saisissant avec le lieutenant Hearn (cf. pp. 301-324), qui, à douze ans, lisait déjà avidement et précisément malgré le fait que sa famille tenait seulement l’argent pour valeur tutélaire. S’ensuit une scolarité presque automatique à Harvard, la culpabilité de bénéficier de tant de facilités, puis une thèse sur Herman Melville et «l’impulsion cosmique» (p. 317) obtenue avec la mention magna cum laude. Devenu par la suite éditeur oisif à New York, le lettré Robert Hearn travaille sur de mauvais livres avec dilettantisme. Il boit le calice de la léthargie de classe et ses propensions bourgeoises l’empêchent de sentir l’humiliation des plus démunis, écrasés par les édifices abstraits de l’économie de marché. Au fond, jusqu’à ce pic d’existence mandarinale, Hearn n’apparaît qu’à l’instar d’un poseur et d’un privilégié, d’où sa décision radicale de bifurquer, de se prescrire un réveil brutal du sommeil dogmatique. L’armée sera son échappatoire davantage que son engagement absolu, comme une opportuniste relativisation de sa biographie patricienne. À l’inverse, Cummings n’a jamais voulu que cela, à savoir la loi et l’ordre édictés par la matrice militaire, la discipline extrême, l’aventure des batailles et les douleurs qui peuvent en découler. Peu importe ici l’exactitude théorique ou la noblesse des références classiques du moment que l’instinct et le charisme prévalent, autant d’atouts qui font défaut à Hearn et qui le repoussent progressivement dans les cordes, acculé par les qualités adaptatives de Cummings. Aussi, au moment où le général médite l’assaut final (cf. pp. 351-371), tandis que la discorde fructifie avec Hearn, ce dernier agit finalement tel un animal défait, consentant à la morsure fatidique alors qu’il s’imaginait un peu plus tôt en position dominante. En représailles à ses incartades et ses airs d’insubordination, Cummings affecte Hearn à la direction d’une section de reconnaissance. C’est le père qui punit l’enfant, le professeur qui corrige l’élève, et Hearn, dès lors, va redescendre des temples intelligibles et platonisants pour tester la matière même des choses, la consistance des phénomènes, la guerre telle qu’elle se fraie un passage hors des livres et des doctrines conseillés ex cathedra.
Les nus et les morts, les dépouillés et les damnés
Avant que le lieutenant Hearn ne soit parachuté savant timonier du détachement de prospection in hostile territory, c’était l’homme fort Samuel Croft qui tenait les rênes de cette patrouille spéciale. Natif du Texas, le dur à cuire Sam Croft franchit le seuil de l’éminente US Military à la suite d’un mariage raté (cf. pp. 142-9). Fou de la gâchette et naturellement despotique, il fait régner sur ses ouailles une atmosphère de terreur qui est de taille à outrepasser les terreurs inhérentes au combat. Son tempérament ne peut s’affirmer qu’au moyen de l’action et il ne dissimule pas son ennui au début de l’intervention à Anopopéi, la routine et les tâches ingrates mettant les soldats en périphérie du champ d’honneur (cf. p. 44). La physiologie et les particularités de ce personnage sont évidemment à relier aux autres combattants dans la mesure où Mailer, pour quasiment chacun d’entre eux, compose un demi-flux de conscience manufacturé comme une machine à remonter le temps. Le procédé n’est pas sans rappeler certaines méthodes narratives choisies par John Dos Passos, oscillant entre plusieurs formes et plusieurs styles, alliant volontiers la factualité la plus journalistique avec le registre le plus oraculaire. Tous ces épisodes narratifs, également, servent à reconstituer un visage composite des États-Unis puisque chacun de ces hommes incarne un fragment du pays lointain, une nuance de fierté blessée, voire trompée – une série d’allégories individuelles de l’effondrement qui révèlent un effondrement national a priori, un genre de névrose généralisée comme celle que Walker Percy a pu identifier dans L’Amour parmi les ruines ou encore Le Syndrome de Thanatos, s’expliquant par une errance de l’âme qui a perdu toute espèce de contact avec les assisses du réel, subjuguée par une dictature de l’abstraction, livrée aux quatre vents des spéculations les plus fantaisistes et des logocraties les plus enclines à homogénéiser les esprits afin de les astreindre au régime de la sédation de masse.
Par conséquent, il est intéressant de faire un tour d’horizon de ces soldats envoyés au casse-pipe, à la mort immédiate (balistique) ou médiate (le choc post-traumatique contribuant à la maladie mentale). Il est primordial de ressaisir au milieu de ce nulle part insulaire et tropical les traces improbables d’une vie d’antan – fût-ce une vie ayant connu l’emprise des discours et les malaises de la civilisation – sous les décombres d’une vie catapultée dans un quotidien qui la nie férocement. D’où ce parti pris de l’écrivain qui consiste à mélanger le ressouvenir, le passé urbain et point tout à fait englouti de ces malheureux, avec la lame aiguisée d’un présent intolérable, sauvage, comme si l’humanité (ou en tout cas son ultime succédané avant la Chute contemporaine) voulait insister en dépit des nombreuses raisons de déclarer forfait une bonne fois pour toutes en succombant aux tentations de la barbarie spontanée. Pourtant et d’une manière très provoquante, ce que semble montrer Norman Mailer, c’est que le Mal de la guerre n’a pu s’emparer de ces hommes que parce qu’ils étaient déjà mûrs pour cela, faillibles à maints égards, fragilisés par une société dont le contexte pacifique intramuros doit être largement remis en question. En d’autres termes, ces soldats ont été pour la majorité pressés par la nécessité, condamnés à intégrer les rangs du ministère de la défense, sidérés par cette évidence qui énonce à bas bruit que la condamnation à se battre pour des mobiles pseudo-patriotiques vaut mieux que la damnation de vivre dans une Amérique où l’on pourrait peut-être mourir plus précocement qu’à la guerre – ou être un mort-vivant piloté par une axiomatique mercantile. Tout compte fait, la société américaine, en sa façon d’être, a criblé ces hommes de failles par lesquelles le soleil noir de la guerre s’est immiscé, leur faisant croire à des miracles lors même qu’il ne s’agit que de perpétuer la monstruosité. Aussi ne doit-on pas juger ou préjuger des actes de ces conscrits, car tout ce qu’ils font, tout ce qui a l’air indicible ou irreprésentable, cela n’est guère qu’une interprétation atténuée de ce qui a lieu aux États-Unis, sur cette terre de liberté où la dépravation politique prospère et où l’on encourage assidûment la pulsion de mort. Ce n’est donc pas tant que la guerre a rendu ces hommes infréquentables ou qu’elle les a subitement déshumanisés, mais c’est qu’ils sont arrivés sur cette île du Pacifique prêts à l’emploi, prêts à décimer la vie et leur vie, avec la peur intermittente de la mort comme unique espérance de se rattacher à eux-mêmes et au monde humain.
Ainsi ne les jugeons pas sévèrement, n’accablons pas ces hommes qui de temps en temps s’avinent d’alcools bas de gamme et profèrent des imprécations misogynes sur ces femmes qu’ils ont laissées derrière eux, sur ces amantes qu’ils soupçonnent bon gré mal gré d’adultère ou de péchés capitaux apparentés. Parmi les plus véhéments, les plus méfiants ou disons les plus inconsistants, il y a Wilson, un queutard qui cumule un mandat de père inopportun et une maladie vénérienne (cf. pp. 343-9). Il y a du reste ces hommes qui se sont mariés et qui se sont lassés, tel William Brown (cf. pp. 503-514), rejeton d’une famille à cheval sur la morale, paresseux sur les bancs de la fac et décidément paresseux en amour, surmené par le ronron domestique et par la déflation du rut avec Beverly, fuguant au bordel et in fine acheminé dans une banale profession de représentant de commerce. Dans la même lignée d’éreintement matrimonial, on a Joey Goldstein (cf. pp. 442-453), fatigué de Natalie qui fut initialement une poupée attirante et qui s’est dégradée en mère assommante, elle qui lisait pourtant du Thomas Wolfe. Puis comme si cette morosité ne suffisait pas, le désappointé Goldstein doit se résigner aux désobligeances de l’antisémitisme ordinaire de l’armée (cf. pp. 189-191), redite des vexations de son enfance où il était harcelé par des petits ritals hargneux, leitmotiv d’une vie aux ambitions minutieusement détruites. Et tout à l’opposé de ces hommes revenus de l’accoutumance conjugale, se tient Roy Gallagher (cf. pp. 245-256), vingt-quatre ans, né d’un père ivrogne et titulaire d’une adolescence effacée, vite embrigadé par les harangues politiciennes qui promettent des triomphes de soi. À Boston, il est excentré, hors des sphères agissantes. Il voit souvent passer des étudiants de Harvard, «ce nom de Dieu de nid à mécréants» (p. 249), tous héritiers de l’impalpable maléfice de la supériorité fiduciaire, clones et répliques du lieutenant Hearn. Avec ses intuitions limitées, Roy Gallagher s’aperçoit néanmoins que les bâtiments de Harvard constituent ce type d’écoles où se fabriquent les dirigeants, les chefs de guerre, les hommes regardés comme au-dessus du lot, les hommes qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur des subalternes tels que lui et ses frères en pauvreté. Témoin de cela, spectateur déconcerté par l’univers parallèle de ces étudiants voués à la lumière tandis que lui paraît voué aux abysses, le jeune Roy s’embarque dans les orbites du complot où quelques prédicateurs fanatiques assurent que la planète est malignement supervisée par la conspiration judéo-bolchévique. Après quoi, envers et contre tout, une femme surgit – une immaculée Mary – au cœur de ce paysage mental perturbé et fait vœu d’aimer cet homme. Elle sera fécondée juste avant que Roy ne parte pour le Pacifique, et, cruellement, il apprendra son décès en couches pendant l’accomplissement de son devoir sur l’île d’Anopopéi.
D’autres calamiteuses destinées s’additionnent à cette somme déjà infâme d’itinéraires brisés. On recense parmi ces hommes exténués du mauvais œil un certain Red Valsen (cf. pp. 204-216), lequel fut, toute sa puberté, enterré dans une mine de charbon du Montana. Il a fui cette fatalité charbonneuse en s’adossant à l’existence au jour le jour des trimardeurs, et, durant cette vadrouille fondatrice, il a fait la rencontre de Loïs avec laquelle il redoute de s’engager, probablement par crainte d’une stabilité dont il s’imagine exclu. Pour lui, sans ambiguïté, la guerre est une occasion de poursuivre sa fuite en avant, de bourlinguer, d’esquiver les infortunes qui lui collent à la peau. Les choses ne sont pas tellement différentes pour ledit Polack Czyniewicz (cf. pp. 559-569), prénommé Casimir, dont le paternel s’échine à l’abattoir et qui mourra comme prévu avant l’heure. Placé en orphelinat, Polack y demeurera deux ans, à la suite de quoi il réintègrera son foyer, le giron de sa mère, une fois que les aînés seront parvenus à commencer un simulacre de vie. Le déterminisme contraint Polack à devenir livreur de viande à treize ans, au lendemain de quoi il sera apprenti boucher, éventuellement charcutier, juste avant d’être admis à son tour au misérable taylorisme de l’abattoir, une jungle de chair et d’oppression comme nous le suggère un roman célèbre d’Upton Sinclair (9), par anticipation de la jungle végétale qu’il tâtera dans un futur proche. Autant dire que la guerre, pour cet enfant de la Pologne immigrée, sera une chance inouïe en même temps qu’un logique prolongement de lui-même, un appel d’air qui pourrait le guérir de la syncope de sa difficile condition. Enfin, parmi toutes ces figures auxquelles Norman Mailer a réservé une description particulière, on trouve Julio Martinez (cf. pp. 57-61), le Mexicain de San Antonio (Texas), doté de «la grâce d’un cerf», apeuré par la guerre mais tout de même conscient d’être en mesure de saisir un kairos violent à dessein de prouver qu’il est un bon Américain. Docile mais aussi arriviste sur le bas-côté de son âme, Martinez ne veut pas rater le coche, à l’affût du moindre coup qui le propulsera vers des jours meilleurs. C’est pourquoi il explose en catimini la mâchoire d’un cadavre nippon pour lui retirer ses dents en or, ceci à la faveur d’une expédition éthylique où les soldats américains de sa section de reconnaissance ont fait la tournée des charniers afin de dépouiller les corps de leurs richesses potentielles (cf. pp. 194-7).
Ce sont donc ces hommes plus ou moins hétérodoxes que le lieutenant Robert Hearn doit mener à l’improviste jusqu’aux lignes arrières des Japonais, ce qui n’est pas sans susciter de la nervosité, notamment vis-à-vis de Croft qui n’apprécie pas le parachutage de cette sommité présumée, inexpérimentée de surcroît pour ce genre de mission spécifique (cf. pp. 399-418). De plus chacun sait exactement les risques encourus, le péril de s’aventurer de la sorte chez l’ennemi, à tel point d’ailleurs que «la pensée de la patrouille les [enveloppe] d’un sombre suaire», aggravée par «la nuit [descendant] sur eux comme un mauvais présage» (p. 412). Ils affrontent vaille que vaille «la densité de la jungle, la brouillasse miasmatique, les bruits liquides, le harcèlement des insectes» (p. 422), encaissant péniblement «la bile amère du surmenage» (p. 467) ainsi que le «long et flasque écoulement du temps» (p. 573). Ils remontent cette jungle à l’instar d’un fleuve maudit, et, pas à pas, mètre après mètre, ils se rapprochent du centre dévorateur de l’île et peut-être même du système solaire tout entier, devinant au loin le tracé minéral du mont Tanaka, cet altier conglomérat de roche qui dénote la minéralité crânienne de Kurtz, comme si la crapule inventée par Joseph Conrad était revenue encore plus grosse, plus menaçante, indéracinable Némésis en charge de punir une humanité pécheresse. Et là, tandis que les soldats s’avancent vers la montagne haïssable, vers la cime qui prélude l’abîme, ils sont soudainement commotionnés par les «vastes espaces» (p. 441), par la brusque nudité des éléments, par le pressentiment d’une aurore du monde qui produit en eux un vertige métaphysique. Ce qu’ils voient de leurs yeux provisoirement purgés de la myopie culturelle, c’est la nature dévoilée, la nature en tant que telle, tenue debout par l’ancestrale polémologie héraclitéenne qui disqualifie d’office les guerres que les hommes se font pathétiquement. Cette vision ne dure pas, mais, à tout le moins, elle a imprégné sur les rétines une forme de consolation, une fibre de sérénité qui soulage un instant de n’être pas grand-chose sinon de la chair à canon – simple cannon fodder.
Un peu plus tard, en rupture avec ces ascensions spirituelles, le lieutenant Hearn se frotte à son premier combat et son sphincter est tout près de le trahir (cf. pp. 471-4). Sa honte est double : il se découvre pusillanime et ordonne à ses hommes de battre en retraite. Cette embuscade des Japonais marque en outre l’irréversible dérèglement de la patrouille américaine. Successivement, le vénérien Wilson écope d’une balle dans l’estomac et Croft, par effet de décompensation, tue un petit oiseau que les hommes avaient pris en affection (cf. pp. 475-502). Un segment de la troupe est sollicité pour rapatrier Wilson sur un brancard de fortune et cette manutention connaîtra les plus torturantes étapes, digne du suppliciant Sorcerer de William Friedkin ou du crucifiant Transport de A. H. écrit par George Steiner. Au bout de quarante-huit heures de marche harassante, Wilson meurt, en martyr consternant cocufié par le Ciel, en parangon de l’inqualifiable défaite, et son corps est emporté dans les rapides d’une ironique rivière, sous le regard impuissant des brancardiers courbaturés (cf. pp. 625-630). Simultanément à cette débandade, à quelques kilomètres de la funeste et involontaire immersion de Wilson, la poule mouillée Hearn est tuée net dans une nouvelle embuscade, offrant à Croft les pleins pouvoirs sur le restant de l’équipée (cf. p. 554). Mais l’ébranlement intérieur de Croft se poursuit et se manifeste par une obsession contre-productive du mont Tanaka. Alors que sa brigade vient de perdre un dénommé Roth, tombé dans le vide ou supposément suicidé en raison d’une inénarrable démoralisation (cf. p. 614), Croft s’obstine à faire crapahuter les siens sur les flancs de l’abominable montagne où «tout se [confond] en un vaste tourment» (p. 644). Son entreprise ne sera réfrénée qu’au moment où ce peloton de forcenés malgré eux va essuyer une attaque de frelons (cf. pp. 645-6), nuée de furies paradoxalement libératrices, délivrant les vassaux de Croft et imposant à celui-ci «une limite à sa voracité» (p. 646).
Cet épilogue entomologique ne fait que confirmer l’absurdité de la mission de reconnaissance et l’entière culpabilité de Cummings qui a sciemment détaché Hearn auprès de ces mercenaires dans le but sinon de l’éliminer, du moins de le discréditer d’une manière ou d’une autre. En aucun cas il n’était utile de procéder à l’investigation de l’arrière nippon. La preuve en est que lorsque le général Toyaku et la moitié de son état-major sont neutralisés, tous ces hommes plutôt vaillants sont oubliés, relégués au fin fond de l’île, l’issue de leur tâche n’ayant strictement aucune valeur (cf. pp. 605-6). Ils n’ont été que les jouets de Cummings, les instruments nécessaires à l’assouvissement de ses combinaisons tordues et délirantes. À cette gabegie de la vie humaine se greffe toute la fatuité offensée d’un chef, tout l’amour-propre entamé d’un tacticien qui se rend compte que la conclusion des hostilités repose moins sur ses brillantes résolutions que sur «un jeu de patience et d’usure», un «vulgaire concours d’heureux hasards» (p. 660). Il n’y a vraiment pas de quoi pavoiser du côté de Cummings et ce n’est pas à lui que reviendrait l’organisation d’un débarquement d’envergure comme celui auquel participèrent les généraux Eisenhower et Bradley. À la portée de Cummings, il n’y a plus que le nettoyage de l’île qui s’apparente à une épuration génocidaire (cf. pp. 662-3). Le symbole est terrible et ne fait qu’étendre l’empire du nihilisme, prêtant tristement main forte au siècle de l’Holocauste.
Notes
(1) Norman Mailer, Les nus et les morts (Albin Michel, 1950). La traduction de Jean Malaquais est parfois datée. En complément de lecture, il faudrait s’appesantir sur le récit d’Eugene B. Sledge, Frères d’armes, disponible en français depuis peu (Les Belles Lettres, 2019).
(2) Cf. Sigmund Freud, Propos d’actualité sur la guerre et sur la mort.
(3) Roger Bruyeron soutient la thèse du nihilisme confirmé par la Première Guerre mondiale dans un beau recueil de textes où il met en perspective des propos de Husserl, Bergson, Russell et Freud : 1914, l’entrée en guerre de quelques philosophes (Hermann, coll. Philosophie, 2014).
(4) Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques.
(5) Laurence Binyon, The Cause – Poems of the war (For the Fallen).
(6) Cf. Roger Bruyeron, op. cit., et les textes commentés de Bertrand Russell, notamment l’article intitulé La guerre : cause et remède (publié le 24 septembre 1914 dans The Labour Leader).
(7) Cf. Alain, Mars ou la guerre jugée.
(8) Nietzsche, Humain, trop humain (§ 444).
(9) Cf. Upton Sinclair, La jungle.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, norman mailer, gregory mion, l'amérique en guerre, les nus et les morts |  |
|  Imprimer
Imprimer