Le Paradis retrouvé de Halldór Laxness, par Gregory Mion (25/12/2021)

Crédits photographiques : Andrew Milligan (PA).
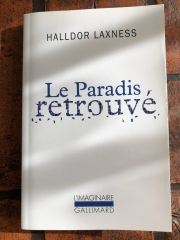 «Sous l’immense ciel de l’Ouest, ils sont alors tous réunis, le père, les mères et les enfants, et ils se serrent la main, s’embrassent, s’étreignent peut-être un peu trop fort, comme s’ils voulaient se convaincre une fois pour toutes qu’ils sont cette chose la plus merveilleuse et la plus impossible : une grande famille heureuse.»
«Sous l’immense ciel de l’Ouest, ils sont alors tous réunis, le père, les mères et les enfants, et ils se serrent la main, s’embrassent, s’étreignent peut-être un peu trop fort, comme s’ils voulaient se convaincre une fois pour toutes qu’ils sont cette chose la plus merveilleuse et la plus impossible : une grande famille heureuse.»Brady Udall, Le polygame solitaire.
«Il tourna, seul, au coin de notre rue ombreuse et se perdit dans une gloire de lumière.»
Charles Dickens, David Copperfield.
À la manière d’un conte ou d’une chronique de la foi dans l’Islande du XIXe siècle et dans l’Utah florissant des bâtisseurs mormons, ce beau et subtil Paradis retrouvé (1) du trop méconnu Halldór Laxness commence durant «les premières années du règne de Christian Williamson [Christian IX], le troisième des derniers rois étrangers qui gouvernèrent» (p. 9) la Terre de glace depuis le Danemark tutélaire, pour se terminer longtemps après, à la suite d’un immense voyage mystique, tel un arc s’étant libéré d’une flèche aventureuse qui aura presque fait le tour du monde avant de revenir sobrement et doucement à son point de départ. Cette longue fulgurance coïncide avec le parcours du fermier Steinar Steinsson, membre rustique et charitable du peuple Islandais. On affirmait jadis de ce peuple qu’il était «le plus pauvre d’Europe» (p. 9), placé sous perfusion danoise, mais toujours enclin à croire en des ancêtres de légende ou à des généalogies royales. À rebours de ces tendances, dépourvu de toute fanfaronnade et de toute prétention à la richesse, le bon et bienheureux Steinar, mari et père de deux enfants, sillonne humblement le quotidien de son modeste domaine (la ferme de Hlidar) où l’on peut entendre «le murmure venant de la mer, par-dessus les sables et les marais», le lancinant ressac de ce littoral sudiste, «toujours le même depuis mille ans» (p. 13). La calme et pourtant puissante répétition de cet assaut des vagues n’est pas sans provoquer des modifications sur ce panorama, et souvent, à l’acoustique débonnaire de la respiration maritime, se noue le brusque sanglot de la pierre, «des morceaux de rochers [tombant] toujours, comme si le cruel lutin des falaises versait des larmes» (p. 13). Ce bouquet de précisions géographiques donne une idée assez fidèle des apparences de la vie de Steinar et des siens au milieu de ce paysage d’une exaltante monotonie. On ne trouve là qu’une incurable mélancolie, ou, alors, une éternelle souveraineté pour les âmes d’humeur à se laisser gagner par le mystère.
Cette sensation de magie assortie à l’évidence d’une grande et impitoyable nature a offert à la ferme de Hlidar la nativité d’un poney miraculeux. Cette prometteuse monture a été engendrée d’une façon improbable à partir du ventre d’une jument blanche. On lui prête d’ailleurs un esprit surnaturel (cf. pp. 9-14). L’animal fantastique est baptisé Krapi et constitue pour les enfants de Steinar un perpétuel sésame pour pénétrer l’univers de tous les prodiges (cf. pp. 20 et 27). On le considère «à peu près comme le pape : non seulement au-dessus des autres chevaux, mais au-dessus de tout ce qui l’entourait, prairies, rivières, montagnes, tout» (p. 29). Se devine ainsi à travers les sauts et les gambades du petit cheval un élan immaculé, une palpitante allégorie de l’innocence, une auréole surplombant le front de cette famille angélique dont la candeur sera maintes fois éprouvée par des potentats locaux. Il s’en faudrait néanmoins de beaucoup pour que Steinar, le maître de Hlidar, rompe l’alliance qui l’unit moralement à ses travaux et à sa glorieuse patrie. D’un tempérament «habile et ingénieux» (p. 60), le fermier de cette histoire est de surcroît un modèle de dévotion, un enfant de Dieu adossé à la Création, soucieux du jugement des volcans d’Islande autant que des moindres détails qui pourraient améliorer la vie de sa famille. Son attitude à la fois pudique et féconde dénote en outre ce qu’il en est de l’amour parmi ces vastes pâturages insulaires, c’est-à-dire une émotion vécue de l’intérieur, un éboulement du cœur, un lumineux cataclysme de l’âme qui n’a pas besoin de se montrer en public ou de parader en arabesques nuptiales. Au plus profond de l’Islande authentique, «bien que le seul soliloque de l’âme fût permis et que les poètes nationaux ne pussent guère rien révéler de leurs pensées intimes dans un poème, [sinon pour] dire qu’ils se moquaient de la destinée, on sent bien que les gens n’en étaient pas moins bâtis normalement», et, de la sorte, «par signes secrets et conversations énigmatiques, il était possible de maintenir le cours naturel ordinaire de la vie dans toutes les régions de l’île» (p. 24). Le silence et la retenue sont ici les meilleurs auxiliaires de l’amour. La parole est d’autant plus rare que les sentiments sont pléthoriques. Plutôt que d’avoir des tirades qui se perdent en artifices, des sérénades qui épuisent leur sujet, des mots qui s’imaginent accomplir des actions, ce sont celles-ci qui se substituent à ceux-là, celles-ci qui deviennent le verbe et l’acheminement de toutes les forces essentielles. Dès lors les hivers de ces provinces qui ont la réputation d’être interminables ne brisent pas la paix stoïque et immuable des autochtones. La discrète continuité des liens humains tissés dans ces régions polaires se passe volontiers des actes de langage ou des futiles énoncés performatifs afin de conserver vivante la vérité la plus étincelante – le Verbe initiatique et illuminateur. Au risque de la pensée proverbiale, on pourrait soutenir encore que le silence est d’or pour ces hyperboréens, tellement prodigue, tellement riche en causes et en effets, qu’il vaut tous les langages et surtout celui de l’argent, celui du hard gold cash, que la femme de Steinar estime être à l’origine de «tout le mal dans le monde» (p. 77).
Le socle de cette ancestrale sagesse prend un virage insoupçonné – mais pas tout de suite influent – lorsque Steinar assiste au sermon improvisé de l’évêque Didrik, un membre de l’Église mormone des Saints des Derniers Jours, courageux missionnaire délégué en territoire hostile pour évangéliser selon lui les consciences dogmatiques, pour leur apporter une vision inédite et avant-gardiste de la vie en Christ. Soit dit en passant, l’intention de Laxness ne consiste pas du tout à révoquer en doute ou à tourner en dérision l’une ou l’autre des traditions religieuses qui se font face dans le roman. L’ironie s’invite quelquefois – plus ou moins mordante – à dessein de souligner les réactions caricaturales des uns ou des autres. Cette ironie agit en vue d’exagérer plaisamment les professions de foi issues de la vieille Europe septentrionale ou du Nouveau Monde mythologisé à outrance, et, dans l’ensemble, cela nourrit un dynamisme littéraire où les odyssées de l’intériorité bouleversée (celle de Steinar) préfigurent de longs voyages terrestres. Des termes spirituels inconnus incitent à l’exploration de l’inconnu dans les termes du temporel. Autrement dit le degré de saisissement de Steinar au moment où il écoute le prédicateur mormon pendant les «grandioses fêtes nationales» d’Islande (p. 32) augure un déplacement dans l’espace après la significative expérience d’un déplacement dans l’âme. C’est ainsi que le modeste périmètre islandais s’étend avec délicatesse et fait de ce livre apparemment régionaliste un axe latent de fraternité sidérale. Rejeté, détesté et ouvertement traité de dissident, l’évêque Didrik n’en sera pas moins perçu par Steinar comme «[son] destin» (p. 101), comme l’inattendu propulseur de son existence, comme celui qui agrandit l’horizon et qui délivre l’œil de certaines illusions d’optique.
Il faut du reste se représenter avec un sourire en coin la déclamation intempestive et quasiment vaudevillesque du mormonisme en plein cœur des «festivités qui eurent lieu à Thingvellir pour commémorer le millième anniversaire de la colonisation de l’Islande» (p. 42). Le discours de l’envoyé spécial des Mormons plaide la cause de Joseph Smith, fondateur persécuté de cette Église innovante. Dans une veine excentrique, ce plaidoyer se complète par les mérites de Brigham Young, successeur et disciple du pionnier susdénommé dont le parcours brutalement interrompu en 1844 (2) devait être réamorcé par un meneur d’hommes fiable. Encore une fois, ce qui intéresse Laxness, ce n’est pas de juger un culte par rapport à un autre ou de s’attarder sur les controverses justifiées qui entourent aussi bien les spéculations de Smith que les boniments de Young, mais c’est de se servir d’un abondant matériau historique où un appétit pour l’exaltation et l’enthousiasme suscite des opportunités narratives tantôt captivantes, tantôt désopilantes. Il en va donc des mystérieuses tablettes en or de Joseph Smith comme il en va de la défense et de l’illustration de la polygamie (cf. p. 37). Ces différentes mentions et incalculables développements, bravement sortis de la bouche de Didrik, provoquent le scandale et excitent la multitude qui réclame la punition et l’expulsion d’un tel apôtre de l’indécence. On ne saurait admettre une seconde de plus la démonstration – ou plutôt la conviction – que «le Seigneur [a] exprès institué la polygamie dans Ses révélations directes pour qu’aucune femme n’ait à coucher dehors dans les fossés avec ses enfants, à Noël» (p. 149). On ne peut aller jusqu’aux plus extrêmes largesses de l’opinion quand il s’agit de recommander la polygamie au prétexte qu’elle permettrait aux femmes d’éviter la réprobation et l’insulte (cf. p. 149). Les bonnes gens de l’Islande conservatrice ne sont assurément pas prêts à reconnaître que la multiplication du «Serment éternel de mariage» (p. 149) puisse octroyer aux femmes une solution de protection aux fins de les préserver à tout jamais de l’oppression. L’humble population islandaise, à cet égard, ne se rend peut-être pas compte que l’un des canons du mormonisme redéfinit la valeur du patriarcat en y injectant une ample nuance de respect et de loyauté, tout comme il est possible que cette population, dans un angle mort de son inconscient, ne souhaite pas interroger les tenants et les aboutissants de sa patriarchie. Il est par conséquent nécessaire de dilater le spectre de nos préjugés et d’accepter par exemple que l’évêque Didrik, en contractant un second mariage, a d’un même geste édifié sa nouvelle promise et sauvé «les enfants qu’elles avait conçus au cours de ses viols» (p. 149) en y ajoutant deux autres descendants de sa propre semence.
Ce registre de la fécondité paternelle décuplée trouve aussi son écho dans la fécondité de la Mère nature localisée en pays mormon. C’est d’ailleurs ce qui a séduit le besogneux Steinar et une partie de l’auditoire pendu aux lèvres inspirées de Didrik. Ils ont eu la vive impression que cet émissaire de la lointaine Amérique leur avait déroulé le tapis rouge, les exhortant à venir rejoindre la somptueuse vallée du Lac Salé, les priant instamment de se rallier aux cultivateurs de la terre la plus fertile du monde, là-bas, de l’autre côté de l’océan (cf. p. 40). L’occasion leur a été donnée de quitter l’ingratitude de l’Islande stérile pour se transporter jusqu’au ventre généreux de l’Amérique mormone (cf. p. 54). Mais il faudra un concours de circonstances avant que Steinar ne prenne la décision de migrer outre-Atlantique pour se rapprocher du Royaume, pour accentuer la pression de sa main sur sa charrue de fervent paysan.
Avant cela, il aura eu la joie d’offrir son fabuleux poney au roi, de s’accorder par ce biais les grâces du souverain, de présumer enfin que la couronne danoise a rendu légitime n’importe quel citoyen d’Islande en l’encourageant à «marcher la tête haute» (p. 47). Dès lors, débarrassé du poids de sa roture et se sentant un être fortifié, Steinar, au lendemain des célébrations de Thingvellir, plie bagage à destination du Danemark, ambassadeur du dimanche et chef de famille à la conquête de perspectives supérieures. Sa femme, emportée par un flot d’amour fou autant que par de louables idéaux, se lance dans un panégyrique joyeusement larmoyant de son mari voyageur : «Il n’est pas étonnant que les rois envoient chercher mon Steinar. Quel monde merveilleusement paisible ce serait si les hommes comme lui étaient plus nombreux dans le monde ! Je suis sûre qu’il y aura le paradis sur terre lorsque des hommes comme mon Steinar pourront avoir de l’influence sur les rois» (p. 67). Quoique ce court monologue soit empreint de partialité, il récapitule d’une manière admirable le tempérament noblement irénique de Steinar, de même que sa tolérance naturelle, ses penchants magnifiques, sa perméabilité à tout ce qui de près ou de loin est guidé par le Seigneur, et, par surcroît, ce bref récital de l’épouse obligée fait apparaître la rarissime qualité d’un paradise maker, d’un convoyeur de fonds célestes dont la boussole indique toujours une Jérusalem divine et nous éloigne radicalement de toutes les routes qui mènent à la malsaine Babylone. À supposer ainsi que le paradis fût perdu ici-bas, une personne telle que Steinar possède les capacités de le récupérer, de le régénérer, de le reconstruire malgré la furor destructionis d’une humanité sous emprise diabolique potentielle. C’est évidemment l’un des sens que l’on peut attribuer au titre de cet intelligent roman de Laxness, à savoir que Steinar, quoi qu’il puisse en être des fragiles états du paradis sur Terre, incarnera d’une façon certaine un infaillible point de retrouvailles, une croisée des chemins ascensionnels, une diagonale unificatrice qui rassemble les lumières égarées en franchissant les noirs précipices de la discorde. Or ce caractère de constructeur ou de reconstructeur de paix, cette disposition à remettre d’aplomb le plan du suprême Architecte, Steinar le sentira aussi progressivement au sein de la parole mormone en général et dans les phrases de l’évêque Didrik en particulier. De telle sorte qu’on peut se figurer une harmonie préétablie ou une Providence (pour le dire autrement que dans les terminologies du concours de circonstances) lorsque Steinar, en marge de ses visites royales à Copenhague, retrouve sur le sentier de sa vie l’itinérance missiologique de Didrik (cf. pp. 128-136), comme si c’était là deux individus hautement compossibles et appelés à concorder selon des voies transcendantes indéchiffrables. Il était somme toute inévitable que Steinar et Didrik se rencontrassent de nouveau pour participer à la rééducation du monde au Paradis, et, sous les espèces d’une nécessité lumineuse, cela s’est produit avec la même force que les mauvaises rencontres d’Œdipe commandées par les espèces d’une nécessité ténébreuse.
La résolution de Steinar de se rendre dans le berceau américain des Latter-Day Saints atteint une définitive intensité pendant que l’éloquent Didrik lui décrit l’orgue du tabernacle mormon implanté à Salt Lake City (3), la «capitale de la foi» (p. 157), la surrection de Sion aux abords du grand lac salé. Non seulement la description de l’évêque ne manque pas de ce lyrisme si pneumatique, si habité, si pénétré par la grammaire du sacré inhérente à tous les prédicants de talent, mais elle insiste également sur le fait que l’orgue est un chef-d’œuvre, un miracle, un instrument exceptionnel dont tous les tubes soufflent l’inflexible volonté du Saint-Esprit. La bascule s’effectue alors dans la tête de Steinar et plutôt que de retourner sur ses pas déjà très aventureux, au lieu de tranquillement revenir à la maison-mère de son Islande natale, il poursuit son périple et s’embarque pour l’Utah, pour ce prolifique désert où des légions d’hommes pieux ont élu domicile et ont érigé autour de Salt Lake City des cités archangéliques comme celle de Provo. Il y a au bout de ce voyage une puissante présomption de dévoilement, un moyen de «découvrir la vérité sur la Terre promise» (p. 145). Cela dit les raisons divines ne sont pas toutes accessibles à la raison humaine et tandis que Steinar lentement se dirige vers la pente opposée de la planète, la ferme dont il s’occupait jusqu’à présent tombe peu à peu en ruine (cf. p. 191). En l’absence du pater familias – et sitôt confirmés les premiers instants d’absence qui ont succédé à son départ pour le royaume point si pourri du Danemark – la propriété se dégrade inexorablement. Il semble que la ferme se pervertisse et que disparaisse tristement son aspect paradisiaque originel, sa pastorale consubstantielle (cf. p. 110). Dans le jeu des poids et des mesures invisibles, Steinar, en partant vers les paradis peut-être artificiels de l’Amérique, a éventuellement compromis un équilibre secret, semant l’enfer parmi les siens en croyant aller dénicher l’abondance éternelle, en croyant prospérer là où l’herbe est chaque fois tenue pour plus verte et pour plus grasse. En cela s’esquisse une orientation plus précise encore de l’intitulé du roman : le Paradis ne sera littéralement «retrouvé» (reclaimed) qu’à partir du moment où Steinar rebroussera chemin, chargé d’ans et de mystique, afin de redresser les effondrements de sa ferme et afin probablement de vivre selon l’étrange mais superbe syncrétisme de la foi mormone et de la foi de son enfance.
Au reste, ce qui nous laisse apercevoir précocement les limites de cette expédition, et, ce faisant, nous fournit la conviction que Steinar reviendra sur ses terres primitives, c’est le genre de répugnant dédain envers l’Islande en même temps que s’affirme un extravagant plébiscite de Brigham Young, «ce chef élu qui dominait non seulement les montagnes du territoire de l’Utah, mais même tout l’hémisphère occidental» (p. 153). Par contraste avec ce porte-drapeau charismatique à l’endroit duquel le narrateur omniscient joue quelque peu d’une ironie douce-amère, l’Islande, elle, a l’air d’une minuscule plaisanterie avec ses «petits fonctionnaires municipaux et ses montagnes naines», sans oublier «ses gratteurs de terre, toujours affamés» (p. 153), symptomatiques d’une politique en échec et d’une calamiteuse damnation. Par conséquent, on aurait d’un côté l’Islande épuisée, presque dépossédée de son histoire, et, d’un autre côté, le spectaculaire engendrement du Jardin d’Éden mormon, aussi biblique que l’Islande paraît profanatrice. Le rabaissement de l’Islande running out of spiritual steam est d’autant plus manifeste qu’elle souffre de la comparaison avec les mérites des précurseurs mormons, à jamais pionniers devant l’éternité, arpenteurs infatigables, pèlerins de l’absolu, cornaqués par le plus fascinant des «conducteurs d’hommes» (p. 154) – l’indétrônable et unique Brigham Young. Alors que l’Islande s’est graduellement perdue dans le malheur, les guerriers de l’ange Moroni, eux, ont répandu la consolation sur la désolation de l’immensité aride, perfectionnant la Création par le truchement d’un remarquable perfectionnisme moral. De là est né un idéal d’éducation du monde et des hommes avec le Seigneur comme irrécusable instituteur. Ce paradigme social est tellement harmonieux que son évidence saute aux yeux, et d’ailleurs, non content d’être sublime à l’œil, il se bonifie encore à l’oreille lorsque Steinar, cette fois, peut écouter l’orgue du tabernacle in situ en compagnie du pasteur Runolf, un autre Islandais immigré dans ce pays véridique, dûment converti aux divulgations de Joseph Smith : «[…] l’organiste vint jouer quelque chose de si beau que, plus tard, ils disaient que pendant que la musique se faisait entendre, ils étaient comme enracinés dans le sol, incapables de bouger un muscle. Bien qu’ils n’eussent jamais entendu de musique auparavant, ils furent si impressionnés par la pensée que Dieu avait pu conduire l’humanité jusqu’à ce point sur la route de la perfection, que les larmes coulaient encore sur leurs joues, quand ils se retrouvèrent dehors, en plein jour» (p. 161).
Demeuré en Europe où il persévère à ses risques et périls dans un émérite prosélytisme, l’évêque Didrik a donc passé la main au pasteur Rudolf s’agissant de la prise en charge spirituelle de Steinar. Ce dernier se voit baptisé assez promptement et une fois transfiguré en adorateur du Livre de Mormon, il adopte l’identité de Stone P. Stanford, devenant un homme de la pierre (stone) et un homme sinon de prestance (stand), du moins de transitivité (ford). Il cumule des emplois de maître briqueteur et de maçon, en parfaite adéquation avec sa nature de constructeur et en parfait accord avec les tendances bâtisseuses des Mormons (cf. p. 163). Il ne peut nier que le mormonisme est une doctrine qui attire la prospérité (cf. p. 178), et à rebours des justes défiances de son épouse vis-à-vis de l’argent, maintenant qu’il est aux antipodes de cette axiologie matrimoniale, Steinar se détend et accepte de plein gré «une poignée de grands dollars d’argent» (p. 165). Mais il n’en reste pas moins que les plus intimes atomes de Steinar ont dû être peu ou pas du tout déviés par ce clinamen pré-capitalistique. Si la surface de sa personnalité semble atomisée par la loi des échanges financiers autrement plus dogmatique dans l’Utah du XIXe siècle que dans l’Islande de la même époque, il ne va pas de soi que Steinar, dans les abîmes de son imprenable forteresse de vertu, ait été pareillement aiguillonné. La preuve en est qu’il veut rester fidèle à sa femme malgré l’énorme distance qui les sépare (cf. p. 171). Il n’est pour l’heure nullement sensible aux licences de la «sainte polygamie» (p. 179) en dépit des vingt-sept femmes que l’on a recensées dans le fructueux sillage de Brigham Young. Au milieu de ce «pays de la Sagesse suprême», Steinar, principalement, désire se concentrer sur l’exploit des héros conquérants qui ont extrait des «marais salants» (p. 176) le meilleur d’eux-mêmes, le sel de la terre pour ainsi dire. Dans sa ligne de mire, Steinar visualise droitement les exigences du Royaume, et si l’Utah des Mormons commet en filigrane le péché de l’usure, lui, le néo-partisan des Saints des Derniers Jours, préfère se répéter que cette région du monde avoisine le Paradis (cf. p. 193). Il veut faire partie de ces hommes quasiment irréprochables qui s’acharnent à rapatrier en tout temps le Paradis «que les méchants ont perdu» (p. 213). Et simultanément à son œuvre de sainteté, il s’acquitte de ses postures ambiguës et de ses louvoiements avec le démon. Il économise de l’argent en vue de l’envoyer à sa famille d’Islande afin qu’ils puissent à leur tour supporter le coût de cet exubérant voyage et gagner le Royaume qu’il est en train de leur bâtir à mains nues.
Malheureusement sa femme décède au cours de la scabreuse navigation océanique (cf. pp. 242-4). Elle a droit à des funérailles typiquement marines et à l’immersion subséquente de sa dépouille, modeste diadème allégorique dont sa tête est gracieusement parée. Puis la terre ferme se substitue aux vicissitudes des flots variables «où toute crainte abonde» (4), les deux enfants de Steinar posant un pied fébrile sur ce jeune continent civilisé, prêts à entamer l’itinéraire de l’auguste circuit, prêts à s’inscrire dans le jubilé révéré, à prendre «la route principale qui [conduit] en Utah» (p.246), confondus aux innombrables pérégrins, mélangés à l’affluence de ces foules galvanisées par une promesse d’ordre messianique. Et après le long trimard d’Est en Ouest, ces enfants nomades rejoignent les dynasties sédentaires du Beehive State, le sang de Steinar se coagulant au sang de Didrik, les deux familles s’agrandissant pour sceller un pacte de vie au cœur de l’intimidante vastitude (cf. pp. 252-5).
En parallèle de cette coalition au fort accent symbolique, deux cents femmes défavorables à la liturgie des Mormons – deux cents adversaires jugées comme appartenant à la «Grande Apostasie» – organisent une descente fédéraliste pour ruer dans les brancards de la Polygamie au nom de la sainte Monogamie, de la vraie justice et de la religion authentique (cf. pp. 256-7). Sûrement habitués à ces passagères émeutes, les Mormons ne tardent pas à répliquer, leurs femmes en première ligne, «[embouchant] la trompette de guerre» (p. 257) et résistant vaillamment à «l’oppression exercée par le gouvernement, par ses troupes et par la police, par ses orateurs au Congrès et au Sénat, par les scribouillards dans les journaux et par les écrivains, les professeurs et les évêques misérables et même par l’Antéchrist lui-même, le pape» (p. 258). Outre la comique et visible exagération de Laxness à propos de ces maquisards polygames, il est important de noter que dans l’un ou l’autre cas, dans l’un ou l’autre des camps, ce sont deux catégories de la croyance qui s’affrontent, l’une étant certes plus officielle que l’autre, plus imprégnée de politique, mais n’étant dans le fond pas plus habilitée que sa rivale pour prétendre détenir une quelconque et culminante crédibilité. On en vient même à se dire que le romanesque mormon et son inénarrable christologie sont moins arrogants que les prélats certifiés de l’Évangile. Tant et si bien que la seule chose qui doive prévaloir et que Laxness paraît défendre au gré de son ironique partage des eaux, c’est que toute personne, tout groupe, toute communauté, toute association humaine qui vit en Christ (et même plus largement dans la divinité) mérite la bénédiction quelles que soient les méthodes et les pratiques mobilisées.
Mais au-delà des eaux partagées et des fleuves religieux censément irréconciliables, il y a des affluents qui convergent, des fusions qui s’ébauchent. La double identité de Steinar et de Stone P. Stanford est le témoignage d’une hybridation davantage que l’annonce d’une irréversible sécession entre deux déclinaisons spirituelles d’un même homme. C’est la raison pour laquelle Stanford repart en Islande, non pas pour renier l’Église mormone qui l’a rebaptisé, mais pour en discuter avec certainement moins de verticalité que n’en avait Didrik, pour raconter à ses anciennes connaissances la manière dont il a pu «[jurer] solennellement [sa] foi» (p. 278) à sa femme islandaise tout en ayant fini par contracter deux mariages supplémentaires en Amérique, l’un avec sa belle-mère et l’autre avec sa bru (cf. p. 278). Il est incontestable que le comeback de Steinar/Stanford en Islande se trouve dominé par les dogmes du mormonisme, car, de surcroît, il fait office de remplaçant de Didrik, mais cette réintégration au pays natal promet beaucoup plus de latitudes mentales et d’approfondissements des grandes questions. La solidité théologique du fermier devenu maçon relève en quelque sorte d’un assortiment de théologie révélée et de théologie naturelle. On peut alors se demander si ce n’est pas cette extension de la spiritualité qui dispense le nouveau missionnaire d’être chassé ou traqué comme le fut jadis l’ancêtre Didrik (cf. p. 280). Les mots du narrateur, toujours colorés des astucieux sarcasmes de Laxness, nous laissent croire que les Islandais ont «perdu complètement l’étincelle de la conviction religieuse» (p. 280) étant donné qu’ils n’agressent pas ce Mormon composite, mais, à bien y regarder, il se peut qu’ils n’envisagent pas de le malmener parce qu’ils pressentent que la religion portée par Steinar/Stanford a une dimension éminemment plus universelle que la religion naguère préconisée par Didrik et que la religion traditionnelle de leur propre cru. Aussi nul ne s’indigne de revoir cet évangéliste épanoui et appesanti de tant d’expériences de la foi, tout comme nul ne s’étonnera de le voir s’investir corps et âme dans la réédification de sa ferme anéantie par la dent du temps (cf. p. 281). C’est ici même que le Paradis doit être retrouvé et que la boucle de lumière doit être bouclée – puis recommencée sans doute par un épigone plus lumineux encore.
Notes
(1) Halldór Laxness, Le Paradis retrouvé (Gallimard, coll. L’Imaginaire, 2015). La traduction est l’œuvre de René Hilleret à partir de la version anglaise. Le roman a été publié par Laxness en 1960.
(2) Joseph Smith meurt en effet assassiné le 27 juin 1844 sous les assauts d’une foule homicide tout à fait belliqueuse envers le mode de vie des Mormons. Son frère Hyrum est également tué.
(3) L’orgue existe toujours et donne lieu plusieurs fois dans la semaine à des concerts gratuits de toute beauté. Du reste, non loin du fameux Tabernacle de Temple Square à Salt Lake City, on peut visiter le colossal auditorium du Centre de Conférence mormon où trône un orgue encore plus impressionnant (mais beaucoup plus récent puisqu’il a été achevé en 2003).
(4) Clément Marot, À la mer.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, halldór laxness, gregory mion, le paradis retrouvé |  |
|  Imprimer
Imprimer