L’Amérique en guerre (30) : L’invaincu de William Faulkner, par Gregory Mion (05/09/2022)

Crédits photographiques : Gian Ehrenzeller (AP).
 L'Amérique en guerre, par Gregory Mion.
L'Amérique en guerre, par Gregory Mion.«Est-ce que ça pleure, un colonel ?»
Gilbert Cesbron, Notre prison est un royaume.
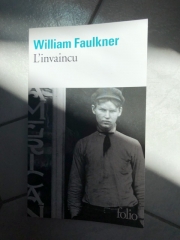 La lecture de L’invaincu (1) permet de remonter dans le temps de la famille Sartoris et de découvrir ce que furent l’enfance et la jeunesse de Bayard Sartoris, celui-là même qui succombera environ quatre décennies plus tard d’une crise cardiaque dans la voiture de son petit-fils après une effrayante sortie de route (2). Réchappé des balles perdues de la guerre de Sécession et des tensions de la Reconstruction au milieu d’un Sud exsangue et vindicatif, Bayard Sartoris, toutefois, ne l’aura pas emporté sur la malédiction des morts violentes dans sa famille, celle-ci étant un peu l’équivalent des Kennedy au cœur de l’univers faulknérien. On le découvre en outre âgé d’une douzaine d’années au lendemain de la reddition de Vicksburg, à l’été 1863, lorsque les troupes fédérales de Grant ont définitivement brisé l’endurance des troupes confédérées de Pemberton. Et lui, adolescent sudiste échaudé par les rumeurs et les mythologies de la guerre, reproduit en miniature le siège de Vicksburg avec son décor de fortune et ses soldats de plomb, recommençant à satiété les mouvements de la bataille en compagnie de Ringo, son ami de douze ans également, nègre et inconscient des enjeux réels de l’assaut qui vient de se terminer sur les rives du Mississippi. Ce binôme en noir et blanc schématise à l’orée de cette histoire le symbole de l’innocence, le caractère inexpugnable de l’enfance euphorique, Bayard et Ringo étant à ce moment-là «au-dessus de tout, invaincus comme deux phalènes, deux plumes chevauchant plus haut que l’ouragan» (p. 13). D’ailleurs l’un et l’autre sont tantôt Grant, tantôt Pemberton, ignorant les mérites respectifs de ces war leaders, méconnaissant totalement l’ironie de la déroute enregistrée à Vicksburg puisque cette défaite du Sud aura pour conséquence d’accélérer la libération officielle des esclaves et donc le changement de statut de toute la population noire (du moins en théorie). Autrement dit, sans qu’il n’en sache rien, le pré-pubère Ringo est déjà sommairement affranchi dans sa relation avec Bayard, mais l’union de ces deux innocents est moins contrainte qu’obligée, à l’inverse de quelques nègres du domaine Sartoris qui ne seront pas longs à assimiler la réalité d’un nouveau paradigme existentiel.
La lecture de L’invaincu (1) permet de remonter dans le temps de la famille Sartoris et de découvrir ce que furent l’enfance et la jeunesse de Bayard Sartoris, celui-là même qui succombera environ quatre décennies plus tard d’une crise cardiaque dans la voiture de son petit-fils après une effrayante sortie de route (2). Réchappé des balles perdues de la guerre de Sécession et des tensions de la Reconstruction au milieu d’un Sud exsangue et vindicatif, Bayard Sartoris, toutefois, ne l’aura pas emporté sur la malédiction des morts violentes dans sa famille, celle-ci étant un peu l’équivalent des Kennedy au cœur de l’univers faulknérien. On le découvre en outre âgé d’une douzaine d’années au lendemain de la reddition de Vicksburg, à l’été 1863, lorsque les troupes fédérales de Grant ont définitivement brisé l’endurance des troupes confédérées de Pemberton. Et lui, adolescent sudiste échaudé par les rumeurs et les mythologies de la guerre, reproduit en miniature le siège de Vicksburg avec son décor de fortune et ses soldats de plomb, recommençant à satiété les mouvements de la bataille en compagnie de Ringo, son ami de douze ans également, nègre et inconscient des enjeux réels de l’assaut qui vient de se terminer sur les rives du Mississippi. Ce binôme en noir et blanc schématise à l’orée de cette histoire le symbole de l’innocence, le caractère inexpugnable de l’enfance euphorique, Bayard et Ringo étant à ce moment-là «au-dessus de tout, invaincus comme deux phalènes, deux plumes chevauchant plus haut que l’ouragan» (p. 13). D’ailleurs l’un et l’autre sont tantôt Grant, tantôt Pemberton, ignorant les mérites respectifs de ces war leaders, méconnaissant totalement l’ironie de la déroute enregistrée à Vicksburg puisque cette défaite du Sud aura pour conséquence d’accélérer la libération officielle des esclaves et donc le changement de statut de toute la population noire (du moins en théorie). Autrement dit, sans qu’il n’en sache rien, le pré-pubère Ringo est déjà sommairement affranchi dans sa relation avec Bayard, mais l’union de ces deux innocents est moins contrainte qu’obligée, à l’inverse de quelques nègres du domaine Sartoris qui ne seront pas longs à assimiler la réalité d’un nouveau paradigme existentiel. En prolongement des légendes véhiculées par la guerre (et subséquemment du mépris des vérités les plus tangibles), précisons que dans l’œil juvénile de Bayard, son père John Sartoris, pourtant d’une taille très modeste, lui apparaît comme agrandi par la guerre, d’une certaine manière surélevé par «les choses qu’il faisait» et par ses missions spéciales accomplies «en Virginie et dans le Tennessee» (p. 16). Se manifeste ici la typique démiurgie du paternel combattant pour l’ordre présumé juste, une divinisation d’autant plus probante qu’elle est associée à la défense immodérée de la cause sudiste débordant notablement le seul contexte de la guerre. Et dans l’appareil sensoriel de l’enfant observant son père exhaussé au rang de colonel et de personnalité d’un imaginaire Hall of Fame du Sud, l’odorat suit les conclusions de la vue, l’odeur de son géniteur étant celle «de la poudre et de la gloire» (p. 16), rétrospectivement corrigée par la lucidité de la raison et par l’évidence historique, le parfum du triomphe se dégradant après des lustres d’objectivité renforcée en un relent de «déclin sarcastique» (p. 16), alors prélude aux inévitables perditions de la Confédération. Ce que l’enfant halluciné avait pressenti dans le registre de l’apothéose, le narrateur adulte l’amende et le reformule dans le registre de l’abaissement, instruit des mauvais tournants de l’armée sudiste et des séquelles stratégiquement irréversibles impliquées par la capitulation de Vicksburg. Il se peut ainsi que l’année 1863 fût pour le Sud l’extension d’un vain combat et la certitude que la substance intellectuelle du mouvement sécessionniste se muât dès lors en Cause Perdue. Du reste, en pure contradiction avec cette chronique de la défaite annoncée, l’immature Bayard ne s’intéresse pas tellement au détail des protagonistes et de leurs faits d’arme, il n’a pas vraiment de représentation claire de Nathan Bedford Forrest ou de John Hunt Morgan (cf. p. 22), tout le monde se trouvant en quelque sorte subsumé dans l’individualité fascinante de son père, mais il a plutôt un sentiment générique des événements, un enthousiasme à l’idée du cumul des «canons», des «étendards» et des «hurlements anonymes» (p. 22). La dramaturgie apportée par le conflit du Nord et du Sud ajoute là du piment au sein de l’âge tendre et donne aux éléments prosaïques de la vie une qualité inouïe, comme si, finalement, tout devait revêtir une cape magique en dépit des dangers sous-tendus par la guerre civile. Aux récits naturellement épiques de l’enfance, la guerre adjoint les superlatifs dont elle est l’entremetteuse, comme le monstre des romans d’épouvante intensifie subitement la moindre minute vécue.
Le son de cloche psychologique est néanmoins différent du côté de la plupart des nègres qui sont employés à la plantation des Sartoris. Ils vivent la lente agonie du Sud à l’instar d’une espérance et ils se figurent des rêves d’émancipation. Alors que pour Bayard la guerre est un prolongement de la joie de vivre et un réseau inextricable de fantasmes, elle est, pour les nègres, une promesse de joie parmi le quotidien très concret de la servitude, une insoutenable attente qui s’en remet aux impénétrables volontés du destin. Au nombre de ces fébriles obstinés de la délivrance, il y a Loosh, un utopiste enragé, pariant sur le fait que «le général Sherman (3) va balayer la terre» (p. 30) et rédimer toute la race des nègres. Aussitôt sa mère Louvinia le reprend, douchant ses visions d’apocalypse, le traitant «[d’imbécile] de nègre» (p. 30) et lui assénant une question qui tuerait n’importe quel illuminé de justice : «Est-ce que tu te figures qu’y a assez d’Yanquis dans le monde entier pour battre les blancs ?» (pp. 30-1). Mais quoi qu’il en soit de la majorité blanche qui pourra toujours compter sur la tyrannie du nombre et sur l’autodénigrement des minorités, la durée de la guerre, objectivement, repousse le Sud dans les cordes de l’atonie, allant même jusqu’à délaver le gris caractéristique des uniformes confédérés qui «avaient presque la couleur des feuilles mortes» (p. 54) après trois ans d’ineffable rivalité. Sur ce fond de délabrement matériel et de décrépitude immatérielle, le colonel John Sartoris doit joindre les deux bouts, maintenir les apparences, alimenter le folklore du midi séparatiste. Il est impératif que l’on continue à dire de lui que c’est une terreur et qu’il terrorisera encore longtemps «tous ces salauds aux ventres bleus» (p. 61). Cette réputation l’arrange bien parce que d’autres voix que celles-ci prétendent qu’il serait incapable de protéger sa plantation, et que, ce faisant, il préfèrerait s’esquiver vers un je-ne-sais-quoi de batailles officieuses plutôt que d’assurer la sécurité de sa maison et de ses occupants (cf. p. 62). Or les absences de John Sartoris (qu’elles soient légitimes ou non), en effet, provoquent un resserrement de l’étau fédéral autour de sa propriété familiale et exploitante, ce qui précipite Bayard, sa grand-mère Rosa et Ringo sur la route, embarqués sur une charrette dans laquelle l’aînée a tenu à introduire une lourde malle d’argenterie, symbole des ultimes richesses encore préservées du saccage nordiste, sorte de sarcophage à l’intérieur duquel seraient momifiées toutes les inaltérables valeurs du Sud.
Ce périple en forme de sauve-qui-peut – Rosa s’écartera d’ailleurs de l’itinéraire convulsif des deux puceaux – est cependant d’une troublante brièveté puisque les fugitifs rencontrent John Sartoris sur leur chemin (cf. pp. 71-82). Ils reviennent tous au domaine sur l’ordre du colonel, la grand-mère over a second phase, et cette dernière, opiniâtrement, n’oublie pas d’enterrer la malle d’argenterie comme si c’était un veau d’or, un talisman de tout le Sud, un cœur de la vitalité dissidente qui cesserait immédiatement de battre si par malheur il échouait entre les sales mains des unionistes. Puis de nouveau John Sartoris reprend le large en «sacré cochon de rebelle» (p. 84), peut-être par couardise, peut-être par jusqu’au-boutisme héroïque, on ne le sait pas, et sitôt l’ombre du colonel envolée pour d’indéfinissables directions, le spasmodique Loosh persuade sa femme Philaldelphie qu’ils sont à présent libérés (non sans avoir usé de la malle secrète à l’égal d’un passe-muraille), que les tuniques bleues sont sur le point d’achever le travail, que le vent de l’indépendance ne saurait désormais plus s’arrêter de souffler sur ces terres dévastées d’iniquité. Il songe sans doute à une inversion de la malédiction, à un châtiment délocalisé, une calamité enfin adressée aux bourreaux des nègres (cf. pp. 84-7). À ce degré d’excitation où l’adrénaline remanie les neurones en particules accélérées de l’onirisme, Loosh, au même titre que ses semblables opprimés, incarne «l’irrésistible besoin de mouvement qui bouillait» (p. 93) chez les nègres prisonniers des plantations et des mentalités esclavagistes. L’effondrement du bastion de Vicksburg, en jetant l’inertie dans les organes sudistes, aura suscité une spectaculaire cinétique dans les âmes noires. Métaphoriquement parlant, la chute du barrage de Vicksburg, tel un Malpasset inondant Fréjus un soir de décembre 1959, aura laissé passer l’eau foudroyante des États-Unis, faisant place nette à la fulguration de l’unité prête à neutraliser toutes les résistances extrêmes de la dualité. À la suite de Vicksburg, l’âme et le corps de l’Amérique pouvaient commencer à se réunir, l’esprit de l’Union rejoignant la matière vigoureuse de la désunion, l’intelligence se rapatriant progressivement dans ses meilleures virilités. Et les nègres, à la faveur de cet élan qui se confirme, se dirigent vers tous les points cardinaux qui ne seraient pas le Sud, marée humaine devenant un lyrique affluent du Mississippi, un débit de justice, une cataracte étoilée (cf. pp. 117-8). L’exode nègre est en outre si puissant que non content de se superposer au majestueux Mississippi, il reflète la suprématie du Jourdain (cf. p. 105), la sensation d’un baptême décisif qui serait les prémisses d’une purification de l’Amérique. C’est l’occasion d’aller de l’avant et d’oublier cette «triste affaire» de la guerre «qui traînait misérablement depuis tantôt trois ans» (p. 109). La vérité saute aux yeux : l’héroïsme du Sud n’existe plus – ce sont dorénavant les nègres qui sont les pionniers d’une fondamentale dépense d’énergie et qui montrent la voie de la future charpente de la maison américaine ressuscitée.
Parallèlement à cette ferveur et en pathétique divergence avec le sens de l’Histoire, Rosa Millard, Bayard Sartoris et l’influençable Ringo s’activent selon les forces négatives de la réaction, partant à la recherche de la malle dérobée et de leurs nègres opportunistes (cf. pp. 126-134). Cette loufoque expédition déclenche un enchaînement de circonstances aggravantes pour Rosa et ses vassaux : ce n’est pas leur malle qu’ils récupèrent, mais une dizaine de malles ainsi que d’innombrables nègres et une quantité impressionnante de mulets, le tout obtenu en fonction d’un usage croissant de faux documents (cf. p. 144), trompant les troupes qui croient que ces diverses réquisitions émanent de l’état-major le plus assermenté. S’ensuit une réédification aussi hâtive que sidérante du domaine des Sartoris, avec, en contrepoids psychique, une certaine mansuétude de Rosa qui autorise les nègres déboussolés à quitter les rangs pour persévérer dans leur jonction des territoires fédéraux (cf. p. 130). Mais ces nègres sont tellement «égarés dans la liberté» (p. 153) qu’ils n’osent pas saisir leur chance, éventuellement stupéfaits par l’habileté de cette grand-mère et assurément captifs de leurs habitudes serviles. Aussi, pour se racheter différemment devant l’étrange immobilisme de ces nègres, devant ce suicide social couronnant le chapitre des trop longues persécutions, la vieille Rosa distribue l’argent issu des ventes animalières à quelques désespérés du Sud. Elle mêle un geste de vertu à la chorégraphie de son vice et dans sa tête submergée de principes confédérés, il n’est pas impossible qu’elle se dise que les faux documents, à tout prendre, ne sont pas pires que la falsification axiologique colportée par le Nord.

La suite de cette étude est à lire dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, william faulkner, l'invaincu, l'amérique en guerre, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer