L’Amérique en guerre (29) : Le sergent Salinger de Jerome Charyn, par Gregory Mion (31/08/2022)

Crédits photographiques : Liam McBurney (EPA).
 L'Amérique en guerre, par Gregory Mion.
L'Amérique en guerre, par Gregory Mion.«Mama, put my guns in the ground
I can’t shoot them anymore
That long black cloud is comin’ down
I feel like I’m knockin’ on heaven’s door.»
Bob Dylan
«La sensation de se trouver jusqu’aux chevilles dans le sang chaud du porc bouilli.»
Jack Kerouac, Big Sur.
Du monde clos de Manhattan au monde exposé de la guerre
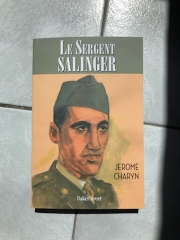 Il y a quelques années Jerome Charyn avait publié un roman dans lequel il démystifiait le tempérament d’Emily Dickinson afin que la réclusion consentie et progressive de la poétesse devienne le vivant motif de l’imagination libératrice (1). Il renoue ici avec une autre figure de la réclusion en faisant paraître un étonnant Sergent Salinger (2) où il ne s’agit pas d’explorer les décennies érémitiques de J. D. Salinger mais peut-être d’en comprendre les causes essentielles. À ce titre particulier, toujours avec le talent de la fiction revisitant la réalité, Jerome Charyn s’intéresse aux années cruciales pendant lesquelles Salinger a pris part aux sanglants chapitres de la Seconde Guerre mondiale, du moins ceux qui ont rythmé le conflit entre 1944 et 1945, lorsque l’écrivain de L’attrape-cœurs, enrôlé dans le contre-espionnage américain, souffrait de l’horreur généralisée, de certaines stratégies douteuses de l’état-major et du peu de poids de son action devant la lourdeur imparable de l’Histoire. Il souffrait aussi plus spécifiquement de ne pas pouvoir s’occuper de son héros Holden Caulfield en raison des impératifs militaires et des scènes d’abomination accumulées qui subjuguaient son âme (cf. pp. 141 et 168), tout cela en crescendo, en continuel serrement du nœud coulant de la guerre autour du cou de l’innocence, jusqu’à ce que le don de l’écriture disparaisse en même temps que le «psychisme» après la découverte insensée des camps de concentration (cf. p. 227). La guerre est ainsi sans concurrence dans la capacité de ruiner toute velléité artistique sérieuse, et Salinger, comme tant de romanciers exposés au feu de la belligérance, comme tant d’hommes de lettres qui n’ont pas cherché la justification behind the lines, aura vécu l’insupportable douleur d’une crise de la vocation littéraire avant de ressusciter peu à peu, en trompe-l’œil, livrant au monde ce qu’il pouvait lui livrer, se délivrant a tiny bit par la même occasion, laissant à son siècle défiguré quelques textes dont la grandeur dépend possiblement moins d’une qualité de style que de la force de les avoir écrits depuis les cryptes d’un esprit hanté. C’est là une manière de considérer J. D. Salinger par d’autres voies que la légende de son succès fulgurant : si L’attrape-cœurs incarne un livre qui a marqué toute une génération d’Américains, c’est parce que son auteur, hypothétiquement parlant bien sûr, transparaît derrière son héros comme le symbole d’une vie revenue de l’enfer et refusant les compromis qui pourraient permettre à l’enfer de sévir à nouveau.
Il y a quelques années Jerome Charyn avait publié un roman dans lequel il démystifiait le tempérament d’Emily Dickinson afin que la réclusion consentie et progressive de la poétesse devienne le vivant motif de l’imagination libératrice (1). Il renoue ici avec une autre figure de la réclusion en faisant paraître un étonnant Sergent Salinger (2) où il ne s’agit pas d’explorer les décennies érémitiques de J. D. Salinger mais peut-être d’en comprendre les causes essentielles. À ce titre particulier, toujours avec le talent de la fiction revisitant la réalité, Jerome Charyn s’intéresse aux années cruciales pendant lesquelles Salinger a pris part aux sanglants chapitres de la Seconde Guerre mondiale, du moins ceux qui ont rythmé le conflit entre 1944 et 1945, lorsque l’écrivain de L’attrape-cœurs, enrôlé dans le contre-espionnage américain, souffrait de l’horreur généralisée, de certaines stratégies douteuses de l’état-major et du peu de poids de son action devant la lourdeur imparable de l’Histoire. Il souffrait aussi plus spécifiquement de ne pas pouvoir s’occuper de son héros Holden Caulfield en raison des impératifs militaires et des scènes d’abomination accumulées qui subjuguaient son âme (cf. pp. 141 et 168), tout cela en crescendo, en continuel serrement du nœud coulant de la guerre autour du cou de l’innocence, jusqu’à ce que le don de l’écriture disparaisse en même temps que le «psychisme» après la découverte insensée des camps de concentration (cf. p. 227). La guerre est ainsi sans concurrence dans la capacité de ruiner toute velléité artistique sérieuse, et Salinger, comme tant de romanciers exposés au feu de la belligérance, comme tant d’hommes de lettres qui n’ont pas cherché la justification behind the lines, aura vécu l’insupportable douleur d’une crise de la vocation littéraire avant de ressusciter peu à peu, en trompe-l’œil, livrant au monde ce qu’il pouvait lui livrer, se délivrant a tiny bit par la même occasion, laissant à son siècle défiguré quelques textes dont la grandeur dépend possiblement moins d’une qualité de style que de la force de les avoir écrits depuis les cryptes d’un esprit hanté. C’est là une manière de considérer J. D. Salinger par d’autres voies que la légende de son succès fulgurant : si L’attrape-cœurs incarne un livre qui a marqué toute une génération d’Américains, c’est parce que son auteur, hypothétiquement parlant bien sûr, transparaît derrière son héros comme le symbole d’une vie revenue de l’enfer et refusant les compromis qui pourraient permettre à l’enfer de sévir à nouveau. Avant toutefois de suivre le chemin de croix de Salinger au sein de l’Europe dévastée, le roman de Jerome Charyn offre un prélude calme et voluptueux, quoique troublé à la fin, une incursion dans le New York débridé du printemps 1942. Cette ouverture assez extravagante se concentre principalement sur Oona O’Neill, la fille du dramaturge nobélisé Eugene O’Neill, «tigresse timide» (p. 12) vivant avec sa mère dans un hôtel indigent depuis que son père est parti relancer son existence hors des contraintes domestiques. En parfaite «déesse de seize ans dans son épiphanie charnelle» (p. 26), la nubile Oona, épanouie parmi les vagues enragées de l’océan new-yorkais, tangue adorablement entre son emploi du temps d’écolière et la trépidante vie nocturne du Stork Club. Elle est déjà le portrait accompli d’une Débutante qui rêve de cinéma et du faste hollywoodien. Comme Kerouac le fera tantôt, elle nourrit le mythe de la Californie, et, plus universellement, le mythe d’une conquête de soi par l’intermédiaire d’une conquête de l’Ouest. Le contraste est pour le moins saisissant entre cette effarouchable tentatrice et le «garçon dégingandé» aux «grandes oreilles» (p. 14) qui caractérise physiquement Salinger. Coloré de son «teint mat» assorti à «ses yeux sombres de bohémien» (p. 14), mesurant plus d’un mètre quatre-vingt-dix (cf. p. 15), le jeune Salinger détonne au milieu de cette carthaginoise succursale de Manhattan. À cette époque de ses vingt ans et des poussières, il a publié plusieurs nouvelles, rien de significatif néanmoins par rapport à son idylle semi-platonique dans les bras d’Oona O’Neill. La plume de Jerome Charyn le décrit à l’instar d’un jouvenceau qui n’apprécie que modérément l’agitation, mais, la force d’attraction d’Oona étant ce qu’elle est, le pondéré Salinger fréquente malgré tout le Stork, «privilège de l’écrivain» qui collectionne toutes les sensations possibles, même celles qui concernent une «descente dans la fange» (p. 16). À la table des artistes, il rencontre Hemingway ou plutôt une déclinaison parvenue d’Hemingway. Il lui préfère une version plus authentique, plus ancienne, lorsque ce fier lion d’Amérique était exilé en France, totalement démuni et alignant des pages et des pages tel un dément de la littérature sans finalité, «méconnu, avec femme et enfant, griffonnant des histoires musclées et modernistes» (p. 17). À côté de ce monstre désormais rassasié de popularité, Salinger, «prodige à une boule, né avec un testicule non descendu» (p. 18), ne ressemble à pas grand-chose sinon à une discrète présence orthogonale qui redresse le bois courbe et indiscret de ce night-club réservé à l’élite de la ville. Il y a en lui une certaine dose de mélancolie qui peut suggérer un rapprochement avec l’expérience new-yorkaise de Sylvia Plath (3) : il est là par le biais d’une espèce d’accident et son essence ne peut pas se déplier dans la promiscuité de ce déploiement festif et rarement véridique. En outre, par un surcroît de différenciation avec ce tambour battant de l’Amérique jouisseuse, le furtif J. D. Salinger a écopé d’un «léger souffle au cœur» (p. 18), l’éloignant immédiatement des premières phases de la conscription. Pour autant, la conjonction de cette physionomie d’autruche et de ce tempérament de modération ne retient pas Oona O’Neill de regarder son officieux petit copain comme son «soupirant préféré» (p. 22).
L’attitude olympienne de Salinger se trouve ainsi plus d’une fois mise à rude épreuve par les tourbillons sentimentaux d’Oona et par la folie des noctambules. Alors que cette héritière plus ou moins délaissée par son père n’aspire qu’aux dédommagements d’une carrière à Hollywood, lui, le nouvelliste relativement introverti, se voit davantage d’affinités avec la profondeur des films russes (cf. p. 22). Il doit aussi composer avec les ouragans de sa famille. D’abord avec son père Solomon Salinger, importateur de jambon et de fromage, pragmatique négociant aux antipodes de toute sensiblerie, dépositaire d’une judaïté contrariée qui a probablement travaillé la conscience de son fils en amont et en aval des révélations du système concentrationnaire. Quant à sa mère, elle se prénomme Miriam par assimilation – elle était née Marie Jillich et elle appartenait à la frange des catholiques d’Irlande. Elle ne fait pas l’économie de quelques effusions maternelles ultra-protectrices et un tantinet castratrices. L’étau familial est donc un obstacle à surmonter en plus de l’étau affectif induit par les caprices d’Oona (4). C’est d’autant plus tangible que Solomon Salinger n’approuve pas vraiment la façon d’être de celle qui a séduit sa progéniture, pas davantage qu’il ne se fait à l’idée que son garçon se comporte en «troubadour» en temps de guerre, à un moment où l’Amérique pense encore à l’humiliation de Pearl Harbor (cf. p. 40). Et pour ne rien arranger aux affaires de celui qu’on surnomme Sonny, le paternel d’Oona, comblé de gloire et de reconnaissances académiques, estime que les auteurs de nouvelles ne sont que des chiffonniers de l’écriture (cf. p. 28). Toute cette adversité privée concorde avec la croissance publique de la guerre, notamment avec les affiches de l’Oncle Sam recruteur placardées sur les murs de New York, incitant le sang frais de la nation à s’engager parmi les serviteurs de l’armée. Or cette pression de la nécessité militaire, aussi bien accrue par un contexte international préoccupant que par une déroute de la patrie américaine, finit par atteindre sinon la forteresse mentale de Salinger, du moins ses assiduités avec Oona (cf. p. 42), le jour où il reçoit son avis d’incorporation (cf. p. 41). En dépit de ses bilans médicaux défavorables, l’administration de la soldatesque a décidé que Jerome David Salinger était maintenant apte au service. La gravité de la situation requiert des mesures exceptionnelles et le combat qui se dessine contre les membres de l’Axe vaut tout à fait que l’on déracine Salinger de ses routines créatrices et de ses espérances amoureuses. Sa mère s’emporte en émettant des réflexions qui ne sont pas imputables aux seuls effets de la dramaturgie : non seulement elle accuse Roosevelt d’être un improvisateur, un piètre chef de guerre, mais elle est surtout terrifiée à la perspective de pouvoir perdre son enfant sur des champs de bataille insuffisamment coordonnés (cf. p. 42).
Le heart of darkness de J. D. Salinger
 Deux années plus tard, l’annexion de Salinger au tempo de la guerre est complètement effective. Il est membre du Counter Intelligence Corps (CIC) et il travaille en Angleterre, dans le Devon, en vue de préserver le secret absolu du Débarquement. Ses attributions au sein du contre-espionnage ont donc été pour l’essentiel un symptôme de sa vie future : en travaillant à consolider l’hermétisme entre les opérations militaires les plus sensibles et les populations civiles curieuses de voir les Alliés à la manœuvre (cf. p. 76), Salinger, indirectement, a développé des compétences pour se couper du monde. De petite main du Débarquement, de factotum des stratèges du D-Day pendant le décisif printemps 1944, il est devenu, dans la suite des temps, l’arbitre suprême non pas d’une invasion mais d’une définitive retraite. Nul doute que dans les abîmes du New Hampshire où il devait s’établir jusqu’à sa mort nonagénaire au mois de janvier 2010, il aura eu maintes et maintes occasions de ruminer la perte d’Oona, la désagrégation de son amour inconditionnel, l’inexorable fuite de son étoile adorée vers les lumières de la célébrité et les bras opportunistes du «misérable satyre» Charlie Chaplin (p. 53). Il faut dès lors supposer que l’ensorceleuse Oona O’Neill n’aura jamais quitté les pensées ensorcelées de J. D. Salinger, et même que la douleur de l’avoir perdue, la douleur de la savoir mariée à un comédien alors que lui se tenait dans les gouffres de la logistique de l’abordage des terres nazies, il faut donc admettre, non sans un certain esprit de tendresse, que cette douleur spécifique fut pire que toutes les douleurs qu’il a ultérieurement subies dans le branle-bas terminal de la guerre. Cette fille qui n’avait pas froid aux yeux fut vraisemblablement son obsession, sa supplication, et la guerre, de la façon la plus abominable, est venue détruire cet amour sacré comme elle est venue profaner un trop grand nombre de temples réputés inviolables, semant sur son satanique passage des veuves et des orphelins, des lassitudes aussi. On imagine ainsi le degré de désolation qui s’est emparé de Salinger dans les brumes de l’Angleterre et sur les plages vaporeuses de ce pays qui sait tant raviver les motifs de l’angoisse, on l’imagine déambulant comme W. G. Sebald déambulait, l’âme en peine mais collectionneuse de toutes ses secousses, de toutes ses motions, tantôt évoluant dans son camp retranché à l’instar d’un soldat modèle, tantôt la main en visière, observant la mer et le rétrécissement de son horizon à cause «de l’inextricable bêtise» (5) des hommes, dévisageant les «flots bouillonnants dans la Manche comme des couches de plomb fondu» (p. 74). Toute l’architecture humaine de Salinger s’était soudainement dissoute parmi l’inhumanité du monde en guerre et parmi l’injustice de la femme impatiente récupérée par un saltimbanque obscène – l’antonyme émérite du jeune homme idéaliste.
Deux années plus tard, l’annexion de Salinger au tempo de la guerre est complètement effective. Il est membre du Counter Intelligence Corps (CIC) et il travaille en Angleterre, dans le Devon, en vue de préserver le secret absolu du Débarquement. Ses attributions au sein du contre-espionnage ont donc été pour l’essentiel un symptôme de sa vie future : en travaillant à consolider l’hermétisme entre les opérations militaires les plus sensibles et les populations civiles curieuses de voir les Alliés à la manœuvre (cf. p. 76), Salinger, indirectement, a développé des compétences pour se couper du monde. De petite main du Débarquement, de factotum des stratèges du D-Day pendant le décisif printemps 1944, il est devenu, dans la suite des temps, l’arbitre suprême non pas d’une invasion mais d’une définitive retraite. Nul doute que dans les abîmes du New Hampshire où il devait s’établir jusqu’à sa mort nonagénaire au mois de janvier 2010, il aura eu maintes et maintes occasions de ruminer la perte d’Oona, la désagrégation de son amour inconditionnel, l’inexorable fuite de son étoile adorée vers les lumières de la célébrité et les bras opportunistes du «misérable satyre» Charlie Chaplin (p. 53). Il faut dès lors supposer que l’ensorceleuse Oona O’Neill n’aura jamais quitté les pensées ensorcelées de J. D. Salinger, et même que la douleur de l’avoir perdue, la douleur de la savoir mariée à un comédien alors que lui se tenait dans les gouffres de la logistique de l’abordage des terres nazies, il faut donc admettre, non sans un certain esprit de tendresse, que cette douleur spécifique fut pire que toutes les douleurs qu’il a ultérieurement subies dans le branle-bas terminal de la guerre. Cette fille qui n’avait pas froid aux yeux fut vraisemblablement son obsession, sa supplication, et la guerre, de la façon la plus abominable, est venue détruire cet amour sacré comme elle est venue profaner un trop grand nombre de temples réputés inviolables, semant sur son satanique passage des veuves et des orphelins, des lassitudes aussi. On imagine ainsi le degré de désolation qui s’est emparé de Salinger dans les brumes de l’Angleterre et sur les plages vaporeuses de ce pays qui sait tant raviver les motifs de l’angoisse, on l’imagine déambulant comme W. G. Sebald déambulait, l’âme en peine mais collectionneuse de toutes ses secousses, de toutes ses motions, tantôt évoluant dans son camp retranché à l’instar d’un soldat modèle, tantôt la main en visière, observant la mer et le rétrécissement de son horizon à cause «de l’inextricable bêtise» (5) des hommes, dévisageant les «flots bouillonnants dans la Manche comme des couches de plomb fondu» (p. 74). Toute l’architecture humaine de Salinger s’était soudainement dissoute parmi l’inhumanité du monde en guerre et parmi l’injustice de la femme impatiente récupérée par un saltimbanque obscène – l’antonyme émérite du jeune homme idéaliste. Relégué de la sorte aux positions les plus inconfortables de la causalité guerrière, Salinger, en irréprochable sentinelle de la vertu, demeure par conséquent fidèle au cahier des charges de sa mission. Il s’assure avant tout que les troupes américaines ne soient pas fortuitement tentées de se greffer au corps de la société britannique. Il n’ignore pas non plus son statut de subalterne et en cela il ne peut rien faire d’autre qu’enregistrer la vanité d’Eisenhower, l’exorbitance de ce planificateur généralissime «qui avait déplacé des hommes et du matériel comme autant de pièces sur son échiquier personnel» (p. 84). D’ailleurs la dress rehearsal du Débarquement ne se passe pas exactement comme prévu sur site de Slapton Sands (cf. pp. 84-8). Les bavures s’enchaînent et l’impression dominante est celle d’une confusion redoublée d’un sacrifice inutile. Le mandat du sergent Salinger prend ici une tournure à la fois complexe et traumatisante : il doit effacer les traces de cette réalité à l’extérieur comme à l’intérieur de lui-même, ou, en d’autres termes, enterrer urgemment les bidasses immolés par la faillite de cette avant-première du D-Day tout en essayant de les chasser de sa mémoire. Il s’agit de nouveau d’un élément prémonitoire pour celui que Charyn qualifie plus loin de «dissimulateur né» (p. 136), à savoir qu’en escamotant le navrant désordre de Slapton Sands, le discipliné Salinger se prépare déjà aux oblitérations de son avenir. Sur le sable souillé de cette plage d’entraînement, il est non seulement un fossoyeur du réel et un croque-mort intempestif pour des hommes outrageusement liquidés, mais il est aussi le pré-fugitif d’un monde irrémédiablement fini. Et concernant les survivants de ce fiasco, ils sont acheminés dans un hôpital de campagne où les chirurgiens s’indignent d’être moins que des vétérinaires pour ces estropiés scandaleusement manipulés (cf. p. 89).

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, l'amérique en guerre, gregory mion, le sergent salinger, jerome charyn |  |
|  Imprimer
Imprimer