Frantz Fanon est vivant et nous sommes morts : une lecture des Damnés de la Terre, par Gregory Mion (22/04/2025)

Crédits photographiques : Ihsaan Haffejee (Reuters).
Henri Bosco, Le mas Théotime.
«Or voici qu’il fait jour ! J’ai patienté et je l’ai vu venir.»
Friedrich Hölderlin, Aux poètes.
«Mon cœur s’emballa dans ma poitrine lorsque je pénétrai dans la Maison Blanche avec notre ambassadeur, qui devait me présenter. Je venais d’atteindre le noyau de la citadelle de la puissance et j’allais rencontrer l’homme le plus puissant du monde, le représentant de la nation la plus puissante du monde.»
Jan Karski, Mon témoignage devant le monde.
Par l’imagination, par la raison ou par le cœur : Frantz Fanon par toutes les voies chemine
 Nous voulons d’abord imaginer le docteur Frantz Fanon dans l’éclatante cymbale du soleil d’Algérie, en 1953, au moment où il entame à vingt-huit ans son précieux travail de chef de service à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville. Et dans la suite de notre vision, nous le considérons telle une radiation de la colère, effaré, subjugué, ulcéré par l’héritage d’une pratique raciste et colonialiste de la psychiatrie, comme elle fut instituée par Antoine Porot, funeste et malavisé pionnier de l’École Psychiatrique d’Alger qui justifiait scientifiquement – ou du moins croyait le faire – l’infériorité des musulmans d’Afrique du Nord par rapport aux représentants des forces coloniales françaises. En réaction immédiate à cette rémanente barbarie des blouses blanches, Frantz Fanon, aussi bien à la manière d’un réformateur de la médecine que d’un opérateur de réhabilitation des opprimés, se met à exercer sur les esprits malades un double travail : d’une part une thérapeutique beaucoup moins invasive, aux antipodes des électrochocs et des lobotomies qui détruisaient plus qu’ils ne réparaient, qui achevaient finalement de rabaisser au niveau de l’objet les sujets arabes de la souffrance mentale, et, d’autre part, une libération du psychisme par l’entremise d’un opportun discours de relaxe, d’une parole de déculpabilisation en capacité de renverser les torts – le prévenu devenant le juge et le juge devenant le coupable (sans autre forme de procès que le procès de l’évidence humaine s’accordant les pleins pouvoirs légitimes de déterminer l’inhumanité de ceux qui étaient venus avec la prétention d’éclairer de leurs lumières européennes le monde soi-disant ténébreux des primitifs du Maghreb). Et le déclenchement de la guerre d’indépendance algérienne en 1954 ne fera que confirmer le cumul des exaspérations de Frantz Fanon à l’égard de la France et des Français, à tel point que celui-ci, au fur et à mesure que se consolidaient les volontés de décolonisation, se sentait de moins en moins un citoyen né sous la bannière tricolore, mais de plus en plus un enfant de l’Algérie, jusqu’à ce qu’il parachève la palinodie de son identité en s’auto-déterminant fennec à part entière (1).
Nous voulons d’abord imaginer le docteur Frantz Fanon dans l’éclatante cymbale du soleil d’Algérie, en 1953, au moment où il entame à vingt-huit ans son précieux travail de chef de service à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville. Et dans la suite de notre vision, nous le considérons telle une radiation de la colère, effaré, subjugué, ulcéré par l’héritage d’une pratique raciste et colonialiste de la psychiatrie, comme elle fut instituée par Antoine Porot, funeste et malavisé pionnier de l’École Psychiatrique d’Alger qui justifiait scientifiquement – ou du moins croyait le faire – l’infériorité des musulmans d’Afrique du Nord par rapport aux représentants des forces coloniales françaises. En réaction immédiate à cette rémanente barbarie des blouses blanches, Frantz Fanon, aussi bien à la manière d’un réformateur de la médecine que d’un opérateur de réhabilitation des opprimés, se met à exercer sur les esprits malades un double travail : d’une part une thérapeutique beaucoup moins invasive, aux antipodes des électrochocs et des lobotomies qui détruisaient plus qu’ils ne réparaient, qui achevaient finalement de rabaisser au niveau de l’objet les sujets arabes de la souffrance mentale, et, d’autre part, une libération du psychisme par l’entremise d’un opportun discours de relaxe, d’une parole de déculpabilisation en capacité de renverser les torts – le prévenu devenant le juge et le juge devenant le coupable (sans autre forme de procès que le procès de l’évidence humaine s’accordant les pleins pouvoirs légitimes de déterminer l’inhumanité de ceux qui étaient venus avec la prétention d’éclairer de leurs lumières européennes le monde soi-disant ténébreux des primitifs du Maghreb). Et le déclenchement de la guerre d’indépendance algérienne en 1954 ne fera que confirmer le cumul des exaspérations de Frantz Fanon à l’égard de la France et des Français, à tel point que celui-ci, au fur et à mesure que se consolidaient les volontés de décolonisation, se sentait de moins en moins un citoyen né sous la bannière tricolore, mais de plus en plus un enfant de l’Algérie, jusqu’à ce qu’il parachève la palinodie de son identité en s’auto-déterminant fennec à part entière (1). Ce n’était là du reste que la conséquence assez prévisible d’une vie angoissée – marquée par le tourment comme si elle avait toujours anticipé sa fatale brièveté – qui avait déjà commencé dans les brisants bas-côtés de l’identité française, par une naissance martiniquaise à Fort-de-France en 1925, par une instinctive rumination du problème calamiteusement millénaire de la couleur de peau, ou, pour l’exprimer avec un surcroît de spontanéité critique, par une progressive absence d’illusion concernant la nature du respect de la France métropolitaine à l’égard de ses territoires d’outre-mer (ainsi qu’à l’endroit de tous ses dissemblables d’un point de vue dermatologique et urbanistique). Il faut dire et redire que Frantz Fanon avait été à bonne école : il a souvent eu la chance d’entendre parler de l’enseignement d’Aimé Césaire au lycée Schœlcher de Fort-de-France (2), et, par ailleurs, il a été le diligent témoin des luttes extra-scolaires du poète originaire de Basse-Pointe, des combats politiques de ce professeur de lettres qui n’a jamais cessé de travailler le sens profond de son retour au pays natal (3), d’être travaillé par l’immense portée de son expérience de Noir étudiant parmi les établissements prestigieux de Paris et du violent contraste ressenti lors de sa réinstallation sur la terre de Martinique, en 1939, où il a tant suffoqué devant l’ampleur des inégalités. Non pas qu’elles étaient demeurées inaperçues en France, car Césaire, en compagnie de Senghor et d’autres propices éveilleurs de conscience, avait là-bas interrogé ou dénoncé le sentiment généralisé d’un malaise des laissés-pour-compte, malaise au sein duquel se recrutait la jeunesse à la peau noire, cette jeunesse autochtone ou émigrante qui s’attendait à trouver en France, sur les doctes bancs progressistes de l’université, la substantielle pédagogie de l’universalisme et qui se rendait compte alors du décalage entre un idéal intégrateur et un réel désintégrateur : on voulait bien admettre que les Noirs fussent des sujets de conversation, des différences pensées selon les catégories de la solidarité, des notions pour les sciences humaines, mais il était tacite qu’ils ne devaient pas être les sujets palpables de la société occidentale. Non pas, donc, que les inégalités étaient passées au travers du tamis d’Aimé Césaire comme un neutre sable fin, mais elles n’en étaient devenues que plus fortes à l’heure de revenir au milieu même de ceux qui ne sont jamais un milieu de la vie parce qu’ils sont perpétuellement appréhendés d’après les taxinomies de la périphérie – de la moindre vie ou de la vie qui n’en est pas une et dont on peut faire à peu près ce que bon nous semble (comme la coloniser afin d’en exploiter les ultimes vitalités).
De là procède une recrudescence de la bagarre théorique et de la praxis engagée du côté de Frantz Fanon. Il s’empare de toute urgence des avancées d’Aimé Césaire et des représentations du monde un tant soit peu soulagées par l’invention du concept de négritude. La frénésie de cet impératif de pugilat contre un monde aménagé pour les uns (les caucasiens) et troublé pour les autres (c’est-à-dire le nègre dans toute l’étendue des chromatismes de carnation suspectés de bassesse) s’explique d’emblée par le tempérament combatif de Fanon, mais, aussi et d’une façon plus énigmatique, par son éventuelle prévision ou son officieux présage d’une existence qui allait être abrégée en raison de la maladie. Dès le début de son militantisme et de son œuvre concrète de soin pour les dominés, il a dû sentir qu’il fallait se dépêcher, non seulement parce qu’il ne faut jamais temporiser avec les injustices, mais encore parce que la succession de ces injustices qu’il découvrait tant à l’échelle de son travail particulier qu’à l’échelle planétaire d’une réticulation de la cruauté ségrégationniste devait chaque fois épancher en lui des flots amers de révulsion, de dangereuses marées de mélancolie qui l’ont possiblement adjugé au désastre d’une mortelle somatisation. En un mot, plus Frantz Fanon s’avançait sur le chemin de la justice, plus il en mourait, comme un conscient et transitoire principe de radicalisation des idées d’Aimé Césaire, comme un homme qui se savait condamné à une mort prématurée en agissant de la sorte et qui ne pouvait faire autrement, espérant dénouer quelque peu le nœud coulant pétrifiant la respiration de toutes les fraternités oppressées, de tous ceux qui étaient astreints à subir le fouet des lois mauvaises et la férule des préjugés.
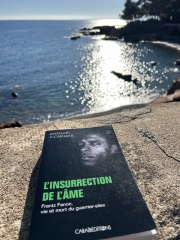 Il en a résulté une spécification du système de l’impérialisme colonisateur et une définition des traumatismes vécus dans les rangs des colonisés. Néanmoins, à l’instar de tous les textes fondateurs ou continuateurs d’un ordre de la sainte et parabolique chevalerie appelée à rendre la justice, les écrits de Frantz Fanon dépassent la quadrature de l’enfer colonial et incitent à questionner la persévérance du colonialisme sur un grand nombre de strates de l’organisation sociale. Et au sommet de ces dépôts de domination se tiennent les dispensés du monde de la nécessité, les déchargés de la dure charge de la vie, parce que ce sont eux qui ont déposé sur le dos des nécessiteux toutes les nécessités qui auraient pu être atténuées si elles n’avaient pas été envisagées iniquement dans la perspective ordonnée ou soi-disant honnête de la civilisation. En d’autres termes, vis-à-vis de ce qui est et qui ne peut pas ne pas être, comme le fait que la vie soit limitée dans sa durée, certains, au détriment de trop nombreuses personnes, ont réussi à s’extraire provisoirement de la nécessité de mourir en accélérant la mortalité de certains autres. En outre, comme il est depuis longtemps nécessaire que tout se fasse par les intermédiaires de l’argent, certains, par l’entremise de la ruse, du profit et du faux mérite des héritages de capitaux, se sont affranchis des risques de tomber dans l’indigence en multipliant ce risque pour ceux qui ont déjà la défaveur de leur naissance au cœur de familles ou de pays contraints de se battre tous les jours non pas pour s’épanouir dans la vie, non pas pour se choisir un avenir, mais uniquement pour ne pas mourir. Or tout individu qui se reconnaît dans cette asphyxie permanente de l’existence est un nègre de la négritude. Le souci, évidemment, c’est que la couleur de la peau des gens qui sont socialement asphyxiés a tendance à vérifier l’invariant des peaux brunes et ces masses de déshérités apparaissent aux Blancs déshérités moins à l’égal de frères en nécessité qu’à l’égal d’ennemis qui seraient responsables des misères du monde des caucasiens rançonnés par les mêmes agents de l’extorsion de fonds. Cette confusion retarde lato sensu la possibilité d’une révolte à l’encontre des machinistes de la monopolisation des richesses et entretient stricto sensu la tragédie des tragédiens de la déshérence. Et plus le temps passe, plus la ligne de démarcation entre les dominants et les dominés se repère moins sous les aspects d’une frontière anthropologiquement configurée que sous les aspects d’un cordon naturel nécessaire qu’il ne vaut même plus la peine de révoquer en doute. Si les dominés pouvaient d’ailleurs totalement assimiler leur domination comme un fait de la nature au lieu de la comprendre ou de la pressentir comme un fait social, alors tout renversement potentiel des valeurs établies les plus nuisibles disparaîtrait.
Il en a résulté une spécification du système de l’impérialisme colonisateur et une définition des traumatismes vécus dans les rangs des colonisés. Néanmoins, à l’instar de tous les textes fondateurs ou continuateurs d’un ordre de la sainte et parabolique chevalerie appelée à rendre la justice, les écrits de Frantz Fanon dépassent la quadrature de l’enfer colonial et incitent à questionner la persévérance du colonialisme sur un grand nombre de strates de l’organisation sociale. Et au sommet de ces dépôts de domination se tiennent les dispensés du monde de la nécessité, les déchargés de la dure charge de la vie, parce que ce sont eux qui ont déposé sur le dos des nécessiteux toutes les nécessités qui auraient pu être atténuées si elles n’avaient pas été envisagées iniquement dans la perspective ordonnée ou soi-disant honnête de la civilisation. En d’autres termes, vis-à-vis de ce qui est et qui ne peut pas ne pas être, comme le fait que la vie soit limitée dans sa durée, certains, au détriment de trop nombreuses personnes, ont réussi à s’extraire provisoirement de la nécessité de mourir en accélérant la mortalité de certains autres. En outre, comme il est depuis longtemps nécessaire que tout se fasse par les intermédiaires de l’argent, certains, par l’entremise de la ruse, du profit et du faux mérite des héritages de capitaux, se sont affranchis des risques de tomber dans l’indigence en multipliant ce risque pour ceux qui ont déjà la défaveur de leur naissance au cœur de familles ou de pays contraints de se battre tous les jours non pas pour s’épanouir dans la vie, non pas pour se choisir un avenir, mais uniquement pour ne pas mourir. Or tout individu qui se reconnaît dans cette asphyxie permanente de l’existence est un nègre de la négritude. Le souci, évidemment, c’est que la couleur de la peau des gens qui sont socialement asphyxiés a tendance à vérifier l’invariant des peaux brunes et ces masses de déshérités apparaissent aux Blancs déshérités moins à l’égal de frères en nécessité qu’à l’égal d’ennemis qui seraient responsables des misères du monde des caucasiens rançonnés par les mêmes agents de l’extorsion de fonds. Cette confusion retarde lato sensu la possibilité d’une révolte à l’encontre des machinistes de la monopolisation des richesses et entretient stricto sensu la tragédie des tragédiens de la déshérence. Et plus le temps passe, plus la ligne de démarcation entre les dominants et les dominés se repère moins sous les aspects d’une frontière anthropologiquement configurée que sous les aspects d’un cordon naturel nécessaire qu’il ne vaut même plus la peine de révoquer en doute. Si les dominés pouvaient d’ailleurs totalement assimiler leur domination comme un fait de la nature au lieu de la comprendre ou de la pressentir comme un fait social, alors tout renversement potentiel des valeurs établies les plus nuisibles disparaîtrait.  Le danger d’une accoutumance à la servitude saisie comme une donnée naturelle implique ni plus ni moins l’abolition de la liberté, à savoir, en dernier ressort, l’abolition de l’homme. Ce que peut la liberté dans son principe, le pouvoir qu’elle confère au sujet examiné dans son inaliénable droit de vivre, c’est, tel que l’écrit Simone de Beauvoir, la faculté de dépassement de n’importe quel registre du donné afin de se projeter «vers un avenir ouvert» (4) où toutes les déterminations auraient à craindre les libres forces de l’aléatoire. Rien ne devrait consister en une fermeture des possibles politiquement admise, en une forme d’accommodement paresseux devant les préjudices flagrants ou à plus forte raison en un verrou caucasien cristallisé à l’encontre des populations de couleur. Et quels sont les projets de la colonisation et de ses mystifiants avatars si ce n’est la volonté d’enseigner le mythe des supériorités et des infériorités naturelles en vue de maintenir les transcendances de la liberté dans un état végétatif ? Quelles sont les aspirations du monde prétendument dominateur si ce n’est la tentative de supprimer la pression intérieure de la liberté à dessein de soumettre le monde prétendument dominé à la seule pression extérieure de la nécessité ? S’il y parvenait, et c’est une chose que l’on peut redouter à la longue, alors la vie des captifs, la non-vie des subordonnés – nous l’évoquions et nous devons désormais l’écrire avec une justesse plus appropriée – se résumerait à l’illusion d’une liberté qui se contenterait de croire qu’elle a fait les choix pertinents pour avoir su vivre un jour supplémentaire. Autant dire le cas échéant que cette réalité attesterait d’une extinction de l’espèce humaine car des hommes qui usent de leur liberté pour que d’autres hommes n’en usent point, ce sont des libertés, à l’une ou l’autre des extrémités où l’on se place, qui n’existent pas dans la mesure où être libre revient d’abord à se sentir responsable, comme aurait pu vivement le soutenir Jankélévitch, de l’intensité de la bonté que l’on veut inscrire dans son acte ou dans sa parole. Mais l’oppresseur ne veut pas être bon et l’oppressé ne peut pas l’être eu égard à l’absence de signification de son acte ou de sa parole dans un monde qui le réduit à l’immobilisme et au silence, aussi faut-il admettre une faillite de l’homme, ou, à tout le moins, une souhaitable liquidation de notre modèle de civilisation qui a presque terminé d’aménager l’impossibilité de vivre pour beaucoup trop de nos semblables. Ce qui ne va pas, ce qui est inadmissible, c’est l’admissibilité d’une situation mondialisée où il est devenu envisageable que quelques-uns se croient autorisés à vouloir être Tout aux dépens d’une multitude réduite à Rien par le truchement de ce délirant vouloir-totalitaire (5). Et c’est à partir de ce dérèglement toléré des volontés d’omnipotence que se clarifie le tragique de l’abandon d’une énorme portion de la Terre que Frantz Fanon a caractérisée comme des endroits de la damnation, des lieux de la malédiction, des zones réprouvées non par un Satan biblique, non par un Adversaire ou un Accusateur trônant parmi les intangibles domaines du Mal, mais par l’homme, par la tangible banalité de l’homme cupide et affamé de régner en maître sur des foules asservies.
Le danger d’une accoutumance à la servitude saisie comme une donnée naturelle implique ni plus ni moins l’abolition de la liberté, à savoir, en dernier ressort, l’abolition de l’homme. Ce que peut la liberté dans son principe, le pouvoir qu’elle confère au sujet examiné dans son inaliénable droit de vivre, c’est, tel que l’écrit Simone de Beauvoir, la faculté de dépassement de n’importe quel registre du donné afin de se projeter «vers un avenir ouvert» (4) où toutes les déterminations auraient à craindre les libres forces de l’aléatoire. Rien ne devrait consister en une fermeture des possibles politiquement admise, en une forme d’accommodement paresseux devant les préjudices flagrants ou à plus forte raison en un verrou caucasien cristallisé à l’encontre des populations de couleur. Et quels sont les projets de la colonisation et de ses mystifiants avatars si ce n’est la volonté d’enseigner le mythe des supériorités et des infériorités naturelles en vue de maintenir les transcendances de la liberté dans un état végétatif ? Quelles sont les aspirations du monde prétendument dominateur si ce n’est la tentative de supprimer la pression intérieure de la liberté à dessein de soumettre le monde prétendument dominé à la seule pression extérieure de la nécessité ? S’il y parvenait, et c’est une chose que l’on peut redouter à la longue, alors la vie des captifs, la non-vie des subordonnés – nous l’évoquions et nous devons désormais l’écrire avec une justesse plus appropriée – se résumerait à l’illusion d’une liberté qui se contenterait de croire qu’elle a fait les choix pertinents pour avoir su vivre un jour supplémentaire. Autant dire le cas échéant que cette réalité attesterait d’une extinction de l’espèce humaine car des hommes qui usent de leur liberté pour que d’autres hommes n’en usent point, ce sont des libertés, à l’une ou l’autre des extrémités où l’on se place, qui n’existent pas dans la mesure où être libre revient d’abord à se sentir responsable, comme aurait pu vivement le soutenir Jankélévitch, de l’intensité de la bonté que l’on veut inscrire dans son acte ou dans sa parole. Mais l’oppresseur ne veut pas être bon et l’oppressé ne peut pas l’être eu égard à l’absence de signification de son acte ou de sa parole dans un monde qui le réduit à l’immobilisme et au silence, aussi faut-il admettre une faillite de l’homme, ou, à tout le moins, une souhaitable liquidation de notre modèle de civilisation qui a presque terminé d’aménager l’impossibilité de vivre pour beaucoup trop de nos semblables. Ce qui ne va pas, ce qui est inadmissible, c’est l’admissibilité d’une situation mondialisée où il est devenu envisageable que quelques-uns se croient autorisés à vouloir être Tout aux dépens d’une multitude réduite à Rien par le truchement de ce délirant vouloir-totalitaire (5). Et c’est à partir de ce dérèglement toléré des volontés d’omnipotence que se clarifie le tragique de l’abandon d’une énorme portion de la Terre que Frantz Fanon a caractérisée comme des endroits de la damnation, des lieux de la malédiction, des zones réprouvées non par un Satan biblique, non par un Adversaire ou un Accusateur trônant parmi les intangibles domaines du Mal, mais par l’homme, par la tangible banalité de l’homme cupide et affamé de régner en maître sur des foules asservies.Ainsi apparaît une dichotomie entre les tragédiens du tragique de l’existence abandonnée et ces individus que nous appellerons les héros ou les profiteurs de l’épopée vivante. Pour les acteurs de l’épopée, la vie est chaque fois vécue dans sa version intrinsèquement épique et elle apporte son lot ininterrompu d’aventures, de telle manière que l’homme de l’épopée ne connaît que le sentiment matutinal des choses : pour lui l’ensemble des composantes de la vie sont des soleils qui se lèvent, des astres ascendants, des phénomènes de croissance qui font oublier la réalité du répertoire des décroissances ou les ombres comminatoires des probabilités d’échouer. Si l’on traduit cela dans un vocabulaire plus frontal, moins allégorique, on obtient le portrait de l’homme fort, la physiologie du maître et du possesseur des occasions de mener une vie pleine, homérique et exemplaire par sa réussite, peut-être même le type de personnage qui serait enclin à réveiller le mot de Mussolini, tiré d’un discours du 2 avril 1924, où le condottiere du fascisme se gargarisait de recommander à son audience de «vivre dangereusement» (6). Tel est le sens de l’épopée qui suppose une combinaison d’exaltation, de frisson et de témérité, une continuelle rhétorique de la prise de risque assortie de preuves que les risques ont été pris et surmontés. Mais l’on repère tout de suite dans la perspective qui nous intéresse que se manifeste là qualcosa sotto, en cela que le grand danger dont les députés de la vie épique s’estiment les vainqueurs ne les a jamais vraiment concernés. Au contraire, ce danger, cette menace, relève en propre de ceux qui prétendent y avoir été exposés. En un mot : ils sont le danger parce qu’ils ne sont pas en danger et que les moyens qu’ils détiennent pour ne pas l’être mettent en danger ceux qui savent intimement ce qu’il en est de vivre sous la menace. Aussi l’épopée des hommes forts n’est matinale dans son essence que sur la base de sa certitude de demeurer une aurore qui suscite à l’autre bout des gradations existentielles un crépuscule tragique pour les hommes victimes d’une présomption de faiblesse. Tant et si bien que si nous avons des vies tout à fait dominatrices d’un côté, c’est que, d’un autre côté, nous avons des vies tout à fait dominées, les premières étant les pillardes des secondes, en tout cas du point de vue des méprisables procédés de colonisation et des mécanismes de confiscation des droits fondamentaux de vivre dignement. C’est pourquoi le héros de la tragédie l’est sûrement davantage que le héros ambigu de l’épopée, quoique l’héroïsme tragique soit ici assigné non pas aux spectaculaires accomplissements de la vie épique, mais aux résistances qu’il doit incarner contre les faisceaux de la décomposition. En effet, ce à quoi les tragédiens de la négritude sont assujettis, ce qui les empêche d’expérimenter le levant de la vie, ce sont les instances de la désintégration, les retombées de la corruption en tant que celle-ci s’élucide au préalable comme l’opposé de la génération (en tant que le nègre – qui peut être blanc de peau – est toujours initialement l’homme qui doit mourir sans avoir aucunement engendré, sans avoir fécondé, sans avoir été fertile dans la chair ou dans l’esprit ou dans les deux à la fois). D’où le crépuscule de cette condition de la vie mutilée : la tragédie s’énonce alors comme l’antinomie pure de l’épopée parce que tout en elle est un écroulement, une chute des astres, une terrible impression vespérale des choses.
Par déduction vis-à-vis de tout ce qui précède et par conformité aux convictions de Frantz Fanon, il serait malhonnête de ne pas
 mieux préciser la personnalité des tenants de l’épopée. Si l’on se borne aux seuls processus de la colonisation, alors, pour les hommes embusqués de la vie épique, la décision de coloniser surgit aussitôt à l’instar d’une promesse d’exotisme, comme un sûr exotisme des lointains qui viendrait se surajouter à la sécurité de l’exotisme des surprises de proximité (qu’on se figure, à titre d’illustration des toutes proches sensations fortes, un nanti de l’épopée prolongeant de plusieurs arrêts son trajet dans le métro parisien et descendant à Château Rouge, puis remontant sur la même ligne après avoir pris un café, après avoir un peu observé en modèle réduit le continent des tragédiens, se dirigeant cette fois-ci à son appartement de Saint-Germain-des-Prés). Dans la vie conçue selon le galvanisant chapitrage de l’épopée, la colonisation est synonyme de voyage, elle est une copieuse ration de pittoresque, et, du reste, même dans les pays a priori décolonisés, les héros de la grandiloquence vitale s’y rendent aux fins d’augmenter le vertige bourgeois du pseudo-danger, de la pseudo-difficulté de vivre. Et que ce soit aux colonies ou dans les anciens comptoirs coloniaux, ils y vont avec l’assurance de le faire de bon cœur et d’être des exemples de générosité active. Ce sont, tout bien considéré, des expatriés assurés de leur rapatriement et qui raconteront à qui voudra les écouter leurs exploits humanitaires, la façon dont ils ont offert aux tragédiens les ressources de l’épopée. Ainsi se dessinent les contours de l’utopie de l’humanisme bourgeois qui préside à toutes les intentions de colonisation : nous venons toujours pour ajouter quelque chose à votre quotidien et jamais pour vous soustraire quoi que ce soit. Mais toute utopie est absolument sans lieu, a-topique, et s’il se dégage une indéniable vérité de la colonisation justifiée par l’humanisme, c’est la scélérate transformation du lieu de la colonisation en total non-lieu pour les colonisés, en déterritorialisation, en dé-spatialisation – tout l’espace de la vie se trouvant comme absorbé par l’envahisseur prospère et moralisateur afin d’être expédié dans les lieux avérés de la prospérité. Autrement dit l’utopie des bourgeois fonctionne à contre-emploi : elle n’amène pas un espace idéal qu’elle va essayer de rendre possible, elle vient à l’inverse perturber un idéal en prétextant qu’il est une débâcle, tout en semant le désordre et en s’emparant des forces de travail locales pour produire des richesses qui seront vite exportées, vampirisant de ce fait l’espace occupé, le lieu investi, plutôt que de s’en faire le licite et nourricier lieutenant. Et nous ne dirons peut-être jamais suffisamment que cette utopie est l’une des pires, sinon la pire, parce qu’elle n’est inspirée que par le capitalisme (ce qui la distingue des utopies marxiste et fasciste, l’une étant le rêve fou de l’ouvrier triomphateur de la bourgeoisie, l’autre étant le rêve aberrant de la pureté raciale). Elle est également la pire, sans doute, parce qu’elle dure, et, si elle dure là où les utopies antécédentes ont été démantelées, c’est en raison de ses machiavéliques collusions avec le mercantilisme étant donné que le commerce tire avantage d’un très gros potentiel d’autojustification. Sa durée corruptrice entraîne par ailleurs un insistant dispositif de répression de la conscience car tout ce qui dure finit par prendre la place de la vérité, et, partant, toute déviation par rapport à la vérité sera directement ou indirectement réprimée. En conséquence, ne pas être un sectateur de la colonisation, ou, alors, ne pas être un colonisé docile, que l’on se situe à pile ou face de cette infecte monnaie de faux-monnayeur, c’est être perçu à travers les mailles du mensonge ou du soupçon d’incohérence. Et qu’est-ce qui s’éternise au fondement même de cette durée, qu’est-ce qui l’entretient, sinon, dans sa moelle, ses propres moyens financiers de durer ? Se développe de la sorte une durée durative de l’argent qui ratifie la plus néfaste architecture de l’esclavage de tous les temps car elle prétend libérer l’homme par le numéraire et par les biens matériels – par le calme contentement d’être un fier possédant (fût-ce de capitaux virtuels) alors même que cette possession contente d’elle-même provoque le tumulte et la dépossession de par le monde. Mais puisque plus personne ou presque, dorénavant, ne s’insurge véritablement contre cette satisfaction des uns au préjudice de tant d’autres, puisque les épopées de l’argent ont remporté une victoire morale devant les conjonctures tragiques qu’elles ont elles-mêmes créées, puisque les échanges, dans leur écrasante majorité, se saisissent par le biais d’une conception catallactique, alors on ne voit guère comment repérer une issue rédemptrice au sein de cette utopie bourgeoise d’autant plus terrible que son allure modérée infère des violences d’un genre inédit et difficile à contester. Il s’agit en outre de ne pas se leurrer devant cette symptomatique modération de l’utopie bourgeoise : elle participe uniment de la durée maléfique des lois de l’économie en cela qu’elle a su malignement se séparer des disciplines martiales consubstantielles à l’utopie marxiste et à l’utopie fasciste. Elle a métabolisé d’une certaine manière, et sans aucun scrupule, les divers éléments rigides du marxisme et du fascisme tout en les assouplissant par l’intermédiaire de l’idéal consumériste et productiviste au nom des sacro-saints besoins de l’homme moderne. Là réside la perfide malignité, le rusé maléfice à visage humain, et, en définitive, il est assez facile à présent de se représenter le bonheur du Diable, la joie des démons, tout heureux de s’apercevoir que les hommes sont parvenus à échafauder une méthode qui permet au Mal de durer tout en se faisant passer pour le Bien – le Malin est adroit, il est patient dans ses entreprises, il a toujours su jouer la montre, cependant, au vu de l’utopie de l’humanisme bourgeois, le Malin s’incline et concède qu’il a pris une leçon.
mieux préciser la personnalité des tenants de l’épopée. Si l’on se borne aux seuls processus de la colonisation, alors, pour les hommes embusqués de la vie épique, la décision de coloniser surgit aussitôt à l’instar d’une promesse d’exotisme, comme un sûr exotisme des lointains qui viendrait se surajouter à la sécurité de l’exotisme des surprises de proximité (qu’on se figure, à titre d’illustration des toutes proches sensations fortes, un nanti de l’épopée prolongeant de plusieurs arrêts son trajet dans le métro parisien et descendant à Château Rouge, puis remontant sur la même ligne après avoir pris un café, après avoir un peu observé en modèle réduit le continent des tragédiens, se dirigeant cette fois-ci à son appartement de Saint-Germain-des-Prés). Dans la vie conçue selon le galvanisant chapitrage de l’épopée, la colonisation est synonyme de voyage, elle est une copieuse ration de pittoresque, et, du reste, même dans les pays a priori décolonisés, les héros de la grandiloquence vitale s’y rendent aux fins d’augmenter le vertige bourgeois du pseudo-danger, de la pseudo-difficulté de vivre. Et que ce soit aux colonies ou dans les anciens comptoirs coloniaux, ils y vont avec l’assurance de le faire de bon cœur et d’être des exemples de générosité active. Ce sont, tout bien considéré, des expatriés assurés de leur rapatriement et qui raconteront à qui voudra les écouter leurs exploits humanitaires, la façon dont ils ont offert aux tragédiens les ressources de l’épopée. Ainsi se dessinent les contours de l’utopie de l’humanisme bourgeois qui préside à toutes les intentions de colonisation : nous venons toujours pour ajouter quelque chose à votre quotidien et jamais pour vous soustraire quoi que ce soit. Mais toute utopie est absolument sans lieu, a-topique, et s’il se dégage une indéniable vérité de la colonisation justifiée par l’humanisme, c’est la scélérate transformation du lieu de la colonisation en total non-lieu pour les colonisés, en déterritorialisation, en dé-spatialisation – tout l’espace de la vie se trouvant comme absorbé par l’envahisseur prospère et moralisateur afin d’être expédié dans les lieux avérés de la prospérité. Autrement dit l’utopie des bourgeois fonctionne à contre-emploi : elle n’amène pas un espace idéal qu’elle va essayer de rendre possible, elle vient à l’inverse perturber un idéal en prétextant qu’il est une débâcle, tout en semant le désordre et en s’emparant des forces de travail locales pour produire des richesses qui seront vite exportées, vampirisant de ce fait l’espace occupé, le lieu investi, plutôt que de s’en faire le licite et nourricier lieutenant. Et nous ne dirons peut-être jamais suffisamment que cette utopie est l’une des pires, sinon la pire, parce qu’elle n’est inspirée que par le capitalisme (ce qui la distingue des utopies marxiste et fasciste, l’une étant le rêve fou de l’ouvrier triomphateur de la bourgeoisie, l’autre étant le rêve aberrant de la pureté raciale). Elle est également la pire, sans doute, parce qu’elle dure, et, si elle dure là où les utopies antécédentes ont été démantelées, c’est en raison de ses machiavéliques collusions avec le mercantilisme étant donné que le commerce tire avantage d’un très gros potentiel d’autojustification. Sa durée corruptrice entraîne par ailleurs un insistant dispositif de répression de la conscience car tout ce qui dure finit par prendre la place de la vérité, et, partant, toute déviation par rapport à la vérité sera directement ou indirectement réprimée. En conséquence, ne pas être un sectateur de la colonisation, ou, alors, ne pas être un colonisé docile, que l’on se situe à pile ou face de cette infecte monnaie de faux-monnayeur, c’est être perçu à travers les mailles du mensonge ou du soupçon d’incohérence. Et qu’est-ce qui s’éternise au fondement même de cette durée, qu’est-ce qui l’entretient, sinon, dans sa moelle, ses propres moyens financiers de durer ? Se développe de la sorte une durée durative de l’argent qui ratifie la plus néfaste architecture de l’esclavage de tous les temps car elle prétend libérer l’homme par le numéraire et par les biens matériels – par le calme contentement d’être un fier possédant (fût-ce de capitaux virtuels) alors même que cette possession contente d’elle-même provoque le tumulte et la dépossession de par le monde. Mais puisque plus personne ou presque, dorénavant, ne s’insurge véritablement contre cette satisfaction des uns au préjudice de tant d’autres, puisque les épopées de l’argent ont remporté une victoire morale devant les conjonctures tragiques qu’elles ont elles-mêmes créées, puisque les échanges, dans leur écrasante majorité, se saisissent par le biais d’une conception catallactique, alors on ne voit guère comment repérer une issue rédemptrice au sein de cette utopie bourgeoise d’autant plus terrible que son allure modérée infère des violences d’un genre inédit et difficile à contester. Il s’agit en outre de ne pas se leurrer devant cette symptomatique modération de l’utopie bourgeoise : elle participe uniment de la durée maléfique des lois de l’économie en cela qu’elle a su malignement se séparer des disciplines martiales consubstantielles à l’utopie marxiste et à l’utopie fasciste. Elle a métabolisé d’une certaine manière, et sans aucun scrupule, les divers éléments rigides du marxisme et du fascisme tout en les assouplissant par l’intermédiaire de l’idéal consumériste et productiviste au nom des sacro-saints besoins de l’homme moderne. Là réside la perfide malignité, le rusé maléfice à visage humain, et, en définitive, il est assez facile à présent de se représenter le bonheur du Diable, la joie des démons, tout heureux de s’apercevoir que les hommes sont parvenus à échafauder une méthode qui permet au Mal de durer tout en se faisant passer pour le Bien – le Malin est adroit, il est patient dans ses entreprises, il a toujours su jouer la montre, cependant, au vu de l’utopie de l’humanisme bourgeois, le Malin s’incline et concède qu’il a pris une leçon. En d’autres termes, l’humanisme bourgeois est impudemment cruel parce qu’il jouit d’une publicité de bienfaisance, et il l’est tant et plus qu’il injecte à doses homéopathiques, dans tout son arsenal d’expédients colonisateurs, des munitions marxisantes et fascisantes, c’est-à-dire, d’une part, des optiques émancipatrices qui nous feraient quasiment confondre le colon avec un sauveur, et, d’autre part, des optiques eugénistes qui avancent masquées en utilisant les alibis d’un putatif sens de l’Histoire ou la rengaine apologiste de la fraternelle rencontre des peuples. Et comme tout cela se réalise dans la sobriété, dans l’insoupçonnable monotonie de la médiocrité bourgeoise, on assiste alors à la naissance d’une sorte de voie moyenne où se trame un nouvel extrémisme. On ne peut du reste s’abstenir de convoquer la pensée pascalienne proclamant que ceux qui veulent faire l’ange finissent par faire la bête (7). Mais encore faut-il, selon Pascal, avoir la ferme intention d’être angélique pour sombrer ensuite dans le drame de l’angélisme désenchanté, au sens où, fort probablement, l’on sera déçu par la vanité d’avoir envisagé de faire le bien et rien que le bien, de s’être cru immaculé, compte tenu de l’inextirpable coefficient de méchanceté qui gît plus ou moins au sein de chaque homme et qu’il est de notre devoir d’accepter (à charge de faire le deuil de nos mirages consolateurs). Au fond l’angélisme est si peu compatible avec la nature humaine que l’homme qui chercherait à faire l’ange à tout prix s’affligerait tôt ou tard de son échec autant que du malheur qu’il aurait involontairement causé autour de lui ou loin de lui, comme si, infailliblement, la volonté de bien faire devait coïncider avec un certain pourcentage de malfaisance ici ou là-bas. Ceci étant posé, il est évident que tous les régisseurs de l’humanisme bourgeois savent qu’ils ne sont pas des anges, mais, en revanche, ils savent que l’on croit qu’ils sont séraphiques du fait de notre domestication. Ce sont ainsi des bêtes plus bestiales que les bêtes par défaut du raisonnement pascalien, et, dans cette aberrante provision de brutes, il y en a qui s’imaginent être des anges, atteignant des seuils inouïs de criminalité car ils ne seront jamais touchés par un quelconque travail de la conscience. Or les effets de domestication, les conséquences de l’intériorisation massive des normes bourgeoises, lamentablement, rallongent dans le temps la détresse des dominés. Il existe donc une dérangeante co-responsabilité des crimes de domination entre les dominants actifs dresseurs de foules et les dominants passifs domestiqués. C’est la raison pour laquelle Frantz Fanon est pleinement qualifié pour établir une dissonance entre les domestiqués contents de leur sort, aveugles et sourds, garants des politiques de l’autruche, puis les dominés qui connaissent qu’ils sont dominés, rongeant leur frein, bouillants de colère, au moins préservés par la dignité de leurs certitudes quand bien même les circonstances extérieures ne leur ouvrent pas la piste carrossable d’un juste et titanesque chamboulement de la (mal)donne. Reste que Frantz Fanon a su verbaliser le verbe de leurs silences informés ou de leurs cris de désolation, comme il a su faire éclore des vocations à la parole anticoloniale, tiers-mondiste, et, à ce titre-là, il a su être une puissance d’assèchement du trop long lacrymatoire des dominés.
 Le corollaire instantané de cet engagement invaincu pour les vaincus consiste en une nette identification des nouveaux états et empires de la barbarie où l’angélologie et la démonologie voient leurs cartes rebattues. Comme le poète W. H. Auden, le psychiatre Frantz Fanon n’a nullement été la dupe des apparences et il a saisi à la racine les propriétés d’une barbarie sans précédent, la sinistre nature d’une brutalité nichée au-dessus de toute méfiance, une violence pour ainsi dire rémissible, étrangère à la «rustrerie des habitants du désert», séparée des sauvages mandés par les «forêts de sapins» car familière des psychologies désaltérées à la mamelle des nations industrialisées, assimilée aux basses «logiques d’entreprise» et aux «villes universitaires» qui l’ont formatée, aux «journaux officiels» qui n’ont eu de cesse de «raffermir ses croyances» (8). Cette barbarie éduquée avait certes subi jadis les foudres du rousseauisme, mais, au siècle suivant, les étapes de l’expansion coloniale européenne ont tôt fait de fonder une équivalence entre les avancées de la science et le progrès moral, rendant sinon impensables, du moins suspectes, les envies de déceler dans le développement des techniques et des idées impériales l’empreinte d’un vice caché. Aussi les hommes cultivés se devaient d’aller répandre la culture dans les lointaines contrées stériles, d’aller socialiser le vandale, et, dès lors, quiconque se mettrait en travers de ces chemins de charité se verrait aussitôt marginalisé par les juridictions occidentales – tel Frantz Fanon séquestré par les terminologies de la controverse dans la bouche de ses détracteurs.
Le corollaire instantané de cet engagement invaincu pour les vaincus consiste en une nette identification des nouveaux états et empires de la barbarie où l’angélologie et la démonologie voient leurs cartes rebattues. Comme le poète W. H. Auden, le psychiatre Frantz Fanon n’a nullement été la dupe des apparences et il a saisi à la racine les propriétés d’une barbarie sans précédent, la sinistre nature d’une brutalité nichée au-dessus de toute méfiance, une violence pour ainsi dire rémissible, étrangère à la «rustrerie des habitants du désert», séparée des sauvages mandés par les «forêts de sapins» car familière des psychologies désaltérées à la mamelle des nations industrialisées, assimilée aux basses «logiques d’entreprise» et aux «villes universitaires» qui l’ont formatée, aux «journaux officiels» qui n’ont eu de cesse de «raffermir ses croyances» (8). Cette barbarie éduquée avait certes subi jadis les foudres du rousseauisme, mais, au siècle suivant, les étapes de l’expansion coloniale européenne ont tôt fait de fonder une équivalence entre les avancées de la science et le progrès moral, rendant sinon impensables, du moins suspectes, les envies de déceler dans le développement des techniques et des idées impériales l’empreinte d’un vice caché. Aussi les hommes cultivés se devaient d’aller répandre la culture dans les lointaines contrées stériles, d’aller socialiser le vandale, et, dès lors, quiconque se mettrait en travers de ces chemins de charité se verrait aussitôt marginalisé par les juridictions occidentales – tel Frantz Fanon séquestré par les terminologies de la controverse dans la bouche de ses détracteurs.Mis à l’index de son vivant ou par les jeux truqués de la postérité, Frantz Fanon, quoi qu’il en soit, n’est pas susceptible de désertion du champ de bataille où s’affrontent les chars d’assaut de Goliath et les lance-pierres de David. Qu’il soit incarné ou désincarné, d’hier ou d’aujourd’hui, le turbulent Frantz Fanon se dresse intact parmi les faibles : son indignation devant les dignités brisées lui a survécu de même que sa pensée. Car l’œuvre de Fanon est aussi bien une physique qu’une métaphysique, une vive description et une redoutable conceptualisation de l’oppression, une voix d’éternité dont il faut parier qu’elle vaincra in fine l’éternelle prééminence du fort sur le faible. C’est donc une œuvre large, viscérale et cérébrale, stimulante à tous les niveaux parce qu’elle dépend d’un cogito qui est descendu dans la douleur et d’une sensibilité douloureuse qui s’est hissée dans le cogito, grâce à quoi Frantz Fanon échappe à l’écueil d’un intellectualisme désinvesti, tiède et pédant. En le lisant, nous sentons et nous comprenons la douleur des persécutés, nous sommes interpellés par l’intelligente brusquerie de ce Diogène de Sinope qui nous parle sans détour afin de nous jeter dans l’hébétude qui prépare l’étude – dans la commotion qui entraîne la réflexion. Nous le savons : les mots de l’école cynique la plus traditionnelle sont les mots stupéfiants du courage de la vérité, les phrases de la vérité choquante qui servent à initier un dialogue après nous avoir interloqués. En ce sens, l’œuvre de Frantz Fanon est à nos yeux dotée d’un cynisme éducateur et vengeur, d’un aplomb bénéfique pour extraire le plomb dans les ailes des dominés et d’une témérité propre à faire baisser le pavillon des persécuteurs les plus témérairement persuadés de leur bon droit de persécuter. On en mesurera toute l’amplitude en parcourant quelques saillants propos des Damnés de la Terre, son texte majeur, son testament, sa cotisation pour l’immortalité qu’il dut principalement dicter à sa secrétaire Marie-Jeanne Manuellan, assistante sociale à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, puis à Josie (9), sa femme, tandis qu’une leucémie de type myéloïde achevait de lui porter l’estocade. Mais auparavant, puisque nous avons commencé par une image irradiante de Frantz Fanon, nous devons clore cette section par un effet de fractale, en agrandissant le motif de l’éclat, du halo, de la lumière qui insiste dans son être malgré l’obscurité montante de la mort. Et cette image d’un magistère des lueurs, nous la trouvons, récurrente, dans l’imagination du romancier John Edgar Wideman, auteur du Projet Fanon, livre dans lequel il souligne l’ironie d’une leucémie pour un homme noir, le sarcasme nosologique d’un «excès de cellules blanches, de leucocytes» en train de submerger Frantz Fanon «dans un hôpital de Bethesda» (10) où il mourra le 6 décembre 1961. S’il est tentant au premier abord de s’assombrir au regard de la fatalité pathologique et du symbole de la blancheur cellulaire mettant au tapis la noirceur pigmentaire, comme s’il s’agissait d’une victoire complète du blanc sur le noir, il nous semble cependant que cette inondation «de cellules neigeuses» leucémiques, cette offensive de la «tempête déchaînée» (11) des globules blancs, concerne moins le gabarit de la réalité sanguine que le plasma d’une invasion de la divine clarté dans un corps supplicié qui a fourni tant d’efforts de justice en si peu de temps passé sur la Terre.
Abscisses et ordonnées de la violence coloniale et de la violence libératrice
 La mort précoce de Frantz Fanon ne lui aura pas laissé l’opportunité de revenir sur certaines de ses idées ou à tout le moins de leur apporter un levain utile de clarification tant celles-ci, livrées à elles-mêmes et à tous les vents de l’interprétation, peuvent facilement ressembler à des bouffées de ressentiment ou des incitations à la haine. Et c’est sans aucun doute l’idée de la violence qui se démarque parmi les discussions posthumes autour de l’héritage intellectuel de Frantz Fanon : elle est même l’infrastructure des Damnés de la Terre (12) et elle a été hyperbolisée par la retentissante préface de Jean-Paul Sartre qui a parfois occulté le texte de l’auteur principal. Or l’usage de la violence n’est pas l’objet d’une promotion impulsive de la part de Frantz Fanon. Si la violence doit intervenir, elle ne le fait qu’à titre de violence indispensable de représailles, violence impérative de réparation d’un tort, violence de réappropriation vitale de ce qu’une violence initiale et illégitime aura commis. Dit d’une façon plus résolue, le colonisé, s’il en arrive là, n’est violent qu’en second lieu et légitimement, tandis que le colon est violent en premier lieu et illégitimement. La violence des dominés n’est alors jamais qu’une contre-attaque répondant à une attaque. Quant à l’objectif ultime et un peu idéaliste de cette violence réparatrice, il entend s’inscrire dans un panafricanisme universaliste, dans un tiers-mondisme entreprenant qui n’aurait de raison d’être qu’en étant arrimé au divers sensible du monde entier. Car, en effet, ce qu’il faut réparer, ce ne sont pas seulement les fractures du monde dominé, mais aussi les cassures du monde dominant : l’espoir serait ainsi de déraciner la vieille mandragore hurlante des catastrophes planétaires perpétrées de main d’homme et de réenraciner l’humanité au cœur même d’un monde commun destiné à la communauté humaine. En quoi le tiers-monde se verrait passer de tierce-présence dans les affaires du destin humain à une situation d’omniprésence parce qu’il aurait pris l’initiative d’une reconstruction générale de notre monde cassé (13). Mieux encore : le tiers-monde aurait donné le «la» d’une mise en route des conditions de possibilité pour réaliser les vœux d’enracinement de Simone Weil, à savoir que tout homme devrait avoir la chance d’être enraciné dans une terre, à quelque endroit que ce soit sur la Terre, de sorte à ce qu’il puisse étancher la soif humaine des besoins fondamentaux de l’humaine contexture – avoir de quoi se nourrir pour le corps et avoir de quoi nourrir les demandes abyssales de l’âme. Autant avouer dès lors que si la violence des dominés poursuit exactement la quête que nous venons de décrire, alors il ne peut être question que d’une violence définitivement abolitionniste de la violence, d’une violence qui serait vraiment la dernière de toutes les agressivités, d’une violence eschatologique, révélatrice, tutrice des suprêmes annonciations, donc en chemin vers les fins dernières d’un monde finissant parce que ce monde enfin décidé à venir à bout de ses agonies se serait mis en capacité d’accoucher d’un monde commençant où l’animalité de l’homme ne pourrait plus recommencer.
La mort précoce de Frantz Fanon ne lui aura pas laissé l’opportunité de revenir sur certaines de ses idées ou à tout le moins de leur apporter un levain utile de clarification tant celles-ci, livrées à elles-mêmes et à tous les vents de l’interprétation, peuvent facilement ressembler à des bouffées de ressentiment ou des incitations à la haine. Et c’est sans aucun doute l’idée de la violence qui se démarque parmi les discussions posthumes autour de l’héritage intellectuel de Frantz Fanon : elle est même l’infrastructure des Damnés de la Terre (12) et elle a été hyperbolisée par la retentissante préface de Jean-Paul Sartre qui a parfois occulté le texte de l’auteur principal. Or l’usage de la violence n’est pas l’objet d’une promotion impulsive de la part de Frantz Fanon. Si la violence doit intervenir, elle ne le fait qu’à titre de violence indispensable de représailles, violence impérative de réparation d’un tort, violence de réappropriation vitale de ce qu’une violence initiale et illégitime aura commis. Dit d’une façon plus résolue, le colonisé, s’il en arrive là, n’est violent qu’en second lieu et légitimement, tandis que le colon est violent en premier lieu et illégitimement. La violence des dominés n’est alors jamais qu’une contre-attaque répondant à une attaque. Quant à l’objectif ultime et un peu idéaliste de cette violence réparatrice, il entend s’inscrire dans un panafricanisme universaliste, dans un tiers-mondisme entreprenant qui n’aurait de raison d’être qu’en étant arrimé au divers sensible du monde entier. Car, en effet, ce qu’il faut réparer, ce ne sont pas seulement les fractures du monde dominé, mais aussi les cassures du monde dominant : l’espoir serait ainsi de déraciner la vieille mandragore hurlante des catastrophes planétaires perpétrées de main d’homme et de réenraciner l’humanité au cœur même d’un monde commun destiné à la communauté humaine. En quoi le tiers-monde se verrait passer de tierce-présence dans les affaires du destin humain à une situation d’omniprésence parce qu’il aurait pris l’initiative d’une reconstruction générale de notre monde cassé (13). Mieux encore : le tiers-monde aurait donné le «la» d’une mise en route des conditions de possibilité pour réaliser les vœux d’enracinement de Simone Weil, à savoir que tout homme devrait avoir la chance d’être enraciné dans une terre, à quelque endroit que ce soit sur la Terre, de sorte à ce qu’il puisse étancher la soif humaine des besoins fondamentaux de l’humaine contexture – avoir de quoi se nourrir pour le corps et avoir de quoi nourrir les demandes abyssales de l’âme. Autant avouer dès lors que si la violence des dominés poursuit exactement la quête que nous venons de décrire, alors il ne peut être question que d’une violence définitivement abolitionniste de la violence, d’une violence qui serait vraiment la dernière de toutes les agressivités, d’une violence eschatologique, révélatrice, tutrice des suprêmes annonciations, donc en chemin vers les fins dernières d’un monde finissant parce que ce monde enfin décidé à venir à bout de ses agonies se serait mis en capacité d’accoucher d’un monde commençant où l’animalité de l’homme ne pourrait plus recommencer.Néanmoins cet idéal de pacification – consécutif à la réplique d’une violence purificatrice – ne fait pas bon ménage avec le réel obliquement guerroyant et détrousseur du monde colonialiste envahissant. Pour parler sans la moindre équivoque, les sociétés colonialistes importent au sein des sociétés qu’elles colonisent les violences qu’elles estiment tout à fait intolérables chez elles, donnant ainsi l’impression de se désinhiber, de se dérober d’un ascétisme factice, de s’autoriser aux antipodes ce qui leur est interdit à domicile. C’est comme si le portrait de Dorian Gray remisé dans une pièce secrète de la maison occidentale pouvait s’exposer aux colonies indépendamment de toute crainte de déshonneur. Et dans la mesure où la barbarie, pour les colonisateurs, n’est du ressort que de ce qui n’est pas ressortissant du monde hégémonique, on en déduit que la laideur morale du monde primordial devient réversible aussitôt qu’elle rapplique dans le monde réputé accessoire (car il n’est qu’un accessoire pour les retors et les impudents accessoiristes de la colonisation). S’ensuit quelque chose du calibre d’une révoltante partition entre les sociétés capitalistes et les sociétés désargentées où les colons débarquent en vue de capitaliser sur la misère, l’exténuation et la crédulité : la violence intrinsèque au monde capitaliste ploie sous une quantité extrinsèque de signes narcotiques, sous la lourde artillerie des stratagèmes inhibiteurs qui empêche le scandale d’éclater, manœuvrant comme une sorte d’indiscernable produit retardant, agissant comme une espèce de crapuleux moratoire qui s’évertue à l’abrogation de toute véritable dénonciation et de toute véritable sanction des inégalités, habituant l’opinion à recevoir le fait même de l’inégalité à l’instar d’une profitable structuration de l’anatomie sociale, et, du côté de la société colonisée, démunie, jugée coupable de son indigence, la violence est archi-visible, positionnée sur le devant de la scène (par conséquent obscène), culminant déjà dans le sentiment d’ubiquité des forces de l’ordre, dans la prolifération de la figure du gendarme et du soldat, dans le déploiement d’un colossal fouet de dissuasion censé réordonner le chaos des barbaries indigènes (cf. pp. 41-2). En d’autres termes, la société du capitalisme ne se perpétue que par l’intermédiaire de sa bonne réputation usurpée, achetée au quotidien, négociée dans les cryptes de la forfaiture, décrétant arbitrairement la mauvaise réputation de la société qu’elle va coloniser en toute rigueur de son rigorisme moralisateur pour les autres (et de son laxisme conciliant pour elle-même). La colonisation a toujours le beau rôle et elle fait d’une pierre deux coups vicieux : elle met un masque sur sa hideur tout en prétextant esthétiser sa politique extérieure, et, en parallèle, elle prétend à la distribution de ses richesses tout en centralisant des ressources qui ne lui appartiennent pas. Il n’est donc pas difficile de promulguer en tout lieu, en tout temps, la décolonisation et le fait que la phase dé-coloniale sera une violente objection régulière face à l’objet de la violence coloniale irrégulière (ou ne sera pas). Il lui faudra vaincre le manichéisme des forces en présence, ou, plutôt, le déloyal dualisme de la force autoproclamée du Bien (le grand colon sotériologique) et de la faiblesse hétéro-désignée du Mal (le petit colonisé de la damnation). Il lui faudra lutter sans merci contre les tentations de baisser la garde, contre les fatigues averties du dominé qui pourraient vouloir s’abriter à l’ombre des sommeils dogmatiques du domestiqué. Dures et meurtrières sont les règles du jeu de la colonisation, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu’il peut déboucher sur une fin de la partie, sur une immuable cessation du machiavélisme ludique du capitalisme. C’est pourquoi toute énergie d’affranchissement des colonies est un coup potentiellement mortel porté dans le ventre gras des jeux d’argent. C’est encore un coup imprévisible à l’encontre des colons car ces derniers se croient les convoyeurs d’une axiologie valorisante dans les mondes qu’ils chiffrent selon le chiffre ingrat de la dévalorisation axiomatisée, et, ce faisant, se croient des dieux substituts de Dieu et réclamant des colonisés un culte non pas tant pour l’argent (qu’ils veulent accaparer) mais pour le monde puissant du Blanc (qu’ils veulent inséminer dans le psychisme du Noir ou du métèque des lactescences – cf. pp. 44-5).
L’opiniâtreté du soulèvement physique ou l’assiduité dynamique des convictions, le muscle ou le cerveau s’opposant aux mobiles instigateurs d’une augmentation des sinistrés de la vie sur la Terre, croyons-le, finiront par faire apparaître le clair-obscur indicateur de la scission entre les vraies et les fausses vertus, entre d’une part les ténèbres qui n’en sont pas et d’autre part les ténèbres qui en sont – entre la luminosité reconquise des subjugués de la colonisation et l’obscurité corroborée des colonisateurs ensorcelants. La déshumanisation et l’animalisation des uns ne compromettra pas le dévoilement de l’abomination des autres car lorsque le colonisé endure la trique de ses maîtres, il personnifie l’humanité, il honore en lui ce qui est humain à l’avenant de ce qu’on lui dénie dans ses droits d’être un homme pendant que ses calomniateurs se déshonorent. Peu importe d’ailleurs que les turpitudes coloniales soient blanchies par les tribunaux blancs, qu’elles soient accommodées aux jurisprudences douteuses de ce que Jacques Lacan appellerait un Surmoi féroce, une conscience dominatrice, un appareil psychique ensauvagé s’avisant de corriger les présumés sauvages, peu nous chaut, en réalité, tant ces libertinages de la déontologie s’abîment d’eux-mêmes, s’enfoncent petit à petit dans une cruelle hypocrisie qui lui sera rétroactivement comptée parmi les assises de la Honte Éternelle. Et d’ores et déjà les chefs d’accusation se rééquilibrent, voire s’annulent pour les accusés alors qu’ils essaiment pour les accusateurs, les décadences de l’Occident ne se fardant plus qu’avec un maquillage de pacotille : sous la croûte cosmétologique de leurs volontés mystifiantes se repère l’anti-cosmologie de leurs passions de faire mal, de faire le Mal, de haïr sans raison comme le Christ a été haï sans cause, de sélectionner sur la mappemonde telle ou telle région du monde où beaucoup seront privés du monde, où des masses d’hommes seront sommées d’être assommées à la matraque parce qu’elles auront été cantonnées dans les sommatifs entrepôts des langages fabriquant le bouc émissaire. Il s’agit ni plus ni moins de l’idiome sédatif et sadiquement institué d’un Moloch, d’une systématisation d’un discours du sacrifice, d’une rationalisation de l’hécatombe des enfants du tiers-monde au bénéfice des enfants de la finance, du bordereau libéral qui énonce que la mort de certains enfants est chaque fois nécessaire pour assurer la vie de certains autres. Mais nous avons vu que c’était un caprice de perversité bien davantage que la sombre justification d’un darwinisme social, nous avons compris que c’était plus sombre que toutes les mutations de la pénombre, et, ici même, on ne pourra élucider l’infernale dépravation du colonialisme qu’en acceptant de reconnaître qu’il est d’abord un luxe malin – c’est-à-dire le luxe de l’oppresseur, le faste du créancier qui a le temps et l’argent pour oppresser, un luxe d’autant plus libertin qu’il considère que le colonisé dont il abuse est «toujours présumé coupable» (p. 54), toujours l’effet et jamais la causalité. De là résulte une morphologie ultra-perverse de la violence comme produite et justifiée par des moyens économiques illimités où le plaisir de nuire et le plaisir de dévaliser vont de pair.
On doit ainsi réclamer avec Frantz Fanon le permis d’inhumer de la colonisation, de même que doit être exigé, sur ces brisées revendicatrices, la réappropriation de ce dont on a été exproprié. Cela se traduit par une vive doléance d’écrasement du conatus colonialiste, par un retournement de sa perseveratio in esse en perseveratio in nihil, par l’impossibilité que ressuscite l’être du colon qui est un être propagateur de non-être, par préférence d’un être décolonisé qui sera l’apôtre des gradations de l’être pour tous les êtres vivants. Un tel revirement n’est du reste envisageable qu’à la condition d’avoir un œil plus écarquillé que l’œil dilaté du mirador colonialiste (14) : la violence émancipatrice ne pourra émerger comme réfutation de la violence assujettissante que si les colonisés consentent à voir des alliés dans le camp des colons et des traîtres dans le camp occupé. C’est en cela que Frantz Fanon exhorte a se méfier par exemple des intellectuels qui auraient pactisé avec la bourgeoisie des colonisateurs par désir d’assimilation. Ces intellectuels ne sont pas des accidents isolés de la période coloniale, ils sont, tout au contraire, des archétypes de la perdition qui rendent essentielle la défaite de toutes les luttes engagées. Le reproche que Frantz Fanon leur adresse, c’est de ne vivre que dans les registres partitifs, les tessitures du détail, les solennités intempestives, alors même que le visage du peuple n’existe que dans l’intégralité, dans l’existence totale, dans les universaux de la vie où se tressent «la terre et le pain» (p. 52). À peine a-t-il basculé dans le quartier des élites que l’intellectuel putativement porte-parole des opprimés n’est plus en état d’être autre chose que le parolier malgré lui des refrains assimilationnistes. Il se mue en une sorte de schizophrène, de créature ambiguë, de tribun aliéné qui fera preuve d’une violence avérée dans ses réquisitoires avant de se trahir dans des attitudes profondément «réformatrices» (p. 60). D’où le fait que l’intellectuel félon veuille à toute heure parler d’un encadrement de la décolonisation au lieu de professer la prodigalité d’une violence cathartique. Aussi l’intellectuel modérateur d’un débat inutile (car il n’est plus l’heure de débattre au cœur d’un pandémonium) doit-il être perçu comme l’ennemi dans l’ami et la nécessité d’entamer une recherche de l’ami paradoxal dans la figure monolithique de l’ennemi. Et une fois recrutés les apostats des religions coloniales, la violence pourra se déplacer, elle pourra quitter le corps et l’esprit toujours tendus du colonisé (parce que les colonies sont des districts de la tension permanente) afin d’aller percuter le persécuteur. Partant de là, Frantz Fanon ne peut que dépister un saut qualitatif dans cette violence étant donné qu’elle est unificatrice (cf. p. 90), coagulatrice des sangs différents, libératrice encore des recours sécessionnistes au tribalisme et au maraboutisme (cf. p. 90), magies noires ou autres fétichismes qui ne font que différer les alliances nouvelles et prometteuses. Par ailleurs, s’agissant de cette violence fédératrice, elle contient presque une dimension médicinale car Frantz Fanon l’appréhende en psychiatre : il sait que les colonisés ont largement introjecté les effets de la colonisation et que leurs esprits en ont été endommagés, il sait que des hommes et des femmes ont été dépossédés d’eux-mêmes, dépersonnalisés, également coupés de leur environnement, et il sait encore que plusieurs de ses collègues (du moins sur le papier) refusent de voir que les maladies psychiatriques des oppressés sont acquises à cause de la tyrannie et non pas innées à cause d’un je-ne-sais-quoi de défaillant dans les complexions africaines ou extra-européennes – par conséquent la fédération issue de la violence néguentropique pourra être l’occasion collatérale de faire violence à la violence académique jusqu’ici enseignée en roue libre (quoique Frantz Fanon n’ait pas attendu l’avènement d’une révolte de cette envergure pour mettre l’hôpital de Blida sens dessus dessous), l’opportunité de fustiger les relents xénophobes d’une médecine caduque, ceci afin de montrer une bonne fois pour toutes l’évidence des maladies mentales suscitées par les politiques coloniales. On aboutirait en outre à une requalification du fou comme étant foncièrement localisable au sein même de celui qui a pourtant la si noble mission de contention ou de guérison de la folie – ce serait l’exhibition du savant fou, l’humiliation publique de tous les Antoine Porot des univers coloniaux, la mise en avant, peut-être, d’une préoccupante mouture des hollow men de T. S. Eliot, d’une variante des hommes creux, d’un signalement des hommes vides en tant qu’ils ont creusé dans la plénitude des hommes comblés pour les vider de leurs saintes substances, pour littéralement les lobotomiser, pour commettre un siphonnage de la vitalité par vile exécration de la vie, pour se venger des vivants authentiques (15).
Apparaît alors de plus en plus nettement l’urgente supplique en faveur d’une rupture de ce mouvement alternatif régulateur de l’entière corporation des hommes que Machiavel avait identifié à la subtile manière d’une articulation indéfectible entre la «violence qui détruit» et la «violence qui restaure» (16), sorte de dynamisme ondulatoire et cyclique fomentateur de toute l’aventure humaine, animé d’une course pendulaire allant d’une intensité massacrante à une intensité sanctifiante, allant, à en croire la philosophie machiavélienne ramenée à notre contexte, de la colonisation à la décolonisation en attendant d’autres colonisations. C’est que le recul absolument certain que nous avons sur la colonisation nous concède volontiers la licence d’affirmer que le mal colonial est d’un niveau paroxysmique : on ne peut pas le digérer à l’intérieur d’une dialectique des violences et c’est la raison pour laquelle sa violence poly-traumatisante ne doit plus amorcer un quelconque retour. Le psittacisme de la violence tel que le présente Machiavel nous incite à enrayer ce disque, à le faire bégayer, à le condamner le plus rapidement possible au mutisme. Toutefois – hélas – le colonialisme récuse de lui-même les rotations machiavéliennes des deux tonalités de la violence dans la mesure où les décolonisations n’ont été qu’une façon de réadministrer différemment la violence des colons. C’est-à-dire dire que la guerre de la violence restauratrice n’a pas (ou n’a presque pas) eu lieu aux colonies : elle n’a été qu’un succédané d’intensité sanctificatrice parce que les retraits des bourreaux se sont soldés par d’innovantes maîtrises des hautes œuvres (les départs concrets n’ayant pas réglé le problème des sédiments abstraits). Donc lesdites anciennes colonies attendent encore leur tour d’être significativement violentes à l’égard des colonisateurs aux mille ruses – elles rétorquent au mobilisme machiavélien de la violence qu’elles sont aux prises avec un immobilisme qui comprime les forces véhémentes d’une émancipation ne serait-ce que provisoire mais vraie, et, du reste, elles aspirent à une Solution Finale de la Question Coloniale, à une réponse définitive au mauvais point d’interrogation de l’impérialisme impuni. En d’autres termes, à supposer que Machiavel ne soit pas dans son tort dans sa compréhension de ce qui meut l’humanité, elles voudraient bien, déjà, que le pendule spéculatif de la violence redevienne ondoyant, que la régénération des peuples dégradés se déclare, après quoi elles souhaiteraient que la paralysie de la violence soit enfin prononcée au profit d’une dialectique des concordes. Et au moyen de cette espérance dé-coloniale que nous formulons intuitivement, les colonies affranchies ne se montreraient pas vindicatives, elles ne convoiteraient pas de faire subir ce qu’elles ont subi, elles feraient redécouvrir au contraire leur tempérament de nature courtoise tel qu’Aimé Césaire l’avait souligné – car c’est l’arrogance, l’impertinence et donc toutes les grimaces de l’outrecuidance colonisatrice qui se sont attablées aux tables courtoises des mondes honnêtes en abusant de leur beau savoir-vivre (17). Reste à savoir néanmoins si les occupants malpolis et sanguinaires accepteront de saigner une fois avant de réfléchir aux modalités de la paix car il faudra bien qu’ils saignent lors de la transition constitutive de l’ultime violence restauratrice. Reste à savoir également s’il est même possible qu’une telle violence légitime puisse affleurer étant donné la faculté de renouvellement et de duperie de la violence capitalistique (comme il reste aussi à savoir si la courtoisie ne sera pas un obstacle tenace au sursaut final des opprimés).
En effet le franchissement sans retour du portique de la justice pour les sociétés colonisées ne va pas de soi lorsque Frantz Fanon en personne diagnostique dans le colonialisme «la violence à l’état de nature» et la conviction que cette violence «ne [pourra] s’incliner que devant une plus grande violence» (p. 61). Tout d’abord, en prenant Fanon au mot, il est satisfaisant d’attribuer aux engeances coloniales une humanité barbaresque conforme à un état de nature qui serait l’exutoire de ses pulsions belliqueuses, il est cohérent de les décrire comme des présences dé-régulatrices d’un état civil qui n’avait pas besoin d’une telle incursion chaotique en son sein, mais il est moins correct de penser que des populations naturellement affables et intelligentes réussiront un de ces jours à se défaire de leurs atomes de civilité pour combattre à armes égales l’atomisation attisée par l’état de nature et qui n’est du rayon que des colonisateurs. Et pourtant il le faudrait (au grand dam d’Aimé Césaire et de ses justes paroles sur l’urbanité des colonisés). Il le faudrait car nous ne sommes plus en mesure de nous représenter une sortie de crise autrement que par la décision de la plus énorme des violences (si énorme qu’elle résilierait pour les siècles des siècles tout autre parti que le parti du pacifisme). Mais par-delà le sens littéral de ce que Frantz Fanon dit du colonialiste et de sa fonction amplificatrice d’un état de nature que le colon vient assouvir en terre étrangère, nous devinons, en un sens figuré, un état de nature résorbé en un état civil, une anarchie des pulsions convertie en un système tolérable de la violence. Or c’est cela qui rend malaisé voire inconcevable la riposte violente des violentés car ils ont affaire à un genre de Léviathan politique : ils ont en face d’eux – et s’infusant en eux – un puissant artifice associatif, ils ont le sentiment croissant que la colonisation serait l’âme souveraine de la colonie, comme un esprit commun, annexant, englobant, venu au secours de tous les esprits individuels qui se seraient trouvés plus faibles et à la merci d’une mort violente ou trop tôt survenue sans l’irruption spirituelle et animatrice de l’État colonial enveloppant. Comment faire dans ce cas pour déborder cette débordante puissance qui dispose à pactiser dans le vaste dispositif des envoûteuses associations coloniales ? Comment être plus souverain que ce qui est unanimement perçu comme un absolu de la souveraineté ? Comment prouver que le Droit conféré à ce Léviathan rassembleur n'est qu’une Force tamisée qui rejoue un état de nature moyennant des fantasmagories orchestrées par l’argent et par la mise en scène assidue des bonnes volontés ? Ainsi la colonisation n’est-elle le plus souvent qu’un état de nature crypté que les colonisés, s’ils désirent aller plus loin dans leur connaissance de la domination et leur méconnaissance de la domestication, se doivent de décrypter en tant que tromperie maximale sur la marchandise. Et nous parlons non pas tant des colonies d’antan (un peu moins sibyllines) que de leur tempérante conversion à ce cryptage de l’état de nature dû aux intraveineuses novatrices que l’humanisme bourgeois s’est plu à planter dans les bras des pays visés par l’abjecte bonne conscience occidentale. Nous parlons depuis notre présent faussaire contre lequel Frantz Fanon aurait aimé croiser le fer, depuis ce présent des colonisations métamorphosées, depuis la sourde menace de la méchante mesure grise intronisée par la graduation bourgeoise, depuis la grisaille du renouveau du Léviathan colonial où l’on subodore l’état suprême d’une violence stabilisée, d’une violence mutante, impalpable sur le nuancier des brutalités pures (car le gris de la violence du Léviathan colonialiste est une impureté qui outrepasse le noir et même l’outre-noir de toutes les violences auxquelles on a opposé de claires hostilités). Nous parlons dans le fond d’une redite de la zone grise que Primo Levi avait repérée dans le camp de concentration et qui stipule un désarçonnant traité de conciliation entre les inconciliables, un perturbant compromis des contraires, une connivence entre l’humain et l’inhumain parce que tout est possible lorsque les circonstances obligent au pire pour vivre ne serait-ce qu’un jour de plus, et, aux colonies, le carré de l’hypoténuse des Colonisés, sur le triangle rectangle du nouveau Léviathan, est forcé d’être égal à la somme du carré des deux autres côtés où résident les Colons. C’est à la fois transparent et opaque : transparent pour la vie extérieure parce que ce pythagorisme épure les relations entre les occupants et les occupés, opaque pour la vie intérieure parce que les occupés sentent l’entourloupe, le tour de passe-passe, tout en s’accoutumant aux gradients des fonctions colonisatrices, aux forces du pseudo-humanisme qui veillent à ne jamais dépasser certains seuils de violence réelle alors même qu’elles agrandissent le seuil des violences symboliques. Et c’est peut-être cet impénétrable colorant de grisaille, de brume, de ciel nuageux dans les âmes qui obsède Aimé Césaire quand il nous enjoint à nous méfier des fausses libérations : le monde a su un tant soit peu juger les flagrants délits de la colonisation, mais il n’est pas du tout sûr qu’il ait pris la mesure de la mesure grise du «grand risque yankee» (18), de l’américanisation des pillages organisés, du degré supérieur et terrifiant de falsification des intentions, débouchant vers un mondialisme d’apparence neutre mais en réalité disciple d’une kleptomanie dans les poches des peuples méprisés (pp. 79-81).
 Il n’est pas juste que le moyeu de la roue des destins, là où les turbulences sont limitées par rapport à la périphérie, soit toujours colonisé par les mêmes. Ce statu quo persiste à travers une sorte de neutralisation mutuelle des antagonistes, puisque, d’une part, les colons s’emploient à ce que les rêves de liberté soient irréalisables, et, d’autre part, les colonisés s’ingénient par toutes les voies de l’ingénierie onirique à mettre fin au cauchemar colonialiste (cf. p. 89). Mais des rêves ne pourront pas remplacer des réalités cauchemardesques sur le très long terme, ni ne pourraient suffire à tenir le choc, sans compter que l’oppresseur, malgré son armure fendue par sa propre décadence et par la lance des chevaliers du tiers-mondisme, continue, tel que l’avait vu Frantz Fanon, à mener une guerre écrite et orale de l’opinion davantage qu’une guerre de terrain, contrôlant le récit de l’Histoire grâce à un journalisme partial dont l’objectivité controuvée prend chaque fois l’oppressé pour un parasite ou un sale menteur. C’est dire que si la colonisation a l’air d’avoir reflué dans les actes (alors qu’il n’en est rien), elle n’a pas du tout fait marche arrière dans les idées, se ravivant, se rechargeant, rebondissant au gré d’une phraséologie aussi bien rancunière que trompeusement magnanime. Pris dans l’étau d’une amphigourique grammaire aigre-douce et d’une tactile avidité du capitalisme à la recherche d’une plus-value dans les endroits les plus reculés de la Terre, le colonisé (et surtout le néo-colonisé) doit inventer sa phrase claire et distincte ainsi que sa répulsion incarnée contre le corps affamé de l’argent conquérant, tout comme, ne l’oublions pas, il doit également et avant toute chose apprendre à surmonter la perversion infinie de son agresseur. Son devoir consiste encore à requérir une redistribution des richesses déjà spoliées parce que l’Europe est «repue» (p. 95) de ce qu’elle a mangé, ce qui, bien entendu, requiert aussi une attention toute particulière à l’égard du nouvel estomac américain qui pourrait s’être substitué ou incorporé à la boulimie de l’oppresseur historique. Ici s’esquisse le piège des décolonisations qui n’en sont pas vraiment parce qu’elles ne sont que des réaffirmations de la violence, des faux-semblants de dettes remboursées. Quant aux colonies qui auraient véritablement été désertées par la violence, redevenues des nations libres mais exsangues, il est obligatoire, selon Frantz Fanon, qu’elles exigent promptement leur dû et qu’elles travaillent simultanément à une profonde réhabilitation de l’homme en tant qu’homme (cf. p. 103), à une réfection de tout ce qu’il y a d’universel dans l’univers de l’homme, c’est-à-dire, à suivre la belle conception d’Aristote au sujet de l’universel, qu’elles persévèrent dans un effort de jonction avec «ce qui est toujours et partout» (19) tant la colonisation a mesquinement tenté de poser l’homme dans le jamais et le nulle part de l’humanité.
Il n’est pas juste que le moyeu de la roue des destins, là où les turbulences sont limitées par rapport à la périphérie, soit toujours colonisé par les mêmes. Ce statu quo persiste à travers une sorte de neutralisation mutuelle des antagonistes, puisque, d’une part, les colons s’emploient à ce que les rêves de liberté soient irréalisables, et, d’autre part, les colonisés s’ingénient par toutes les voies de l’ingénierie onirique à mettre fin au cauchemar colonialiste (cf. p. 89). Mais des rêves ne pourront pas remplacer des réalités cauchemardesques sur le très long terme, ni ne pourraient suffire à tenir le choc, sans compter que l’oppresseur, malgré son armure fendue par sa propre décadence et par la lance des chevaliers du tiers-mondisme, continue, tel que l’avait vu Frantz Fanon, à mener une guerre écrite et orale de l’opinion davantage qu’une guerre de terrain, contrôlant le récit de l’Histoire grâce à un journalisme partial dont l’objectivité controuvée prend chaque fois l’oppressé pour un parasite ou un sale menteur. C’est dire que si la colonisation a l’air d’avoir reflué dans les actes (alors qu’il n’en est rien), elle n’a pas du tout fait marche arrière dans les idées, se ravivant, se rechargeant, rebondissant au gré d’une phraséologie aussi bien rancunière que trompeusement magnanime. Pris dans l’étau d’une amphigourique grammaire aigre-douce et d’une tactile avidité du capitalisme à la recherche d’une plus-value dans les endroits les plus reculés de la Terre, le colonisé (et surtout le néo-colonisé) doit inventer sa phrase claire et distincte ainsi que sa répulsion incarnée contre le corps affamé de l’argent conquérant, tout comme, ne l’oublions pas, il doit également et avant toute chose apprendre à surmonter la perversion infinie de son agresseur. Son devoir consiste encore à requérir une redistribution des richesses déjà spoliées parce que l’Europe est «repue» (p. 95) de ce qu’elle a mangé, ce qui, bien entendu, requiert aussi une attention toute particulière à l’égard du nouvel estomac américain qui pourrait s’être substitué ou incorporé à la boulimie de l’oppresseur historique. Ici s’esquisse le piège des décolonisations qui n’en sont pas vraiment parce qu’elles ne sont que des réaffirmations de la violence, des faux-semblants de dettes remboursées. Quant aux colonies qui auraient véritablement été désertées par la violence, redevenues des nations libres mais exsangues, il est obligatoire, selon Frantz Fanon, qu’elles exigent promptement leur dû et qu’elles travaillent simultanément à une profonde réhabilitation de l’homme en tant qu’homme (cf. p. 103), à une réfection de tout ce qu’il y a d’universel dans l’univers de l’homme, c’est-à-dire, à suivre la belle conception d’Aristote au sujet de l’universel, qu’elles persévèrent dans un effort de jonction avec «ce qui est toujours et partout» (19) tant la colonisation a mesquinement tenté de poser l’homme dans le jamais et le nulle part de l’humanité.Repeupler l’idée de peuple parmi les décombres du monde colonial
Toute situation de colonisation a entraîné des schémas de désobéissance et des hommes se sont spontanément ou sciemment élevés contre une syntaxe politique légalisée mais non légitime : ils ont extériorisé leurs convictions et ils ont par là même assumé l’irrésistible consistance de l’élan moral par contraste avec l’inconsistance des lois injustes. Ces hommes-là n’ont pas pu se contenter de vivre légalement parce qu’ils avaient compris ou intuitionné que l’illégalité seulement ferait d’eux des hommes légitimes (tandis que la légalité respectée à la lettre ferait d’eux la lettre et l’esprit d’une incarnation d’illégitimité). Ils ont pu être des meneurs d’hommes dans l’immédiat, des inspirateurs dans le médiat, des violents ou des non-violents, mais quoi qu’il en soit de la temporalité de toutes leurs actions ou conceptions, ils ont été les visibles iconoclastes des icônes du colonialisme (car les modèles de légitimité n’ont pas besoin de se cacher contrairement aux tactiques de brouillage des pistes au sein des codes civils imprégnés d’influences immorales). Le problème, néanmoins, c’est que cette glorieuse visibilité de la juste cause défendue en place publique omet la plupart du temps de se demander ceci : après avoir désobéi au-dehors pour faire valoir ce qui nous sied au-dedans, à la suite de cette explosion de la moralité dans l’espace, a-t-on assez pris en considération la capacité de revenir en nous-mêmes pour désobéir à notre part interne éventuellement toujours aliénée par l’insidieuse logique de la colonisation ? Disons-le différemment dans la perspective classique d’un mouvement de désobéissance : une fois que nous avons désobéi à la loi qui favorisait l’immoralité, s’est-on assuré, en nous-mêmes, qu’il ne restait pas des résidus d’aliénation suscités par cette loi ? Le cas échéant, il faudrait y désobéir avec une fermeté plus vive encore, car la disparition d’une loi injuste à l’extérieur n’est jamais la garantie de la disparition de l’injustice dans les esprits. C’est que l’attention portée aux libérations externes peut avoir tendance à provoquer l’inattention par rapport aux libérations internes qui sont encore à conquérir. Et le colonialisme, peut-être bien plus que tout autre contexte oppressif, prête la main aux effets de captation des intériorités tant les euphories qui succèdent aux conquêtes extérieures font oublier que la colonisation, loin d’être l’unique ponction des vitalités de la réalité adventice, consiste aussi et surtout en un quasi increvable arraisonnement des consciences. Aussi est-il fondamental de concevoir que le colonialisme est mortel en tant que molestation des corps et qu’il tend à l’immortalité en tant que principe de possession des âmes ou de harcèlement moral. La pérennité psychoactive du colonialisme est ce qui fait barrage à toutes les envies de trop vite ratifier les climats de décolonisation et à toutes les joies bénévoles qui voudraient apercevoir ici et là des peuples définitivement fondés sur les fondations de la liberté. L’invagination du colon dans les âmes est plus grave que l’innervation de sa violence sur les corps, et, sans intention de minimiser outre mesure la chair du monde colonisé, nous souhaiterions en quelque sorte penser que le trajet de la violence coloniale commence dans l’âme et descend dans le corps et qu’il remonte insidieusement dans l’âme quelles que soient les données de la liberté d’aller et venir : que les corps soient libérés ou non de la colonisation, une trace subsiste dans les âmes, une traînée de sorcellerie coloniale végète dans le spirituel abstraction faite de l’état des choses charnelles. Par conséquent, ce n’est pas tant la traque de la trace post-coloniale qui devrait nous intéresser, car celle-ci, au moins, pourra être à peu près traquée en toute tranquillité, mais plutôt la traque de la trace intra-coloniale, la manière dont l’emprise resserre son étau, car c’est parce que cette emprise a lieu qu’elle continue ensuite d’avoir lieu – c’est l’emprise initiale qui ouvre la porte aux emprises terminales et c’est à elle qu’il convient de désobéir pour ne pas qu’elle métastase à l’avenir, et, donc, c’est elle qu’il convient d’identifier à l’épicentre même du phénomène colonial.
Durant la colonisation, au cours le plus quintessentiel de la durée coloniale, la captivité des consciences s’opère probablement à un degré superlatif dès lors qu’un nombre non négligeable de colonisés parvient à «tirer parti de l’exploitation» sans se rendre compte qu’il existe un important segment de la population correspondant au «colonisé exclu des avantages du colonialisme» (cf. p. 111). Cette disjonction entre les opportunistes et les quiétistes – pour ainsi dire – crée une distance entre les villes et les campagnes : les citadins s’activent dans les activités louches du colonialisme, ils sont pris dans le tourbillon des occasions, et, sur les hauteurs factices des récentes acropoles, on observe l’hermétisme moral en train de devenir poreux, des mains en train d’en serrer d’autres, des oppressés qui rejoignent l’oppresseur (et ce faisant des agentivités affectées de passivité), tandis que les ruraux se découvrent isolés, apathiques par antithèse, mais affectés d’une certaine cinétique dans la mesure où ils sont des survivances de la période anticoloniale, des réserves de passé conjurant le présent usurpateur, des atouts hyper-mnésiques résistant à l’amnésie dissolvante des nobles vérités nationales (cf. p. 113). Il y a même dans l’abstinent pays du paysan «une tendresse et une vigueur insoupçonnées» (p. 123), un silo de prodigalités, un quotient de populus de taille à rapatrier dans la mémoire collective la velléité de former un peuple, une communauté interhumaine, une coalition qualitative où les populaces écrouées dans les Cités préjudiciables, disséminées par monts et par vaux, concurrentes, se rallieraient en un peuple délivré du monde sans réelle foi et sans réelle loi de la colonisation. Mais la disharmonie est telle que l’écart des villes et des campagnes semble ne pas pouvoir se réduire, ajournant voire supprimant l’espoir d’avoisiner un peuple qui serait devenu peuple après avoir vivement colligé le reliquat des forces de la nation défigurée afin de reconfigurer ce que le colonialisme a pu déranger. Car la force exo-nationale est en réalité plus attractive que la force endo-nationale, et, mutatis mutandis, le colon s’est qualifié pour faire croire qu’il pouvait être un distributeur de qualifications pour les colonisés, disqualifiant de la sorte les mondes supposés sans qualités des périmètres éloignés, les arrière-mondes de «l’arrière-pays», les inconnaissables et les insignifiants de «l’inconnu» (p. 116), alors que c’est là-bas que vit «l’infinie misère du peuple» dont il faudrait se soucier en priorité (p. 123), la province des misérables infiniment disponibles aux éventualités de l’aventure nationale qui viendrait sonner le glas de la mésaventure coloniale. Rien n’est plus simple en vérité dans l’œil de Frantz Fanon : que les ruraux et que le lumpenprolétariat des bidonvilles, un jour, soient regardés comme des grands professeurs d’énergie, qu’ils soient un jour désignés comme des neurotransmetteurs du potentiel énergétique contradicteur de l’efficience adynamique, et, alors, ç’en sera certainement terminé du colonialisme et du gros trou noir de son affairisme.
Toutefois le gel des consciences dans le glacis colonial détourne de faire des campagnes et des marges vives de la nation autre chose que des interlocuteurs auxquels on impose une orientation plutôt que de leur proposer une discussion. S’agissant d’ailleurs des terres agricoles ou des brousses autarciques par contrainte d’isolement, on commet l’erreur ou bien de vouloir les rendre modernes, de vouloir les acculturer à l’idéologie coloniale, au progressisme masochiste, ou bien de vouloir les utiliser comme une substance «rétrograde, [passionnelle] et spontanéiste» (pp. 117-8) qui sera dès demain envoyée à l’abattoir des émeutes mal étudiées – impréparées. Trop souvent les paysans et les faubouriens des taudis sont astreints à une position de variable d’ajustement malgré le fait qu’ils soient invariablement individuels et donc imperméables aux manœuvres d’homogénéisation que le colonialisme infère. Leur hétérogénéité promet un peuple homogène parce que ce dernier aura su conserver sa singularité, au lieu que la colonisation, par sa standardisation directe, par son carnassier nivellement, détruit d’emblée le singulier pour installer le mensonge de son pluralisme. En partant de ce qui est hétérogène, on peut aboutir à un peuple enraciné dans sa diversité, mais en partant de la matrice coloniale normalisatrice, on obtient un faux départ et une contrefaçon de peuple qui cache sa difformité populacière, une trahison monstrueuse, un arrachement du sol de la véracité. Revenir à l’au-delà du cordon sanitaire colonialiste, briser la frontière de cet hygiénisme pathologique, c’est tenir pour vraisemblable que le volume d’énergie des populations invisibles pourrait «participer de façon décisive à la grande procession de la nation réveillée» (p. 126). Manière de reconnaître que les plus bannis d’entre les bannis sont les seuls éveillés de l’environnement colonial et qu’ils ont en leur possession les trompettes de Jéricho qui abattront les murailles de l’expansionnisme occidental. Ils ont plus précisément cette «stratégie de l’immédiateté totalitaire et radicale» (p. 127), cette force de déferlante des jacqueries spontanées, cet illogisme de l’irrépressible puissance des forts courants telluriques qui vient dégringoler sur les logocentrismes coloniaux, ce délire de justice surabondant qui se permet de notifier aux raisons suffisantes du colonialisme que sa rationalité est plus délirante que le torrent qui vient la mettre hors d’état de nuire (parce que le rationnel n’est pas le signe certain de ce qui est raisonnable et le colonialisme est une rationalisation du déraisonnable). En tant que tribunal cataractant, les peuples impopulaires de la nation colonisée ont cette vigueur contagieuse qui donne la volonté d’enfoncer un drapeau dans la terre et de fonder une religion. Ils ont davantage à montrer qu’à démontrer, ils sont pratiques et non théoriques, et ce qu’ils arborent, c’est la majeure nécessité d’être un principe, d’être un commencement, d’être des archétypes se ruant sur les ectypes du colonialisme, et, en cela, ils sont littéralement des moudjahidin archéo-praxiques (pratiquants de tout ce qui est susceptible provenir d’une ancestrale sacralité). Ils archaïsent ce qui est en nous, ce qui dans les âmes était ancien et a été retourné en contemporanéité colonisée, et, au fur et à mesure, ils destituent la populace juvénile et ils instituent le peuple d’expérience – à condition bien sûr qu’on les accompagne dans la surrection et que chacun veuille «rendre le peuple adulte» (p. 140).
 Et, d’ailleurs, faute d’une cohésion sensée avec cet insensé inchoatif de la rénovation nationale, il s’ensuit que ces fiers matricules de la croisade terraquée à même de terrasser le Léviathan colonial sont subordonnés à la figuration d’un idéal de la révolte, sont suspendus au niveau d’une δύναμις (dunamis) de la sédition, d’une charge intime et cruciale de démantèlement qui attend son passage à l’acte, sa migration dans l’actualité, son actualisation transformatrice dans la matière du monde. Or, jusqu’ici, les noyaux durs de la nation n’ont été qu’un spontanéisme qui s’est brisé les reins contre la némésis du régime colonial car nous n’avons pas offert à ce complément d’objet informe de la révolte son complément du sujet informateur. Ce en quoi Frantz Fanon appelle à être hyper-vigilant à l’égard de la «mitraille» revancharde, fielleuse, envenimée du logiciel colonialiste (cf. pp. 129-130). Si la guerre éclate spontanément, elle doit au plus tôt se diriger vers les attributs d’une guérilla, elle doit se faire mouvante, ambulante, anticipatrice, comme si elle entendait toujours garder un ou plusieurs coups d’avance. Il s’agit en somme d’apporter une méthodologie flexible à la provision inflexible de tous les affrètements insurrectionnels, et ce directoire des inconscients, plutôt que de gêner l’essor de la liberté, le favorise et lui apprend que la souveraineté sera préservée tant que le mouvement rebelle aura la double compétence – physique et métaphysique – de décider de la situation exceptionnelle (20). Autrement dit la révolte est passible d’une victoire si son corps et son esprit s’allient et dictent dans le sensible et l’intelligible un texte inhabituel qui met à genoux le texte habituel du colonialisme – une atypique narratologie où les poursuivis deviennent graduellement les insurmontables poursuivants. On assisterait ainsi à une mutation du diamant brut de l’exaspération en véhémence adamantine de la conscience politique, car, si l’ignorance et l’inconscience devaient perdurer, la chefferie coloniale s’en servirait comme alibis pour battre en brèche la crédibilité des récalcitrants (cf. p. 130). Toujours la conscience doit être travaillée, au travail, afin de ménager les forces du corps séditieux parce que la colonisation a plus d’un tour dans son sac (cf. pp. 135-6) – elle a plus de réserves matérielles mais elle a beaucoup moins d’épargne immatérielle étant donné qu’elle ne travaille pas de la conscience (car le moindre travail de la conscience arrêterait sur-le-champ les expéditions coloniales). En peu de mots : «l’insurrection [doit se prouver] à elle-même sa rationalité» (p. 140) puisque la violence toute seule serait la chronique annoncée de l’échec. Et à supposer que ce possible soit réalisé dans le réel (21), on verrait donc le Mal incessamment malmené, l’homme veilleur de l’homme, et l’on dirait, avec l’un des personnages les plus optimistes et déroutants de Vassili Grossman : «J’ai vu que ce n’était pas l’homme qui était impuissant sans sa lutte contre le mal, j’ai vu que c’était le mal qui était impuissant dans sa lutte contre l’homme.» (22)
Et, d’ailleurs, faute d’une cohésion sensée avec cet insensé inchoatif de la rénovation nationale, il s’ensuit que ces fiers matricules de la croisade terraquée à même de terrasser le Léviathan colonial sont subordonnés à la figuration d’un idéal de la révolte, sont suspendus au niveau d’une δύναμις (dunamis) de la sédition, d’une charge intime et cruciale de démantèlement qui attend son passage à l’acte, sa migration dans l’actualité, son actualisation transformatrice dans la matière du monde. Or, jusqu’ici, les noyaux durs de la nation n’ont été qu’un spontanéisme qui s’est brisé les reins contre la némésis du régime colonial car nous n’avons pas offert à ce complément d’objet informe de la révolte son complément du sujet informateur. Ce en quoi Frantz Fanon appelle à être hyper-vigilant à l’égard de la «mitraille» revancharde, fielleuse, envenimée du logiciel colonialiste (cf. pp. 129-130). Si la guerre éclate spontanément, elle doit au plus tôt se diriger vers les attributs d’une guérilla, elle doit se faire mouvante, ambulante, anticipatrice, comme si elle entendait toujours garder un ou plusieurs coups d’avance. Il s’agit en somme d’apporter une méthodologie flexible à la provision inflexible de tous les affrètements insurrectionnels, et ce directoire des inconscients, plutôt que de gêner l’essor de la liberté, le favorise et lui apprend que la souveraineté sera préservée tant que le mouvement rebelle aura la double compétence – physique et métaphysique – de décider de la situation exceptionnelle (20). Autrement dit la révolte est passible d’une victoire si son corps et son esprit s’allient et dictent dans le sensible et l’intelligible un texte inhabituel qui met à genoux le texte habituel du colonialisme – une atypique narratologie où les poursuivis deviennent graduellement les insurmontables poursuivants. On assisterait ainsi à une mutation du diamant brut de l’exaspération en véhémence adamantine de la conscience politique, car, si l’ignorance et l’inconscience devaient perdurer, la chefferie coloniale s’en servirait comme alibis pour battre en brèche la crédibilité des récalcitrants (cf. p. 130). Toujours la conscience doit être travaillée, au travail, afin de ménager les forces du corps séditieux parce que la colonisation a plus d’un tour dans son sac (cf. pp. 135-6) – elle a plus de réserves matérielles mais elle a beaucoup moins d’épargne immatérielle étant donné qu’elle ne travaille pas de la conscience (car le moindre travail de la conscience arrêterait sur-le-champ les expéditions coloniales). En peu de mots : «l’insurrection [doit se prouver] à elle-même sa rationalité» (p. 140) puisque la violence toute seule serait la chronique annoncée de l’échec. Et à supposer que ce possible soit réalisé dans le réel (21), on verrait donc le Mal incessamment malmené, l’homme veilleur de l’homme, et l’on dirait, avec l’un des personnages les plus optimistes et déroutants de Vassili Grossman : «J’ai vu que ce n’était pas l’homme qui était impuissant sans sa lutte contre le mal, j’ai vu que c’était le mal qui était impuissant dans sa lutte contre l’homme.» (22)Là où le bât blesse et la guérison se dresse
Une ère dé-coloniale n’a jamais pu être officiellement déclarée en raison de la continuité des ascendances étrangères (fussent-elles elliptiques ou plus abstraites), mais, pour autant, il ne faudrait pas sous-estimer la responsabilité d’un ennemi intérieur, d’un ver dans le fruit, d’un parasitage que Frantz Fanon repère dans l’orbite de la bourgeoisie nationale des pays sous-développés. Il reproche à cette bourgeoisie son inaptitude «à rationaliser la praxis populaire» (p. 145). Il voit en elle toutes les sordides séquelles du colonialisme que sont la veulerie, la pusillanimité, la promotion d’un mol héroïsme de lâches se gobergeant d’arguties morales, autant de manquements à la mission d’être des hommes que l’on pourrait ainsi récapituler : le bourgeois des nations retardataires s’empresse de reprendre le flambeau du colonialisme là où le colon l’a laissé brûler de sa flamme simulatrice et il se couvre de mérites en le faisant. Le bourgeois compatriote et zélé récupérateur de la machinerie coloniale se pare du vêtement de machiniste en chef en persuadant la masse que la machine est une chose risquée ne devant pas être mise dans les mains de n’importe qui. Il s’agit à très bon compte de conserver la mainmise sur la manutention des multitudes. Le mot d’ordre n’est pas de servir le peuple mais de se servir de lui. D’où la spécification de cette bourgeoisie nationale par les prédicats d’une «psychologie d’hommes d’affaires», d’hommes de la «combine» (p. 146), confinant à une combinatoire de la logicisation des initiatives, de la banalité de ces mêmes initiatives, de l’oisiveté rentable et d’un enrayement de tout esprit visionnaire. Ces bourgeois ne sont ni des entrepreneurs d’envergure, ni des manieurs d’argent massif, ce sont d’obscurs pantomimes des bourgeois de la métropole occidentale, une ontologie délabrée du bourgeois transcendantal, un autoportrait raseur du miteux gagne-petit qui joue à l’inventeur et au législateur de l’avenir. Et en tant que tel, le groupe de ces bourgeois locaux constitue un État neuf qui n’est que la duplication de l’État colonial – en l’occurrence l’ancienne malédiction qui insiste dans la nouveauté d’emprunt. Autrement dit ce cartel de la bourgeoisie-maison relève de millionnaires dans l’âme qui se prennent pour des millionnaires factuels : dans les deux cas l’ordure prévaut mais l’imitation de la petite ordure vis-à-vis de la grande ordure déclenche des maladies peut-être plus inguérissables encore. C’est pourquoi «la bourgeoisie nationale va se complaire, sans complexe et en toute dignité, dans le rôle d’agent d’affaires» de ses maîtres d’autrefois (p. 149). Elle use des masses en mésusant de ses leviers tout en agissant pour les intérêts coriaces de l’usufruitier métropolitain. Elle ne regarde aucune futurition parce que son action n’invente rien : elle est prisonnière d’un prétérit exorbitant qui l’apparente à une prostituée centenaire, elle refait ce qui n’était ni-fait-ni-à-faire, elle est tellement moribonde qu’elle a comme réformé le devenir en le fixant dans le devenu. À sa charge, Frantz Fanon pose un verdict sans appel de sénescence à rebours d’une direction adolescente qui serait impatiente de découvrir des mondes et d’en faire naître. À tout prendre, ces bourgeois du tiers-monde ne sont guère que des employés de tourisme qui réorganisent les villes et les cambrousses pour les rendre éligibles aux plus basses philosophies du voyage – pour les restaurer en tant que «lupanar de l’Europe» (p. 150). Et tandis que l’on attendrait plutôt que les bourgeois s’acheminent «à l’école du peuple» (p. 147), ils plongent le peuple dans l’ignorance, ils enflent le fossé qui les sépare du peuple, confisquant aux pauvres les savoirs qu’ils ont pu apprendre dans les universités coloniales (qui ne sont – il est vrai – quasiment que des savoirs d’intoxication des consciences et des techniques de maniement du népotisme).
Se produit en ce sens un ténébreux printemps de l’eugénisme social où les bourgeois de la nation tiers-mondiste, par leur acharnement du contrôle et de l’occupation systématisée des places fortes, en viennent à diaboliser comme leurs prédécesseurs occidentaux les personnes composites, les sangs hétéroclites, les éléments humains conjecturés selon des diapasons d’infériorité, ravivant ainsi des «haines interethniques» au mépris des secourables paroles d’unité (cf. pp. 151-4). C’est toute l’espérance panafricaine qui s’effondre et qui réarme en simultané les tensions inhérentes à la religion. C’est toute l’insolence occidentale qui renaît de manière latente et qui nous donne la nette impression d’un enfant gâté enfui de sa chambre africaine sans la ranger (comme s’il avait laissé des machettes à la vue de tout le monde et que celles-ci, par exemple, devaient servir à desservir la vie, à semer la mort, tel que cela s’est vérifié durant le génocide rwandais de 1994). Le sentiment d’une débâcle est si prononcé qu’on en viendrait presque à plaider en faveur d’un retour du colonialisme comme un retour de l’enfant-roi. Or à ce point de rabaissement, il est impératif de voir une poussée populaire, et, d’ailleurs, elle se fait voir, elle veut désamorcer la malversation bourgeoise (cf. p. 159), mais elle est sans tarder suivie d’un tour de vis sécuritaire qui est souvent l’embryon d’une société dictatoriale. La sécurité se mue alors en sémantique de la liberté alors que c’était la liberté, jadis, qui se muait en sémantique de la meilleure des sécurités quand tous les espoirs étaient permis à la suite de tel ou tel élan d’émancipation. Ainsi va l’éclosion du dictateur africain : la vulve sidéenne de la contrariété post-coloniale accouche d’un dirigeant d’airain qui s’intercale entre le peuple colérique et le bourgeois effarouché. Le dictateur est là en vue de casser la cadence accélérée de la colère – il est un système de freinage qui sidère le peuple et un système d’accélération pour les dividendes du bourgeois. Le dictateur, en outre, profite du crime : l’amplification du malaise social fomente autour de lui les remparts du pouvoir militaire (cf. p. 167), et, peu à peu, l’armée prescrit son omniprésence martiale et commande un dispositif exponentiel de répression. Le gain de ces mesures disciplinaires n’est pas contestable en apparence eu égard à la virile aseptisation des conduites, à la jugulation superficielle de la délinquance ordinaire, mais, en profondeur, il fait planer le risque permanent du coup d’État – le péril militaire des innombrables garnisons arrivistes et de leurs généraux populistes. Toutefois les conséquences désastreuses de la dictature empirent encore à ce niveau-là : le dictateur n’est que l’appareilleur d’un appareil consacré à l’ensevelissement du peuple dans le passé, dans le passéisme le plus dépassé, dans l’impuissance historique, dans l’anhistoricisme, dans l’élimination de toutes les opportunités de s’inscrire sur les mobiles charnières de l’Histoire. Ce n’est pas autre chose que du devenir devenu au carré. Ce n’est pas autre chose non plus que le miroitement de cette bourgeoisie sous-développée qui se fane dans la fleur du peuple parce que le bourgeois, quel qu’il soit, respire la haine de l’Histoire, la haine de tout ce qui se meut et qui meut, haine à laquelle il faut ajouter l’inutilité, l’inanité, la vaniteuse vanité bourgeoise, et lorsque ces indigences tombent dans le cerveau du coquin d’Afrique comme un aérolithe lépreux, elles font du bourgeois nègre non plus la «réplique» du bourgeois d’Europe mais sa très maudite «caricature» (p. 168).
Et cependant, quels que soient l’étendue de la blessure coloniale et le degré de sacrilège de ses héritiers, il existe une remédiation, du moins une projection mentale d’un affleurement de la terre promise, à savoir l’effort continuel de penser un gouvernement de politisation des masses (cf. p. 173). Ce serait une politique de la maturation de l’immaturité, ou, plus rigoureusement, un essai obstinément réitéré de faire advenir à la surface du peuple le substrat de son archaïsme sacralisant et par là même virtuellement guérisseur des profanations. Ce serait également, par un effet bienvenu de réciprocité, un mûrissement des façons de gouverner car la gouvernance mûrirait sa juvénilité à l’égard des choses anciennes, intemporelles, étanches aux airs du temps. Il y aurait ainsi deux genres de jeunesse qui progresseraient en régressant non pas vers la régression, mais vers le progrès de ce qui est immémorialement le mémorial de toute l’humanité : le signe d’une trame divine œuvrant et à la veille d’approuver la création de l’homme. Renouer avec les ancestralités fondatrices ne pourrait que dissiper les ancestralités dévoyées, comme, par exemple, l’exacerbation du réflexe tribal et du tropisme ethnique dans les dictatures, autant d’antinomies particularistes conspirant contre l’espoir d’un universalisme revigoré (cf. p. 175). Concrètement, du reste, cette réconciliation avec les entités universelles n’a de chance de voir le jour que sous réserve d’une décentralisation du pouvoir, d’une fragmentation de la puissance politique, ne serait-ce déjà que par la décision de diffracter la capitale sur le territoire, de désagréger l’agrégat de la grande ville (cf. p. 176-7). Ici l’affinité de Frantz Fanon avec la pensée de Montesquieu ne saurait faire le moindre doute : en se faisant l’avocat d’un pouvoir dilué, desserré, débaptisé des fonts-baptismaux des Babel politiciennes, Frantz Fanon a en ligne de mire les abus du pouvoir de même que ses tendances à être abusé par des pouvoirs plus vastes, et, dans le sillage du philosophe des Lumières, il nous redit que «par la disposition des choses», par l’obligation de bien penser les choses publiques et privées, «le pouvoir [devrait pouvoir arrêter] le pouvoir» (23) – le pouvoir devrait partout pouvoir être habité de son contrepouvoir. Or se disposer à correctement disposer les choses d’un juste gouvernement de l’homme, c’est, déjà, gouverner son âme propre, et c’est aussi songer que le peuple des hommes à quelque chose à dire et à faire, qu’il n’est pas une masse grégaire, un troupeau en quête de berger, mais qu’il est a priori le berger de ses forces attroupées (cf. p. 179). Pour en arriver là, pour en arriver à ce point de bascule d’une vision améliorée de la population populaire, on a besoin d’intellectuels d’une infaillible honnêteté et d’un parti véridique. Tout doit converger dans la sincérité des uns et des autres ainsi que dans la ferme résolution d’un immense programme d’éducation (cf. p. 187). Éduquer, ici, ce sera rendre plus humain ce qui est déjà humain dans l’homme, ce sera en outre une fortification des cerveaux, une maïeutique des esprits comme naissance d’un Esprit du Pays de l’Homme. Ce sera, comme formulé par les mots d’Aimé Césaire que Frantz Fanon nous remémore, un commandement qui commande à «inventer des âmes» et à procéder à l’inventaire du spirituel en passe de spiritualiser le temporel. Ce sera encore l’occasion d’expliquer et de comprendre que «la conscience nationale» n’est pas ce qui prévaut car «la conscience politique et sociale» est ce qui prémunit le peuple contre les Tentateurs nationalistes et les tentations du nationalisme qui serait un repli davantage qu’un pli supplémentaire sur le plissé de l’éventail humain (p. 192). Ce sera dans les termes personnels et apothéotiques de Frantz Fanon l’à-propos d’une politique très scrupuleuse, très soucieuse de «meubler les cerveaux, [d’emplir] les yeux de choses humaines, [de] développer un panorama humain parce qu’habité par des hommes conscients et souverains» (p. 193).
Un si haut langage visant un si glorieux chemin des crêtes de l’âme préconise forcément de fuir l’Europe et sa «monotone ondée du sous-langage» (24). Telle est l’instructive prescription de la sublime péroraison de ces Damnés de la Terre (cf. pp. 301-5) qui est aussi le contenu de l’ultima verba de Frantz Fanon gisant sur son lit d’hôpital : prendre ses distances avec l’Europe, décontaminer le continent africain du démon européen et de ses démonomanies, couper les ponts avec les maîtres tortionnaires de la «désintégration atomique» et les abominables mages noirs de la «désintégration spirituelle» (p. 301). Qu’on laisse alors l’Europe enterrer ses morts et mourir de sa mauvaise mort, qu’on l’abandonne à sa thanatocratie, à sa mythocratie, à tout ce qu’elle entreprend au détriment d’une psychocratie. Il n’y a plus de paradigme en Europe parce que l’Afrique a pris le chemin paradigmatique de sa délivrance et des réels universaux qui délivrent des prisons égotistes. Et pour tout à fait savoir ce que l’homme sera en tant qu’homme, il faudra suivre l’Afrique et sa réinvention de l’homme, ou, plutôt, ses retrouvailles avec l’homme au sein d’une direction majoritaire remettant à leur juste place les directions minoritaires. Ainsi se pavera la Via Appia de l’Afrique et sa digne sortie du précipice européen. Et l’Afrique, sur ces entrefaites, n’omettra pas de fuir avec une même volonté de fer les monstres de l’Amérique et les malformations de la Pax Americana (cf. p. 302) : ce n’est qu’à la faveur de cette double fuite de l’Europe et de l’ogre américain que l’Afrique pourra réellement se mettre en position de «[reprendre] la question de l’homme» (p. 303). Et c’est ce questionnement humain qui sera le pourvoyeur d’une capacité de «faire peau neuve» à dessein de sonder l’illustre ciel étoilé d’un «homme neuf» (p. 305) comme reflet du sacre de l’homme ancien – de l’homme divin – que l’on avait momentanément perdu.
La préface de Jean-Paul Sartre : entre pertinences et impertinences
Souvent brutal, parfois trivial, mais toujours ingénieux, Jean-Paul Sartre livre là une préface qui a le mérite de ne pas s’encombrer de raffinements inutiles et de déjuger les juges ayant (pré)jugé de l’infériorité du tiers-monde aux fins de le coloniser. Il accable tout de suite les élites européennes qui ont cru bon d’élaborer un «indigénat d’élite» dont la finalité savante devait justifier l’avènement de «nègres gréco-latins» – en vain. Non pas que les nègres ne pouvaient décoder les codes de cette culture : tout au contraire. Non pas que les nègres étaient sourds à ce Verbe présumé informé qui leur avait peut-être manqué dans le soi-disant désert verbal situé par-delà tous les murs d’Hadrien issus de l’architectonique des bonnes consciences gréco-romaines. Non pas que les nègres étaient aveugles aux splendeurs de l’intelligence, car, de l’intelligence, ils en avaient à revendre, mais ils ont vu et entendu, à travers le Verbe professoral désireux de professer aux supposés mauvais élèves de la planète, un Verbe adverbe du baiser de Judas, une Langue de vipère, une Parole si maigre dans sa non-Parole déjouée qu’elle ne pouvait qu’apparaître «filiforme», eût dit Armel Guerne, aussi fine et pateline que la rampante tubulure du serpent séducteur s’infiltrant par tous les filtres ou presque (25) (à l’exception du filtre tiers-mondiste qui a filtré dans d’acceptables délais les discours ophidiens de l’Europe grâce à une voix comme celle de Frantz Fanon, lequel, prestement, a voulu recommander une culture de la révolution avant l’usage d’une culture nationale (26)). Dominés par le carcan du mal économique, les indigènes ne sont pas facilement domesticables par les sophismes, et, par le biais d’une progressive répudiation de la parole falsifiée, ils ont commencé à mordre les mollets de tous les donneurs de leçons. À l’image d’un Rousseau faisant une entrée fracassante dans la philosophie, avec un sens similaire du paradoxe, les indigènes n’ont pas estimé que les sciences et les arts venus d’Europe étaient des garanties de vertu – ils ont pressenti à l’inverse que plus on venait leur apporter de la science et de l’art, plus on venait répandre le vice (27). C’est comme s’ils avaient auguré sous les délicatesses le vrai gisement de la rudesse, comme s’ils avaient saisi, sous la notoire plasticité de ces cerveaux occidentaux, le comble de l’adaptabilité qui a décrété que l’adaptation au Mal serait le parti le plus rentable parce qu’il serait dissimulé par de nombreux ondoiements du Bien. C’est toujours la même violence tranquille, assise, prévoyante, la violence méthodique des holocaustes commis en raison de la raison. Et ce flegme de la cruauté ne s’est pas le moins du monde affolé de ce que l’on commençait à le remettre en cause. En dépit des ruées dans les brancards, l’Europe, rappelle Jean-Paul Sartre, a été comparable à la caravane qui passe devant les chiens qui aboient, reconduisant ad nauseam sa conduite pontifiante, pédante, dispensatrice des bons points dans une classe turbulente, allant, «une fois», jusqu’à «décerner le prix Goncourt à un nègre» (en l’occurrence à René Maran au cours de l’année 1921).
Relativement à ces pièces à conviction émaillant le mouvement d’exorde de cette pressante préface, son auteur, fort de son exaspération et de son talent argumentatif, en vient à faire valoir le tout premier bénéfice d’une lecture des Damnés de la Terre : le crescendo du sentiment de la honte en nous-mêmes. La honte est de surcroît censée nous métamorphoser, nous hisser sur les frontons du repentir, nous inculquer la honte de ne pas avoir eu honte pendant tant de temps malgré l’action de nos mercenaires et de nos fonctionnaires du colonialisme. La honte nous prend la main dans le sac ou l’œil au trou de la serrure, elle permute les vues car tel est pris qui croyait prendre, et toutes nos complicités, actives ou passives mais clandestines, se voient ouvertement exhibées. Le colonisé tout à coup surprend le colonisateur et ses cautions, son œil pénètre les consciences et les confins de l’esprit, comme l’œil des catacombes dilate sa pupille et interpelle Caïn le meurtrier des origines. Et maintenant que nous sommes vus, maintenant que nous sommes honteux parce que nous avons été placés sous les yeux d’autrui, c’est l’Autre, enfin, qui s’affirme, l’Autre qui apparaît pendant que je disparais, l’Oppressé qui survient à la visibilité lors même que son Oppresseur aspire aux espaces limbiques de l’invisibilité. Car la honte engendre autrui, elle l’engendre d’autant plus que l’autre était jusqu’alors altéré dans son altérité, annihilé dans le nihilisme du colon, et, ainsi, la honte intraitable est l’émotion dévastatrice qui peut le mieux traduire que ma solitude était un fallacieux arrangement de ma conscience, un enfouissement de la mauvaise conscience, écho d’un travestissement de la réalité que j’avais choisi de ne voir que d’un œil – l’œil du strabisme qui fuit le réel, ou, inversement, l’œil du voyeur qui voyait la colonisation dans les journaux et qui croyait voir de l’humanisme en sachant bien – par un examen rigoureux du fond de l’œil moral – que c’était là une œuvre terrible de la déshumanisation. Et dans l’enchaînement des permutations conceptuelles motivées par le jeu de la honte, je m’objective dans l’appréhension de celui qui m’a confondu, je deviens l’Objet de ce Sujet nouveau-né, je suis liquidé du monde de la subjectivité parce que j’ai chuté dans le monde de l’objectivité et je me situe désormais dans l’objectif impitoyable de celui qui a servi trop longtemps de cobaye pour les chosifications coloniales. Donc je suis pris tandis que l’autre s’est dépris de moi en reprenant pied dans la vie, et, à présent, me voilà prêt à me voir tel que je suis, tout nu, cloué au pilori, obligé de me juger, de m’évaluer, condamné à remanier les mots fameux d’Angelus Silesius dans la mesure où ce que je suis, à présent je le sais, et où ce que je sais, à présent je le suis (28). Tel est le pouvoir magique de la honte testée à l’encontre du colonialisme, pouvoir de disparition du bourreau et de réapparition de la victime, pouvoir d’expédition autopunitive dans la mauvaise conscience, pouvoir de dire que l’appartenance au genre humain n’est pas un antidote à l’inhumanité, en cela que, avec Primo Levi, la honte d’être un homme ne nous quittera jamais plus dès lors que nous aurons enfin compris que les hommes, éhontément, cyniquement, ont la faculté de «construire une masse infinie de douleur» (29) et de s’en féliciter.
La seconde récompense d’une lecture de ce Frantz Fanon des tous derniers instants, c’est, toujours selon Sartre, une compréhension de la violence comme obstétrique de l’Histoire. Le legs de Marx est ici explicite et réfère à une phrase aphoristique tirée du Capital à laquelle la préface fait allusion : «La violence est l’accoucheuse de toute vieille société qui est enceinte d’une nouvelle.» Autrement dit la décolonisation ne peut se faire que par le truchement de la violence si elle veut se constituer en société neuve et en société pleinement historique. La violence serait par conséquent le radical des configurations successives du roman de l’homme, un roman polémique, pour ne pas dire polémologique, chapitré par les guerres et les rébellions. C’est là une exaltation de la violence, une violence exaltée, productrice d’événements exaltants, sûrement un peu tributaire des hommes exceptionnels qui ne sont qu’une poignée, hommes capables d’événementiel, donateurs autoritaires des formes nouvelles de la vie et insensibles aux sensibilités morales. Ce sont de vivants matériaux conducteurs et ils peuvent acheminer les masses vers des transports inouïs de violence. Pour eux, seuls comptent les buts conscients de leur personnalité ainsi que les masses qu’ils drainent – il ne saurait y avoir, d’après eux, aucune espèce de signification intime de l’Histoire en-deçà ou au-delà de l’agissante extimité des hommes. Leur liberté veut faire l’Histoire et elle la fait, elle la pousse à se faire, en dehors de toute finalité cosmique tamisant le relief de l’agitation humaine, en dehors, également, de toute ruse stellaire qui ruserait les hommes quant à leur libre arbitre en se servant d’eux pour accomplir un sens caché du récit humain. Tout cela pour exprimer finalement que la violence formatrice de formes historiques n’admet pas une interprétation de l’Histoire dans les tonalités subtiles (du moins en première intention) : pour changer de morphologie, un peuple doit recourir à la violence, à plus forte raison encore s’il est un peuple colonisé. Or les parturitions de la décolonisation par les voies uniques de la violence sont quelque peu essentialistes, limitatives, ce qui, en soi, relève déjà d’une bizarrerie pour le philosophe qui a toujours clamé que l’existence devait à tout prix précéder l’essence. Il est indéniable que Sartre charge la mule de la violence, même si, évidemment, il le fait de bon cœur compte tenu de l’ignominie coloniale, à moins qu’il ne le fasse, aussi, pour se dédouaner d’une affiliation à la bourgeoisie qui l’a souvent contrarié. Quoi qu’il puisse en être, cependant, il est indispensable de savoir que cette préface ne rend pas hommage au propos de Fanon sur la violence, un propos analytique, virilement pondéré, donc un propos, tel que le fait remarquer Alice Cherki dans sa propre préface (cf. pp. 5-15), qui n’astreint pas la violence à une finalité indépassable et qui ne la justifie pas de but en blanc. En effet, pour Fanon, la violence et rien que la violence ne serait pas une accoucheuse mais plutôt une avorteuse de l’Histoire, une très nette sortie de l’Histoire avant même d’y être entré, ce dont les nations du tiers-monde, avouons-le, n’ont pas du tout besoin. Être violent avec les violents, par une sorte de loi du Talion, ce serait du reste un peu vite minimiser la qualité possible de la violence, ce serait, au fond, prendre le risque de rater la légitimité de la violence en la subordonnant d’emblée à l’illégitimité des colons. Non : ce qui est requis, ce n’est pas un mimétisme de la violence, ce n’est pas un historicisme de la violence, mais une violence didactique, une violence qui porte en elle ce qui fera de l’homme autre chose que le grossier perpétuateur de la violence.
C’est pourquoi nous ne pouvons souscrire en totalité aux thèses sartriennes, hormis en ce qui concerne le côté spectaculaire de certaines formules, comme par exemple lorsqu’il soutient que l’inconscient collectif des colonisés ne peut être qu’un inconscient d’assassins aux abois. Et nous ne ferons pas l’économie du passage le plus virulent de cette préface : supprimer un Européen, le tuer, c’est «supprimer en même temps un oppresseur et un oppressé : restent un homme mort et un homme libre.» Il s’agit davantage d’un slogan que d’une pensée, d’un cabotinage d’intellectuel, d’une devise qui sent les couloirs de la Sorbonne, et, comme de coutume dans les écrits de Sartre, les difficultés philosophiques ont tendance à être traitées par l’intervention d’un deus ex machina : les colonisés ont l’air de vivre dans une impasse, alors faisons descendre la violence du ciel – les réalités de la vie ont l’air de valider des servitudes insurmontables, alors faisons descendre la liberté du ciel avec son cortège d’infinies possibilités. C’est aller vite en besogne et Frantz Fanon ne va pas aussi vite en dépit de la maladie qui le ronge. Mais gardons-nous aussi du même écueil et saluons Sartre d’avoir rédigé ce sincère préambule en nous forçant à regarder et à subir «le strip-tease de notre humanisme» – notre effroyable nudité de vieux exploitants et d’ayants droit de la misère, car il se trouvera bien, en cherchant bien, à un endroit de nos arbres généalogiques, un violent de jadis, un violent colonial, un violent qui nous demande de demander pardon au tiers-monde et de ne nous y rendre que sur suppliante recommandation du Seigneur.
Notes
(1) Frantz Fanon repose d’ailleurs à la Nécropole des Martyrs d’Aïn Kerma, au nord-est de l’Algérie, dans la région d’El Tarf. Son corps a pu y être transféré en 1965. Il était jusqu’alors inhumé non loin au cimetière de Sifana.
(2) Ce que mentionne Raphaël Confiant dans son livre L’insurrection de l’âme où il entreprend de forger l’autobiographie de Frantz Fanon comme narration de la «vie et [de la] mort du guerrier-silex» (ce sous-titre reprend l’appellation minérale et baroudeuse qu’employait Aimé Césaire pour désigner l’auteur de Peau noire, masques blancs).
(3) Cf. Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal.
(4) Simone de Beauvoir, Pour une morale de l’ambiguïté. L’essai est publié en 1947 et il continue de démocratiser les grandes questions de l’existentialisme de style athée.
(5) Nous adaptons ici un propos de Georges Bataille, repris par Simone de Beauvoir, où l’essayiste de L’Expérience intérieure affirme que chaque individu nourrit l’ambition d’être Tout.
(6) Cité par Max Picard dans L’homme du néant (Mussolini reprenant ici une formule de Nietzsche et lui insufflant l’engrais malsain de l’idéologie fasciste).
(7) Cf. Blaise Pascal, Pensées (B 358).
(8) Citations et images issues de l’un des plus admirables (sinon le plus admirable) poèmes d’Auden : The Age of Anxiety.
(9) En l’occurrence Marie-Josèphe Dublé (1930-1989). La dictée faisait en outre partie d’une habitude de Frantz Fanon et son épouse a été le réceptacle privilégié de sa parole activiste (cf. Raphaël Confiant, L’insurrection de l’âme). Mais c’est Marie-Jeanne Manuellan (1928-2019) qui en a fait l’expérience la plus consistante, ce qu’elle raconte dans son ouvrage Sous la dictée de Fanon (L’Amourier Éditions, 2017).
(10) John Edgar Wideman, Le projet Fanon (Gallimard, 2013). Ce roman expérimental est conçu à l’instar d’une hybridation entre la vie même du romancier et la vie de Frantz Fanon. Il se veut également un «scénario qui ramènerait Fanon à la vie». Il se veut encore le furtif mémorial de deux autres héros du peuple noir, nés aussi en 1925, comme Frantz Fanon : Patrice Lumumba et Malcolm X, tous les deux assassinés, le premier en 1961 (ce qui lui donnera les mêmes épitaphes que Fanon), le second en 1965.
(11) J. E. Wideman, ibid.
(12) Nous travaillons à partir de la version des Éditions La Découverte (coll. Poche, 2002).
(13) Pour le dire en empruntant un célèbre vocable de Gabriel Marcel.
(14) Comme le dit Vassili Grossman de l’œil du mirador dans le dispositif du goulag (cf. Vie et Destin).
(15) Pour approfondir les enjeux d’une approche psychiatrique de la colonisation : cf. Guerre coloniale et troubles mentaux (dernière partie des Damnés de la Terre).
(16) Cf. Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live.
(17) Cf. Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme.
(18) Cf. Aimé Césaire, ibid.
(19) Aristote, Seconds analytiques.
(20) Selon le principe de stratégie politique de Carl Schmitt qui énonce que le souverain est toujours celui qui décide de l’exceptionnalité d’un contexte.
(21) À supposer alors que l’on ait également vaincu «l’impréparation des élites, l’absence de liaison organique entre elles et les masses, leur paresse et, disons-le, la lâcheté au moment décisif de la lutte» (p. 145).
(22) Vassili Grossman, Vie et Destin.
(23) Montesquieu, De l’esprit des lois.
(24) Cf. Armand Robin, La fausse parole.
(25) Cf. Armel Guerne, Les jours de l’Apocalypse.
(26) Cf. Sur la culture nationale (avant-dernière section des Damnés de la Terre).
(27) Cf. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts.
(28) Le poète mystique disant plutôt cela : «Ce que je suis, je ne le sais pas ; ce que je sais, je ne le suis pas.» C’est en outre Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau qui rappelle que ce visionnaire de Basse-Silésie est maintes fois utilisé dans les réflexions de Jankélévitch (cf. Vladimir Jankélévitch, La mauvaise conscience – présentation).
(29) Primo Levi, Les Naufragés et les Rescapés (tel que dûment cité par Jean Vioulac dans le second volume de sa Métaphysique de l’Anthropocène).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, philosophie, histoire, colonialisme, frantz fanon, gregory mion, les damnés de la terre |  |
|  Imprimer
Imprimer