Gershom Scholem et la lecture secrète de la Cabale (20/03/2008)

Crédits photographiques : Yanping Wang.
Gershom Scholem, Dix Propositions anhistoriques sur la Cabale.
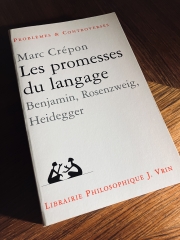 Le livre de Marc Crépon, Les Promesses du langage est un des signes évidents de la redécouverte éditoriale d’auteurs tels que Walter Benjamin ou Karl Kraus qui, l’un et l’autre, malgré d’irréductibles différences, ont bâti leur œuvre sur la problématique du langage. Problématique ? Le mot, sans doute, est trop vague et faible, même s’il convient aux philosophes de métier. Que le questionnement de la langue soit un des soucis majeurs des penseurs les plus importants du XXe siècle, comme Wittgenstein ou Heidegger et, à présent, Appel ou Agamben, doit à nos yeux avoir valeur de preuve irréfutable. C’est dans le mystère – le mystère et non pas, donc, une problématique – du langage qu’est déposé le sceau de notre Modernité bavarde et malade ou, à tout le moins, inquiète, dans ce mystère du langage plutôt que dans son plat agencement formaliste selon Noam Chomsky, dans ce mystère exploré par les paradoxes d’Hamann, maître de Kierkegaard, dans ce mystère dévalué, dans le meilleur des cas, en secret de polichinelle par le mensonge, la propagande, la publicité, la vivisection déconstructrice ou, je l’ai dit, formaliste. Pourtant, le mystère devenu secret, la lumière éblouissante contrainte de se travestir sous des dehors grotesques et prétendument ésotériques rayonne encore de son antique grandeur, comme nous l’apprend l’étude du langage menée par les auteurs que je viens de citer. J’ai parlé de Benjamin, auquel il faudrait consacrer certainement plusieurs pages rendant compte des ouvrages qui paraissent de lui ou analysant son œuvre, tant son «aura» semble rayonner de nouveau depuis quelques années, et ce malgré une influence profonde, cachée, jamais disparue, sur des penseurs tels que son grand ami Gershom Scholem, influence et aura que ce dernier s’est attaché à commenter et expliquer à diverses reprises.
Le livre de Marc Crépon, Les Promesses du langage est un des signes évidents de la redécouverte éditoriale d’auteurs tels que Walter Benjamin ou Karl Kraus qui, l’un et l’autre, malgré d’irréductibles différences, ont bâti leur œuvre sur la problématique du langage. Problématique ? Le mot, sans doute, est trop vague et faible, même s’il convient aux philosophes de métier. Que le questionnement de la langue soit un des soucis majeurs des penseurs les plus importants du XXe siècle, comme Wittgenstein ou Heidegger et, à présent, Appel ou Agamben, doit à nos yeux avoir valeur de preuve irréfutable. C’est dans le mystère – le mystère et non pas, donc, une problématique – du langage qu’est déposé le sceau de notre Modernité bavarde et malade ou, à tout le moins, inquiète, dans ce mystère du langage plutôt que dans son plat agencement formaliste selon Noam Chomsky, dans ce mystère exploré par les paradoxes d’Hamann, maître de Kierkegaard, dans ce mystère dévalué, dans le meilleur des cas, en secret de polichinelle par le mensonge, la propagande, la publicité, la vivisection déconstructrice ou, je l’ai dit, formaliste. Pourtant, le mystère devenu secret, la lumière éblouissante contrainte de se travestir sous des dehors grotesques et prétendument ésotériques rayonne encore de son antique grandeur, comme nous l’apprend l’étude du langage menée par les auteurs que je viens de citer. J’ai parlé de Benjamin, auquel il faudrait consacrer certainement plusieurs pages rendant compte des ouvrages qui paraissent de lui ou analysant son œuvre, tant son «aura» semble rayonner de nouveau depuis quelques années, et ce malgré une influence profonde, cachée, jamais disparue, sur des penseurs tels que son grand ami Gershom Scholem, influence et aura que ce dernier s’est attaché à commenter et expliquer à diverses reprises.Ce qui vient des profondeurs présente toujours, exposé sous la lumière vive du jour, de bizarres propriétés. Ainsi : l’essence de cette influence souterraine, quel n’est pas notre étonnement de constater qu’elle provient d’une œuvre qui a tenté d’unir matérialisme dialectique et souci métaphysique, bien que le suicide précoce de l’écrivain nous interdise de juger de l’orientation de sa pensée après ses sombres thèses sur l’histoire, où l’interrogation spirituelle se faisait plus pressante, à vrai dire urgente, peut-être même désespérée : «Jamais, d’ailleurs, je n’ai entendu sortir de sa bouche une phrase exprimant une pensée athée», nous confie ainsi Scholem. L’auteur des Grands courants de la mystique juive va plus loin lorsqu’il dit de son ami Benjamin qu’il «raisonne en théologien dans un monde profane, masquant sa pensée et la traduisant dans un langage étranger qui est celui du matérialisme historique». Il s’agit bien, dans ces lignes, de légitimer, à propos de Benjamin mais aussi de Kafka, une démarche contre-historique, une réflexion ou une création artistique indirectes pour ainsi dire, obligées, pour parvenir à leurs fins, d’emprunter des vias tortas, des voies tortues ou tortueuses, voilées et, parfois même, travesties. Il n’est donc pas exagéré de dire que Scholem, selon Biale, privilégie la voie intellectuelle, quasi secrète dans son essence, d’une véritable logique de subversion, d’un paravent métaphysique derrière lequel se cache… Quoi ? Nous le verrons plus loin.
 Dès lors, que cette tentative d’élucidation ou d’exégèse avançant masquée soit intimement corrélée avec le langage ne peut nous étonner. Je parlais d’essence secrète et de langage : je crois en effet que l’une et l’autre sont indissociablement liés, comme Pierre Boutang a tenté de le montrer dans son œuvre magistrale, Ontologie du secret. Je crois encore qu’il nous reste beaucoup à faire pour sonder l’immense richesse de ces auteurs que Steiner appela pour s’en éloigner immédiatement «logocrates», auteurs qui ont affirmé que la parole et l’Être étaient une seule et même chose, que le mensonge et le non-Être étaient également, donc, une seule et même réalité. Tous ces auteurs, de même que Pierre Boutang, sans exception, sont devant nous, tant la pertinence de leurs interrogations apparaît à notre époque en poussières, lequel cherche les causes géopolitiques et économiques du 11 septembre sans même paraître s’aviser que la déchéance du langage utilisé par les dirigeants politiques, langage qui mêle vocabulaire profane et sacré, est l’un des ferments invisibles mais prodigieusement actifs de la colère, non seulement de quelques fous qui osent passer aux actes, mais de millions d’humiliés qui triment en silence et se reproduisent comme des lapins, en faisant plus de bruit toutefois.
Dès lors, que cette tentative d’élucidation ou d’exégèse avançant masquée soit intimement corrélée avec le langage ne peut nous étonner. Je parlais d’essence secrète et de langage : je crois en effet que l’une et l’autre sont indissociablement liés, comme Pierre Boutang a tenté de le montrer dans son œuvre magistrale, Ontologie du secret. Je crois encore qu’il nous reste beaucoup à faire pour sonder l’immense richesse de ces auteurs que Steiner appela pour s’en éloigner immédiatement «logocrates», auteurs qui ont affirmé que la parole et l’Être étaient une seule et même chose, que le mensonge et le non-Être étaient également, donc, une seule et même réalité. Tous ces auteurs, de même que Pierre Boutang, sans exception, sont devant nous, tant la pertinence de leurs interrogations apparaît à notre époque en poussières, lequel cherche les causes géopolitiques et économiques du 11 septembre sans même paraître s’aviser que la déchéance du langage utilisé par les dirigeants politiques, langage qui mêle vocabulaire profane et sacré, est l’un des ferments invisibles mais prodigieusement actifs de la colère, non seulement de quelques fous qui osent passer aux actes, mais de millions d’humiliés qui triment en silence et se reproduisent comme des lapins, en faisant plus de bruit toutefois.C’est en tout cas, à l’évidence, de cette même certitude que Scholem a nourri son œuvre monumentale, dont seulement quelques grands pics ont été livrés à l’exploration des lecteurs français, comme la monographie consacrée à l’un des personnages les plus controversés de l’histoire religieuse d’Israël, Sabbataï Tsevi, œuvre qui illustre admirablement mon propos puisqu’il s’agit, pour Scholem, de sonder la réalité d’une présence de Dieu dans l’inversion radicale de toutes les valeurs prônée par l’hérésiarque juif en guise de méthode mystique. Dans l’essai remarquable que David Biale a écrit sur le maître de l’exégèse cabalistique, le langage, le soin et l’attention amoureuse, presque maniaque que la tradition juive lui a consacrés, constituent le nœud gordien de toute interrogation véritable sur la place, historique et intellectuelle, de Scholem. Certes, si la première vertu de l’auteur est d’avoir révélé un judaïsme qui «ne peut plus être considéré comme une religion exclusivement rationnelle et légaliste» (11), l’importance réelle de Scholem tient au fait qu’il a accordé une place essentielle au langage en faisant de lui le substrat d’une vérité cachée, quoique essentielle. «L’étincelle magique est perdue quand le langage devient un instrument purement conventionnel de communication humaine» écrit ainsi David Biale, ajoutant cependant qu’à «chaque génération l’homme a la capacité de retrouver la créativité édénique dans le langage» (224). Il s’agit en somme de remotiver les mots de la tribu, de les débarrasser de leur gangue de futilité utilitaire pour leur permettre d’appeler (le mot n’est pas trop fort) leur Créateur et de répondre ainsi à leur vocation (vocatus) première, véritable, essentielle : là s’arrête donc la ressemblance avec l’entreprise menée par Mallarmé puisque la tradition cabalistique patiemment commentée par Scholem vise une connaissance de Dieu, connaissance opérative et pas seulement intellectuelle, cette caractéristique rapprochant la cabale de la Gnose ou, mieux, d’une forme de théurgisme magique. Ce travail mené sur le langage vise à libérer les forces vives de la Parole, enfouies sous la croûte sèche de la banalité, du mensonge et de l’utilitarisme commerçant.
Ce texte figure dans son intégralité (avec son apparat critique) dans mon ouvrage intitulé La Critique meurt jeune, publié par les éditions du Rocher.
Sans autre indication, les pages entre parenthèses renvoient au bel essai de David Biale, Gershom Scholem. Cabale et contre-histoire suivi de Dix propositions anhistoriques sur la cabale (Éditions de L’Éclat, 2001).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, gershom scholem, pierre boutang, george steiner, cabale |  |
|  Imprimer
Imprimer