En lisant Leo Strauss : pourquoi écrire sous la persécution ? (19/03/2009)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 La question semblera scandaleuse une fois qu'elle aura longuement résonné dans les cervelles molles des bien-pensants. Pourquoi, en effet, écrire sous la persécution, lorsque notre magnifique liberté, garantie par toute une batterie de lois débarrassées de leurs inutiles devoirs, fait de cet acte un pur divertissement, une vulgarité criarde, un geste dépourvu de toute portée comme de toutes conséquences (Jean-Philippe Domecq évoque un art sans conséquences), comme l'illustre, par exemple, l'initiative, baptisée M@nuscrits, des éditions Léo Scheer, où des textes, dont la qualité d'ensemble est rien de moins qu'inexistante, s'exposent à tous les regards dans des poses pornographiques, sans art de la réserve, sans pudeur ? Cet exemple, hélas, n'est en rien une initiative notable qui, selon les propos ineptes de Léo Scheer, tracerait une voie nouvelle dans notre façon de lire, voire, pour un éditeur, de publier, mais la commune mesure ou plutôt l'étiage de l'âge publicitaire qui est le nôtre.
La question semblera scandaleuse une fois qu'elle aura longuement résonné dans les cervelles molles des bien-pensants. Pourquoi, en effet, écrire sous la persécution, lorsque notre magnifique liberté, garantie par toute une batterie de lois débarrassées de leurs inutiles devoirs, fait de cet acte un pur divertissement, une vulgarité criarde, un geste dépourvu de toute portée comme de toutes conséquences (Jean-Philippe Domecq évoque un art sans conséquences), comme l'illustre, par exemple, l'initiative, baptisée M@nuscrits, des éditions Léo Scheer, où des textes, dont la qualité d'ensemble est rien de moins qu'inexistante, s'exposent à tous les regards dans des poses pornographiques, sans art de la réserve, sans pudeur ? Cet exemple, hélas, n'est en rien une initiative notable qui, selon les propos ineptes de Léo Scheer, tracerait une voie nouvelle dans notre façon de lire, voire, pour un éditeur, de publier, mais la commune mesure ou plutôt l'étiage de l'âge publicitaire qui est le nôtre.Répondons donc à notre question en inversant la proposition : écrire dans ou sous la liberté, publier des livres en les insérant dans l'immense circuit de la démocratie libérale faisant triompher la plus stricte orthodoxie des idées plutôt que l'originalité, idées communes puisqu'elles sont aussi bien partagées par le pouvoir que par la foule (1), c'est sans aucun doute ne pas écrire, ou alors se contenter de bavarder, publier des ouvrages de peu de poids. Il nous faut retrouver le sens du désir, une érotique donc, s'il est vrai que le secret aime autant se cacher que se révéler. Or, l'art d'écrire, comme celui de lire affirme Leo Strauss le très subtil, est volonté du secret, de la pénombre plutôt que de la lumière sous laquelle les putains appâtent leurs clients en exhibant l'absence de tout secret, une chair livrée, une langue standardisée, un érotisme de commande, une parole monnayable.
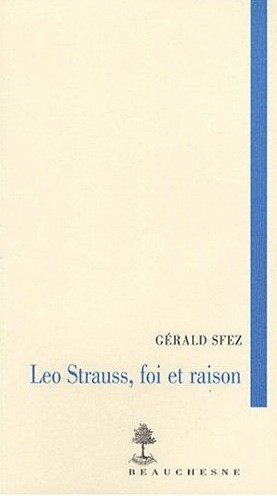
LRSP (livre reçu en service de presse, Beauchesne, 2007).
Si la vérité exige d'être dite, elle ne peut du moins être livrée à tous. Seuls les plus dignes, dans la Cité, seront à même de lire entre les lignes puisque c'est dans cet espace même, qui n'existe point en dehors d'une tension entre plusieurs textes sur laquelle nous reviendrons, que nous avons le plus de chance d'en surprendre l'étrange et délicate apparition. Dans une lettre à Gershom Scholem du 10 mai 1950, Leo Strauss, évoquant avec le maître des études cabbalistiques des questions de succession à des postes universitaires, affirmait qu'aucun des trois candidats que «vous évoquez [Georges Vajda, Alexander Altmann et Simon Rawidowicz] ne remplit [l'une des] deux conditions essentielles : le fait que nous ne pouvons rien savoir ne les affecte pas au plus profond d’eux-mêmes […].» (2) Leo Strauss, lui, est le penseur qui a été plus que tout autre affecté par le fait que nous ne puissions savoir, non pas rien, ce qui frapperait d'une totale inutilité la tâche du philosophe, mais certaines choses seulement à l'intérieur de limites très précises (3), et encore, à la seule condition que nos lectures reviennent aux sources de la philosophie, Socrate (4) et Platon tels qu'ils ont été lus et commentés par Fârâbî par exemple, tout en se débarrassant des présupposés aussi aveuglants que faux hérités des Lumières (5) dont celui, bien sûr, d'une croyance en un progrès inéluctable (6).Que tenter de connaître ? La vérité bien sûr. Comment y parvenir ? En questionnant, donc en lisant. Lire est un questionnement, un art, pas une distraction. Lire suppose donc de prendre au sérieux l'auteur dont on lit les ouvrages : peut-être s'est-il, plus qu'un autre, approché de la vérité ? En tous les cas, Strauss balaiera les prétentions qu'exprima Kant dans sa Critique de la raison pure : le lecteur ne peut en aucun cas mieux comprendre le texte que ne l'a compris son auteur (7). C'est en lisant avec grande attention, en lisant entre les lignes les grands auteurs du passé que l'on tentera de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Lire, plus qu'une herméneutique, est une aventure que l'on ne peut accomplir qu'à l'unique condition de savoir regarder la multitude de signes que le vulgaire promeneur (et que dire du touriste !) ne désirent même pas voir : «Il y a des livres dont les phrases ressemblent à des sentiers assez tortueux qui mènent le long de précipices dissimulés par d’épais buissons, et parfois même le long de cavernes spacieuses et bien cachées. Ces profondeurs et ces cavernes ne sont pas remarquées par ceux qu’occupe le travail et qui se hâtent vers leurs champs; mais elles deviennent graduellement connues au voyageur oisif et attentif» (8).
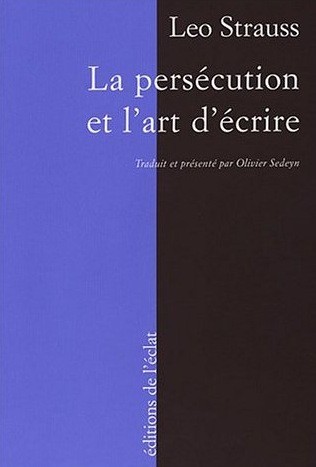 Leo Strauss, l'un des penseurs les plus subtils, voire paradoxaux (9) de sa génération et l'un des moins facilement réductibles à quelques fades monochromes néo-conservateurs comme celui qui consiste à faire de lui un réactionnaire (10), a développé sa théorie de l'art d'écrire par le truchement d'un concept devenu fameux, la persécution. Dans des pages denses qui constituent le deuxième chapitre (L'art d'écrire et l'établissement de la preuve) d'une très belle étude intitulée Leo Strauss, foi et raison, Gérald Sfez définit ainsi la persécution : «Par ce terme [Strauss] désigne plutôt le présupposé de pensée nécessaire, que la persécution soit sensible ou non, pour que la liberté de penser trouve sa vitalité et que la pensée trouve son écriture; la persécution est la dimension présupposée de l’écart entre le vif de la pensée et de la liberté avec tout consensus de l’opinion sociale, source de tous les credo conformistes et, pis encore, de tous les phénomènes tyranniques» (11). Les termes employés par Sfez évoquent cette dimension du désir, que nous notions plus haut et qui s'oppose à la satisfaction pornographique des besoins; l'auteur poursuit : «Toujours pris dans une double parole, le discours de vérité, en se couvrant ainsi, se protège et protège ceux à qui il est adressé. Composé et diffusé sous la condition de la persécution, condition dont il faut comprendre le sens, la preuve, aussi bien du discours effectivement tenu par le philosophe que de sa vérité (son adéquation à l’essence des choses), est tenue secrète. Pour y accéder, il faut recourir à un art de déchiffrer la parole oblique, les allusions, les sous-entendus, les paroles dites une seule fois et comme en passant, il faut se faire sensible à «la vision fugitive du fruit défendu», ce qui requiert, pour une part, une discipline et une ascèse, pour une autre part, une érotique de l’événement de vérité, celle de désirer savoir «lire entre les lignes» (12).
Leo Strauss, l'un des penseurs les plus subtils, voire paradoxaux (9) de sa génération et l'un des moins facilement réductibles à quelques fades monochromes néo-conservateurs comme celui qui consiste à faire de lui un réactionnaire (10), a développé sa théorie de l'art d'écrire par le truchement d'un concept devenu fameux, la persécution. Dans des pages denses qui constituent le deuxième chapitre (L'art d'écrire et l'établissement de la preuve) d'une très belle étude intitulée Leo Strauss, foi et raison, Gérald Sfez définit ainsi la persécution : «Par ce terme [Strauss] désigne plutôt le présupposé de pensée nécessaire, que la persécution soit sensible ou non, pour que la liberté de penser trouve sa vitalité et que la pensée trouve son écriture; la persécution est la dimension présupposée de l’écart entre le vif de la pensée et de la liberté avec tout consensus de l’opinion sociale, source de tous les credo conformistes et, pis encore, de tous les phénomènes tyranniques» (11). Les termes employés par Sfez évoquent cette dimension du désir, que nous notions plus haut et qui s'oppose à la satisfaction pornographique des besoins; l'auteur poursuit : «Toujours pris dans une double parole, le discours de vérité, en se couvrant ainsi, se protège et protège ceux à qui il est adressé. Composé et diffusé sous la condition de la persécution, condition dont il faut comprendre le sens, la preuve, aussi bien du discours effectivement tenu par le philosophe que de sa vérité (son adéquation à l’essence des choses), est tenue secrète. Pour y accéder, il faut recourir à un art de déchiffrer la parole oblique, les allusions, les sous-entendus, les paroles dites une seule fois et comme en passant, il faut se faire sensible à «la vision fugitive du fruit défendu», ce qui requiert, pour une part, une discipline et une ascèse, pour une autre part, une érotique de l’événement de vérité, celle de désirer savoir «lire entre les lignes» (12).Lire entre les lignes n'est donc point une activité démocratique, au sens où elle serait d'un usage commun. L'écriture philosophique véritable, l'écriture entre les lignes, est liberté essentielle puisqu'elle est résistance contre la persécution. La masse ne perçoit pas l'exigence de cette résistance (13) et, pour le dire simplement, se moque de devoir vivre conformément à la droiture qu'exige la liberté. Leo Strauss n'a du reste jamais estimé que l'activité philosophique devait être l'affaire de tout un chacun, ou de ces clowns médiatiques, Onfray, Comte-Sponville et d'autres qui passent plus de temps sur les plateaux de télévision qu'à écrire leurs ouvrages. L'art de lire, comme celui d'écrire entre les lignes, est réservé selon Strauss à une élite, parce que la résistance n'est jamais le fait que d'une minuscule poignée d'hommes. C'est d'ailleurs en raison même de cette dimension élitiste de l'activité philosophique que le penseur a non seulement le droit mais aussi le devoir de cacher ce qu'il révèle aux regards inattentifs. Sfez écrit significativement que : «[…] tout message, s’il veut traverser les temps, doit se protéger ainsi car, si, à la rigueur, il peut être lu ouvertement de son temps, il ne peut se sauvegarder pour le futur que grâce à la mise en place d’un tel dispositif» (14).
J'ai évoqué, plus haut, la question de la vérité. Il serait illusoire de croire que, si la démarche philosophique réelle exige de la rechercher, ce serait un seul texte qui, dans sa singularité opaque, pourrait nous la présenter. Mieux vaut penser que comme l'aleph rayonnant au fond d'une cave imaginé par Borges, cette vérité, unique, n'en rayonne pas moins dans une multitude de directions et se donne par le biais de la confrontation entre plusieurs textes ou, même, au sein du même livre, entre plusieurs chapitres desquels naîtra l'étincelle (15). Comme Sfez l'écrit : «Lire entre les lignes n’est pas chercher le texte essentiel derrière le texte manifeste en une approche selon la profondeur, mais produire l’étincelle qui jaillit du frottement entre deux pierres inconnues, l’évidence surgie d’une confrontation entre deux textes opaques» (16). En fait, l'éclosion de la vérité ne peut se produire que pour un seul esprit : celui qui, sachant correctement lire, fait jouer entre eux les textes. C'est uniquement dans ce jeu que la vérité peut apparaître, même s'il faudra ensuite, par un travail raisonné et lent, faire deviner la démarche par laquelle la vérité s'est produite. Ainsi, il s'agira, pour Leo Strauss, d'écrire à son tour entre les lignes, et sans doute de parier sur l'intelligence de ses propres lecteurs qui, lisant correctement ses textes, pourront peut-être affirmer que Strauss a compris ce qu'était la vérité. Sfez poursuit : «La conséquence du caractère laconique de la vérité et de son déchiffrement dans l’intertexte est qu’il n’existe pas de texte qui se tienne entièrement dans l’élément de la vérité. Il n’y a de chair du texte que pour autant qu’il ne peut y avoir de corps de pensées vraies, c’est-à-dire de chaînes de raisons. C’est dire combien nul ne peut prétendre établir et détenir explicitement le vrai texte qui courrait sous le texte et qui n’aurait pas été produit seulement pour des motifs de dissimulation face à la persécution. Il y va de la vérité que le vrai texte n’apparaisse jamais pour la bonne raison qu’il n’existe pas non seulement en fait, pourrait-on dire, mais encore en droit. Il est improductible : le sens ne se laisse saisir que dans un vis-à-vis entre deux textes, et leur éclairage mutuel et la totalisation des sens ne peut faire système doctrinal ni même composer de cohérence congruente et consistante» (17).
On comprend ainsi la raison pour laquelle l'art d'écrire entre les lignes non seulement ne peut qu'être mais se doit d'être réservé à une élite, si cette dernière, en fin de compte, est composée par les derniers infréquentables, c'est-à-dire les derniers hommes libres.
Notes
(1) Puisque, selon une distinction établie par Merleau-Ponty, le pouvoir ne contraint pas mais circonvient, voir la Note sur Machiavel, in Signes (Gallimard, 1980, p. 269) : «Ni pur fait, ni droit absolu, le pouvoir ne contraint pas, ne persuade pas, il circonvient.»
(2) Gershom Scholem & Leo Strauss, Cabale et philosophie. Correspondance 1933-1973 (traduction et présentation d’Olivier Sedeyn, L’Éclat, 2006), p. 55.
(3) Pierre Bouretz, tentant de définir ces limites, écrit : «En parfaite similitude avec le projet de Maïmonide tel qu’il le comprend, celui de Leo Strauss consisterait donc moins à trancher le conflit des interprètes pour apporter une solution définitive aux questions controversées, qu’à sortir de l’oubli où l’ont enfermé les Modernes le problème fondamental que les Médiévaux affrontaient en toute conscience : celui de la tension entre Loi et raison, philosophie et Révélation», in Témoins du futur (Gallimard, coll. Nrf essais, 2003), p. 730.
(4) «Le retour aux Anciens n’est pas pour Strauss un retour à une figure dogmatique et rigide de la philosophie, mais bien un retour à une pratique socratique de la philosophie. Ce caractère non dogmatique de la philosophie de Strauss se perçoit dans la défense minimale de la philosophie qu’il présente, en l’absence même d’une preuve qui établisse définitivement l’existence d’un ordre éternel», Daniel Tanguay, Leo Strauss. Une biographie intellectuelle (Grasset & Fasquelle, 2003; Le Livre de poche, coll. Biblio Essais, 2005), pp. 329-30.
(5) Strauss à Scholem, 11 août 1960 : «Plus clairement, nous sommes d’accord que le rationalisme moderne, ou les Lumières modernes avec toutes leurs doctrines particulières sous toutes leurs formes [...], est au bout du rouleau», Cabale et philosophie. Correspondance 1933-1973, op. cit.., p. 97.
(6) «Nous avons perdu toutes les traditions qui faisaient tout simplement autorité auxquelles nous puissions nous fier, nous avons perdu le nomos qui nous donnait avec autorité une direction à suivre, et cela parce que nos maîtres et les maîtres de nos maîtres ont cru à la possibilité d’une société purement et simplement rationnelle», Leo Strauss, Qu’est-ce que l’éducation libérale ?, cité par Pierre Bouretz, op. cit., p. 748.
(7) «Je ne veux pas m’engager dans une recherche littéraire pour déterminer le sens que l’illustre philosophe y attachait à son expression. Je remarque seulement qu’il n’y a rien d’étrange à ce que, soit dans l’entretien familier, soit dans les écrits, on arrive, en empruntant les pensées qu’un autre exprime sur son objet, à le comprendre mieux qu’il ne s’est compris lui-même, faute d’avoir déterminé son concept et pour avoir été conduit ainsi à parler ou même à penser contre son intention», Kant, Critique de la raison pure, Dialectique transcendantale, Livre I, Première section, Des Idées en général (Gallimard, coll. Folio, 1999), p. 333.
(8) Leo Strauss, Le caractère littéraire du Guide pour les perplexes, in Maïmonide (Puf, 1988), pp. 256-7.
(9) Subtilité du penseur et de l'homme, l'un et l'autre paradoxaux, selon l'analyse que livre Tanguay dans ces lignes de conclusion à son livre : «La vie selon l’obéissance s’oppose donc à la vie autonome du philosophe qui se donne à lui-même des règles d’action en conformité avec sa fin naturelle. Arrivé à ce point, on peut reposer la question centrale de la pensée straussienne : «Quelle est la meilleure vie ?», la vie d’obéissance à la Loi ou la vie philosophique ? Une réponse philosophique, c’est-à-dire une réponse qui ne soit pas une décision morale ni existentielle, supposerait que la philosophie soit en mesure de réfuter la révélation dans sa possibilité même. Or, comme nous l’avons vu à plusieurs occasions, Strauss soutient que la philosophie zététique, parce qu’elle ne dispose pas d’une connaissance du Tout, ne peut fournir une telle réfutation. Le philosophe, qui prend au sérieux la révélation, ne peut donc jamais avoir une totale assurance en ce qui concerne le bien-fondé de sa propre vie. Il n’est pas en mesure de savoir si sa vie ne repose pas sur une illusion. Plus gravement encore, l’erreur d’appréciation au sujet de la bonne vie pourrait avoir pour lui des conséquences terribles. En effet, selon une compréhension traditionnelle de la loi divine – qui fait aujourd’hui sourire presque tout le monde, y compris les théologiens –, le refus d’obéir à la loi divine peut être synonyme de damnation éternelle. La probité intellectuelle, qui n’est pas dogmatisme, exige de nous que nous affrontions cette aporie sans chercher à la maquiller avec des paroles réconfortantes et rassurantes, mais dénuées de vérité. Nous croyons que l’œuvre de Strauss tout entière se place sous le signe de cette aporie qu’il n’a surmontée ni personnellement ni philosophiquement. Le choix farabien de la vie philosophique est peut-être une réponse pratique au conflit entre Athènes et Jérusalem, mais ce choix pratique n’élimine pas la question. Dans son expression la plus élevée, le problème théologico-politique est insoluble», Daniel Tanguay, op. cit. pp. 384-5.
(10) Strauss reconnaît l’irréversibilité des temps et pense la reprise de la tradition en des termes opposés à l’attitude réactionnaire : «Il est certain qu’une reprise pure et simple de la tradition de la philosophie politique classique – tradition qui n’a jamais été interrompue jusqu’ici – n’est pas possible», in La Cité et l’homme (Presses Pocket, coll. Agora, 1987), p. 8.
(11) Gérald Sfez, Leo Strauss, foi et raison (Beauchesne, 2007), pp. 36.
(12) Ibid., p. 55.
(13) «La persécution est ainsi le résultat conjugué du pouvoir et de la foule, elle est la jonction entre le grand nombre et les chefs, l’effet d’une tyrannie que les uns et les autres partagent, en raison de la nécessité de précipiter son propre jugement et de la facilité (la rapidité) qu’il y a à suivre le jugement des autres. L’orthodoxie persécutrice est l’effet du concours entre la foule et le pouvoir, si bien que le sage ne peut briser directement cette complicité tacite dont le ressort est l’impatience», Ibid., p. 60.
(14) Ibid., p. 63.
(15) «Le secret est jusqu’à un certain point identique à la rareté; ce que tout le monde dit tout le temps est le contraire d’un secret. Nous pouvons par conséquent établir la règle suivante : de deux propositions contradictoires du Guide ou de tout autre ouvrage de Maïmonide, la proposition qui apparaît le moins fréquemment, ou qui n’a qu’une seule occurrence, était pour lui la vraie» (Le Caractère littéraire du Guide pour les perplexes, in Maïmonide, PUF, coll. Épiméthée, 1988, p. 88). Sfez commente ces lignes en écrivant que : «Le secret vaut preuve et la preuve d’authenticité d’une proposition se mesure au fait qu’elle n’est ni augmentée ni diminuée par sa répétition. C’est bien en ce sens que Strauss lit Spinoza : «Seule une minorité de lecteurs reconnaîtra que si un auteur énonce des propos contradictoires sur un sujet, il se peut bien que son opinion s’exprime dans les propos les moins fréquents, voire une unique fois, tandis que son opinion est dissimulée par les propos les plus fréquents, voire les propos toujours affirmés sauf cette unique fois» (Comment étudier le Traité théologico-politique de Spinoza, in La Persécution et l’art d’écrire, L’Éclat, 2003, p. 232).
p. 58.
(16) Gérald Sfez, Léo Strauss, foi et raison, op. cit., p. 59.
(17) Ibid., p. 60.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, théologico-politique, leo strauss, gérald sfez, éditions beauchesne, éditions de l'éclat, éditions léo scheer, m@nuscrits, audrey baschet |  |
|  Imprimer
Imprimer