La Nuit de Walpurgis de Gustaw Meyrink (30/09/2009)

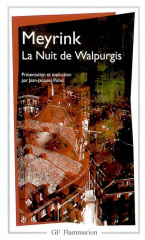 Étrange et excellent petit roman de Gustaw Meyrink, l'auteur de L'Ange à la fenêtre d'Occident qui, quelques mois après le suicide de son fils unique, Harro, âgé de vingt-quatre ans et atteint d'une paralysie à la suite d'un accident de montagne, prit sereinement congé des siens le soir du 4 décembre 1932, se retira dans sa chambre, lutta contre l'angoisse toute la nuit et, une fois le jour levé, les bras en croix et la poitrine découverte, laissa sa fenêtre grande ouverte pour laisser entrer le froid et la lumière.
Étrange et excellent petit roman de Gustaw Meyrink, l'auteur de L'Ange à la fenêtre d'Occident qui, quelques mois après le suicide de son fils unique, Harro, âgé de vingt-quatre ans et atteint d'une paralysie à la suite d'un accident de montagne, prit sereinement congé des siens le soir du 4 décembre 1932, se retira dans sa chambre, lutta contre l'angoisse toute la nuit et, une fois le jour levé, les bras en croix et la poitrine découverte, laissa sa fenêtre grande ouverte pour laisser entrer le froid et la lumière.L'astre en quelque sorte vint à sa rencontre comme, dans La Nuit de Walpurgis, la locomotive du train qui broie Flugbeil errant et délirant, le médecin de la Cour impériale, inconsolable après la mort de celle qui fut, il y a des années de cela, presque dans une vie passée, sa splendide maîtresse, Liesel, désormais réduite à n'être qu'une épouvantable sorcière sale et repoussante, dont il finira tout de même par retrouver la grâce et la beauté. Dans les deux cas, cette mort semble aussi bien acceptée qu'elle est une délivrance et peut-être le romancier a-t-il, par son geste ultime, assuré sa créature de papier qui ne désire plus qu'une seule chose, marcher droit devant lui jusqu'à l'épuisement, d'avoir fait le bon choix.
Tout autre est la mort du couple Ottokar-Polyxena qui rejoue au cours de la Première Guerre mondiale, en pleine ville de Prague la mystérieuse, la sanglante révolte des Hussites menés par Jean Zizka qui, une fois tué, demanda, comme le raconte la légende, que l'on fît de la peau de son cadavre un tambour conduisant ses troupes de taborites révoltés à l'assaut des nobles. Zizka paraît s'être réincarné dans le corps de l'acteur Zrcadlo qui, comme celui qui le possède, sera écorché par un tanneur, alors qu'Ottokar, pitoyable empereur du monde durant quelques heures de frénésie et de meurtres, chevauchera un cheval factice porté par la foule en délire et que sa maîtresse, Polyxena, elle, retrouvera le portrait maléfique d'une de ses aïeules qui semble l'avoir envoûtée (1) par l'entremise de l'aweysha, une théorie de suggestion et même de possession développée par Molla Osman (cf. p. 131).
Comme dans L'Ange à la fenêtre d'Occident, Meyrink joue finement le parallélisme des trames narratives qui ne paraissent point devoir se rejoindre à l'infini mais ici même, dans l'intrigue savante de son roman, l'un des plus aboutis sans conteste. L'infini ? Disons la puissance de l'invisible. La force de ce court roman est en effet de nous montrer que le récit de la fureur et du sang (l'une des obsessions de Polyxena et de certains des personnages du roman (2)), est par essence destinée à ne s'incarner que ponctuellement, dans tel ou tel épisode historique violent qui échappera au contrôle de ceux qui croient le mener et qui, en fait, selon le romancier, sont eux-mêmes possédés par une force qui les dépasse : «Une fois chaque année, le 30 avril, revient la nuit de Walpurgis. La nuit où, selon la croyance populaire, les fantômes se libèrent. Mais il y a également des nuits de Walpurgis d'ampleur cosmique [...]. Elles sont trop espacées dans le temps pour que les hommes s'en souviennent, de sorte qu'elles apparaissent à chaque fois comme des phénomènes inédits et inouïs» (p. 118). Point n'est besoin, comme Meyrink, de se familiariser avec les doctrines farfelues de Bô Yin Râ (nom d'auteur de l'écrivain suisse Joseph Anton Schneiderfranken) : tout romancier sait qu'il doit creuser au-delà des apparences, afin que son histoire, aussi incroyable qu'il le voudra, acquière une vérité qui n'est point celle de la plate lumière du jour.
Si Zrcadlo revêt ainsi une multitude de masques effrayants capables de faire mourir d'épouvante ceux devant lesquels il se tient, c'est qu'il n'est qu'une coquille vide, un de ces hommes creux que Conrad retrouvera, par le biais de Marlow, tapi au plus profond de la jungle ténébreuse. Le rapprochement, même à peine esquissé, entre ces deux textes est d'ailleurs troublant : dans les deux cas, seuls ceux qui sont vides vont devenir le réceptacle des forces démoniaques, Conrad puis Meyrink stigmatisant d'une certaine façon le destin d'un Occident qui a perdu ses entrailles plus qu'il n'a été la proie d'idées devenues folles, les deux romanciers se moquant des velléités révolutionnaires de conspirateurs qui ne cherchent qu'à prendre la place de ceux qu'ils veulent déchoir pour de prétendus nobles motifs.
Cette moquerie, que l'on retrouve, par petites touches discrètes et dévastatrices, dans bien des pages du roman de Meyrink (3), a pu servir de base à la thèse de Lars Gustaffson (4) selon laquelle toute écriture liée au fantastique ne peut qu'être réactionnaire puisque, dépeignant les actions de personnages qui se meuvent dans plusieurs réalités et pour lesquels le monde quotidien n'est jamais que le reflet visible d'un invisible infiniment vaste (5), elle conteste avec force toute idée d'émancipation et de progrès.
Qu'elle soit réactionnaire ou pas, les morts qui infestent les souvenirs des vivants et les légendes noires grouillant dans les venelles pragoises, paraissent, dans le roman de Meyrink, comme dans ceux de Guy Dupré ou dans Monsieur Ouine de Bernanos, avoir plus de consistance que les vivants (6) : «Pourquoi, selon toi, les morts viennent-ils s’immiscer dans le corps des vivants ?», demande ainsi Polyxena à Liesel la Bohémienne, qui lui répond : «Peut-être pour prendre du plaisir. Peut-être pour rattraper des choses qu’ils ont manquées lorsqu’ils étaient sur terre. Ou bien, si ce sont des êtres cruels, pour provoquer un gigantesque bain de sang» (p. 132).
 Il est ainsi assez dommage que ces trois romans n'apparaissent point dans le sommaire d'un collectif intitulé Les entre-mondes et sous-titré Les vivants, les morts (Klincksieck, sous la direction de Karin Ueltschi et Myriam White-Le Goff, toutes deux médiévistes) qui, il est vrai, semble davantage évoquer la littérature du Moyen Âge que des textes modernes, preuve supplémentaire que la littérature fantastique (et certains romans comme Monsieur Ouine qui, sans appartenir spécifiquement à ce genre, empruntent quelques-unes de ses caractéristiques) puise à des sources très profondes et anciennes.
Il est ainsi assez dommage que ces trois romans n'apparaissent point dans le sommaire d'un collectif intitulé Les entre-mondes et sous-titré Les vivants, les morts (Klincksieck, sous la direction de Karin Ueltschi et Myriam White-Le Goff, toutes deux médiévistes) qui, il est vrai, semble davantage évoquer la littérature du Moyen Âge que des textes modernes, preuve supplémentaire que la littérature fantastique (et certains romans comme Monsieur Ouine qui, sans appartenir spécifiquement à ce genre, empruntent quelques-unes de ses caractéristiques) puise à des sources très profondes et anciennes.Ces deux ouvrages :
Notes
(1) «[…] la comtesse Lambua, l'arrière-grand-mère de la comtesse Polyxena; elle avait empoisonné son mari et, avant de mourir folle, s’était ouvert les veines en se mordant les poignets et avait peint avec son sang son portrait sur le mur», Gustaw Meyrink, La Nuit de Walpurgis [1917] (Flammarion, coll. GF, présentation et traduction par Jean-Jacques Pollet, 2004), p. 89.
(2) «Sais-tu, mon p’tit gars, sais-tu pourquoi il y a autant de sangsues dans la Moldau ? Depuis sa source jusqu’à l’Elbe, tu ne peux pas soulever une pierre sur la rive sans trouver de petites sangsues collées en dessous. Cela vient de ce que le fleuve, autrefois, ne charriait que du sang, alors elles attendent, parce qu’elles savent qu’elles recevront un jour, à nouveau, leur pitance…», pp. 70-1.
(3) Le médecin de la Cour impériale pense ainsi être affecté de troubles oculaires lorsqu'il découvre des blancs dans les colonnes de son journal, avant d'y voir l'intervention de la censure.
(4) Lars Gustaffson, Über das Phantastiche in der Literatur, in Utopien. Essays (5) «Quel miroir cruel que ce monde qui laisse lentement se faner, se dégrader épouvantablement toutes les images qu’il nous offre, avant qu’elles ne s’effacent…», p. 103. L'une des scènes les plus extraordinaires de notre roman est celle où le médecin de la Cour impériale observe, dans un miroir ornant le mur d'une taverne, toute une scène dans laquelle finira par apparaître Zrcadlo (cf. pp. 97-119), un nom pour le moins transparent.
(6) Voir encore ces lignes superbes : «Il n’y a pas de hasard ou d’arbitraire aveugle dans le fait que l’homme a choisi le terme d’«arbre généalogique» pour désigner la succession des générations; car il s’agit bien, en vérité, d’un «arbre» qui, après avoir connu une longue période d’hibernation et si souvent changé de couleur de feuillage, donne toujours invariablement naissance aux mêmes pousses», p. 126.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, gustaw meyrink, la nuit de walpurgis |  |
|  Imprimer
Imprimer