La carte et le territoire de Michel Houellebecq ou la tentation de l'humain (08/11/2010)

Crédits photographiques : Alberto Pellaschiar (AP Photo).
L'anomalie, monstrueuse selon les journalistes, a donc été réparée : Michel Houellebecq a obtenu le Prix Goncourt pour La carte et le territoire.
L'auteur, son éditeur seront ravis : ils vont gagner beaucoup d'argent.
Ils en ont déjà gagné beaucoup, du reste, grâce aux excellentes ventes de ce roman.
Les lecteurs de l'écrivain, du moins les plus fatalistes ou les plus lucides, auront raison de penser qu'une œuvre littéraire digne de ce nom se construit toujours dans le silence et n'a que faire d'une publicité si excessive qu'elle en devient parfaitement ridicule, qui de la littérature oublie l'essentiel : elle n'a pas de prix et lui en décerner mille ou un seul, c'est déjà, peu ou prou, la brader et la réduire à un objet de consommation parfaitement indifférenciable des centaines de milliers d'artefacts qui nous envahissent, objet de consommation qu'à dire vrai elle est depuis bien des années à présent.
Houellebecq n'en finit pas de jouer avec la modernité nihiliste : ce jeu, sincère ou parodique, ne plaît pas aux belles âmes.
Les voici vengées puisque c'est ce même ventre mou si justement disséqué par le romancier qui a avalé un titre (et peut-être son auteur ?) pour l'agglutiner à sa molle matière.
Rappelons enfin ces mots très drôles et justes de Baudrillard, l'un de ceux, innombrables, qui moquèrent la comédie des prix littéraires et des distinctions à la mode française : «Leur régularité, absurde en d'autres temps, redevient compatible avec le recyclage conjoncturel, avec l'actualité de la mode culturelle. Jadis, ils signalaient un livre à la postérité, et c'était cocasse. Aujourd'hui, ils signalent un livre à l'actualité, et c'est efficace» (in La Société de consommation, Denoël, 1970, repris par Gallimard, coll. Folio Essais, 1986, p. 153).
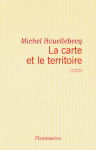 À propos de Michel Houellebecq, La carte et le territoire (Flammarion, 2010).
À propos de Michel Houellebecq, La carte et le territoire (Flammarion, 2010).LRSP (livre reçu en service de presse).
Sur La Possibilité d'une île.
Pierre Assouline ne sait pas lire, mais nous le savions (depuis quelques années déjà)
Finalement, le dernier roman de Michel Houellebecq, La carte et le territoire est un livre de facture classique (même si ces dernières pages évoquent une France des années 2040) qui a beaucoup de défauts. Un élève de seconde, pas spécialement brillant ni attiré par la littérature, pourrait faire de ces défauts un relevé quasiment exhaustif. Quelques-uns d'ailleurs ont été énumérés par l'un des plus mauvais critiques littéraires de France dans sa note du 30 août 2010, Pierre Assouline.
Faire l'inventaire des défauts de La carte et le territoire (abondance des clichés, comme la description d'une existence humaine typique, p. 105, usage répétitif des italiques, situations et personnages souvent grotesques, saluts plus ou moins discrets aux amis, ennemis et vedettes, surtout du petit écran, citations de grandes marques, phrases creuses, etc.) prouve moins la médiocrité du livre que l'on se propose de critiquer que l'incapacité profonde voire totale, pour le prétendu critique, de mener à bien sa lecture.
Pierre Assouline : si piètre lecteur qu'une future compilation des plus médiocres seconds couteaux de la critique n'osera pas le mentionner à moins de le ranger dans la catégorie purement informative des aberrations. Parcourant les commentaires de la note d'Assouline, je suis même tombé sur le blog d'un obscur cacographe déclarant, du haut de sa montagne de pénétration littéraire de la taille d'un pot de chambre, que Michel Houellebecq produisait «une littérature rassurante, une littérature pour grand enfant». Bizarre tout de même, j'aurais juré que les livres de Houellebecq, que l'on pouvait certes qualifier de bien des façons ou bien renoncer à le faire, étaient tout ce que l'on voudra sauf rassurants, comme s'il s'y distillait quelque sourde inquiétude, apprise peut-être à l'école de Lovecraft, que l'apparente banalité des textes du romancier serait chargée de conjurer.
Apprenons à Pierre Assouline et à ses fort nombreux collègues analphabètes et illettrés à lire, en affirmant que La carte et le territoire est un roman qui tente de définir ce que l'humain est par l'évocation bifide du capitalisme et de la figuration. À leur tour, capitalisme et figuration, l'un et l'autre d'ailleurs étant peut-être les deux faces d'une unique réalité si l'on considère que l'argent n'est que la figuration spectrale d'une entité toute-puissante que Bloy (1) ne craint pas de nommer Dieu, tentent d'appréhender l'humain, en le transformant.
Affirmer cela c'est encore rester dans la généralité. Soyons plus précis, donc : le dernier roman de Michel Houellebecq n'est, ni plus ni moins, qu'une tentative de retrouver la réelle présence évoquée par George Steiner, sans la poursuite de laquelle l'art n'est ou ne serait qu'un jeu de dupes. En fait, La carte et le territoire est un roman sur la chair, et sur l'incapacité du romancier à donner vie à ses personnages, sauf peut-être à l'un d'entre eux, Michel Houellebecq lui-même, mais en le tuant, ou plutôt : en l'assassinant de la plus horrible des façons, alors que survivra, comme un double maudit, son portrait à l'intensité du regard troublante (cf. pp. 185-6).
Poursuivons notre leçon de lecture, que les cancres et les mauvais lecteurs feront bien d'écouter, image claudélienne que l'on me pardonnera, les yeux grands ouverts, en écrivant que La carte et le territoire est le roman par lequel Michel Houellebecq tente de s'échapper d'un monde devenu fou, ayant oublié le sens de l'incarnation et de la joie (que ce monde confond avec le plaisir, moins que cela : la satisfaction creuse, commerciale, perpétuellement renouvelable, des sens), et n'y parvient pas.
Cet échec, que Houellebecq inscrit, involontairement ou pas peu nous importe en fin de compte puisqu'un livre s'impose à son auteur comme un «bloc de béton» (p. 254), dans la trame même de son texte, est tout simplement fascinant. Assouline n'a point vu cet échec, en fait il n'a rien vu du tout, puisqu'il se contente de stigmatiser un livre (lorsqu'il ne s'agit pas, plutôt, de son auteur) dont il se moque de constater l'imparable vérité lui qui, comme Lamartine selon Tocqueville et, bien sûr, comme il se doit, toutes proportions gardées, «n'honor[e] point assez [la vérité] pour s'occuper d'elle d'aucune manière» (p. 261).
Pierre Assouline n'a même pas vu ce que tout lecteur à peu près débutant, à l'instar d'Arnaud Viviant pour Bibliobs, a vu dans le roman de Michel Houellebecq, une série d'emprunts (calques, références, pastiches) à l'œuvre de Georges Perec. Ce sera de toute façon le but de prochaines études que de relever les influences de cet auteur, de Jean-Louis Curtis, d'Emmanuel Bove, Karl Popper ou même du père de la sémantique générale, Alfred Korzybski qui avait pour volonté de dépasser les systèmes de pensée aristotélicien et cartésien, sur La carte et le territoire. N'oublions toutefois pas que, quelles que soient les influences, réelles ou supposées que nous pourrions trouver dans ce dernier roman, Michel Houellebecq est, justement, un romancier, pas un penseur.
De la figuration ou nombreuses hésitations devant l'humain
Évoquant l'humain, Houellebecq ne pouvait qu'être confronté à la redoutable question de la figuration, qu'illustre la trajectoire artistique de son personnage principal, Jed Martin : notons que celui-ci tient en piètre estime la photographie lorsqu'il s'agit de tenter de saisir la vérité d'un être, fût-il simple «paysan dans le lointain qui répare ses clôtures» (p. 144), prêtre (cf. p. 173) ou même morceau de saucisson à la matière complexe comme il l'explique à Houellebecq, lui préférant alors la peinture. Supérieure à la photographie selon l'auteur, la peinture, pourtant, échoue, dès les toutes premières lignes du roman, à s'enfoncer dans la vérité. Jed Martin déchire une de ses toiles, sans doute parce qu'elle est mauvaise, plus sérieusement parce qu'elle s'enfonce dans une impasse, Koons et Hirst représentant deux pôles de la modernité picturale qu'une seule toile qui prétendrait les réunir ne saurait représenter sans risquer de se déchirer.
La vérité d'un être, vérité, ce grand mot qui fait peur, est lâché : il n'en finira pas de rôder dans le roman de Houellebecq, comme un lion cherchant qui dévorer, à moins qu'il ne s'agisse d'un singe farceur s'amusant avec les portraits de John Fitzerald Kennedy (cf. p. 136) et, au travers de la bouffissure, lui prêtant quelque singulière valeur symbolique. La vérité, Jasselin, le commissaire chargé de résoudre l'enquête sur l'assassinat de Houellebecq, veut aussi, coûte que coûte, la découvrir (cf. p. 292). Il finira d'ailleurs par réaliser son souhait, moins grâce à son travail acharné de policier méticuleux que par un heureux concours de circonstances. Entendons-nous sur le terme, car la vérité de Houellebecq est moins la certitude, par le génie de la peinture, d'accéder à quelque véracité aussi hyper-réaliste que troublante d'un visage qu'en celui-ci, le fait de dégager une vérité symbolique qui pourra être lue comme celle de tous les hommes (cf. p. 177). Au fond, tout grand tableau est une narration, quoi qu'en pense Jed Martin.
Beauté est un autre de ces mots. Certes, l'écrivain nous déclare qu'elle est secondaire en peinture, les grands peintres du passé étant considérés comme tels lorsqu'ils «avaient développé du monde une vision à la fois cohérente et innovante» (p. 38). Pourtant, c'est une jeune femme, très belle, qui deviendra la maîtresse de l'artiste, qui se contentera de déclarer, devant l'un de ses tirages de carte Michelin, que c'est très beau (cf. p. 65). Pourtant encore, il est «impossible de nier une certaine beauté au monde» (p. 344).
Le mal est encore un de ces très gros mots. C'est dans son dernier roman que Houellebecq s'en approche le plus visiblement, la sortie de Jed Martin, qui pourtant s'est plusieurs fois déclaré peu préoccupé par les individus de sa propre espèce, nous laissant presque aussi abasourdis que l'a été le commissaire Jasselin lorsqu'il l'a entendue : «Je crois au mal [...]. Je crois à la culpabilité, et au châtiment» (p. 358), le mal contribuant en fin de compte à augmenter de façon sensible la médiocrité de notre monde (cf. p. 359) même si, comme semble le regretter Jasselin, bien rares sont les cas de meurtres pouvant être rangés dans la catégorie du mal absolu, l'essentiel des affaires trouvant son origine dans l'appât du gain (cf. p. 366). Adolphe Petissaud, le pervers ayant assassiné d'atroce façon Michel Houellebecq, est peut-être bien l'un de ces rares exemples de meurtrier hors-normes; notons, en plus, le goût sadique pour la création de chimères, elles-mêmes affreusement mutilées, de ce Docteur Moreau moderne.
Le silence, enfin, est le dernier de ces mots, qui clôt chaque livre écrit depuis des siècles, navrante bluette ou chef-d'œuvre incontestable, mais de ce silence, nous ne pouvons pas dire grand-chose, comme le savait bien Wittgenstein cité par Houellebecq (cf. p. 395).
Houellebecq paraît nous mettre devant ce triste (et réjouissant) constat : les vieilles valeurs platoniciennes puis humanistes ont beau avoir été déchirées en mille morceaux, nous ne parvenons pas à les remplacer par de nouvelles, surtout si nous nous avisons de penser que la modernité est peut-être une erreur (cf. p. 348). La haine, il n'y a pas d'autres mots, que les imbéciles vouent à Michel Houellebecq s'explique assurément parce qu'il place, sous leur nez, l'antique nostalgie d'un ordre proportionné à l'humain, non point tentant de démembrer celui-ci comme le fait l'architecture, selon le romancier, du Corbusier (cf. p. 223), qui a visiblement inspiré les lignes inhumaines du bâtiment où le père de Jed s'est fait euthanasier (cf. p. 370). C'est bien le sens de la mention de l'école préraphaélite qui, selon l'écrivain, a tenté de lutter contre la dégénérescence de l'art après le Moyen Âge et surtout à partir de la Renaissance; le mouvement de réaction (autre vilain mot, ayant plongé dans l'oubli les textes de Jean-Louis Curtis, cf. pp. 168-9) entrepris sera de retrouver la spiritualité, l'authenticité, afin que les artistes ne se contentent point d'une «activité purement industrielle et commerciale» (p. 226).
Notons que dans les deux cas, photographie puis peinture, l'humain est évoqué, qu'il s'agisse des «objets manufacturés du monde» (p. 40), ou plutôt des clichés qu'en fera Jed Martin, ou des fleurs, qu'il a aimé peindre et qui sont, nous dit Houellebecq, comme autant de sexes féminins.
Notons encore que c'est au travers de la photographie que Jed se propose de fournir des clichés «techniquement parfaits, mais neutres» (p. 45), que son ambition est d'être «encyclopédique» (p. 41). «Hommage au travail humain» (p. 51, l'auteur souligne) qui paradoxalement se donne par la recherche du «factuel pur» (p. 50), une «description objective du monde» (p. 51). Cette neutralité à prétentions encyclopédiques n'est point sans évident rapport avec la médiocrité de Jed, un «être humain relativement inexpérimenté» nous dit Houellebecq (p. 105), qui se définit par un «détachement presque ostensible» (p. 63) et, «avant tout, comme téléspectateur !» (p. 87), peut-être parce que sa nature est incapable d'éprouver quelque étonnement que ce soit (cf. p. 73).
Ainsi comprenons-nous pour quelle raison certaines cartes Michelin ont durablement frappé l'esprit de Jed Martin : elles incarnent à ses yeux «l'essence de la modernité [qui est] l'appréhension scientifique et technique du monde» mais, détail frappant, mêlée avec «l'essence de la vie animale» (p. 54), à moins que ces mêmes cartes n'illustrent une juxtaposition plutôt qu'une narration (cf. pp. 258-9), à laquelle, tout comme Houellebecq, Jed Martin semble avoir renoncé (cf. p. 268).
Complémentarité des objets et des êtres vivants ? Leur incroyable imbrication plutôt, comme nous le voyons dans tous les romans de Maurice G. Dantec. Houellebecq s'amuse bien évidemment : son chauffe-eau, «bête vicieuse» (p. 367) semble être aussi caractériel que sensible et paraît presque sur le point de parler (cf. p. 398), la Mercedes classe S de son père ronronne comme un chat (p. 61), Houellebecq personnage clame haut et fort son amour du cochon (pp. 139-140) alors que les criminels les plus endurcis sont, aux yeux du commissaire Jasselin, des «animaux dégénérés» (p. 356).
Complémentarité encore entre les hommes, sortis de l'état de nature, et les objets qu'ils ont fabriqués (cf. p. 425) : dans d'étranges vidéogrammes dont la réalisation occupe les trente dernières années de sa vie, Jed Martin met en scène des objets lentement engloutis par une végétation triomphante, celle-là même dont quelque intelligence extraterrestre devra endiguer la progression, la «voracité destructrice des plantes» (p. 360) étant sans limites puisqu'elle parvient à ne plus laisser de traces des anciennes immenses usines «où se concentrait jadis l'essentiel de la capacité de production» (p. 427).
L'économie comme distorsion de la réalité
Déformation de la réalité, des us et des coutumes, des traditions et des gestes les plus anciens. Faire de l'économie une puissance phénoménale de changements et de révolution n'est pas, à proprement parler, une idée bien nouvelle, même si cette force mystérieuse, y compris lorsqu'elle se cache derrière le paravent de l'information, est capable de déformer non seulement le territoire mais aussi la carte (cf. pp. 147 et 152). Plus intéressant en revanche me semble le fait de remarquer que, pour Michel Houellebecq, la modernité et ses ravages évidents (de ses conquêtes, nous ne savons pas grand-chose) sont à très brève échéance condamnés au reflux : l'avenir, annoncé dans les dernières pages de La carte et le territoire, comme l'auteur l'a fait dans certains de ses derniers romans, sera bucolique. Non point quelque formidable jihad butlérien contre les machines omniprésentes mais bien plutôt une apologie du progrès lent (cf. p. 235, l'auteur souligne) qui tenterait moins de «mettre fin au système de production industrielle» qu'il n'essaierait de faire de chacun d'entre nous un «producteur de beauté» (p. 227).
L'avenir, d'ailleurs, est dans ce roman évoqué dès la page 59 (en fait, avant, par l'inclusion de jugements sur les œuvres de Jed Martin dus à des historiens d'art futurs), où Jed Martin éprouve un plaisir évident lorsqu'il habite une maison dont la partie ancienne a été intelligemment mise en valeur par une partie rénovée (cf. p. 59). Tout, dans le roman de Houellebecq, est économique, de l'homme, défini par sa place «dans le processus de production» (p. 158) et dont l'existence n'est qu'une «fiction brève au sein d'une espèce sociale» (cf. p. 127), à l'amour (comme toujours pour l'auteur de Plateforme), en passant par l'art bien sûr, les toiles de Jed Martin valant, au bout de quelques années, plusieurs millions d'euros.
L'économie n'est pas une science et, pour l'épouse du commissaire Jasselin, elle n'est «en définitive à peu près rien du tout» (p. 331), à la différence de l'art ou même du crime, qui touchent tous deux aux zones les plus secrètes de l'homme.
Il se pourrait aussi que l'économie devenue mondiale, blocs d'informations «ramifiés, reliés, s'engendrant les uns les autres comme un gigantesque polype» (p. 185), blocs qui seront décrits de la même façon que les photographies de la scène du crime (cf. p. 337), les entrelacs de trajectoires stochastiques des individus au sein d'une même société (cf. p. 353) ou même les dessins du père de Jed Martin (cf. p. 404), il se pourrait donc que l'économie que Jed Martin s'est proposé d'illustrer et d'analyser comme s'il était, selon Houellebecq, un «ethnologue» (p. 189) bien plus qu'un artiste, remplace peu à peu le Dieu mort selon Nietzsche ou éclipsé selon Martin Buber, en contrefaisant ses attributs comme la toute-puissance ou l'omniscience, comme nous le montre le tableau de Jed Martin représentant Steve Jobs et Bill Gates (cf. pp. 191-2), respectivement décrits comme «évangéliste itinérant» et «être de foi», annonciateurs d'une époque où le capitalisme lui-même se serait réconcilié avec le monde et celles et ceux qui l'habitent dans une sorte d'apocalypse molle, bucolique, de millénarisme (2) bon teint redonnant grâce à l'artisanat (3) incarné par le présentateur Jean-Pierre Pernaut (cf. p. 234), ironique parousie qui verrait, chose absolument inimaginable, un Michel Houellebecq ayant l'air heureux (cf. p. 237).
L'économie transforme l'humain : n'est-ce pas celle de la mort, une mort rapide, sans souffrance, industrialisée, après tout, qui semble avoir supplanté l'économie du sexe (cf. p. 371) ? Le capitalisme lui-même semble condamné (cf. p. 397), tout comme l'ensemble de l'humanité selon les dernières œuvres de Jed Martin, symboles de «l'anéantissement généralisé de l'espèce humaine» (p. 428 et dernière).
À moins que la solution la moins désastreuse ne soit, comme le constate Jed Martin, la naissance d'une France capable de résister aux crises financières les plus dures, du fait même qu'elle est et sera de plus en plus, si nous en croyons le romancier, un «pays surtout agricole et touristique» (p. 415).
Fascination trouble pour l'incarnation : du corps à la chair ?
Le dernier roman de Michel Houellebecq, sans doute l'ensemble de ses œuvres pourrait se lire comme l'un des plus beaux poèmes de Blaise Cendrars, Les Pâques à New York, qui se conclue par ces trois vers : «Je pense, Seigneur, à mes heures malheureuses... / Je pense, Seigneur, à mes heures en allées... / Je ne pense plus à Vous. Je ne pense plus à Vous.»
C'est peu dire toutefois que de prétendre que La carte et le territoire est un roman inscrivant dans son corps même la haine et (bien évidemment) l'amour de l'incarnation. Le corps d'abord, plutôt que la chair : le corps décomposé et affreusement supplicié de Michel Houellebecq, objet d'étude pour les enquêteurs (cf. p. 287), le corps magnifique d'Olga, qui finira bien par se gâter, le corps mystique de la loi, incarné par Jasselin. Le corps, objet de toutes les attentions romanesque de Houellebecq, dans ce roman comme dans tous ceux qui l'ont précédé, allons-nous pouvoir l'auréoler d'un peu de respect et le faire ainsi accéder au statut de chair ? C'est peu dire pourtant que Michel Houellebecq semble détester son propre corps, lui qui se voit comme une tortue malade ou un «débris torturé» (p. 175), qui aspire à ce que son corps, enterré, parvienne enfin à se libérer de sa chair, de son «carcan de chair» plus précisément (p. 317). Dégoût de la chair, dégoût encore plus évident de la génération, de la perpétuation de l'espèce, la littérature n'étant finalement réservée qu'aux célibataires qui refuseraient toute idée de paternité et pourtant, tentatives nombreuses pour incarner des personnages : ainsi Houellebecq, revenu dans la maison de son enfance, semble-t-il heureux aux yeux de Jed Martin, ainsi encore refuse-t-il que son père se fasse euthanasier par une organisation suisse. Il faut se débarrasser du corps au lieu d'en faire sa matière artistique de prédilection, comme les artistes du body art, von Hagens (p. 390) ou les actionnistes viennois l'ont fait (cf. p. 351). Il faut pourtant, dans le même mouvement contradictoire, l'honorer puisque détruire «en sa propre personne le sujet de la moralité, c'est chasser du monde, autant qu'il dépend de soi, la moralité» (p. 344, l'auteur souligne), phrase dont l'auteur est Kant, que se répète Jed lorsqu'il discute avec son père de sa décision de se faire euthanasier.
Mais la leçon que nous livre Houellebecq est ambiguë car, durant les dernières années de sa vie, à mesure que son corps est rongé, comme le fut celui de son père, par un cancer des voies digestives, Jed Martin tente sans relâche de créer des œuvres d'art où il met en scène la décomposition d'objets puis de photographies de celles et ceux qu'il a connus et même de figurines humaines (cf. p. 426).
Le jeu de Michel Houellebecq avec Dieu : cuculterie bondieusarde et véritable piété
Notons, en guise de préambule, que ce dernier roman comporte une série de motifs pour le moins discrets qui évoquent une ambiance religieuse, spécifiquement chrétienne. En voici quelques exemples : un être humain, qui s'est élevé au-dessus de la condition animale, doit reposer sous terre lorsqu'il meurt, plutôt que d'être réduit en un petit tas de cendres dispersées aux quatre vents (cf. p. 320), Jed Martin est lui-même «familier des principaux dogmes de la foi catholique dont l'empreinte sur la culture occidentale [a] été si profonde» (p. 50), beauté des tableaux de Fra Angelico, «si proche du paradis» (p. 58), nostalgie pour l'amour, «l'amour réciproque du couple qui irradie les murs d'une certaine chaleur» (p. 59), pastiche du style du divin Patrick Kéchichian (p. 83), belle description de la situation des prêtres à notre époque (p. 99), rapprochement surprenant entre la situation d'un cadre vis-à-vis de sa hiérarchie et celle du Christ pour l'Église (p. 103), jusqu'au discret baptême de Houellebecq lui-même ! (p. 318).
Plus largement, et bien que les goûts de Jed Martin en matière artistique ne semblent point faire grand cas des exemples d'illustres peintres comme Rembrandt, notre personnage éprouve une nostalgie, curieuse (sauf si l'on considère, avec l'auteur, que nous nous trouvons déjà à l'époque de la fin du capitalisme sauvage), du «monde moderne, de l'époque où la France était un pays industriel» (p. 169), nostalgie encore pour la tradition (une nouvelle fois démentie par l'auteur, p. 120), l'artisanat (cf. p. 60), y compris décliné sous forme de sommations mercantiles à l'endroit des touristes russes et chinois, mais surtout pour une forme de pérennité, de chaîne d'or, de transmission, qu'il s'agisse d'art de vivre ou de sensibilité à l'invisible, condition essentielle de l'artiste (cf. p. 106). Nous pouvons ainsi interpréter la sortie du grand-père paternel de Jed Martin, hors de la pure et simple reproduction sociale du même (p. 40) comme une forme de faute première ayant conduit son fils, architecte qui aura jusqu'à son dernier souffle rêvé de construire des maisons réellement habitables, puis son petit-fils, artiste, au désespoir de devoir gagner sa vie, prouver quelque chose, la réussite d'une ascension sociale par exemple.
Un chapitre est marquant, à cet égard, le dixième de la deuxième partie (cf. pp. 211-230), où le père de Jed se confie à son fils et semble retrouver, durant quelques minutes, la pureté d'un recommencement : «il venait de revivre, écrit Houellebecq, pour la dernière fois, l'espérance et l'échec qui formaient l'histoire de sa vie» (p. 229). Nous sommes la veille de Noël et ce n'est sans doute pas un hasard si c'est durant ce même émouvant chapitre nous décrivant les vieux rêves brisés de son père que Jed Martin a la vision de «prairies immenses, dont l'herbe [est] agitée par un vent léger, [où] la lumière [est] celle d'un éternel printemps» (pp. 215-6). Sans doute n'est-ce pas un hasard non plus si les restes de Michel Houellebecq, revenu vivre dans la demeure de son enfance, ont été mis dans un cercueil destiné à un enfant, bien que cet épisode (cf. p. 322) puisse être parfaitement lu comme la preuve de l'humour particulièrement noir du romancier.
Je crois que ces quelques éléments suffisent à nous indiquer que l'horizon d'attente de ce roman est religieux, chrétien même, quelles que soient les moqueries (bien évidemment très drôles) adressées à Patrick Kéchichian le Vénérable, auteur d'une «cuculterie bondieusarde» justement refusée par Pépita Bourguignon, chef de rubrique au Monde, quelles que soient encore les déclarations d'amour de Houellebecq adressées à un hypothétique et cauchemardesque «hypermarché total, qui recouvrirait (sic) l'ensemble des besoins humains» (p. 196). Demeure encore la certitude d'avoir, par paresse ou indifférence, raté le moment, infinitésimal, pendant lequel le destin nous sourit, condamnés alors que nous sommes, malgré nos prières (et Jed Martin, dans ce roman, prie ou essaie de prier plusieurs fois), à une fin de vie remplie d'une «résignation douce», «la sensation inutile et juste que quelque chose aurait pu avoir lieu» (p. 251).
Mais éprouver ce trouble, n'est-ce pas déjà, quelque peu, prier ? Faire de Jed le double romanesque qui survivra à votre propre mort mise en scène avec une délectation visible, n'est-ce pas conjurer les puissances de l'écriture pour tenter d'accéder à une forme d'immortalité qui ne soit point trop barbare, comme celle consistant à se survivre dans un tableau inquiétant mêlé à deux meurtres ?
Notes
(1) Et Houellebecq lui-même : «Ces crises avaient été d'une violence croissante, d'une imprévisibilité burlesque – burlesque tout du moins du point de vue d'un Dieu moqueur, qui se serait amusé sans retenue de convulsions financières plongeant subitement dans l'opulence, puis dans la famine, des entités de la taille de l'Indonésie, de la Russie ou du Brésil : des populations de centaines de millions d'hommes» (p. 415).
(2) Millénarisme que l'on retrouve d'ailleurs, selon différentes formules bien évidemment, dans les œuvres de ces «réformateurs sociaux» que sont Marx, Proudhon, Fourier ou Saint-Simon, volumes que Jed Martin découvre dans la bibliothèque de Houellebecq (cf. p. 259) et encore dans le texte le plus connu de William Morris, intitulé Nouvelles de nulle part, auteur plusieurs fois cité dans le roman de Houellebecq. Enfin, remarquons que le père de Jed lui-même a semble-t-il longtemps nourri le projet de bâtir des cités idéales (cf. pp. 404-6).
(3) Notons que Houellebecq évoque le curieux roman de Chesterton intitulé Le Retour de Don Quichotte où l'auteur du Nommé Jeudi dépeint «une révolution basée sur le retour à l'artisanat et au christianisme médiéval se répandant peu à peu dans les îles britanniques» (p. 263).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, michel houellebecq, la carte et le territoire, éditions flammarion, pierre assouline |  |
|  Imprimer
Imprimer