Le Cavalier de la nuit de Robert Penn Warren (09/06/2011)

Crédits photographiques : Shah Marai (AFP/Getty Images).
 Robert Penn Warren dans la Zone.
Robert Penn Warren dans la Zone.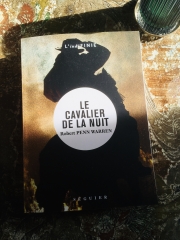 Le Cavalier de la nuit sur Amazon.
Le Cavalier de la nuit sur Amazon.Il faut bien sûr garder à l'esprit ce que l'auteur lui-même, en préambule de son magnifique premier roman, prend le soin de nous dire, lorsqu'il évoque, pour les lecteurs français peu au fait des Black Patch Tobacco Wars qui eurent lieu, au début du siècle passé, dans les États du Tennessee et du Kentucky, l'histoire des cavaliers de la nuit : «j'ai voulu démontrer un aspect de notre histoire humaine en général. C'est-à-dire que ce roman aspire à être poésie, et non pas histoire» (Avant-propos, p. 1). Nous verrons que Penn Warren est en fait parvenu à nous livrer une méditation poétique sur l'histoire, qu'il a donc fait œuvre double, lançant, comme il le fera dans chacun de ses romans, une sonde dans les profondeurs d'une Histoire saisie par le grappin de l'écriture.
Magnifiquement traduit par Michel Mohrt qui donna, des Fous du roi, une belle préface, Les Cavaliers de la nuit a paru aux États-Unis en 1939 et publié en France en 1951 par la Librairie Stock. Comme la presque totalité des autres romans de Robert Penn Warren, ce livre ne se déniche plus ailleurs que chez les bouquinistes alors que ce roman, comme tous ceux de leur auteur, aurait au moins une bonne raison de passionner les foules par le souffle prodigieux qui l'anime.
Ce souffle est celui d'une histoire qui tente de nous donner, de l'Histoire et des démons qui semblent la gouverner, une vision essentielle, que le romancier appelle poétique, et que je ne crains pas d'affirmer métaphysique.
Ce souffle est celui de toutes les foules humaines, ici, des foules amassées pour écouter les discours des meneurs comme nous le voyons également dans Les Fous du roi, chefs plus ou moins inspirés qui tentent de regrouper la population des cultivateurs de plants de tabac contre les intérêts des grandes compagnies qui cassent les prix de leur précieuse récole. Notre roman s'ouvre d'ailleurs par un discours sur une place de village, où nous retrouvons quelques-uns des personnages principaux, dont Mr. Perse Munn qui, au moins une fois dans sa vie, aura connu l'exaltation d'une prise de parole véhiculant une idée s'emparant des individus pour «les rassembler, pour les fondre tous ensemble» (p. 20. Voir encore p. 171).
Munn, comme le lui affirmera sa maîtresse, est un homme qui n'est jamais exalté, un être froid : «Quoi que tu aies fait, tu l'as fait parce que tu étais glacé, parce que tu avais besoin de chaleur» (p. 433).
Le drame de Mr. Munn : la personne moderne, une épave selon Julien Green qui, dans notre roman, ne semble à peu près heureuse qu'au moment de se fondre dans la foule, puis de prêter serment pour faire partie d'un des exécutants d'une société secrète. Et encore, ce bonheur ne peut être saisi qu'après-coup, dans ces trouées par lesquelles, comme des nappes de résurgence, le passé, dans les romans de Penn Warren, infuse le présent de la narration. Innombrables sont les images qui, dans notre roman, dressent le pauvre Munn face à ce gouffre : perdu lorsqu'il est seul, commençant à éprouver du dégoût et de la méchanceté pour sa propre femme à laquelle il ne peut rien dire et qui le quittera définitivement, éprouvant en revanche un sentiment de réconfort et de bien-être (cf. p. 41) lorsqu'il se fond dans une foule d'hommes et bien plus même qu'un sentiment de réconfort, «l'imminence d'une révélation» (p. 51). Si le démon est inconstance selon le juge De Lancre, nous tenons notre pauvre hère !
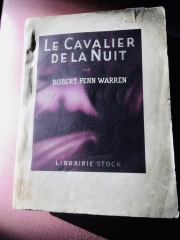 En effet, «À quel point fixer le centre immobile et véritable de son être, le foyer de ses devoirs ?» (p. 43). C'est bien la question lancinante (lancée encore p. 151) que pose l'écrivain tout au long de son roman et il semble bien que l'action collective, puis de nouveau solitaire une fois que les représentants de la loi seront parvenus à porter des coups décisifs aux cavaliers de la nuit, constitue l'un de ces foyers, sinon le seul pour lequel il vaille la peine de risquer une vie d'homme.
En effet, «À quel point fixer le centre immobile et véritable de son être, le foyer de ses devoirs ?» (p. 43). C'est bien la question lancinante (lancée encore p. 151) que pose l'écrivain tout au long de son roman et il semble bien que l'action collective, puis de nouveau solitaire une fois que les représentants de la loi seront parvenus à porter des coups décisifs aux cavaliers de la nuit, constitue l'un de ces foyers, sinon le seul pour lequel il vaille la peine de risquer une vie d'homme.Mais d'où nous vient, alors, cette curieuse impression que Munn ne risque rien, pas même sa vie qu'il perdra en entendant «comme des voix d'enfants qui jouent dans la nuit» (p. 453), promesse évanouie de rédemption ? D'où nous vient cette évidence qui fait de celui qui croit pouvoir délier les nœuds du destin en tuant un homme (cf. p. 449), un pauvre dupe, alors même que la justice l'accuse d'un meurtre qu'il n'a point commis ? D'où nous vient cette certitude que, même lorsqu'il a tué un paysan qu'il avait pourtant défendu, en sa qualité d'avocat, il l'a fait comme s'il avait agi sans même s'en rendre compte, à l'instar d'un somnambule ? Munn est ainsi une espèce de Macbeth moderne auquel nulle sorcière n'aurait daigné se présenter, car, à notre époque de sécheresse (ce sera le constat, sans cesse répété, d'un des personnages du roman, lequel d'ailleurs, dans ses toutes dernières pages, trahira Munn), le Mal n'existe plus, ou bien, s'il existe, il n'est qu'affaire de point de vue. Et pourtant, un peu comme Macbeth, Munn, son pitoyable héritier, semblera lui aussi éprouver un divorce entre sa conscience et son corps, qui, plus d'une fois, réagit avant même que son esprit ne parvienne à forger une représentation de l'action qu'il est sur le point de commettre (cf. pp. 155 ou 204). Dans ce décalage entre le rêve de l'action et cette dernière proprement dite se glisse la béance infernale, comme je l'avais montré dans ma note sur la pièce de Shakespeare.
Si l'Histoire a un sens (mais lequel, n'oublions pas que Penn Warren est l'héritier de Faulkner ?), l'existence individuelle n'en a plus qui est brisée entre une multitude de moments où la personne n'est plus capable de reconstituer sa propre identité chancelante (et que dire du fait de percer les motivations des autres !, cf. pp. 135, 144), une identité individuelle qui est sans cesse fluctuante (cf. p. 117), comme entourée d'un nuage d'inconnaissance (cf. p. 176), étrangère même (cf. p. 186) à moins, et c'est la leçon d'un magnifique chapitre (le quinzième et avant-dernier), qu'elle ne s'inscrive dans la recherche d'une terre de nouveau irriguée, rédimée, d'une terre promise vue en rêve (alors que Munn, lui, fait un horrible cauchemar, cf. p. 385) dont l'existence ne pourra que s'accorder, dans un rêve, par la vision du paradis reconquis tout autant que de la femme donnée. Notre vie retrouve son assiette, si je puis dire, lorsqu'une Histoire tout entière tendue vers une révélation la préserve du vertige de l'inaction et du désespoir.
Mais Munn est par excellence l'homme de peu de poids qui, grisé par l'ivresse labile des foules et d'une action qu'il estime juste, est incapable de conquérir quoi que ce soit, épave pitoyable, homme creux qui pensera clore son destin en décidant de tuer celui, Edmond Tolliver, qui lui avait prédit une grande carrière politique et qu'il tient pour responsable de tout ce qui lui est arrivé après leur rencontre (cf. p. 150). Il échouera même à abattre l'homme qui a ses yeux a pourtant trahi l'Association et précipité, dirait-on, son entrée dans l'action violente. Munn est l'homme médiocre, l'homme des foules c'est le cas de le dire avec Poe et Baudelaire, l'être insensible qui n'éprouve plus rien, pas même le transport de la violence ou la sidération de la décision engageant âme et corps (cf. p. 158), la marionnette avec laquelle les puissances infernales ou divines semblent jouer à un jeu cruel consistant à lui refuser la certitude d'une seule action légitime, d'une seule vérité, fût-elle minuscule, une seule fois révélée : «Et, tandis qu'il contemplait tout cela, il se sentit envahi par une tristesse qui était plus que de la tristesse : un désespoir qui semblait sourdre de quelque vérité profonde, jamais suspectée auparavant et qui, même maintenant, se dérobait encore» (p. 132).
Ainsi il ne sera même pas donné à Munn de vieillir, puisque vieillir, c'est «pénétrer l'enveloppe des choses» (p. 107). Il ne lui sera pas donné d'aimer, sa femme d'abord, qu'il perdra, puis une jeune femme dont il brisera le cœur en provoquant l'accident cérébral de son père puis en refusant, une fois ce dernier mort, de la suivre, puisqu'il s'agit, par-delà l'épuisement de l'être et des sentiments, de tenter un nouveau départ, dans un pays où la sécheresse, à entendre dans sa portée métaphysique, n'aura pas fait tant de ravages qu'ici, là où les femmes et les hommes meurent à petit feu de n'être plus rien, d'avoir exterminé tous les bisons et d'avoir perdu l'art de la vie simple dans laquelle, pour quelques années encore, les Indiens ont su conserver leur génie.
Ainsi même il ne sera pas donné à Munn d'être le maître de son propre destin puisque celui-ci a «presque toujours l'impression qu'il lisait une histoire à laquelle il n'avait pris aucune part, l'histoire de quelque chose qui serait arrivé depuis très longtemps» (pp. 173-4) puisque son passé lui semble «aussi instable, d'aussi peu de valeur qu'une bouffée de fumée, et son avenir dépourvu de sens» (p. 209).
Ainsi, nous pouvons aller jusqu'à affirmer que Munn n'a même pas tué un homme et tenté d'en tuer un autre, alors que, à ses yeux portant, seule «une action singulière, héroïque» aurait pu lui permettre de découvrir «la raison» de son existence et ainsi «accomplir son destin» (Ibid.). Munn est l'homme dépossédé, celui qui s'est dépouillé mais dont le dépouillement est vain (cf. p. 361) et c'est cette dépossession même, ce dépouillement délétère, qui semblent le prédisposer à toutes les aventures, alors que son être, secrètement, ne désire rien : «Un calme profond, lourd et menaçant, qui pesait sur son esprit comme une masse de rocher en équilibre si précaire qu'un souffle de vent, le grignotement inconscient d'une bestiole, suffirait pour le précipiter» (p. 212; nous retrouverons cette image dans Un Endroit où aller).
Le précipiter dans quoi ? Dans l'Histoire sans doute, confondue avec une vérité aveugle, impitoyable, détruisant les vérités fragiles des personnes (cf. p. 354). Mais, conséquence ou bien au contraire raison profonde, inavouable, de l'état dans lequel Munn vit, de ce que Munn est, l'Histoire elle-même est bouchée dans Le Cavalier de la nuit, alors même que la matière historique dont s'est intelligemment servi le romancier est indéniable et abonde dans ce roman, affleure à sa surface à tel point que l'écrivain a jugé utile d'en informer les lecteurs non Américains, pour qu'ils comprennent dans quel torrent d'événements il a plongé ses mains, son regard de poète. C'est que, homme creux, vide (1) alors qu'un docteur Mac Donald a trouvé en lui la force de résister aux épreuves (cf. p. 318), froid ou somnambule insensible (2), être sans mots (3), maigre Ouine nord-américain qui essaie, lui aussi, de reconstituer son être autour d'un acte (cf. p. 382), démon acculé qui, à la différence de celui de Selby, jamais ne rencontrera le diable, désespéré pris de vertige devant le vacillement de sa propre identité (cf. p. 292), Munn n'est coupable de rien, pas même de la haine qui l'envahit et qu'il croit être son unique planche de salut (cf. p. 291), puisque le monde dans lequel il essaie coûte que coûte d'inscrire son action, fût-elle d'un poids et d'une trace infimes, est lui-même cassé, épuisé, sec (4), envahi par la nuit dans laquelle ont lieu la majorité des scènes du roman de Penn Warren.
Ainsi pouvons-nous penser que l'avant-dernier chapitre, tout entier consacré à l'histoire de l'homme qui a accueilli, sans lui demander un seul mot d'explication, le fugitif pourchassé par les troupes qu'est devenu Munn, constitue une sorte de jour ouvert dans l'épaisse muraille qui entoure tous les personnages de notre roman, singulièrement ceux qui ont décidé de se mettre au service de l'Association. Dans ce long et magnifique chapitre, Proudfit, au nom transparent, a été je l'ai dit guidé par un rêve vers ce qu'il ne faut pas craindre de considérer, dans l'économie de notre texte, comme une véritable terre promise, le Kentucky, nouvelle réincarnation du vieux rêve millénariste particulièrement sensible dans l'esprit des premiers colons nord-américains et, bien sûr, dans les textes des plus grands écrivains de cet immense continent : «J'avais voulu venir là et maintenant j'y étais. Ça dépasse toute idée comme le bon Dieu mène quelquefois un homme et dirige ses pas. J'étais là et je savais que, pas loin de là, dans le plat pays, il y avait tout un monde de gens, à gagner de l'argent et à faire des enfants, sans s'occuper du lendemain. Je savais qu'il y avait eu la guerre et des massacres dans le pays, et que des gens s'étaient entretués, frère contre frère. Et que des gens étaient morts, qu'ils étaient maintenant sous la terre où ils avaient marché comme moi et comme leurs semblables; et personne n'aurait pur dire pourquoi. Rien que le Seigneur Dieu» (pp. 412-3).
Lorsqu'il se remettra en route, Munn entendra des voix perçantes, sans doute celles des soldats qui le pourchassent, «comme des voix d'enfants» qui le remplissent d'une «joie étrange, d'un mépris sauvage et enivrant» (p. 452) mais sa dernière course ne le mènera que dans une nuit impénétrable.
Notes
(1) «Brutalement, il connut le dégoût de lui-même, la vanité de l'acte qu'il venait de commettre, de cette honteuse et écœurante pantomime, sans lien avec toute sa vie antérieure, avec toute autre vie, coupée du temps, vide de sens, même du sens aveugle et convulsif du plaisir. Il était contaminé par le vide qu'il découvrait en [Lucille Christian]. Ou bien c'était ce vide qui lui avait fait découvrir le sien. Elle le lui avait présenté comme un miroir, et dans ce vide il avait vu le sien» (p. 311).
(2) Comme l'est ce personnage évoqué par Penn Warren : «Un matin, il était sorti pour aller chercher son lait, et il l'avait rapporté à la maison, passé et mis de côté; puis, avec un marteau à glace, il avait tué sa femme au moment où elle se penchait sur le fourneau pour préparer le petit déjeuner, puis sa fille enceinte, qui était au lit, et l'enfant à son côté. D'un coup de carabine, il avait tué son gendre, alors qu'il revenait de donner à manger aux bêtes. Il avait téléphoné au shérif. Puis il s'était couché. Quand le shérif était venu pour l'arrêter, il dormait. Maintenant il était là, dans sa cellule, allongé sur sa couchette, ne bougeant que pour répondre aux questions. Il répondait avec une patience effarée, innocente, comme un homme qui vient à peine de se réveiller» (p. 345).
(3) «Il avait perdu le sens des mots parce qu'il avait perdu le sens du futur. Quand il essayait d'y penser, il se fait l'effet d'un de ces insectes maladroits qui s'efforce sans arrêt de gravir la muraille lisse de l'assiette où il est tombé» (p. 375).
(4) Du reste, Penn Warren ne manque pas de rapprocher la sécheresse de la terre de celle de l'âme de Munn lorsqu'il écrit : «Il n'avait pas en lui le germe de l'avenir, la semence vivante. Elle était desséchée; elle était morte, comme le grain de blé germé entraîné par l'eau au pied d'une colline et qui est resté exposé aux ardeurs du soleil» (p. 379).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, le cavalier de la nuit, robert penn warren |  |
|  Imprimer
Imprimer