Max Nordau, Gustave Le Bon et Édouard Drumont ou la trinité diabolique (16/03/2006)
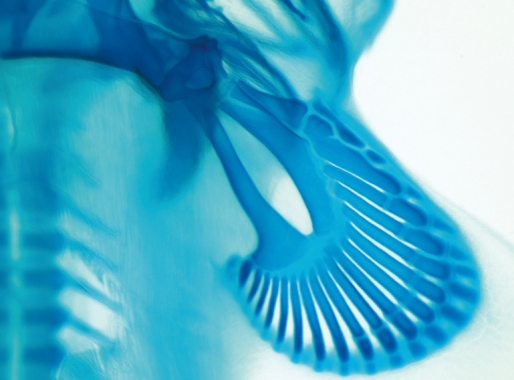
Crédits photographiques : Dr. Andrew Gillis.
J.-K. Huysmans, À Rebours.
«La forme romanesque n’est pas conçue pour peindre l’indifférence, ni le néant; il faudrait inventer une articulation plus plate, plus concise et plus morne.»
Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte.
«On peut imaginer que le poisson, sortant de temps en temps la tête de l’eau pour happer l’air, aperçoive pendant quelques secondes un monde aérien, complètement différent – paradisiaque. Bien entendu il devrait ensuite retourner dans son univers d’algues, où les poissons se dévorent. Mais pendant quelques secondes il aurait eu l’intuition d’un monde différent, un monde parfait – le nôtre.»
Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires.
Voyez-vous, commença notre étrange professeur, trois livres, trois livres seulement, pas un de plus, peuvent suffire à nous donner la clé de l'époque abjecte, inquiète et fatiguée qui est la nôtre, au bout du rouleau selon le titre d'une nouvelle de Joseph Conrad. Quels sont-ils, ces trois livres que vous irez lire, j'en suis certain, comme s'il s'agissait de grimoires magiques ? Notre professeur s'amusa, un instant, à guetter nos réactions, balayant de son regard ironique chaque élève de la classe, jouissant à l'évidence des sentiments de curiosité et d'attente qu'il venait de créer dans nos esprits. Il se rassit avant de déclarer, lentement : Notez bien ces titres, et, retrouvant tout à coup son calme un peu méprisant, lâcha sèchement, prenant soin de bien prononcer : Psychologie des foules de Gustave Le Bon, Dégénérescence de Max Nordau et La Fin d'un monde d'Édouard Drumont. Il ajouta aussi, bizarrement : vous vous amuserez, messieurs, à retrouver les dates de publication de ces livres et, une fois lus, serez... surpris par leur justesse prophétique. Je dois avouer que je ne connaissais aucun de ces livres et je ne pense pas qu'il en eût été différemment, à cette époque, pour le meilleur d'entre nous, un élève discret, renfermé, préférant passer des heures enfermé dans la bibliothèque de l'externat plutôt qu'à boire des cafés dans l'un des bars de la place Saint-Paul. Je m'appliquai donc à écrire les titres mentionnés, louchant tout de même sur les feuilles volantes de mon voisin qui, plus rapide que moi ou peut-être moins rêveur, avait eu la bonne idée de noter ce que notre professeur venait de dire. Nordau, Le Bon et Drumont donc... Jamais entendu parler. Mais qui diable pouvaient être ces trois auteurs parfaitement inconnus ?
Rassurez-vous, mesdames et messieurs les professeurs de l'Éducation nationale et vous, petits étudiants crasseux et incultes, reprenez surtout votre souffle par la même occasion car vous avez sans doute manqué de vous étouffer en lisant ce triptyque d'auteurs maudits, que je ne puis résister, parce que tel est mon humour douteux, au plaisir de nommer une fois encore : Nordau, Le Bon et Drumont. Rassurez-vous puisque cette petite mise en bouche douce amère est pure invention de mon esprit malade, pas du tout, donc, l'horrible réalité d'une salle de classe bien réelle, encore moins le discours inimaginable en France d'un professeur qui aurait exercé sa délétère influence sur de pauvres esprits sans défense, moutons obéissants qui auraient pu, certains tout du moins, se plonger dans des ouvrages réputés sulfureux. Je l'ai échappé belle pas vrai, car il ne manquait plus, pour compléter ma petite liste, qu'Adolf Hitler, voire Lucien Rebatet pour que je sois pour de bon dénoncé auprès des autorités compétentes, la Sainte Congrégation de la Bienséance Républicaine, aux motifs gravissimes de déviance idéologique évidente et d'irrécupérable dégénérescence de mon cerveau. Un réparateur enfermement m'aurait été alors promis jusqu'à la fin de mes jours, les douches froides et les électrochocs en guise de récréation, et pas de lecture bien sûr, surtout pas celle du pauvre Artaud, rien d'autre, pour le déviant, que des auteurs réputés idéologiquement corrects, pourtant les plus mauvais stylistes de langue française songez donc, peut-être même, comble de la torture carcérale, les quarante-cinq volumes écrits par Jacques Derrida. Plutôt la mort par pendaison je vous le dis sans fioritures, qui dit-on impressionna tellement Truman Capote que le trublion new-yorkais ne se remit jamais de l'exécution de ses deux bandits préférés, et ce jusqu'à sa propre mort par noyade dans l'alcool huppé.
 Laissons au préfacier de ce remarquable petit ouvrage (l'original, en deux tomes d'ailleurs disponibles chez Slatkine Reprints pour un prix exorbitant [depuis, ce texte a été publié par L'Âge d'Homme, Nda], étant beaucoup plus volumineux, l'éditeur a dû se résoudre à ne présenter que des extraits, en fait les première et dernière parties de l'ouvrage), expliquer la vogue de la dégénérescence qui présente d'ailleurs bien des similitudes avec le courant des études consacrées aux criminels-nés et à l'eugénisme plus ou moins scientifique. Ces théories prétendument sérieuses eurent en France non seulement leurs initiateurs (Pinel dès 1808, Lucas en 1847, Morel en 1857, Moreau de Tours deux années après) mais aussi ses meilleurs représentants (Lacassagne), si l'on excepte toutefois le cas de l'Italien Cesare Lombroso (auquel Dégénérescence est dédié) et celui de l'Anglais Henri Maudsley. Nordau ne se mêle pas de recommander l'élimination physique des dégénérés (d'autres s'en chargent comme... Le Bon évoquant le cas des criminels, cf. note 1) qu'il paraît avoir auscultés d'une façon plutôt désinvolte, moins dans son cabinet que dans les livres, romans, recueils poétiques et tableaux d'artistes qu'il n'estime guère, pour le moins. L'auteur se contente d'expliquer les principaux symptômes de ce mal appelé par les Français fin de siècle, d'en exposer les probables causes (la fatigue d'une société de plus en plus pressée, déshumanisée) et, dans la dernière partie de la traduction française de son ouvrage, de se livrer à un réjouissant exercice d'imagination consistant à se projeter dans le futur, disons : notre présent. Voici ce qu'écrit Nordau, à propos des étranges coutumes littéraires à venir, dans ce livre paru en France en 1894 : «Quelques poètes qui ne publient plus que des lettres isolées de l'alphabet ou dont les œuvres sont des feuilles coloriées sur lesquelles il n'y a absolument rien, provoquent la plus grande admiration. Il y a des sociétés ayant pour but de les interpréter, et leur enthousiasme est si fanatique, qu'elles se livrent les unes aux autres des combats en masse fréquemment meurtriers». Cette description plus vraie que nature d'auteurs sans œuvres, ceux que Nordau appelle «les graphomanes et leurs gardes du corps critiques» ainsi que de lecteurs sans cerveau n'est-elle pas admirablement adaptée à notre situation actuelle ?
Laissons au préfacier de ce remarquable petit ouvrage (l'original, en deux tomes d'ailleurs disponibles chez Slatkine Reprints pour un prix exorbitant [depuis, ce texte a été publié par L'Âge d'Homme, Nda], étant beaucoup plus volumineux, l'éditeur a dû se résoudre à ne présenter que des extraits, en fait les première et dernière parties de l'ouvrage), expliquer la vogue de la dégénérescence qui présente d'ailleurs bien des similitudes avec le courant des études consacrées aux criminels-nés et à l'eugénisme plus ou moins scientifique. Ces théories prétendument sérieuses eurent en France non seulement leurs initiateurs (Pinel dès 1808, Lucas en 1847, Morel en 1857, Moreau de Tours deux années après) mais aussi ses meilleurs représentants (Lacassagne), si l'on excepte toutefois le cas de l'Italien Cesare Lombroso (auquel Dégénérescence est dédié) et celui de l'Anglais Henri Maudsley. Nordau ne se mêle pas de recommander l'élimination physique des dégénérés (d'autres s'en chargent comme... Le Bon évoquant le cas des criminels, cf. note 1) qu'il paraît avoir auscultés d'une façon plutôt désinvolte, moins dans son cabinet que dans les livres, romans, recueils poétiques et tableaux d'artistes qu'il n'estime guère, pour le moins. L'auteur se contente d'expliquer les principaux symptômes de ce mal appelé par les Français fin de siècle, d'en exposer les probables causes (la fatigue d'une société de plus en plus pressée, déshumanisée) et, dans la dernière partie de la traduction française de son ouvrage, de se livrer à un réjouissant exercice d'imagination consistant à se projeter dans le futur, disons : notre présent. Voici ce qu'écrit Nordau, à propos des étranges coutumes littéraires à venir, dans ce livre paru en France en 1894 : «Quelques poètes qui ne publient plus que des lettres isolées de l'alphabet ou dont les œuvres sont des feuilles coloriées sur lesquelles il n'y a absolument rien, provoquent la plus grande admiration. Il y a des sociétés ayant pour but de les interpréter, et leur enthousiasme est si fanatique, qu'elles se livrent les unes aux autres des combats en masse fréquemment meurtriers». Cette description plus vraie que nature d'auteurs sans œuvres, ceux que Nordau appelle «les graphomanes et leurs gardes du corps critiques» ainsi que de lecteurs sans cerveau n'est-elle pas admirablement adaptée à notre situation actuelle ?Poursuivons, nous ne sommes pas au bout de nos surprises.
Nordau, Le Bon, Drumont ou la sainte trinité des honnis, le triptyque abominable des pestiférés qui ont au moins un point commun, celui d'imaginer un étiolement de la vitalité occidentale, alors même que sont constamment célébrés sa prétendue puissance, son génie souverain. Nordau affirme ainsi que les artistes portées aux nues par les journalistes et le public sont aussi les plus débiles, Drumont que la France, naguère phare de l'Europe et du monde, crève sous les richesses amassées, corruptrices du vieux sens de l'honneur, Le Bon que la société moderne est tout entière devenue foule (donc folle), comme telle infiniment malléable, proie de toutes les suggestions mauvaises. Ces trois-là partagent encore la hantise de la contagion (Nordau emploie le terme d'intoxication) sous l'influence de la crédulité de masse, de la capillarité instillant le Mal par le phénomène de l'imitation, de la transmission instantanée de la rumeur, du complot, de la bêtise : une foule sensible comme une femme sera hypnotisée par son dictateur et maître, un public avili sera incapable de constater la bizarre complexion physique des écrivains qu'elle encense, des hommes politiques n'hésiteront pas à vendre leur âme pour que leur nom apparaisse sous la plume du dernier des échotiers. Ces trois auteurs annonçaient ainsi, assurément en ayant conscience de la pertinence de leurs analyses, bien des emballements actuels dont la Presse est la victime tout autant que l'heureuse élue. Que dire de la peinture de notre monde pressé, technologiquement possédé (je veux dire, possédé par la technologie reine), irréel mais crédule, aspirant comme une lamproie les plus microscopiques miettes de paroles, frémissant comme une tige de cristal à la moindre éclosion de nouvelle tombouctienne, de fait divers anodin ensanglantant le barrio chino d'une favela lointaine.
Nordau et Drumont paraissent en outre obsédés par les comparaisons et les métaphores empruntées au vocabulaire médical (et aussi psychologique, La Fin d'un monde étant sous-titrée Étude psychologique et sociale), singulièrement celui des médecins légistes. Dans La Fin d'un monde (1889), nous pouvons lire : «Le cadavre social est naturellement plus récalcitrant et moins aisé à enterrer que le cadavre humain. Le cadavre humain va pourrir seul au ventre du cercueil, image régressive de la gestation le cadavre social continue à marcher sans qu'on s'aperçoive qu'il est cadavre, jusqu'au soir où le plus léger heurt brise cette survivance factice et montre la cendre au lieu du sang. L'union des hommes créé le mensonge et l'entretient : une société peut cacher longtemps ses lésions mortelles, masquer son agonie, faire croire qu'elle est vivante encore alors qu'elle est morte déjà et qu'il ne reste plus qu'à l'inhumer...». Je n'insiste pas sur le vocabulaire choisi par Nordau puisque les termes «symptômes», «diagnostic», «étiologie», «pronostic» ou encore «thérapeutique» constituent autant de titre de chapitres de Dégénérescence. L'erreur serait pourtant de croire que Nordau est un pessimiste. Il pense au contraire que dans quelques siècles seulement, l'humanité étant parvenue à une plus claire connaissance du génie scientifique, sans la moindre nostalgie les arts seront de fait relégués dans le domaine des jeux pour enfants : «Les aberrations de l’art n’ont pas d’avenir. Elles disparaîtront quand l’humanité civilisé aura triomphé de son état d’épuisement.» Drumont, lui, se lamente inlassablement sur la fin de la France, qu'il impute à une seule et unique cause, invisible et délétère, que Bernanos d'ailleurs saura parfaitement lire et analyser dans sa magistrale et peu goûtée par les imbéciles Grande peur des bien-pensants : le mépris du Pauvre. Drumont écrit : «Ne croyez point que je sois triste quand je cause avec tous ces amis disparus dans les allées mystérieuses de la forêt. Au fond je les trouve très heureux d’être partis, il ne verront pas ce que nous verrons : l’état de plus en plus misérable où tombera cette France qui fut si grande.
Chère France ! Avoir monté si haut parmi les nations et tomber si bas, recevoir tous les outrages et ne pouvoir répondre, perdre chaque jour quelque fleuron de son étincelante couronne, quelque débris de sa gloire passée et écouter encore, d’un air déjà morne et bien désabusé, il faut le reconnaître, les paroles des rhéteurs qui nous tromperont jusqu’à la dernière heure !
Pourquoi cette chute ? Quelle cause dominante assignera l’Histoire à cette fin ? Une déviation du sens de l’Idéal […].» Pour Le Bon enfin, la cause, là aussi, paraît être définitivement entendue : «Quand l’édifice d’une civilisation est vermoulu, les foules en amènent l’écroulement.» Plusieurs pages d'un article nourri pourraient donc être consacrées aux rapprochements entre ces trois auteurs, à condition qu'ils perdent leur réputation bien peu enviable : car, si la Psychologie des foules a été éditée par les PUF il y a déjà quelques années, si Dégénérescence vient donc de l'être, dans une version certes amputée de ses chapitres les plus spécifiquement littéraires (consacrés, entre autres, à Zola et Huysmans), pour ce qui est de La Fin d'un monde, il faut encore se résoudre à devoir chercher ce livre chez les bouquinistes ou bien, comme je l'ai fait, à se procurer quelque édition (libanaise !) de contrebande, truffée de fautes de frappe et de typographie. Je ne désespère pas un jour de voir l'Université (le goût d'un public érudit semble significativement la précéder) s'ouvrir, malgré ses solides verrous idéologiques, à ces textes car, depuis quelques années, des auteurs tels que Joseph de Maistre, Bloy, Huysmans retrouvent quelque peu de la place qui devrait être la leur, rien de moins qu'essentielle pour qui prétend goûter les écrits d'un Baudelaire, d'un Claudel, d'un Massignon, d'un Valéry et de combien d'autres !
 Face à ces trois enragés lucides (enfin, j'exagère peut-être quelque peu en ce qui concerne la lucidité de Nordau...), les extraits de Michel Houellebecq, continuateur atone du Huysmans flamboyant et décadent, peuvent paraître de gentilles petites fadaises, d'irréprochables truismes, la monotone consignation des longues heures d'une après-midi passée sur la place du Vieux Marché, à Rouen. Banals, ces extraits le sont assurément, tout comme le furent, aux yeux de l'impitoyable Nordau, la totalité des romans de Huysmans, lequel paraît être, dès la publication d'À Rebours, le véritable initiateur de la mode décadente en littérature (ainsi que dans les arts plastiques et musicaux).
Face à ces trois enragés lucides (enfin, j'exagère peut-être quelque peu en ce qui concerne la lucidité de Nordau...), les extraits de Michel Houellebecq, continuateur atone du Huysmans flamboyant et décadent, peuvent paraître de gentilles petites fadaises, d'irréprochables truismes, la monotone consignation des longues heures d'une après-midi passée sur la place du Vieux Marché, à Rouen. Banals, ces extraits le sont assurément, tout comme le furent, aux yeux de l'impitoyable Nordau, la totalité des romans de Huysmans, lequel paraît être, dès la publication d'À Rebours, le véritable initiateur de la mode décadente en littérature (ainsi que dans les arts plastiques et musicaux). 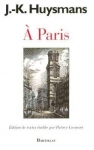 Des Esseintes, pourtant stérile, devenait le père des Durtal, Claudius Ethal, Dorian Gray et celui de tant d'autres héros névrosés, maléfiques, désespérément vides de Dieu puis mollement gidiens, le personnage emblématique inventé par Huysmans se transformant en un modèle (au même titre que celui de la belle dame sans merci analysé par Mario Praz dans La Chair et le Diable) dont les derniers feux rougeoieront dans un roman splendide et bien méconnu de Jean de Boschère, Satan l'Obscur, dans le Beau ténébreux de Gracq puis, une fois la métamorphose accomplie du papillon à tête de mort en chenille grise, dans le premier roman de Houellebecq, voire dans Pogrom de Bénier-Bürckel (dont l'Infréquentable retrouve toutefois quelque peu de la grandeur diabolique de ses ancêtres). Il est donc pour le moins curieux que l'époque actuelle, comme si elle était revenue d'un périple monotone dans des limbes fuligineux, se plaise, dans les romans de certains de ses écrivains les plus intéressants (je pourrais également évoquer le chatoyant Le Plomb d'Arnaud Bordes) à redonner à leurs inventions littéraires quelque peu de leur grandeur mauvaise, parfois satanique. Le diable redevient diabolique alors qu'il était parvenu, au terme d'une longue évolution initiée depuis Milton, sous la plume d'un Dostoïevski, d'un Sologoub, d'un Bernanos (exception faite de son premier roman) ou d'un Green, au stade peu enviable d'un personnage caricatural ayant perdu l'un après l'autre tous ses oripeaux romantiques.
Des Esseintes, pourtant stérile, devenait le père des Durtal, Claudius Ethal, Dorian Gray et celui de tant d'autres héros névrosés, maléfiques, désespérément vides de Dieu puis mollement gidiens, le personnage emblématique inventé par Huysmans se transformant en un modèle (au même titre que celui de la belle dame sans merci analysé par Mario Praz dans La Chair et le Diable) dont les derniers feux rougeoieront dans un roman splendide et bien méconnu de Jean de Boschère, Satan l'Obscur, dans le Beau ténébreux de Gracq puis, une fois la métamorphose accomplie du papillon à tête de mort en chenille grise, dans le premier roman de Houellebecq, voire dans Pogrom de Bénier-Bürckel (dont l'Infréquentable retrouve toutefois quelque peu de la grandeur diabolique de ses ancêtres). Il est donc pour le moins curieux que l'époque actuelle, comme si elle était revenue d'un périple monotone dans des limbes fuligineux, se plaise, dans les romans de certains de ses écrivains les plus intéressants (je pourrais également évoquer le chatoyant Le Plomb d'Arnaud Bordes) à redonner à leurs inventions littéraires quelque peu de leur grandeur mauvaise, parfois satanique. Le diable redevient diabolique alors qu'il était parvenu, au terme d'une longue évolution initiée depuis Milton, sous la plume d'un Dostoïevski, d'un Sologoub, d'un Bernanos (exception faite de son premier roman) ou d'un Green, au stade peu enviable d'un personnage caricatural ayant perdu l'un après l'autre tous ses oripeaux romantiques. 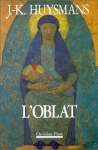 Je ne conclus point cette note, qui ne fait tout au plus qu'annoncer celle où j'évoquerai plus longuement Joris-Karl Huysmans qui, à l'instar de celui qui fut son ami puis son ennemi, Léon Bloy, semble lui aussi attirer de nouveaux lecteurs, si j'en juge par la facilité avec laquelle, désormais, on pourra lire des romans tels que L'Oblat ou La Cathédrale, il y a encore quelques années disponibles seulement grâce aux superbes (et rares) volumes édités par Christian Pirot dans la collection Autour de 1900.
Je ne conclus point cette note, qui ne fait tout au plus qu'annoncer celle où j'évoquerai plus longuement Joris-Karl Huysmans qui, à l'instar de celui qui fut son ami puis son ennemi, Léon Bloy, semble lui aussi attirer de nouveaux lecteurs, si j'en juge par la facilité avec laquelle, désormais, on pourra lire des romans tels que L'Oblat ou La Cathédrale, il y a encore quelques années disponibles seulement grâce aux superbes (et rares) volumes édités par Christian Pirot dans la collection Autour de 1900.Oui, je le dis avec grande prudence : peut-être sommes-nous en train d'assister à quelque timide frémissement annonçant le réveil du cadavre disséqué par les critiques. La littérature devenant adulte contrairement aux prévisions de Max Nordau, puisque certains de ses plus remarquables représentants ne seraient plus embastillés derrière les murs du politiquement correct. Nous pouvons rêver...
Note
(1) «Quand une vipère, un chien enragé me mord, je me soucie peu de savoir si l'animal est responsable ou non de son méfait. Je tâche de me protéger en l'empêchant de nuire et de nuire à d'autres : voilà ma seule préoccupation. [...] Nous pouvons plaindre les individus doués d'une organisation qui les condamne aux actions mauvaises, plaindre ceux qui ont la stupidité, la laideur ou une santé débile en partage, tout comme nous plaignons l'insecte que nous écrasons en passant ou l'animal que nous envoyons à l'abattoir; mais c'est là une compassion vaine qui ne saurait les soustraire à leur destinée» (Gustave Le Bon, La question des criminels, Revue philosophique, 1, 1881, pp. 538-539).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, max nordau, gustave le bon, édouard drumont, joris-karl huysmans |  |
|  Imprimer
Imprimer