Georges Bernanos à la merci d'un journaliste, Philippe Dufay (27/10/2013)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Georges Bernanos dans la Zone.
Georges Bernanos dans la Zone.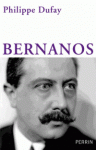 À propos de Philippe Dufay, Georges Bernanos (Éditions Perrin, 2013).
À propos de Philippe Dufay, Georges Bernanos (Éditions Perrin, 2013).LRSP (livre reçu en service de presse).
 Curieuse et fort décevante biographie que celle que Philippe Dufay a écrite sur Georges Bernanos, où le pire côtoie le mauvais. Les universitaires s’amuseront à relever les nombreuses coquilles émaillant le texte ainsi que les erreurs factuelles que contient cet ouvrage (1), mais c’est là finalement peu de choses, alors tout de même que l’auteur disposait, comme n’importe quel lecteur du Grand d’Espagne, des travaux biographiques autrement rigoureux d’un Max Milner ou d’un Jean-Loup Bernanos.
Curieuse et fort décevante biographie que celle que Philippe Dufay a écrite sur Georges Bernanos, où le pire côtoie le mauvais. Les universitaires s’amuseront à relever les nombreuses coquilles émaillant le texte ainsi que les erreurs factuelles que contient cet ouvrage (1), mais c’est là finalement peu de choses, alors tout de même que l’auteur disposait, comme n’importe quel lecteur du Grand d’Espagne, des travaux biographiques autrement rigoureux d’un Max Milner ou d’un Jean-Loup Bernanos. Plus grave me semble être l'utilisation abondante des invincibles platitudes propres aux journalistes qui écrivent des livres, et qui confondent sans doute un travail sérieux, quitte à ce qu’il ne cherche pas l’esbroufe, avec une accroche publicitaire sans intérêt. «Georges Bernanos était un écrivain, un chrétien, un royaliste et un antisémite», peut-on ainsi lire dès le Prologue du livre, alors que dans la page qui suit (cf. p. 12), l’auteur condense en un paragraphe qui mérite d’être cité intégralement tous les clichés pas même dignes de figurer dans un mauvais épisode de Rouletabille contaminé par La Varende : «Non pas né, mais élevé, «poussé» à deux pas du champ de bataille d’Azincourt, Georges Bernanos était un preux. Une réincarnation des Bayard et Du Guesclin, des vieilles gestes qui nourrirent son enfance. Un cousin du marquis de Morès, officier-aventurier assassiné, comme le père Foucault en Algérie par les tribus nomades insoumises du Sud tunisien. Une sorte d’hibernatus congelé à l’époque des croisades et «dégelé» sous la IIIe République des affaires Dreyfus, Panama et Stavisky. Un colonel Chabert, demi-solde de la France des Capétiens égaré dans celle du petit père Combes».
De telles lignes sont tout simplement ridicules, comme bien d’autres clichés dont regorge la plume faussement alerte de Philippe Dufay, qui qualifie Bernanos de «scribe, à la foi médiévale, de la misère humaine» (p. 16) ou de «preux», de «vrai chevalier de la Mancha, pourfendant non des moulins, mais les barbichus laïcards du Palais-Bourbon», l’auteur se demandant en outre si Bernanos n’était pas une sorte d’«Ivanhoé», de «Robin des Bois», de «Cyrano» ou de «D’Artagnan» (p. 42).
Que nous apportent de telles facilités si lamentablement publicitaires, petites réclames et slogans forcément faciles («Bernanos : catholique et mécanique toujours !», p. 131) indignes de la complexité de l’homme et, bien plus encore, de ses œuvres, et tant d’autres formules à l’avenant (2) ?
Car, plutôt que de tenter de relever le défi que représente, pour tout lecteur sérieux de Bernanos, la grande biographie de Max Milner qui mieux qu’aucune autre parvient à allier la description de la vie mouvementée de l'écrivain sans jamais la dissocier de la douloureuse gestation de ses textes admirables, Philippe Dufay, lui, fait de Georges Bernanos un pauvre type coincé entre son attirance pour les jolies femmes et les interminables bagarres entre ses nombreux enfants (3).
C’est là que le ton de l’auteur devient franchement déplaisant, peut-être parce qu’il se croit autorisé à nous lancer un clin d’œil de camionneur lorsqu’il évoque par exemple deux piquantes jeunes femmes «de moins de vingt-cinq ans : Marie Vallery-Radot, la sœur de Jacques, et Christiane Manificat, leur cousine» (p. 107), apparemment l’objet de l’attention du très fin limier qu’est Philippe Dufay qui nous glisse, non sans malice, qu’on «ne connaît pas le contenu de la centaine d’autres [lettres] adressées à Christiane Manificat, décédée à près de cent ans en 2002» (p. 205), lesquelles, apprend-on par le biais d’une note lourde de sous-entendus, ne pourront pas être connues avant 2040 : «y a-t-il eu quelque chose entre eux ?» (p. 108), s’aventure en fin de compte l’auteur à demander en incise, comme si la question ne valait pas mieux qu’une œillade appuyée ? Un bon enquêteur, s’il a des faits indiscutables à nous présenter, nous les expose sans rouler des yeux comme un maquignon devant un veau à cinq pattes et, s’il n’en a pas, ma foi, se tait, alors même que nous pourrions légitimement douter de l’intérêt littéraire fondamental de savoir si oui ou non aventure il y eut entre Christiane Manificat et le vieux lion éternellement rugissant, si oui ou non il nous importe encore de savoir que Chantal, l’aînée de Bernanos, est tombée enceinte parce qu’elle ne supportait plus la vie errante de la famille au Brésil (cf. p. 158).
Il n’est sans doute pas plus intéressant de présenter la femme de Georges Bernanos comme une espèce de demi-mondaine, amatrice, une fois arrivée au Brésil, des «cocktails qui [lui] permettent […] de mettre une robe de ville et, loin de l’odeur entêtante des zébus, de s’inonder de parfum» (p. 194), puis, devenue veuve, comme «une femme étrange au corps amaigri par la vieillesse et à la voix rauque devenue métallique par la fumée d’immondes cigarettes. Une sorte de fantasme échappé d’un roman médiéval, avec un long buste, telle Jeanne d’Arc, pour cotte de maille; comprimé dans une robe de velours noir. Une veuve giralducienne. Une héroïne de tragédie ployant sous la fatalité» (p. 236).
Le lecteur naïf aura beau jeu de m’opposer le fait que, ici ou là, Philippe Dufay ne fait que reprendre les termes utilisés par d’autres, par exemple, pour le cas de la veuve Bernanos, la description que Dominique de Roux en fit dans une lettre à Robert Vallery-Radot en mai 1960. Certes, le devoir d’un biographe est de parvenir, sans rien gâcher du mystère de la destinée de celui dont il peint la vie et les œuvres, pourtant si peu évoquées je l’ai dit par Philippe Dufay, à nous le rendre touchant et profondément humain, et il est vrai que l’unique intérêt de cette biographie est de souligner les anecdotes souvent cocasses (cf. p. 142, avec José Bergamín en factotum) qu’il a puisées dans les travaux de bien d’autres commentateurs plus doués que lui, et qui ne faisaient justement pas de ces anecdotes des nœuds gordiens où il s’agissait de lire la vie de chien (et pas la chienne de vie, comme le soulignait l'intéressé lui-même) de l’écrivain.
Encore serait-on en droit de réclamer, lorsque l’on se mesure à un écrivain de la trempe de Georges Bernanos, l’évocation d’une vie par le biais d’une écriture qui, sans jamais s’attarder sur la complexe intrication entre les événements et les œuvres, fût à tout le moins capable d’aligner quelques belles pages. Las ! Philippe Dufay, journaliste de son état qui n’oublie pas de remercier le très journalistique Pierre Assouline, ne possède, en guise de besace percée, que quelques petites formules qu’une exposition de plus d’une seconde sous le soleil portant pâle de l’Artois suffirait à faire s’évaporer. Jugeons ainsi de cette ridicule entrée en matière brésilienne : «À Pirapora, les lézards sont gros comme des chats et le cœur des immigrés plus lourd que les pastèques du marché. Ce n’est pas tant cela qui inquiète Georges Bernanos que les nouvelles en provenance de l’Europe lues dans la presse locale» (p. 156), où deux comparaisons indigentes sont lamentablement reliées aux préoccupations de l’écrivain par le bais d’une cheville qui a la discrétion d’un de ces arbres géants de l’Amazonie.
Comme tous les écrivants, Philippe Dufay, si peu doué, veut à tout prix nous montrer qu’il sait filer une métaphore lourde de références infinies, ce qui risque de provoquer quelques fâcheux coups de soleil sur le visage du lecteur. Ainsi, «Sous le soleil… du Bon Dieu» (p. 165) utilisé à propos des amis de Bernanos, est suivi par les «fourmis piquent, les chevaux boitent, la pluie ravine et le soleil reste celui de Satan» (pp. 166-7) à propos de la vie de la tribu d’exilés à Barbacena, l’auteur se demandant ensuite si le «soleil de Satan n’achèverait […] pas aussi les chevaux» (p. 171), la vie brésilienne menée par la famille étant finalement assez néfaste pour les montures qu’elle utilisa, Philippe Dufay mettant enfin un terme à sa série de plages d’ensoleillement métaphorique par un simple «Sous le soleil des Bernanos», expression qui clôture l’évocation de la vie brésilienne pour le moins agitée d’Yves Bernanos qui «ne trouve rien de mieux que de faire un enfant à Elsa, la fille des gardiens» (p. 200). Ouf, nous avons tout de même réussi à éviter un «Sous le soleil des embardées hormonales» !
Ce ne sont donc pas quelques lignes à peine moins ridicules que les précédentes, où Philippe Dufay se risque à tenir une plume et bien sûr ne parvient qu’à barbouiller une page de grosse tâches toutes fuligineuses (4), qui parviendront à sauver de l’insignifiance cette biographie qui ne présente qu’un seul avantage, celui de condenser en un seul livre la somme d’anecdotes plus ou moins intéressantes sur Georges Bernanos éparpillées dans les livres de son fils Jean-Loup (5), de Raymond-Léopold Bruckberger (6) ou encore de Jean De Fabrègues (7).
Quant au lecteur sérieux, c’est-à-dire au lecteur qui s’intéresse avant tout aux textes du magnifique écrivain et romancier que fut Georges Bernanos, nous ne pouvons que conseiller de lire ou relire le travail remarquable de Max Milner (8), qui n’a pour le moment pas été dépassé ni même égalé, ou encore la belle somme de Hans Urs von Balthasar (9).
Notes
(1) Comme la mention (p. 234) d’une certaine Marie-Amélie Bernanos, petite-fille de l’écrivain et fille de Jean-Loup Bernanos, dont nulle trace n’existe, puisqu’il s’agit en fait d’Anne-Marie-Louise-Jehanne, connue sous le nom de scène d’Anne Caudry et qui mourut en 1991. Autre bizarrerie (p. 225), puisque nous apprenons qu’Armel Guerne serait une «ancienne déportée, à l’occasion secrétaire et préceptrice de ses enfants». Le nom de l’écrivain et traducteur est d’ailleurs orthographié Guern en note, p. 250, sans doute parce que le sexe de l’auteur du Poids vivant de la parole est assez peu défini ! Nous apprenons également dans les remerciements que le journaliste Gérard Leclerc est «théologien» et que Catherine Dhérent est «organisatrice de pèlerinages sur les traces de Georges Bernanos». Ayant participé à l’un de ces pèlerinages, je n’ai pas le souvenir d’y avoir transporté mon rosaire ni d’avoir accompli le voyage à genoux et vêtu d’une bure.
(2) Ailleurs (p. 80), Georges Bernanos est désigné comme étant un «grand tribun lyrique au catholicisme sanguin et médiéval, aux larges yeux azur et aux viscères fragiles», ou bien comme «un Franc, un «Blanc», un Chouan à la Cadoudal, sanguin, matamore, agenouillé au pied du trône et de l’auteur» (p. 91), un «croisé», «fou de Dieu à la foi si médiévale, rêvant à une monarchie si populaire» (p. 102), ses ennemis ayant droit, eux, «aux ailes décapitantes du tourbillon de son robuste moulin» (p. 92).
(3) C’est, avec celle du soleil, l’une des deux pauvres métaphores filées que contient la biographie de Philippe Dufay, qui ne cesse de nous suggérer un Georges Bernanos pathétique, l’auteur de Monsieur Ouine redoutant plus que le diable lui-même les éclats de voix de sa tribu nombreuse : «Ceux-ci, livrés à eux-mêmes, forment une horde qui impressionne le dominicain [le Père Bruckberger] : bagarres continuelles, insultes, coups de gourdin, échanges de jets de pierre et villa entièrement dévastée», avec, comme remarquable conclusion, cette chute : «Qui oserait s’étonner encore que Georges Bernanos écrive dans les cafés ?» (p. 133). Voir encore : «Seul, réfugié dans sa thébaïde en planches, l’écrivain ausculte le faux silence de la nuit brésilienne, alors qu’à deux pas la maison familiale résonne des violentes querelles qui éclatent – en français, en anglais et en portugais – entre ses enfants» (p. 159). Troisième occurrence de ces chocs de titans domestiques à la page 191.
(4) Ainsi : «Par soir de grand vent, les hauts eucalyptus plient – et pleurent – sur la petite fazenda, paroisse à demi morte… Au fil des mois, des pluies torrentielles, des longues semaines de sécheresse plus raide que celle du Sahel et des plaintes languissantes des crapauds buffles aux yeux hallucinés de princes damnés, la Croix-des-Âmes a fini par ressembler, avec ses nouveaux bâtiments blancs, chaulés, ses bacs à fleurs accrochés aux fenêtres et son pigeonnier, à une ferme de l’Artois» (p. 190). Nouveau clin d’œil hautement hermétique de la part de l’auteur, rappelons en effet que le premier titre de Monsieur Ouine était La Paroisse morte…
(5) Georges Bernanos à la merci des passants, Plon, 1986.
(6) Bernanos vivant, Albin Michel, 1981.
(7) Bernanos tel qu’il était, Mame, 1963.
(8) Georges Bernanos, Desclée de Brouwer, 1967.
(9) Le chrétien Bernanos, Seuil, 1956, réédité en 2004 chez Parole & Silence.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, georges bernanos, philippe dufay, éditions perrin |  |
|  Imprimer
Imprimer