L'Avenue de Paul Gadenne (22/08/2014)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Paul Gadenne dans la Zone.
Paul Gadenne dans la Zone.J'ai consacré voici quelques années un texte à L'Avenue, recueilli dans La Critique meurt jeune, paru au Rocher en 2006 et intitulé L'Avenue de Paul Gadenne ou la transparence de l'art.
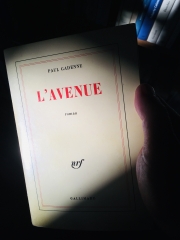 Publié en 1949, L'Avenue est le quatrième roman de Paul Gadenne et pourrait être lu comme une variation, cette fois lumineuse à la différence du crépusculaire et maléfique Vent noir, sur le thème de l'impossible Reprise (1) qui toute sa vie hanta le grand Kierkegaard (et Gadenne, n'en doutons pas), thématique profondément existentielle que nous avons déjà évoquée dans la Zone.
Publié en 1949, L'Avenue est le quatrième roman de Paul Gadenne et pourrait être lu comme une variation, cette fois lumineuse à la différence du crépusculaire et maléfique Vent noir, sur le thème de l'impossible Reprise (1) qui toute sa vie hanta le grand Kierkegaard (et Gadenne, n'en doutons pas), thématique profondément existentielle que nous avons déjà évoquée dans la Zone.Cette Reprise ne peut se produire, logiquement, qu'une fois la séparation consommée qui, dans notre roman, a lieu dès les toutes premières lignes,dans une belle scène de cohue et de foule française en déroute sous le feu allemand : le sculpteur Antoine Bourgoin est séparé de sa femme, sans qu'il n'en éprouve beaucoup de tracas ni de peine (2).
Ce n'est donc pas la séparation entre un homme et sa femme qui nous intéresse, mais une séparation fondamentale, celle de l'artiste avec sa propre création, Antoine Bourgoin étant un sculpteur pressé de profiter de son exil involontaire pour revenir à ses premières et, sans doute, uniques amours : «A peine eut-il touché la glaise qu’il comprit que son exil avait cessé» (p. 13), mais, pourtant, ce retour à la sculpture, compris comme étant une «protestation en réponse à la brutalité des faits» (ibid.) ne peut que traduire un éloignement fondamental, notre sculpteur estimant que son œuvre la plus emblématique, Eve et non ce couple trop symbolique de Caïn et de son frère (cf. p. 17), a, comme le dit l'écrivain lui-même, bougé : «Ce n’était plus la rupture de courant, supportable parce qu’on la sait brève, mais un sentiment de dépossession, qu’il subissait dans la plénitude de ses moyens, et qui vidait de toute signification ce monde de formes qui était sa vie, le frappant d'inefficacité» (p. 19).
Bien évidemment, Paul Gadenne a vite fait de balayer la thématique, classique sinon éculée, de la béance qui existe et ne peut exister qu'entre l'artiste et son public d'admirateurs mais aussi entre ce dernier et sa création (3), car la rupture existant entre Bourgoin et sa statue, qu'il va enfin se décider à reprendre, n'est que l'indice d'une séparation bien plus profonde, ontologique et spirituelle, englobant tout l'univers comme dans les drames de Shakespeare, ainsi qu'il en va toujours avec Paul Gadenne, et dont mille indices indiquent la puissance et la réalité aux yeux d'Antoine Bourgoin : «Voilà : c’était ce blâme qu’il entendait aujourd’hui, mais accompagné d’un blâme encore plus sourd, qu’il n’arrivait pas à mettre au clair» (p. 18).
Cette rupture est ainsi le signe ou plutôt la conséquence d'une faute, et d'abord, d'une faute commise à l'endroit de sa propre création qui, probablement imparfaite, n'a pu se tenir et se retenir, imperfection non pas due, une fois encore, à l'inévitable inachèvement de la création de l'artiste mais au fait que, plus sûrement, celui-ci s'est négligé, retenu, économisé, comme s'il avait eu peur de se perdre dans ce qui est sorti de son esprit et de ses mains, comme s'il était allé contre l'impératif même édicté par Gadenne : «les temps d'orage ne sont pas pour l'artiste une permission» (p. 20). Oui, Eve a bougé, car celui qui l'a créée ne s'est pas abîmé en elle, création et créature dont il est responsable : «Son Eve avait bougé, – mais elle l’avait fait en son absence, et la différence était qu’il se sentait responsable» (p. 38). «Il y avait donc des choses faites par nous, et qui, une fois faites, nous échappaient, nous déroutaient même», constate ainsi Antoine Bourgoin, choses, mais tout autant, personnes, comme nous le savons par l'exemple des autres romans de Paul Gadenne, «menaient loin de nous une vie à elles, dont notre effort, nos intentions étaient insuffisants à rendre compte» (p. 172). C'est le scandale dont rien ne peut rendre compte, jamais : comment cette œuvre qui est la mienne peut-elle me semble être devenue une parfaite étrangère ? Comment cette femme, que j'ai pourtant aimée à la folie et à laquelle, ne serait-ce qu'une minute, j'ai accordé tout mon souffle, à laquelle j'aurais pu donner ma propre vie, comment cette femme a-t-elle pu se détourner de moi au point d'être devenue d'abord une ennemie, puis une parfaite étrangère dont la mort ne m'arracherait pas même un soupir de nostalgie, une larme de peine ? Le scandale est la matière hautement instable que Paul Gadenne, comme Kafka, manie avec des précautions de chercheur, la tordant dans tous les sens, tentant d'en analyser les plus infimes composants, y exposant ses propres personnages, afin d'observer les étranges mutations qui s'opèrent en eux à son voisinage ou même à son contact.
Antoine Bourgoin, c'est là le premier mot des plus grandes aventures littéraires métaphysiques, se sait donc coupable, bien qu'il n'ait commis aucun crime, et même si, au cours de ses longues promenades dans les environs de la petite ville de Gabarrus, il semble goûter quelque «saveur dans ce mélange de nature et de médiocrité bourgeoise où la courte vie des hommes» est pourtant, elle aussi, soumise «à l'investissement du silence et de la lumière» (p. 24).
Ainsi, la voie est claire : il faut se perdre, non pas en tentant d'annihiler sa conscience et sa personne dans les drogues ou les vices (ou les deux ensemble) mais en laissant comme unique témoignage une œuvre qui, dans sa perfection, résume ou résumerait la vie de tout un homme, celle de tout homme, sa geste créatrice, et n'aurait donc plus besoin de la charpente pourrie qu'est une biographie : «Comme d’autres courent à la renommée, Antoine courait à l’oubli» (p. 15). Comme d'autres, oui, c'est-à-dire comme tous les personnages de Paul Gadenne, perpétuellement frappés de constater qu'eux-mêmes, apparemment, ont bougé ou bien tremblé, comme on dit d'un sujet pendant la pose qu'il a bougé ou bien tremblé, comme s'ils ne pouvaient s'empêcher de constater que tout est signe, «l'aboiement d'un chien» venant éveiller un «écho enfoui» de l'enfance sonnant dans la mémoire du personnage «comme un écho de l'éternité» (p. 28). Il faut partir, puisque la création n'a pas su rester en place, et que notre vie est composée de minuscules moments aussi dissemblables que possible dans leur concaténation faussement rationnelle, et qui n'est bien davantage, peut-être, que miraculeuse. Il faut partir puisque nul ne saurait réellement récuser cette sensation de «paradis tout proche, mais irrémédiablement secret», qui vous condamne à «être toujours en marge» (p. 31), il faut bien partir, puisqu'il vous est parfaitement impossible de taire, sauf à se mentir ou bien être un imbécile, ce sentiment d'avoir raté quelque chose : «Il lui semblait toujours qu’il avait manqué quelque chose, qu’il n’avait pas fait ce qu’il devait, qu’il était attendu quelque part, ailleurs, dans un lieu où il n’était pas» (pp. 29-30).
Il faut bel et bien partir, sans toutefois regretter ce départ, comme l'ange de Paul Klee selon Walter Benjamin ou bien l'Eve première du sculpteur Antoine Bourgoin, le visage «tourné désespérément en arrière» (p. 45), cette sculpture ne pouvant qu'échouer au yeux de son créateur, puisqu'elle est encore par trop symbolique (cf. p. 124 pour le refus d'une interprétation de l'art par le symbolisme) et qu'elle livre ainsi, misérablement, le pauvre secret si visiblement intentionnel ayant présidé à sa construction.
Il faut partir, puisque, comme Paul Gadenne le répète après Georges Bernanos : «Il faut partir sur les routes, de grand matin, pour savoir pourquoi nous sommes au monde» (p. 91).
Pourtant, Antoine Bourgoin, s'il marche beaucoup (prétexte à d'admirables descriptions de la nature, qu'il faudrait pouvoir citer intégralement), ne part jamais, mais s'enfonce en lui-même, comme les autres personnages du romancier, Paul Gadenne étant l'écrivain de la profondeur de la conscience, des profondeurs de l'âme humaine.
Une seule voie, aux yeux de Paul Gadenne, est juste, et bonne : «Le devoir de l’artiste s’inscrivait dans cette limite : il était d’abord devoir envers soi; il était honnêteté, – honneur» (p. 37). C'est dès lors parce qu'il obéit à un tel devoir que, loin de se replier dans l'hermétisme de l'autiste, le véritable créateur est investi d'une mission, aussi ridicule que semble ce terme à l'heure de la déconstruction généralisée, et une mission doublement suspecte puisqu'elle se doit d'être universelle : «C’était donc à cela qu’il fallait viser : créer une œuvre douée de ce pouvoir, capable de surmonter le temps, d’entrer, à des années de distance, dans une relation immédiate avec n’importe quel homme situé à son niveau» (ibid.).
L'artiste véritable est donc le premier des réactionnaires, à condition de redonner à ce terme une signification qui l'éloigne le plus possible des petites dénominations par lesquelles les journalistes et autres incultes prétendent insulter leurs adversaires ou bien une entreprise dont ils ne comprennent pas l'essence, puisqu'il s'agit d'inscrire dans une permanence et une véritable continuité une création qui, née de l'intimité du temps, prétend tout de même lui tenir tête : «C’était à cela qu’il travaillait, et à rien d’autre, persuadé que l’art suffit, que l’artiste n’a pas à signifier autre chose, et que son rôle est moins de fournir des illustrations à son temps, que de l’installer dans une permanence, de lui ouvrir un débouché sur l’éternel. Faire une statue qui soit comme un caillou usé par le temps, mais sur lequel le temps glisse, faute de prise» (pp. 37-8).
N'ayant d'autre finalité (cf. p. 45) que celle de faire tendre la matière, lumière, matière, langage, musique, à la pureté, l’œuvre d'art véritable possède en elle toutes les énigmes et excède toutes les définitions et interprétations (4). Elle est signe, puisqu'elle provient de l'esprit, lui-même partie et matrice de tout ce qui l'entoure, lui-même signe : «Mais on ne peut non plus que l’œil ne soit esprit, et qu’ainsi toute ligne ne soit signe, si tout signe est langage» (p. 35). Ainsi la description de la nature et des paysages qui entourent Antoine Bourgoin, comme dans d'autres textes dont le plus éminent est Baleine, constituent-ils une sorte de phénoménologie spirituelle plus que symbolique, le signe n'étant lui-même qu'un écho (5) d'une réalité perdue ou d'un univers invisible qui, parfois, l'espace de quelques secondes à peine, peut vous laisser l'impression qu'une minuscule mais réelle épiphanie ou bien rencontre, auraient pu se produire, sensation fugace et, si c'est possible, vérité qu'il s'agira bien évidemment de reconquérir, parce que l'homme n'est grand, et d'abord heureux, que lorsqu'il se sait membre d'une communauté dont l'intégrité est inviolable parce qu'elle s'alimente à une source mythologique : «Et puis il se disait aussi, à tort ou à raison, que l’humanité […] a besoin, de temps en temps, de reconnaître ses mythes dans les œuvres qu’on lui propose» (p. 41).
Reconquérir, reprendre, gagner le pas perdu. C'est dans ce mouvement que se nouent les différents faisceaux qui composent le roman de Paul Gadenne, puisqu'il s'agit donc, pour le sculpteur Antoine Bourgoin, non pas de parvenir à se connaître ou, comme disent nos contemporains, à se réaliser (6) par le biais de son art mais, en donnant la vie à une œuvre sincère et exigeante qui le résume et résume la geste humaine depuis la nuit des temps (7), s'accorde harmonieusement à l'univers, et touche ainsi les autres hommes, tout en constituant une sorte de havre où se perdre, s'oublier et, bien sûr, parvenir à comprendre que l’œuvre d'art, aussi réussie soit-elle, n'est que le marchepied vers une réalité plus haute, que Gadenne ne nomme jamais directement dans son roman, mais qu'il nomme pourtant ailleurs sans la moindre ambiguïté, Dieu (8).
Ce frémissement de l'invisible n'est pas seulement procuré à Antoine Bourgoin par la statue qu'il s'efforce d'achever, ni même par la vision fugace d'un visage de femme qui semble toujours le même au travers de ses multiples incarnations (cf. pp. 42-3), mais par la mystérieuse avenue dont il est question dans le roman : «Antoine ne pouvait croire, la voyant s’avancer parmi des choses aussi profondément belles, que l’avenue ne débouchait pas, sans doute beaucoup plus loin, sur quelque révélation importante, sur quelque seuil inoubliable» (p. 93).
L'avenue elle-même semble frémissante d'une révélation sans cesse procrastinée : «cette partie de l’avenue soustraite aux homme retrouvait, en même temps que le visage de la nature, cet au-delà du geste d’où nous tombe soudain une clarté sur nous-mêmes que nous n’attendions pas» (p. 26).
La Construction (ou bien la Résidence) elle-même à laquelle mène l'avenue bordée de Demeures mystérieuses ne saurait nous donner une réponse claire : «Demeuré au bas de la pente, il gardait les yeux fixés sur cette construction inachevée, dont la présence en ce lieu démuni était troublante comme une proclamation faite à distance par quelqu’un que l’on n’entend pas», l'assemblage de bétons et de poutrelles laissé à l'abandon constituant autant de «pièges géométriques tendus à l’absence et à la mémoire» (p. 33).
Comme dans les textes de Kafka, que Paul Gadenne lisait d'ailleurs avec autant d'attention que d'admiration, le personnage s'interroge sur la signification de ces constructions laissées abandonnées, et ne manque pas d'interroger différents témoins aux orientations idéologiques multiples pour en apprendre plus sur elles, comme l'Instituteur, qui exprime certainement une vision progressiste : «L’Instituteur critiquait fort cette négligence qui s’étalait partout, et qui permettait aux choses mortes de subsister, et d’exercer sur les vivants leur pouvoir de séduction et de nostalgie» (p. 63).
Revenons à Eve, après avoir quelque peu évoqué l'avenue et la Construction, Eve décrite comme si elle était un «pin, un cyprès, une colonne de chasteté. D’une chasteté éblouissante» (pp. 47-8), Eve qui ne cesse de tourmenter notre sculpteur : «Cette œuvre, qu’il avait dépassée, le tourmentait comme un remords» (p. 122), Gadenne précisant quelques lignes plus loin qu'elle «éclatait comme une de ces fautes sur lesquelles nous ne pouvons plus rien, et qui nous poursuivront jusqu’au jour où nous saurons les justifier». Nous avons vu que, chez Gadenne, la thématique de la Reprise était indissociable de celle de la faute, peu importe que cette dernière soit explicite ou qu'elle ne réside que dans les agissements les plus ténus des êtres qui se défont les uns des autres, s'éloignent les uns des autres après la passion amoureuse, comme le montrent Le Vent noir ou encore La Plage de Scheveningen : «C’était même le sentiment de cette terreur qui le ramenait si obstinément à cette photographie, à ce tiroir : qu’il y eût quelque part dans le monde cette chose sur laquelle il ne pouvait plus rien, et qui témoignait contre lui…» (p. 123). En somme, la première Eve témoigne contre celui qui l'a créé, peut-être dans un instant de trop grande facilité, tout comme il ne serait que trop tentant, après l'Eve, de créer un Adam qui détruirait le sens de l'effort de celle-ci. Non, car Eve, comme une pâte (et qu'est-ce que la glaise, après tout ?) doit se reposer, puis que c'est la marche, l'exploration de Gabarrus et de l'avenue, mais aussi de nouvelles tentatives de sculpture comme l'Objet (cf. p. 148) qui ramèneront Antoine Bourgoin au foyer d'incandescence qu'elle représente.
Le détour (artificiel bien sûr, ces thématiques étant finement liées dans notre roman) par l'avenue et le dédale interprétatif qu'elle nous propose nous permet d'adopter une voie prudente, modeste, à la limite de l'apophatisme (9), seule peut-être susceptible de nous montrer ce qu'Eve doit être, la déhiscence d'un instant de bonheur tout d'abord, comme celui qu'Antoine Bourgoin a pu contempler durant l'une de ses promenades, en observant un couple au loin : «Cela avait cessé soudain d’être un scandale : cette éternité silencieuse d’un couple debout contre un mur, contre la nuit, créait pour tous les êtres une chance de bonheur» (p. 119).
Cet instant, s'il sera peut-être bien incapable de racheter le scandale ancien, la faute commise et jamais oubliée, parviendra au moins à créer un sentiment d'harmonie, d'une totalité organique et spirituelle dans laquelle tout homme, dût-il un créateur, devra pouvoir trouver sa place : «Antoine était frappé de l’accord qui existait, à certaines heures, entre les ouvrages de l’homme et les aspects de l’univers» (p. 118).
Eve doit frapper par sa matérialité, son extrême pesanteur, s'imposer en somme comme une évidence aux yeux et dans l'esprit de celles et ceux qui la regarderont sans qu'ils aient besoin de recourir à des explications trop avancées (10), mais, pourtant, sa plus grande force est de nous suggérer non seulement ce qui n'est pas, mais sa propre disparition, tout comme l'attente semble acquérir sa plus haute signification non pas dans la possession de ce qui était attendu, mais dans sa conquête pour l'éternité (Kierkegaard dirait : dans sa reprise) : «et il commençait à se demander si, en de certains moments, l’attente n’était pas déjà une plénitude, – si notre attente, ce n’était pas déjà l’éternité» (p. 99).
Paul Gadenne, grand lecteur des textes mystiques (ainsi Maître Eckhart est-il cité en exergue de notre roman), n'est jamais plus troublant que lorsqu'il ne fait que nous suggérer, c'est-à-dire en quelque sorte enrichir le visible, ce qui nous est donné, par ce qui doit nous demeurer invisible, Antoine Bourgoin remarquant ainsi que la respiration même est absence, suffocation, mort possible, avant que d'être aspiration salvatrice, la respiration se fondant sur un «balancement nécessaire», «qui veut que le vide succède au plein, et qu’il en soit la condition même» (p. 127), tout comme la plus grande et parfaite rencontre, qu'est censée justement matérialiser Eve (cf. p. 148) n'a son fondement que dans l'aorasie des Grecs, autrement dit la perte.
La perte est la condition première de l'écriture de Paul Gadenne qui, pourtant, remédie à celle-ci par la seule stratégie possible, sinon efficace : l'effacement, qu'il s'agisse de l'art ou bien de soi-même (cf. p. 123), Eve n'ayant de sens que parce qu'elle referme le cercle derrière celui qui l'a sculptée (cf. p. 115).
Eve, plus qu'une réelle présence même si elle est censée, nous l'avons dit, s'extraire, sans la condamner, de la réalité la plus humble, celle de la matière, même si elle doit posséder «une jeunesse biblique, la jeunesse d'une fille de roi» (p. 135), est en fait une absence, comme chacun des personnages féminins (car Eve en est assurément un) inventés, extraits de la conscience et de la chair douloureuse de Paul Gadenne. Une absence paradoxale certes, mais non pas un mythe, ayant pris son essor depuis la réalité la plus humble, non seulement la glaise que pétrit notre sculpteur, mais la boue, le cloaque, tout comme la Baleine en putréfaction est signe de renaissance. Ce n'est donc pas un hasard si l'avenue débouche sur une décharge à ciel ouvert, de laquelle elle tire d'ailleurs peut-être sa substance et son être : «Tout cet ordre, cette dignité, ce mystère; et à l'origine, cette confusion, cette ignominie, cette impudeur...» (p. 143), puisqu'il y a dans ce «pêle-mêle apocalyptique», comme dans le cadavre d'un cétacé échoué sur une plage, «dans cette confusion du oui et du non, une sorte surprenante d'apothéose, dont la beauté luttait contre la fascination du chaos» (p. 142).
Ce n'est donc pas un hasard si, face aux difficultés qu'Antoine Bourgoin ressent pour recommencer une Eve qui pourrait se tenir droite sans son aide, et qui, ainsi, ne l'accuserait pas, ne lui jetterait pas en pleine figure sa trop grande légèreté en tant qu'artiste, il éprouve une véritable méfiance envers la pâte des mots, argile si peu malléable, comme il le constatera au moment de répondre aux lettres que lui envoie sa femme. Bien évidemment, nul ne s'étonnera que Gadenne, après tant d'autres écrivains, soit confronté à l'éternelle problématique de l'insuffisance des mots : «parce que les choses qui lui tenaient le plus à cœur se révélaient à peu près impossibles à mettre au clair» (p. 130) ou bien que son sculpteur soit désorienté face à l'argile du langage, qui semble bien plus difficile à maîtriser et solidifier que ses propres sculptures : «Antoine s’irritait contre les mots. C’était une matière plate, usée, un peu perfide; on avait beau essayer de la guider, de la soulever, elle retombait à sa platitude, à ses trahisons» (pp. 131-2). Il importe cependant de remarquer que ces récriminations contre le langage n'ont qu'un seul but, non pas celui de pester, comme le ferait l'amateur d'art pour l'art ou bien de petits jeux de mots spéculaires, contre la faillibilité d'un outil, mais d'établir le fait que cet outil ne peut avoir qu'un seul sens, celui de nous permettre de découvrir une vérité plus haute : «comme si, derrière l’opacité du vocabulaire, derrière cette pâte encombrante et rebelle, il espérait atteindre la vie nue, la vérité» (p. 132), y compris lorsqu'Antoine Bourgoin décide de s'adresser, par le biais d'un journal, à un autre comme à lui-même (cf. p. 140 et sq.).
L'usage des mots est une chimère (11), eux qui presque toujours semblent condamner les personnages de Paul Gadenne, comme si le langage et même l'écriture n'excellaient qu'à tenter de dire ce vide qui les constitue et, surtout, qu'à prendre appui sur des réalités qui les dépassent, comme l'est justement Eve, qui a bon droit peut semble constituer, à celui qui tente de la sculpter, un véritable danger, lui qui se trouve «soudain comme un homme qui aurait à faire face à un danger mortel et ne trouverait plus de refuge que dans l'invocation» (p. 128).
Mais Eve elle-même n'est qu'un outil, le plus parfait et poli des outils si l'on veut, celui qui n'opposera aucune résistance à sa propre disparition, celui qui sera le signe même de sa disparition et de celle de son auteur (12), Eve, comme l'avenue, n'est qu'un passage (13), un chemin vers ce qui les dépasse : «L’œuvre d’art n’était peut-être qu’un passage…» (p. 205).
Passage et chemin vers quoi ? Dieu, nous l'avons dit, mais cette réponse n'appartient pas au roman qu'a écrit Paul Gadenne, mais à ses scories, ses commentaires, inutiles comme tous les commentaires, y compris quand c'est l'écrivain lui-même qui en est l'auteur. Le roman, lui, est plus vague, plus mystérieux, donc, forcément, plus romanesque, et nous donne une réponse ambiguë, qui constitue peut-être le cœur ou le cratère de l’œuvre, par le biais de la description d'un tableau, fort banal, que le jeune Antoine a contemplé, jeune, durant des heures : «Ce lieu vers lequel ils se rendaient, c’était le lieu, éternellement vacant, que nous réservions depuis toujours à l’action supérieure à tout amour, à la Présence dont nous avions invoqué la venue au cours des siècles, par toutes nos constructions et nos constitutions, par tous nos édifices, par des armées de maçons et d’architectes ; pour qui nous avions dressé tant d’arches et de tours, élevé tant de voûtes, de flèches, de coupoles, lancé tant de vaisseaux, dans l’espoir qu’elle vienne s’y installer un jour, qu’elle consente à venir occuper la place préparée pour elle. De là ces citadelles, ces sanctuaires sur les hauts lieux» (pp. 190-1).
Ce passage vers Dieu, qualifié de Présence (et même, de «On» : «La nuit, s’il nous arrivait d’ouvrir les yeux, nous nous levions en hâte et allions voir si la place était occupée, si l’On avait mordu à l’hameçon, si l’On avait bien été pris au piège», p. 191), cette attente de la Venue (une des lectures possibles, bien sûr, du titre du roman : «L’idée lui vint que toute sa vie, depuis le premier jour, il n’avait travaillé qu’à dégager les voies pour cette approche, cette venue mystérieuse», p. 255.) ne peut qu'être effacement, selon le mouvement même qui anime les personnages principaux de Paul Gadenne. Si Eve existe, si elle constitue, même, un «faisceau convergent» (14), un scandale aux yeux des hommes (15), celui qui l'a créée n'a plus qu'à disparaître (16), peut-être à la seule fin de rejoindre ce qu'il a créé (17), une œuvre, tellement concentrée qu'elle semblera implorer une ouverture (18) et qui devra elle-même disparaître et céder le passage à ce qui la dépasse (19), non pas dans le geste rageur et rimbaldien, finalement très romantique malgré son affirmation de modernité absolue, mais dans une attitude d'humilité qui, ô surprise, ne brisera rien, mais s'insérera au contraire dans la longue chaîne des innombrables œuvres d'art existant dans le monde : «Des civilisations entières, des aspirations séculaires, se trouvaient résumées dans l’espace étroit d’un tableau : Venise dans un geste du Titien, la France féodale sur une page de livre d’heures» (p. 182), comme si le geste du créateur véritable était de piété plutôt que de colère : «Des révolutions avaient passé, d’autres étaient en route; mais chaque fois qu’un homme tentait une expérience un peu haute, d’autres hommes l’avaient tentée avant lui, il refaisait des étapes déjà faites, et les lignes de crête, comme les précipices, avaient déjà leurs noms marqués sur les cartes» (p. 210), comme si l'attitude du véritable artiste consistait à mettre ses pas dans les traces qui le précèdent : «Nous habitons une terre où les chemins s’entrecroisent de telle sorte que chacun passe par tous les autres, et qu’il est aussi difficile d’aller tout droit que de ne jamais rencontrer les nœuds où ils se rejoignent» (p. 247), comme s'il nous suffisait, avant même que de parler, d'écouter la très lointaine rumeur du premier mot, duquel tous les autres sont nés : «Il suffisait de soulever un peu la brillante matière des paysages, des routes, et des architectures que les hommes posaient au bord des routes, et voici que nous pouvions entendre, sur la nudité de la terre, se répercuter l’écho du mot initial» (p. 248) et, avant même que de partir, de faire quelques gestes très simples, qui ont été répétés par les hommes durant des millénaires, et sans lesquels nous ne serions rien (20), et qui nous permettent d'accueillir, finalement mieux que l'art y compris le plus exigeant (21), Celui qu'il s'agit de louer, dont il s'agit de chanter l'Absence, pourvu qu'elle nous remplisse (22) : «Alors il comprend que l’art n’était qu’un moyen d’arriver à cette vérité. Maintenant qu’il la possède, il n’a plus besoin ni désir de créer. Son Eve aura été sa dernière œuvre, et son Moïse lui-même restera inachevé. L’Art est vain a qui a trouvé la Voie» (23).
C'est à notre tour de souhaiter que de nouveaux lecteurs désirent accompagner Antoine Bourgoin en lisant L'Avenue, en empruntant son itinéraire tortueux, parfois onirique et magnifiquement kafkaïen (voir la parabole des ouvriers, pp. 225-228 et tout le chapitre XVI auquel elle appartient), qui ressemble à une espèce de parcours de Croix qui, d'effacement en effacement, nous conduit jusqu'à l'abîme et la transparence d'une araignée morte, desséchée (24), puisque ce «livre est un itinéraire. Itinéraire du connu à l’inconnu. Nous souhaitons au lecteur la démarche patiente et le grain de folie qui lui permettra de suivre Antoine jusqu’au bout» (25), jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la porte d'une révélation silencieuse et humble que les dernières lignes du roman nous laissent deviner,le sculpteur rejoignant peut-être, enfin, sa création la plus achevée devenue inutile comme toutes les autres, alors qu'il sent la présence de quelqu'un (p. 258, terme souligné par des guillemets), s'étirant à l'infini pour ne faire plus qu'un avec cette «ligne ferme, sertissant la terre», qui parcourt le monde et lie entre elles, ordonne mystérieusement ses réalités les plus humbles (cf. pp. 250-1), «terre où les chemins s'entrecroisent de telle sorte que chacun passe par tous les autres» (p. 247), chemin identique «conduisant d'un visage inconnu à un visage plus inconnu encore» (p. 249), du visage de l'inconnue qui donne la main à Antoine Bourgoin en se promenant dans la campagne gabarroise jusqu'à celui, contemplé dans sa mort, d'Irma qui vient de se suicider, femme derrière les femmes (cf. pp. 42-3), source enfantine (26) qui sera peut-être seule capable d'apaiser ce «sentiment de nostalgie irrémédiable qui fait pleurer Diane au bord de ses fontaines» (p. 185).
Notes
(1) «La hantise de Kierkegaard : «Y a-t-il une répétition possible ?» traverse les romans de Gadenne»,
Charles Blanchet, Gadenne ou la passion de la rencontre (Esprit, avril 1963, n°316, repris dans Carnets Gadenne n°11, Agen, 1996), pp. 137-8. C'est, au moins, écrire les choses simplement, au rebours de toutes ces fadaises laborieuses dans lesquelles se complaisent, comme dans un bain de pieds ou de siège, nos modernes universitaires, ces têtes creuses, cœurs secs et bouches gâtées que sont les actuels pseudo-spécialistes de l'écrivain, Bruno Curatolo, Marie-Hélène Gauthier et autres Sophie Balso.
(2) «Éliane était décidément un vocable trop frêle pour franchir l’épaisseur d’une foule apeurée»,
L’Avenue (Gallimard, 1984, réédition du roman paru chez Julliard en 1949), p. 10. Toutes les pages entre parenthèses et sans autres mentions font référence à cette réédition, devenue introuvable. Gadenne poursuit à la même page, évoquant une fois de plus sa femme que nous aurons, comme lui, vite oubliée : «c’était un nom sans vigueur, anodin, un nom qui ne convenait pas du tout d’ailleurs à cette opulente créature».
(3) «[…] ces gens avaient tous dans leur esprit une image d’Antoine Bourgoin, et cette image était pour tous à peu près la même, c’était celle d’un homme dont les pouvoirs excèdent ceux de la commune humanité, d’un homme dont la main n’hésite pas, qui toute sa vie a connu des matins triomphants; et il leur aurait été impossible de supposer que, tel jour en les jours, l’artiste restait planté devant son argile, la tête basse, portant son talent comme une faute, convaincu que chacune des figures présentes autour de lui était là non pour sa gloire mais pour sa confusion» (pp. 17-8).
(4) «[…] mais l’œuvre d’art n’est-elle pas justement celle qui possède la capacité de franchir les frontières des civilisations, de passer d’un sens à un autre et de modifier ses effets suivant l’œil qui en reçoit le contact, sans rien perdre de ses pouvoirs ?» (p. 36).
(5) «Peut-être étaient-elles [ces esplanades] un écho, elles aussi ?» (p. 28).
(6) «Il se trouvait perpétuellement au-delà de ce qu’il avait fait, en deçà de ce qu’il voulait faire – jamais en sécurité», p. 42.
(7) La beauté et la grandeur d'une œuvre ne peuvent que dépendre de l'exigence de celui qui l'a créée, comme Gadenne ne cesse de le répéter, allant même jusqu'à affirmer que c'est seulement en étant parvenu à se dépouiller que le créateur parviendra à façonner une œuvre elle-même parfaitement dépouillée : «Il aurait aimé que l’on pût voir en elle la sœur de ces figures surgies à l’aube des grandes périodes historiques, quand la force qui habitait l’artiste ne s’était pas encore émoussée, quand son outil ne connaissait pas encore les facilités, les douceurs, les énervements. Nous ne pouvons plus revenir à cette fraîcheur […] mais il nous appartient toujours de refuser la complaisance» (p. 125).
(8) Par exemple dans les Carnets contemporains de la rédaction de son roman, où Paul Gadenne écrit : «L’Avenue. Un homme prend conscience de la part d’inconnu ou si voulez de divin qui est dans son art, et cherche à rejoindre directement cet inconnu, – ce divin. Dès lors il découvre que l’art ne lui est plus nécessaire», in La Rue profonde. Carnets Paul Gadenne n°10 (Séquences, 1989), p. 92.
(9) «Ce sont les plans, les proportions qui doivent sourire, non les lèvres… Le sourire de ce qui est parfait, – le seul qui soit permis à l’art» (p. 89), comme si l'art, en somme, ne tirait sa grandeur que d'une aura de significations dont la plus grande efficacité tenait non seulement à sa discrétion, mais à son extrême subtilité, voire à son hermétisme, comme le suggère la description d'une gravure (cf. p. 95) rembrandtienne dans le ton, de laquelle Paul Gadenne ne nous offre aucune interprétation obvie. Nous le verrons, l’œuvre d'art la plus accomplie est celle qui n'est pas, puisque celui qui l'a créée a compris qu'elle n'était, aussi aboutie soit-elle, qu'une étape vers ce qui la dépasse.
(10) «Mais une pensée surgissait ici. Car si un simple trait pouvait nous satisfaire ainsi, pourquoi déranger les vieux mythes ? Pourquoi demander à la beauté son nom, si les contours parlaient d’eux-mêmes, si certains combinaisons de lignes, de volumes, se révélaient capables de nous satisfaire ? Ne suffisait-il pas de faire une volonté, une perfection, de ce qui, dans la nature, était hasard et inachèvement ?» (p. 145).
(11) Chimère, oui, surtout si elle ne sert qu'elle-même, si celui qui utilise le langage ne le fait qu'à l'unique fin de ne se contenter que de cette maigre pitance, sans oser approcher un festin autrement plus abondant : «S’il avait pu arriver à décrire, oui, ne fût-ce que ce mur, mais de façon à le cerner parfaitement avec les mots, à ne rien en laisser échapper, et surtout s’il avait pu aller jusqu’au fond de l’impression qu’il en avait reçue, et jusqu’au fond de ce qui était caché dans ce fond, alors peut-être une porte se fût-elle ouverte devant lui, en effet, et eût-il fait quelque chose pour son salut – et en même temps pour le salut d’autrui» (p. 176). Pourtant, Antoine Bourgoin, qui trahit bien évidemment les préoccupations de Paul Gadenne, ne hait pas l'écriture, mais semble lui porter bien davantage un respect qui est celui des grands écrivains, conscients qu'il leur faut plier à leur propre usage une matière qui existait bien avant qu'il ne s'avise de s'en saisir : «Mais écrire, justement, n’était-ce pas ajouter des signes à des signes ? Il aurait fallu aussi connaître les mots, et ce qui s’y cache. Comment pouvait-on s’exprimer ? Il avait déjà échoué dans cet effort. Comment pouvait-on se servir des mots, ces explosifs, sans les avoir d’abord décapés, désamorcés, sans avoir mis à nu ces racines qui se perdent dans la nuit des temps ?» (p. 177). Dans L'Avenue, c'est sans doute un certain M. Maignon qui est le meilleur exemple, par sa façon même de s'exprimer, de la difficulté inhérente au langage, dont l'usage quotidien, appauvri, masque en effet l'extraordinaire complexité et puissance explosive. Peu importe, finalement, qu'il évoque ce qui est au-delà des mots, la Résidence, car nous le soupçonnons de pouvoir parler d'elle, de la réalité la plus spirituelle, comme il parlerait d'un vulgaire croûton de pain : «De même, dans certaines circonstances de la vie, certaines rencontres, comme dans certaines musiques, je suis persuadé qu’il existe… oui, quelque chose, comme un élément chimique, qui développe notre perception, la rend apte à saisir… hum… eh bien, ce qui s’y trouve, ou plutôt ce qui se trouve… comment dire ? par derrière – oui, une espèce de réactif qui nous aide à découvrir en nous-même une aptitude… que nous sommes étonnés de posséder – car elle ne se révèle qu’en présence de ce qui l’excite – mais qui est suffisante pour créer, entre nous et l’objet qui en a provoqué l’éveil, un lien personnel, et pour nous… comment dire ? pour nous permettre de nous y associer… Eh bien, la Résidence fait partie de ces rencontres» (pp. 160-1). Notre hypothèse est confortée par cette phrase : «Antoine ne croyait plus que M. Maignon traduisait ses mots d’une langue étrangère. Ce qu’il entendait, c’était bien la langue étrangère elle-même, et il n’y avait ni glossaire, ni traducteur» (p. 161).
(12) «Ce qu’il aurait fallu, c’était que son œuvre pût voir le jour, et rester sans nom ; c’était qu’il pût s’effacer derrière elle ; qu’elle témoignât non pour lui, mais pour l’esprit. Et après tout il était temps qu’il se souvînt de ce peu de latin qu’il avait appris si tardivement, et si mal. Les Romains n’appelaient-ils pas les statutes [je rétablis les italiques, probables sinon logiques dans le texte] des simulacres ? Oui, c’était tout l’art, se dit-il, qui est simulacre» (p. 258).
(13) «Tout se passait comme si la matière se trouvait, dans certaines circonstances favorables, transmuée en esprit, ou était capable du moins de livrer passage à l’esprit» (p. 171).
(14) «Il y a des époques dans la vie où toutes les impressions que nous recevons du monde composent une sorte de faisceau convergent, paraissent vouloir se réunir en un point qui échappe à la vue, mais dont il faut supposer l’existence, comme on admet que les parallèles se rejoignent à l’infini» (p. 179).
(15) «Or son Eve était là, irrécusable, plus certaine devant ses yeux que ne peuvent l’être les préceptes de la morale : une figure pure, selon une volonté pure; l’éclat d’une signification qui ne s’exprime pas. Mais voilà jusqu’à quel point une chose pareille, une pareille volonté étaient-elles admissibles, séparées de celui qui les avait produites ?» (p. 206). Et encore : «Mais où avait-il mieux marqué le chemin, plus étroitement et plus désespérément tenté l’approche, que dans cette œuvre qui avait commencé comme un chant de réconciliation et de clarté, dans cette Eve qui avait d’abord grandi comme un poème heureux, et qui s’était vue privée petit à petit de ses plus apparentes séductions, de ses chances les plus certaines, pour devenir cet objet de scandale probable, ce glaive créateur de division ?» (pp. 255-6).
(16) «Le moment est dur à traverser, où l’artiste entrevoit l’abus qu’il constitue, où naît en lui le soupçon de ce qu’il faut peut-être appeler une imposture. Ce soupçon le révolte, le scandalise. Il se demande – en mesurant l’horreur de cette interrogation sur lui-même, et de la rupture dont elle le met en demeure de faire acte – il se demande comment il a osé créer des formes, construire des figures, s’il n’était pas certain de pouvoir appliquer à lui-même le jugement qui visait à légitimer ses meilleures œuvres : ensemble clos, achevé, forme sûre, intègre – incorruptible…» (p. 251).
(17) «A peine lâchée, quelque chose s’était donc passé, – en elle ? en lui ? – qui déjà avait altéré ses relations avec elle. Cette fois, l’alarme retentit au plus profond de lui-même. Car il y avait décidément autre chose dans cet écart que la distance à laquelle un artiste se trouve toujours projeté par rapport à ce qu’il vient de faire» (p. 204).
(18) «[Eve] commençait à se concentrer sur elle-même, à se contracter, comme les astres morts, ou à la manière des objets que l’on dépasse en effet» (p. 212).
(19) «Jusque-là il avait dialogué avec le monde, alignant des statues comme les mots d’un alphabet. Maintenant son interlocuteur avait changé de visage, et il usait, pour s’entretenir avec lui, des pauvres signes du commun. Il avait épuisé dans son œuvre toutes ses capacités d’émotion, et à son tour cette œuvre lui semblait n’avoir été qu’un substitut prêt à se retirer» (p. 211-2).
(20) «Ce feu allumé avant l’aube […], c’était assez pour donner le départ, délier l’esprit engourdi, rouvrir le cycle des gestes millénaires, la porte des mondes effacés» (p. 181).
(21) «Retrouver l’ingénuité de l’art. Foin des données sociologiques. Voir à quoi conduit l’indigeste doctrine de l’homme en situation – cet historicisme de primaire – cette philosophie de batracien», in La Rue profonde. Carnets Paul Gadenne n°10, op. cit., p. 108.
(22) «La quête de Dieu connaît donc la «nuit mystique», le tourment du doute. Cependant elle ne se termine pas sur les images de la nuit : le dépotoir gigantesque, la vision désespérante de la chair pourrie de la baleine, le château vide de toute présence. La hantise de l’absence est surmontée par une attente passionnée, qui est l’acte de foi de Gadenne, et par la recherche d’une pureté absolue, d’un amour totalement désintéressé qui nous paraissent être l’achèvement de cette quête», in Charles Blanchet, Gadenne ou la passion de la rencontre, op. cit., p. 153. Ajoutons que le sens de L'Avenue ne fait aucun doute pour ce commentateur, qui écrit : «Dieu hante les pages de L’Avenue sous un double symbole, la Résidence et le Château» (p. 150).
(23) La Rue profonde. Carnets Paul Gadenne n°10, op. cit., p. 89.
(24) Charles Blanchet encore, qui déclare que : «Le livre est le récit d’un double acharnement vers une pureté radicale, d’un double dépouillement, celui d’Eve, la statue, et celui d’Antoine», in op. cit., p. 156. Gadenne lui-même : «Retrancher tout ce qui est en trop. Mais ce qui est en trop, c’est la sculpture même, c’est l’art», La Rue profonde. Carnets Paul Gadenne n°10, op. cit., p. 104. Un livre sur cet écrivain de race mériterait je crois de porter le titre suivant : Paul Gadenne ou l'effacement. La référence à l'araignée provient de saint Jérôme, et est utilisée par Gadenne à la page 210 du roman.
(25) La Rue profonde. Carnets Paul Gadenne n°10, op. cit., p. 113.
(26) Plusieurs fois l'enfance est nommée dans notre roman, et mériterait sans aucun doute une étude approfondie, les thématiques de la nostalgie et de la pureté, «l'illusion d'un monde sans rupture» (p. 88), donc, pour Gadenne, de l'art et, bien sûr, de l'innocence première, «point où les détails trouvent leur justification, où les divergences sont expliquées» (p. 100), y étant associées (cf. pp. 28, 31, 248).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, paul gadenne, l'avenue, éditions gallimard |  |
|  Imprimer
Imprimer
