Paroles du Christ de Michel Henry (19/01/2015)
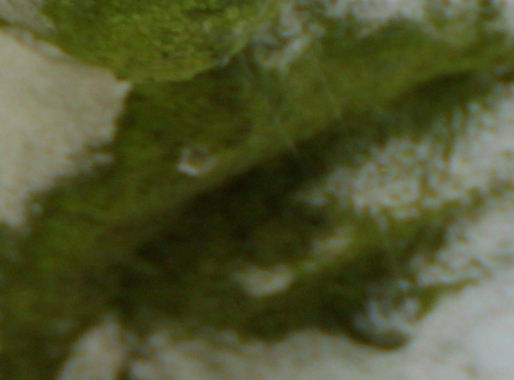
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Études sur le langage vicié.
Études sur le langage vicié. Ce sont quelques lignes de sa conclusion qui nous permettront de saisir l'enjeu vital de ce livre parfait, et d'une clarté éblouissante : «L'incarnation du Verbe en la chair du Christ est cette venue de la Parole de la Vie dans une chair semblable à la nôtre. Dès lors, pour que cette Parole de Dieu soit effectivement reçue par nous, la condition n'est-elle pas que le Christ nous donne sa propre chair qui est celle du Verbe – qu'il se donne à nous dans sa chair, unissant sa chair à la nôtre, de façon qu'il soit en nous et nous en lui – de même qu'il est dans le Père et que le Père est en lui ?» (1).
Ce sont quelques lignes de sa conclusion qui nous permettront de saisir l'enjeu vital de ce livre parfait, et d'une clarté éblouissante : «L'incarnation du Verbe en la chair du Christ est cette venue de la Parole de la Vie dans une chair semblable à la nôtre. Dès lors, pour que cette Parole de Dieu soit effectivement reçue par nous, la condition n'est-elle pas que le Christ nous donne sa propre chair qui est celle du Verbe – qu'il se donne à nous dans sa chair, unissant sa chair à la nôtre, de façon qu'il soit en nous et nous en lui – de même qu'il est dans le Père et que le Père est en lui ?» (1).La réponse à la question de principe que pose Michel Henry, l'un des maîtres de la phénoménologie française, qui se demande, comme l'indique un texte de l'auteur en quatrième de couverture, s'il est «possible à l'homme d'entendre dans le langage qui est le sien une parole qui parlerait dans un autre langage, qui serait celle de Dieu, très exactement de son Verbe», est ainsi donnée par l'incarnation (auquel l'auteur a consacré un grand livre) du Christ, «coup de force» inouï, puisque «l'économie du salut» nous est exposée «en tout clarté» par le fait que la «toute-puissance de la Parole est l'invincible venue en soi de la Vie absolue se révélant à soi en son Verbe», autrement dit, la réalité selon laquelle, parce que «le Verbe s'est incarné en la chair du Christ, l'identification à cette chair est l'identification au Verbe» (p. 155).
 Nous pouvons donc comprendre les paroles que le Christ a adressées aux hommes et tenues sur eux mais, aussi, sur lui-même,sur sa propre nature divine, sur le sens de sa mission, parce que l'homme est incarné, et que le Christ a assumé cette même incarnation, jusqu'à sa plus extrême déréliction. C'est avec le Christ que Dieu a touché la pointe la plus extrême de l'homme, sa propre chair, et ce qui le fait homme et plus qu'homme, sa propre parole.
Nous pouvons donc comprendre les paroles que le Christ a adressées aux hommes et tenues sur eux mais, aussi, sur lui-même,sur sa propre nature divine, sur le sens de sa mission, parce que l'homme est incarné, et que le Christ a assumé cette même incarnation, jusqu'à sa plus extrême déréliction. C'est avec le Christ que Dieu a touché la pointe la plus extrême de l'homme, sa propre chair, et ce qui le fait homme et plus qu'homme, sa propre parole. Croire en un Dieu qui ne s'est pas réfugié, comme un horloger craintif, dans quelque empyrée inatteignable, c'est donc affirmer que les paroles du Christ, aussi stupéfiantes et même, souvent, sidérantes qu'elles soient, violentes parfois, frappantes toujours, ne sont pas essentiellement extraterritoriales à notre condition, pour ainsi dire, puisque, en fait, elles participent à celle-ci et même, l'assument pleinement. Nous comprenons les paroles du Christ, aussi énigmatiques qu'elles puissent nous paraître et, de fait, aussi étranges et énigmatiques qu'elles ont paru à ceux-là même qui les ont entendues ou écoutées, parce qu'elles sont la clé de notre propre vie et, tout simplement, parce qu'elles sont la Vie : «Tout se passe comme si, derrière ce tissu de propositions invraisemblables, une autre Raison était à l’œuvre, un autre Logos qui, pour aller à l'encontre de tout ce que les hommes disent ou pensent d'eux-mêmes, les atteint cependant au cœur de leur être. Comme si cette Parole, loin d'être étrangère à notre réalité véritable, ne lui était pas seulement liée selon une convenance qui nous échappe encore, mais consubstantielle. Il existerait alors une clé pour comprendre l'enseignement énigmatique du Christ. Cette clé ne proviendrait pas de quelque savoir ésotérique, de mythologies archaïques ou de cosmogonies absurdes, elle se tiendrait cachée en nous. Elle seule serait capable de nous introduire à l'intelligence de nous-mêmes» (pp. 33-4).
Si nous comprenons ces paroles, si nous les comprenons au plus intime de nous-mêmes, par une compréhension qui n'est pas seulement celle de l'intelligence, parce que nous ressentons qu'elles ne mentent pas, si nous les comprenons même dans leur caractère foudroyant et énigmatique mis en scène par les paraboles (cf. p. 116), nous pouvons bien évidemment nous en détourner, parce que nous feignons de ne pas les comprendre ou parce que, les ayant au contraire trop bien comprises, ayant parfaitement compris de quoi il en retournait et ce qu'elles nous demandaient, quelle conversion elles exigeaient de nous, nous sommes happés par le bruit qui nous entoure, la mort qui nous entoure, et qui nous éloignent de la vie, de la parole, de notre propre cœur, qui nous divertissent : «C’est l’organisation du monde tout entière en réalité, avec son matérialisme omniprésent, ses idéaux sordides de réussite sociale, d’argent, de pouvoir, de plaisir immédiat, son exhibitionnisme et son voyeurisme, sa dépravation en tout genre, son adoration des nouvelles idoles, des machines infra-humaines, de tout ce qui est moins que l’homme, la réduction de celui-ci à du biologique et, à travers celui-ci, à de l’inerte – c’est tout cela (dont l’enseignement est devenu le reflet tour à tour scandaleux, aveugle ou burlesque), ce tumulte incessant de l’actualité avec ses événements sensationnels et ses bateleurs de foire, qui recouvre à jamais le silence où parle la parole que nous n’entendons plus» (p. 13).
Que nous ne voulons plus entendre, aussi, car les paroles du Christ ne peuvent que nous détourner de tous nos divertissements, sérieux ou grotesque, grotesques et sérieux, parce que ces paroles décomposent tout simplement le monde humain et qu'elles bouleversent notre condition autarcique, monadique, écrira Michel Henry : «C'est parce que la condition humaine est constituée par la relation à Dieu que celle des hommes entre eux ne peut plus obéir à des critères et à des prescriptions humains puisant leur origine dans une prétendue nature humaine qui n'existe plus», et qui même semble fondre à mesure que l'énormité de certaines paroles du Christ, au travers des siècles, ne cesse de nous frapper : «Priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux» (Matthieu, 5,44) (p. 45).
Michel Henry explique ces paroles si difficiles à appliquer, parfois même à comprendre ou simplement à admettre, d'autres encore, où le Christ témoigne par exemple d'une dureté minérale à l'égard de sa propre famille (cf. Marc 3,32-35), en remarquant que l'enseignement du Christ opère comme une puissance d'arrachement au confort quotidien, une brutalité nécessaire qui doit nous extraire du monde, de nos relations avec les autres hommes et femmes, pour nous rappeler que seule importe notre relation à Dieu, que seule importe notre vraie parenté, qui est invisible, que seule importe notre vraie filiation, qui est divine, que seule importe notre vraie paternité, qui nous dépasse infiniment. Nous ne sommes donc maîtres de rien et, d'abord, nous ne sommes pas les maîtres de notre langage, pourtant de plus en plus réduit à quelques basses besognes de désignation purement technique. En effet, tout «homme est fils de Dieu et de lui seul. Et la raison de cette situation «radicale», qui concerne la racine de l'homme, est la suivante : aucun vivant n'ayant le pouvoir de s'apporter lui-même dans la vie, il ne saurait tenir cette vie d'un autre vivant tel que lui, aussi démuni que lui, aussi incapable que lui de se donner la vie à lui-même» (p. 47).
Dès lors, les paroles que le Christ adresse aux hommes «au sujet d'eux-mêmes» renversent «les relations naturelles qu'ils entretiennent spontanément entre eux dans l'injonction qui leur est faite d'aimer leurs ennemis», car c'est bien parce que la condition humaine n'est plus «saisissable dans une généalogie naturelle mais divine que tout ce qui concerne l'homme, ses actions comme ses affections, doit procéder de l'origine dont il dérive, de sa relation à Dieu» (p. 71).
Et Michel Henry de prétendre que ce n'est pas l'écoute des paroles que le Christ nous adresse qui déroute et doit être la cause du scandale, mais, bien au contraire, leur oubli, voire, «comme aujourd'hui, de l'interdit qui [les] frappe». Et d'ajouter : «Tout soubassement sacré étant retiré à la nature humaine comme au monde qui repose sur elle, l'homme se trouve livré à la facticité de la nature matérielle, à un réseau de processus aveugles dépourvus de toute justification intérieure. La réciprocité des relations naturelles n'est plus celle de l'amour, c'est, on l'a vu, celle de la rivalité, de la lutte pour les biens matériels, l'argent, le pouvoir, le prestige – et ainsi le règne de la feinte, de la fourberie, du mensonge, de l'adultère, de l'envie, de la haine, de la violence –, finalement la lutte de tous contre tous tempérée par la formation de clans en dehors desquels l'individu ne peut plus survivre dans la jungle de la modernité. Voilà donc, poursuit Michel Henry, ce qui advient dès que perd son pouvoir la parole paradoxale du Christ d'aimer ceux qui vous font du mal. Elle seule peut empêcher l'engrenage de la vengeance et de la haine» (p. 72) (2).
La critique est violente, et ne craint même pas d'affirmer que c'est l'humanisme tout entier, au sens strict de ce terme qui indique le domaine de l'homme, de l'humain, et qui est le paysage sur le fond duquel les hommes se livrent une lutte mortelle, qui est dangereux et pervers, cet «humanisme où les hommes font du monde et d'eux-mêmes leur propre possession, manipulant toute chose ainsi qu'eux-mêmes selon les multiples possibilités qui s'offrent à eux, dans ce monde et en eux» (p. 79) alors que, au rebours de cette stérilité meurtrière, la «figure du Christ s'auréole d'un pouvoir qu'aucun homme ne détient, celui, en pardonnant le péché, de faire que ce qui est ou a été ne soit plus - dont la face cachée est le pouvoir de faire que ce qui n'est plus, que ce qui est mort soit vivant» (p. 78).
Si la parole du monde, la parole que prononce le monde est immonde et destructrice, ne possède aucun pouvoir autre que celui de nous assécher et de nous souiller, la parole du Christ, elle, est la puissance, est encore, nous dit Michel Henry que je vais citer longuement, la parole de Vie : «Quelqu'un assurément peut dire «je souffre» alors qu'il ne souffre pas, ou encore : «Quel moment merveilleux !» quand il n'éprouve que de l'ennui. Mais c'est la parole du monde qui parle alors, celle qui se rapporte à un référent extérieur à elle, à une souffrance simulée, à un bonheur inexistant», et Michel Henry de poursuivre ainsi : «La souffrance qui intervient ainsi dans la proposition «je souffre» n'est que la «signification-souffrance», une représentation irréelle, un contenu mental visé par la conscience. Cette signification formée par l'esprit n'est qu'une représentation de la souffrance, non celle-ci. En lui-même, ce contenu représentatif ne souffre pas, pas plus que n'aboie le concept de chien» (pp. 96-7, l'auteur souligne). Dès lors, la «parole du monde parle sur la souffrance, elle en parle comme d'une réalité extérieure à elle en effet, différente d'elle, à laquelle elle peut d'ailleurs être totalement indifférente».
Toute autre en revanche est «la parole de la souffrance, qui «ne disserte pas sur la souffrance», qui «ne fait usage d'aucun mot, d'aucun signe sonore ou écrit, d'aucune signification», qui «ne relie pas des significations toutes irréelles par des formations langagières appropriées». En effet, parce que «la souffrance parle dans sa souffrance et par elle, parce qu'elle ne fait qu'un avec ce qu'elle dit, une seule chair souffrante à laquelle elle est livrée sans pouvoir y échapper ni se défaire d'elle, alors en effet la parole de la souffrance ignore la duplicité, c'est en elle-même, dans l'effectivité de sa souffrance, qu'elle témoigne d'elle-même sans recourir à aucun autre témoignage. Elle est vraie absolument, sa parole est une parole de vérité» (p. 97, l'auteur souligne).
La parole de la vie, comme l'appelle Michel Henry, se situe donc à l'opposé de la parole du monde, qui «parle de ce qui est rendu manifeste dans l'indifférence de l'extériorité», alors que l'autre, la parole de la vie qui n'est donc pas l'«objet des sciences du langage», «c'est dans un sentiment, dans ce sentiment dans lequel elle s'éprouve chaque fois, de façon pathétique donc» (p. 98).
En somme, la souffrance dit sa souffrance, et «l'angoisse, son angoisse», car elle «parle d'elle-même, jamais d'autre chose, jamais du monde. Mais d'abord elle ne parle pas dans le monde. Ainsi est-il impossible de l'y entendre», précise Michel Henry, car la «parole de la vie est inaudible», car encore personne «ne l'a jamais entendue à la manière dont on entend un bruit du monde, un son qui résonne en lui», ce qui signifie encore que personne n'a entendu la parole de la vie «avec ses oreilles, en usant du sens de l'ouïe» : qui «a jamais entendu sa souffrance ou sa joie en usant du sens de l'oreille ?».
Ainsi, il serait stupide de penser que cette parole qui n'est pas celle du monde pourrait être mieux entendue dans un cloître ou, pourquoi pas, dans le désert le plus reculé du monde : «Ceux qui entrent dans les couvents pour mieux entendre la parole de Dieu n'espèrent pas l'entendre comme ils entendront le bruit de la fontaine dans la cour du cloître, ou le silence de la cour quand la fontaine se sera tue. Le silence du cloître n'est que l'occasion, en faisant taire les bruits du monde, d'entendre un autre silence, qui n'est pas de la diminution du nombre des décibels ou de leur absence. Ce n'est pas un silence où il n'y a pas de bruit, c'est un silence où il ne peut pas y en avoir, parce que, là où il s'établit, aucun sens n'est à l’œuvre, aucune oreille, et qu'ainsi il n'y a plus aucun son possible. Ce silence pourtant n'est pas celui du mutisme, c'est celui en lequel parle la plénitude sans rupture et sans faille de la vie» (p. 134).
La parole de la vie qui s'oppose à la parole du monde, au contraire de cette dernière, n'a aucun compte à rendre, n'a pas besoin de témoin ni même de fondement, car elle est le fondement, elle est son propre fondement, elle est sa propre «auto-révélation» (p. 133). Ainsi, tandis que la parole du monde bavarde et «enchaîne ses significations sans qu'aucun terme soit assigné à son discours, une autre parole a déjà parlé en nous», qui est «la parole de la vie qui ne cesse de dire à chacun sa propre vie» (p. 128) : «Si l'homme est un vivant généré dans la vie, s'il est son Fils, ne porte-t-il pas nécessairement en lui, outre la capacité de parler des choses du monde qui lui vient de son ouverture à ce dernier, une parole plus ancienne, celle de la vie dans laquelle il est révélé à lui-même et qui ne cesse de faire de lui un vivant ?» (pp. 127-8).
Remarquables sont les pages où Michel Henry analyse le mal, tout entier le surgeon du «système de l'humain», à savoir l'humanisme, «et qui est en vérité un système de l'égoïsme» (p. 122) et, selon une belle expression de l'auteur, «la ronde la réciprocité» (p. 123) de la haine, de l'envie et du mensonge, que la parole du Christ détruit, tout comme il détruit la mauvaise autonomie, le mauvais infini pourrait-on dire, de l'ego replié sur lui-même : «Sourd à la parole de la Vie qui ne cesse de lui parler d'elle en même temps qu'elle lui parle de sa propre vie de tous les jours, sa vie finie», endurci, «rejeté en lui-même, enfermé dans cet ego monadique qui se prend désormais pour l'unique réalité, se plaçant au centre de tout ce qui lui advient», c'est bien de ce «cœur aveugle à la Vérité, sourd à la parole de la Vie, plein de dureté, exclusivement préoccupé de lui-même, se prenant comme point de départ et fin de ses expériences et de ses actions, «que sort le mal» (p. 122). C'est d'un «moi insurmontablement passif vis-à-vis de lui-même, toujours déjà donné à lui-même dans la vie, placé en celle-ci indépendamment de son propre vouloir» et «devenu à ses yeux un Sujet tout-puissant, maître de lui-même, principe en quelque sorte absolu de sa condition de vivant» (pp. 121-2), que naît le mal.
Le mal accompli par Caïn, à tout le moins, possédait une grandeur qui n'est plus celle à laquelle peuvent prétendre nos contemporains, comme le montre l'auteur dans une analyse remarquable du péché du premier meurtrier : «Et comme la révélation à soi de la Vie en chaque Soi vivant habite chacune des modalités de sa vie, de ses joies, de ses blessures, des actes qui en résultent, c'est chacun de ces actes, au moment même où il s'accomplit, qui est connu de Dieu, aussi bien que ses motivations avouables ou non. C'est pourquoi ce Jugement auquel nul n'échappe est implacable. Et la supériorité de Caïn sur les hommes de notre temps, ce qui lui vaudra peut-être la grâce d'un inconcevable pardon, c'est qu'il le savait. Il le savait lorsqu'il détournait son visage de la colère de Dieu. Car il était, lui aussi, un Fils, non d'Adam et d'Eve, mais de la Lumière» (p. 124).
Nous prenant pour notre propre créateur, nous ne pouvons plus commettre qu'un mal non motivé, ignorant de sa propre grandeur et de ce qu'il fait subir à la source de la vie, et nous avons bien de la peine, désormais, à trouver des pécheurs assez endurcis pour, en toute connaissance de cause, haïr viscéralement la lumière : «C'est parce que le Verbe est la révélation sans partage qui illumine le secret des cœurs que les hommes voués au mal haïssent le Verbe» (p. 125). Nous savons que les Évangiles ne cessent d'insister sur la haine que les hommes témoignent au Verbe, Michel Henry parlant même d'un «thème lancinant» qui lui permet de distinguer le mal du péché, toujours à propos de Caïn, car, une fois de plus, il ne saurait pour nous être question de péché, puisque nous n'avons plus conscience de Dieu : «C’est donc lorsqu’il entre dans la lumière de la Vérité que le mal devient le péché. Dans le péché, le mal se dédouble en quelque sorte. Loin de se reconnaître comme le mal sous l'éclat de cette lumière dévastatrice, c'est à cette dernière que le mal s'en prend. Ce qui advient dans le scandale. Le scandale qui renverse l'accusation, ne laissant plus cette lumière implacable le démasquer, mais poussant le mal à sa limite, au péché suprême, qui n'est plus le simple mal, mais la dénonciation de la Lumière, la négation de Dieu. Telle une braise qui ne s’éteint jamais, la Lumière continue de brûler le cœur de Caïn. Dans son rayonnement incandescent, ce n’est plus seulement un moi qui se consume, c’est elle qui flamboie dans la splendeur de sa Parousie intemporelle» (p. 126).
C'est donc par sa capacité d'écoute intérieure que Michel Henry définit essentiellement l'homme, l'analyse phénoménologique de l'auteur pouvant à ce titre être comprise comme une espèce de lecture en arrière, une analyse de ce qui précède notre vie forcément limitée, qui n'existerait même pas si ne la fondait le mouvement d'auto-donation de la Vie. Non pas une écoute de la parole du monde nous l'avons vu, mais une écoute de la Parole de la Vie, que nulle oreille ne peut entendre : «Si l’homme est un vivant généré dans la vie, s’il est don Fils, ne porte-t-il pas nécessairement en lui, outre la capacité de parler des choses du monde qui lui vient de son ouverture à ce dernier, une parole plus ancienne, celle de la vie dans laquelle il est révélé à lui-même et qui ne cesse de faire de lui un vivant ?» (pp. 127-8).
Cette écoute signifie assez que nous ne sommes pas les maîtres du monde, et encore moins de notre propre vie. Celui qui écoute se place en effet dans la position de pouvoir recevoir, d'éprouver de la joie à recevoir ce qui ne vient pas, ne peut pas venir de lui. En fait, Michel Henry caractérise les hommes, et donc leur parole, par leur «impuissance native», qui «se laisse reconnaître en chacun de [leurs] pouvoirs, dont aucun ne s'est donné à lui-même le pouvoir de s'exercer» (p. 135).
La parole du Christ, au contraire, elle, se manifeste essentiellement, dans son essence, par la puissance, comme lors de l'épisode où le fonctionnaire royal, à Capharnaüm, supplie le Christ de venir guérir son fils mourant. Jésus lui répond : «Va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite» (Jean, 4,46-53), comme si le pouvoir, pourtant inconcevable, de la parole christique n'était rien si, au préalable, celui qui la reçoit n'avait décidé, non seulement de l'accepter, mais de croire en sa puissance, pourtant bien réelle. Car, non seulement notre vie est finie, donc «dépourvue de se donner à soi-même la vie», mais c'est notre parole qui l'est tout autant, puisqu'elle est «incapable de conférer la réalité à ce dont elle parle». Ainsi, celui qui peut affirmer qu'il est, qu'il existe et qu'il vit, «ce n'est pas lui qui s'est apporté lui-même dans la condition merveilleuse d'être vivant. Bien au contraire fallait-il qu'il soit déjà dans la vie pour être en mesure de formuler à son sujet toute proposition du genre de celles que nous avons citées. Aussi faut-il reconnaître que la parole de la vie, dans la mesure où il s'agit d'une vie comme la nôtre, demeure marquée de la même impuissance vis-à-vis d'elle-même que la parole du monde vis-à-vis des choses» (p. 136, l'auteur souligne).
Contre la folle volonté des temps modernes, leur légitimité dirait Hans Blumemberg, à vouloir fonder le sujet dans sa plus radicale et meurtrière autonomie, Michel Henry nous rappelle que nul homme ne saurait être une île, donc, un barbare, un homme sans père et sans fils, livré à la fausse parole et à la rhétorique (3).
Notes
(1) Michel Henry, Paroles du Christ (Seuil, 2002), p. 154.
(2) Nous retrouvons, dans ces pages et d'autres encore, où Michel Henry stigmatise la vacuité contemporaine, l'analyse de La Barbarie (PUF, 2001, p. 244) qui écrivait : «Les media de l’ère technicienne présentent des caractères assez différents. Leur contenu, c’est l’Insignifiant, l’actualité – ce qui n’aura plus le moindre intérêt demain et dont il y a fort à penser qu’il n’en a pas davantage lors même qu’il constitue l’Événement. Le medium, c’est l’image télévisée, non point le permanent à quoi il faut faire retour afin de s’accroître de soi, mais ce qui s’effondre sans cesse dans un néant qu’il n’aurait jamais dû quitter».
(3) «[…] le pouvoir intellectuel et spirituel traditionnellement assumé par ceux qui, accomplissant en eux le grand mouvement d’auto-accroissement de la vie, se donnaient pour tâche de le transmettre à d’autres en une répétition possible – ce pouvoir a été arraché aux clercs et aux intellectuels par de nouveaux maîtres qui sont les serviteurs aveugles de l’univers de la technique et des médias – par les journalistes et par les hommes politiques» (cf. op. cit., p. 237).
Lien permanent | Tags : philosophie, phénoménologie, religion, christianisme, michel henry, paroles du christ, éditions du seuil |  |
|  Imprimer
Imprimer