Avant la fin d'Ernesto Sábato (27/10/2015)
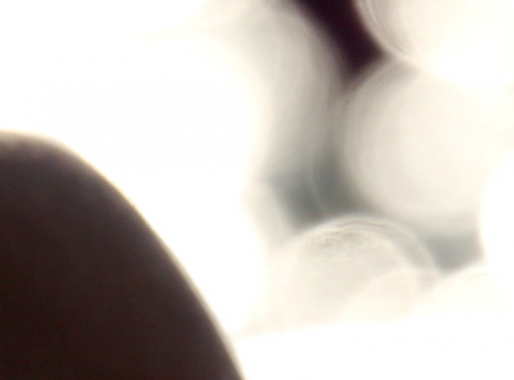
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Ernesto Sábato dans la Zone.
Ernesto Sábato dans la Zone. Avant la fin est le très beau titre des Mémoires d'Ernesto Sábato, dans lesquelles il ne fait pas mentir sa sombre réputation de pessimiste, d'écrivain hanté par des cauchemars auxquels il a en partie donné forme dans sa trilogie romanesque et qui a préféré délaisser une carrière scientifique somme toute confortable, pour s'enfoncer dans les territoires non balisés de la souffrance, du Mal, du désespoir. C'est parce que, comme peu de romanciers sinon Dostoïevski «avec par exemple son transcendantal souterrain» (p. 119), il n'a pas hésité à se lancer dans l'exploration de ces terres, qu'il a le droit d'affirmer qu'il n'a jamais voulu s'écarter de l'unique chemin qui importe, celui qui consiste à chercher la vérité. C'est ce qu'il écrit, non sans lyrisme, dans le premier chapitre de son ouvrage, intitulé Premières années et grandes décisions : «À l’orée des pénombres que j’entrevois, plongé dans l’abattement et le malheur, comme l’un de ces vieillards d’une tribu qui, se réchauffant près des braises, remémorent leurs antiques mythes et légendes, je me dispose à raconter quelques épisodes, entremêlés, diffus […] d’une vie remplie d’erreurs, désordonnée, chaotique, mais vouée à la recherche désespérée de la vérité» (1). L'écrivain prend d'ailleurs le soin de préciser que ses «vérités les plus atroces», elles, il les a évoquées dans ses romans, «dans ces sinistres bals costumés où les personnages, à l'abri de leur masque, disent ou révèlent des vérités qu'ils n'oseraient pas avouer à visage découvert» (pp. 11-2), remarque qui nous fait immédiatement comprendre que Sábato, même s'il se révélera être sans pitié pour ses propres erreurs et fautes, ne va pas s'adonner à un de ces exercices de confessions quotidiennes, ineptes et rances dont sont si friands nos pleurnichards Narcisse.
Avant la fin est le très beau titre des Mémoires d'Ernesto Sábato, dans lesquelles il ne fait pas mentir sa sombre réputation de pessimiste, d'écrivain hanté par des cauchemars auxquels il a en partie donné forme dans sa trilogie romanesque et qui a préféré délaisser une carrière scientifique somme toute confortable, pour s'enfoncer dans les territoires non balisés de la souffrance, du Mal, du désespoir. C'est parce que, comme peu de romanciers sinon Dostoïevski «avec par exemple son transcendantal souterrain» (p. 119), il n'a pas hésité à se lancer dans l'exploration de ces terres, qu'il a le droit d'affirmer qu'il n'a jamais voulu s'écarter de l'unique chemin qui importe, celui qui consiste à chercher la vérité. C'est ce qu'il écrit, non sans lyrisme, dans le premier chapitre de son ouvrage, intitulé Premières années et grandes décisions : «À l’orée des pénombres que j’entrevois, plongé dans l’abattement et le malheur, comme l’un de ces vieillards d’une tribu qui, se réchauffant près des braises, remémorent leurs antiques mythes et légendes, je me dispose à raconter quelques épisodes, entremêlés, diffus […] d’une vie remplie d’erreurs, désordonnée, chaotique, mais vouée à la recherche désespérée de la vérité» (1). L'écrivain prend d'ailleurs le soin de préciser que ses «vérités les plus atroces», elles, il les a évoquées dans ses romans, «dans ces sinistres bals costumés où les personnages, à l'abri de leur masque, disent ou révèlent des vérités qu'ils n'oseraient pas avouer à visage découvert» (pp. 11-2), remarque qui nous fait immédiatement comprendre que Sábato, même s'il se révélera être sans pitié pour ses propres erreurs et fautes, ne va pas s'adonner à un de ces exercices de confessions quotidiennes, ineptes et rances dont sont si friands nos pleurnichards Narcisse.Sa position est donc éminemment morale, jamais moralisatrice : il se donne en exemple, s'expose à la corne de taureau (2), non sans nous faire part de ses propres doutes, sur Dieu auquel il veut parfois croire (cf. p. 52) (3), surtout lorsqu'un geste d'un héroïsme absolu seul capable de racheter l'humanité nous en fait deviner la présence (cf. p. 53), auquel il refuse de croire lorsqu'il est dévoré par la souffrance et la douleur, consécutive à la mort de son fils, Jorge (cf. p. 174), mais aussi sur le sens de la vie, le futur, terrifiant selon lui, qui approche, qui en fait est déjà là, sous nos yeux, et sa position est celle d'un homme qui semble s'adresser, d'abord, aux plus jeunes, héros anonymes et même, parfois, saints, ou alors tout bonnement jeunes crétins mais qui sont au moins animés d'un rêve de lendemains qui chantent, rêve devenant cauchemar, y compris communiste (cf. p. 68), pourvu que l'espoir d'une transformation politique radicale, apportant de meilleures conditions de vie à l'humanité, guide la jeunesse.
 C'est pour ces jeunes idéalistes que Sábato a accepté d'écrire un tel livre, parfois un peu trop didactique mais, après tout, ne clame-t-il pas son admiration pour les vertus de l'éducation, «ce qu'il y a de moins matériel, mais de plus décisif dans l'avenir d'un peuple» (p. 131) ? : «La dure réalité est une désolante confusion de magnifiques idéaux et de réalisations maladroites, mais il y aura toujours quelques obstinés, héros, saints et artistes, qui, dans leur vie et dans leurs œuvres, réussiront à capter des lambeaux d’Absolu, lesquels nous aident à supporter les répugnantes réalités» (p. 38).
C'est pour ces jeunes idéalistes que Sábato a accepté d'écrire un tel livre, parfois un peu trop didactique mais, après tout, ne clame-t-il pas son admiration pour les vertus de l'éducation, «ce qu'il y a de moins matériel, mais de plus décisif dans l'avenir d'un peuple» (p. 131) ? : «La dure réalité est une désolante confusion de magnifiques idéaux et de réalisations maladroites, mais il y aura toujours quelques obstinés, héros, saints et artistes, qui, dans leur vie et dans leurs œuvres, réussiront à capter des lambeaux d’Absolu, lesquels nous aident à supporter les répugnantes réalités» (p. 38).Ce qui intéresse d'abord le romancier est ce qui peut sauver l'homme des lendemains terrifiants qui s'annoncent («Cette fin de siècle nous trouve plongés dans l’obscurité, et l’évanescente clarté qui persiste encore ne fait qu’accentuer les ombres qui nous cernent. Naufragé dans les ténèbres, l’homme avance vers le prochain millénaire avec l’appréhension de qui devine un abîme devant lui», p. 117), mais aussi ce qui peut le sortir du froid matérialisme, qu'il s'agisse d'une pratique scientifique sclérosée ou du carcan économique absurde esclavagiste qui plonge les plus fragiles dans la misère (4), voire de la réification de la langue (cf. p. 45) ravalée à la technique (cf. p. 121). Il nous faut un rêve, il nous faut des héros ou, plus simplement encore, des hommes dignes de ce nom, et ce n'est sans doute pas un hasard si Saint-Exupéry est cité, de même que Camus, et ce dernier à plusieurs reprises : «Oui, mon cher frère, tu faisais partie de ces hommes de l’envergure de Saint-Exupéry, qui luttait dans son avion contre la tempête, avec son radio, tous deux unis dans le silence par le péril commun mais aussi par l’espérance. Ces hommes qui ont élevé leur autel au milieu de la crasse du monde, avec la force de leur camaraderie devant l’échec et la mort» (p. 47).
Dès lors, la littérature ne saurait elle aussi devenir systématique, systématiquement vendue avec une régularité de prostituée offrant ses charmes au consommateur, selon le putanat de la rentée dite littéraire. Elle doit engager tout l'être, et d'abord l'être de celui qui l'écrit. Elle doit être un oracle mais aussi une introspection dans le monde des ténèbres : «Un roman profond surgit quand notre existence affronte des situations limites, douloureuses croisées des chemins où nous sentons la présence inéluctable de la mort. Dans un tremblement existentiel, l’œuvre est notre tentative, jamais tout à fait réussie, de reconquérir l’unité ineffable de la vie» (pp. 89-90).
La littérature, comme l'art en règle générale, est, ne peut qu'être intimement lié avec la chair, le monde des humeurs, des ténèbres, de la souffrance, sauf peut-être lorsqu'elle est confrontée à la mort du propre enfant de celui qui écrit, du Mal, avant que de prétendre s'en extraire et s'en abstraire. Contre les refuges commodes dans les tours d'ivoire de l'abstraction desséchante, l'auteur prône un retour à une littérature difficile, exigeante (5), à des années-lumière des productions des «individus claustrés dans une sacristie» (p. 105), existentielle, au sens le plus profond de ce terme (6), Camus, Kierkegaard, Dostoïevski, d'autres encore comme Rimbaud, Artaud et Nietzsche, Van Gogh ou même Cioran (cf. p. 159), qui tous ont payé de leur sang pour écrire, peindre, témoigner (7), même si nous nous étonnons de ne point trouver mentionné Georges Bernanos dans cette liste de douloureux élus : «La véritable patrie de l’homme n’est pas l’univers pur qui fascinait Platon. Sa véritable patrie, à laquelle il revient toujours après ses détours dans l’idéal, c’est cette région intermédiaire et terrestre de l’âme, ce territoire de déchirements où nous vivons, aimons et souffrons. Et dans une époque de désespérance totale, l’art seul peut exprimer l’angoisse et la désespérance de l’homme, parce que, à la différence de toutes les autres activités de la pensée, c’est la seule qui capte la totalité de son esprit, et tout spécialement les grands romans qui réussissent à pénétrer jusqu’au domaine sacré de la poésie. La création est ce début de sens que nous avons conquis de haute lutte contre l’immensité du chaos» (p. 90).
L'auteur ne se lasse pas de répéter qu'il ne peut qu'admirer ceux «dont l'engagement dans la lutte va de pair avec le souci d'une spiritualité profonde; et qui, dans leur quête désespérée du sens, ont créé des œuvres dont la nudité et le déchirement sont ce [qu'il a] toujours imaginé comme unique moyen d'exprimer la vérité» (p. 106), et qu'il se tient aussi éloigné que possible, ce qui après tout n'est que logique avec ses dires, des universitaires et des esprits à système, car il appartient «à cette catégorie d'hommes qui se sont formés en se cognant à la vie» (pp. 108-9), car il «est à un géographe» ce qu'est «un explorateur, un aventurier dont l'intuition lui suggère de rechercher au fin fond de la forêt primitive un trésor dont il n'a que des échos ambigus, sans même être sûr de son existence» (p. 109).
Finalement, je crois que Sábato demande à la grande littérature, qui ne peut être très éloignée d'une forme de désolante lucidité et même de pauvreté radicale, de tenter de combler la rupture très ancienne qui a eu lieu entre «la pensée magique et la pensée logique», à partir de laquelle «l'homme s'est retrouvé exilé de son unité primitive», par laquelle «fut brisée à jamais l'harmonie entre l'homme et lui-même, et entre l'homme et le cosmos» (p. 140). Oui, «que nous sommes loin, Hölderlin, du temps où les hommes se sentaient fils et filles de leurs dieux !» (p. 151), puisque nous voici tombés «en des temps où l'homme et son pouvoir ne paraissent capables que de récidiver dans le mal» (p. 154), qui sont aussi les temps de la faillite de l'humanisme occidental (p. 161), un monde cassé (Sábato cite l'expression de Gabriel Marcel) fait «de tunnels et de corridors, d'impasses et de carrefours» (p. 164).
Ainsi, si la «plus grande noblesse des hommes est d’édifier leur œuvre au milieu de la dévastation, en y travaillant sans relâche, à mi-chemin entre le déchirement et la beauté» (p. 202) et si «en ces temps de triomphalisme frelaté, la vraie résistance est celle qui combat pour des valeurs considérées comme perdues» (p. 213), le grand écrivain et, pour le dire en un mot qui hérissera le poil des imbéciles, le véritable écrivain est celui qui, toujours, se rangera du côté des déshérités, sel de la terre et peut-être, qui sait, pour reprendre un terme prophétique mystérieux, reste de l'humanité concrète, de chair et de sang et non de chiffres, perdue et sauvée : «Quand le mode hyperdéveloppé s’effondrera, avec tous ses sidéranthropes et sa technologie, c’est sur les terres de l’exil qu’on retrouvera l’homme de l’unité perdue et rédimée» (p. 217).
Notes
(1) Avant la fin. Mémoires (Antes del fin, 1998, traduction de Michel Bibard, Seuil, 2000), pp. 21-2. Les pages entre parenthèses renvoient à cette édition.
(2) «Je n’ai jamais été un lecteur d’œuvres complètes et je ne me suis jamais laissé guider par aucune sorte de système. Au contraire, au milieu de chacune de mes crises j’ai changé d’orientation, mais je me suis toujours comporté devant les œuvres suprêmes comme si j’avançais dans un texte sacré ; comme si à chaque rencontre m’étaient révélées les étapes d’un voyage initiatique. Les cicatrices qu’elles ont laissées dans mon âme attestent qu’il s’est bien agi de quelque chose de tel. La lecture m’a accompagné jusqu’à ce jour, en transformant ma vie grâce à ces vérités dont seul le grand art peut nous enrichir»
(pp. 50-1). Ailleurs, dans une véritable profession de foi que nous pourrions qualifier, par son intransigeance et sa valeur, de bernanosienne, Sábato, qui hésite à appeler son livre «témoignage», «épilogue ou testament spirituel» (p. 199), affirme que l'écrivain «doit être le témoin incorruptible de son temps, avec assez de courage pour dire la vérité, et pour s'élever contre toute doctrine officielle qui, aveuglée par ses propres intérêts, perd de vue le caractère sacré de la personne humaine. Il doit être prêt à assumer ce que l'étymologie du mot témoin, «martyr» en grec, lui promet : le martyrologe. Le chemin qui l'attend est difficile : les puissants le qualifieront de communiste parce qu'il réclame la justice pour les faibles et les affamés; les communistes le taxeront de réactionnaire parce qu'il exige la liberté et le respect de la personne. Il vivra cette dualité dans la douleur et le déchirement, mais il devra tenir coûte que coûte» (p. 71).
(3) Dans ce passage, l'auteur légitime a posteriori les théories manichéistes exposées dans L'Ange des ténèbres : «Où est Dieu ? Quelle réponse as-tu donné à ton Fils, quand il t’a crié cette phrase tragique ? Est-ce que cela n’autorise pas une sorte de manichéisme ? […] Et si le combat est infini, et si Dieu n’est pas assez puissant pour venir à bout de son Adversaire, et si, comme beaucoup le disent, le Démon l’a déjà vaincu et le tient dans ses chaînes, ou alors, ce qui serait encore plus pervers, s’il règne désormais sur le monde et fait croire aux naïfs qu’il est Dieu pour le déconsidérer — quelle horreur ! —, quel sens aurait alors la vie ?» (p. 200).
(4) «Tout tend à prouver qu’au sein des Temps modernes, exaltés avec tant d’enthousiasme, était en gestation un monstre à trois têtes : le rationalisme, le matérialisme et l’individualisme. Et cette créature que nous avons aidé à engendrer, et avec quel orgueil, a commencé à se dévorer elle-même.
Aujourd’hui, nous ne subissons pas seulement la crise du système capitaliste, mais celle de toute une conception du monde et de la vie, fondée sur la déification de la technique et l’exploitation de l’homme» (pp. 120-1).
(5) Et exigeante d'abord avec soi-même, puisque nous apprenons que «nouvelles, essais et pièces de théâtre se sont consumés» sous les yeux de l'auteur «dans les flammes auxquelles était également destiné Héros et Tombes» (p. 103).
(6) Et Dieu lui-même ne saurait être envisagé que comme «une personne qui [le] sauverait, qui [le] prendrait par la main tel un enfant accablé de chagrin» et non «comme une affirmation ou une négation» (p. 185). Ailleurs, Sábato affirme que Dieu lui est montré par un petit garçon, «dans son humilité de cireur de chaussures» «qui dans la ville de Salta s'est approché» de lui pour l'embrasser «avec une grande émotion» (p. 199).
(7) «Oui, la race d’artistes que j’ai toujours admirée, c’est [ceux] dont l’engagement dans la lutte va de pair avec le souci d’une spiritualité profonde; et qui, dans leur quête désespérée du sens, ont créé des œuvres dont la nudité et le déchirement sont ce que j’ai toujours imaginé comme uniques moyens d’exprimer la vérité» (p. 106).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, avant la fin, ernesto sábato, éditions du seuil |  |
|  Imprimer
Imprimer