2666 de Roberto Bolaño au théâtre Goodman de Chicago, par Gregory Mion (24/02/2016)

Photographie (détail) de Liz Lauren.

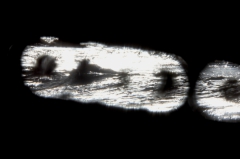 2666 dans la Zone.
2666 dans la Zone.Les photographies illustrant le corps du texte de Gregory Mion sont dues à Dominique Thomas et, pour la production, à Liz Lauren [ndJA].
Des remerciements doivent être formulés à Juan Asensio, qui rend possible un tel travail, et à Dominique Thomas, qui m’a accompagné dans la folie de Bolaño et qui m’a donné envie d’approfondir ma lecture. Je voudrais aussi remercier Robert Falls et Seth Bockley, les metteurs en scène de cette fabuleuse pièce de théâtre, qui m’ont très gentiment fait parvenir leur script dès mon retour en France.
Le défi de mettre en scène un roman multiforme et intarissable
 Deux moments aussi savoureux que romanesques sont à l’origine de l’adaptation théâtrale du mythique 2666 de Roberto Bolaño au théâtre Goodman de Chicago. Le premier concerne Robert Falls, directeur artistique du théâtre Goodman depuis trente ans, grand manitou de la scène dans l’état de l’Illinois, par ailleurs plusieurs fois remarqué à Broadway et tout récemment intronisé au Theatre Hall of Fame des États-Unis, une institution new-yorkaise à but non lucratif qui met en valeur des personnalités ayant consacré leur vie au théâtre et l’ayant irrigué de leur talent. En déplacement à Barcelone en 2006 pour assister à un festival de théâtre, R. Falls, lors d’une déambulation, est intrigué par des affiches géantes où se dressent dans un paysage désertique des croix funéraires peintes en rose. Sur les affiches se profile une balafre étrange et numérale en guise d’intitulé ou de légende, le nombre 2666 posé là comme une ambiguïté, comme une cicatrice qui viendrait appesantir l’ambiance déjà sinistre de la photographie. Il s’agissait alors d’une campagne de promotion de l’œuvre maîtresse de Bolaño, qui devait du reste débarquer pour la première fois sur les planches du théâtre Lliure de Barcelone en 2007. Ainsi subjugué par l’affiche, R. Falls en apprendra vite les raisons profondes, et aussitôt il comprend qu’un écrivain majeur a produit un roman du même ordre et qu’il y a dans ce livre un véritable potentiel scénique. Il aura fallu ensuite une décennie de pensée, d’intuition et de travail pour que la source de cet envoûtement préliminaire se transforme en spectacle de scène, dans une salle intimiste au 170 North Dearborn Street à Chicago, adresse où le théâtre Goodman se tient debout depuis 1925 et fait office de place forte des arts non seulement dans la ville, mais aussi à travers tous les États-Unis où sa réputation se renouvelle fréquemment grâce à son esprit d’initiative et sa constante volonté d’étendre les possibilités de la mise en scène. Que l’adaptation américaine de 2666 prenne donc ses quartiers au Goodman entre le 6 février et le 20 mars 2016 n’est en rien une surprise pour les connaisseurs, quoique ces derniers ne manqueront pas d’être époustouflés par la performance qui s’y joue (1). Il était nécessaire que cette œuvre spirituellement gargantuesque et formellement monumentale fût placée entre des mains tout à la fois bienveillantes et exploratrices, de sorte à pouvoir en extraire des aspects inédits, des angles morts, en somme une autre manière de la pratiquer sans pour autant la dénaturer évidemment.
Deux moments aussi savoureux que romanesques sont à l’origine de l’adaptation théâtrale du mythique 2666 de Roberto Bolaño au théâtre Goodman de Chicago. Le premier concerne Robert Falls, directeur artistique du théâtre Goodman depuis trente ans, grand manitou de la scène dans l’état de l’Illinois, par ailleurs plusieurs fois remarqué à Broadway et tout récemment intronisé au Theatre Hall of Fame des États-Unis, une institution new-yorkaise à but non lucratif qui met en valeur des personnalités ayant consacré leur vie au théâtre et l’ayant irrigué de leur talent. En déplacement à Barcelone en 2006 pour assister à un festival de théâtre, R. Falls, lors d’une déambulation, est intrigué par des affiches géantes où se dressent dans un paysage désertique des croix funéraires peintes en rose. Sur les affiches se profile une balafre étrange et numérale en guise d’intitulé ou de légende, le nombre 2666 posé là comme une ambiguïté, comme une cicatrice qui viendrait appesantir l’ambiance déjà sinistre de la photographie. Il s’agissait alors d’une campagne de promotion de l’œuvre maîtresse de Bolaño, qui devait du reste débarquer pour la première fois sur les planches du théâtre Lliure de Barcelone en 2007. Ainsi subjugué par l’affiche, R. Falls en apprendra vite les raisons profondes, et aussitôt il comprend qu’un écrivain majeur a produit un roman du même ordre et qu’il y a dans ce livre un véritable potentiel scénique. Il aura fallu ensuite une décennie de pensée, d’intuition et de travail pour que la source de cet envoûtement préliminaire se transforme en spectacle de scène, dans une salle intimiste au 170 North Dearborn Street à Chicago, adresse où le théâtre Goodman se tient debout depuis 1925 et fait office de place forte des arts non seulement dans la ville, mais aussi à travers tous les États-Unis où sa réputation se renouvelle fréquemment grâce à son esprit d’initiative et sa constante volonté d’étendre les possibilités de la mise en scène. Que l’adaptation américaine de 2666 prenne donc ses quartiers au Goodman entre le 6 février et le 20 mars 2016 n’est en rien une surprise pour les connaisseurs, quoique ces derniers ne manqueront pas d’être époustouflés par la performance qui s’y joue (1). Il était nécessaire que cette œuvre spirituellement gargantuesque et formellement monumentale fût placée entre des mains tout à la fois bienveillantes et exploratrices, de sorte à pouvoir en extraire des aspects inédits, des angles morts, en somme une autre manière de la pratiquer sans pour autant la dénaturer évidemment.Le second moment est incarné par un coup de chance dont a bénéficié un certain Roy Cockrum. Vainqueur en 2014 de la célèbre loterie du Powerball, R. Cockrum, qui fut pendant vingt ans acteur et régisseur de théâtre, décide de contribuer massivement à l’expansion des arts, sachant ô combien nos sociétés contemporaines sont réticentes à financer des projets économiquement improductifs. Dans la foulée de son gain, ce natif de Knoxville, Tennessee, inaugure The Roy Cockrum Foundation, et il devient alors un généreux donateur du théâtre Goodman, ce qui permet de bâtir une équipe sur le long terme et de concrétiser l’adaptation tant fantasmée de 2666. De plus, en choisissant le théâtre Goodman, R. Cockrum apporte son aide précieuse à un établissement qui défend la démocratisation de l’art. Situé en plein cœur du très renommé quartier du Loop au centre-ville de Chicago, le théâtre Goodman applique en effet une politique tarifaire admirable, tordant le cou à ce cliché qui voudrait que l’art soit réservé à ceux qui jouissent de nombreux privilèges sociaux. Si Max Horkheimer et Theodor Adorno ont soutenu la thèse des privilégiés dans leur Dialectique de la raison (2), prenant l’exemple d’Ulysse qui se paie le luxe d’écouter le chant enivrant des sirènes pendant que ses camarades moins prestigieux rament avec les oreilles bouchées par de la cire (tel un seigneur moderne qui se rendrait à un concert divin en ayant rusé les plus faibles afin qu’ils lui financent la meilleure place), on pourrait dire en contrepartie que le théâtre Goodman est un endroit où même les compagnons d’Ulysse sont cordialement invités à venir profiter de ce qui ne paraît d’abord convenir qu’aux maîtres ou aux héros. Il eût été dommage, en outre, de faire de 2666 un espace restreint à quelques bourses fortunées dans la mesure déjà où Bolaño lui-même n’était pas un bourgeois, et dans la mesure encore où le roman est traversé d’un souffle universel eu égard au problème qu’il pose : d’où vient le Mal et peut-on envisager de le questionner artistiquement ?
 L’amplitude du roman est d’ailleurs telle que la question générale du Mal est introduite par une énorme quantité de contextes et de thèmes précis. Le Mal ne se limite pas à une présence impalpable et métaphysique qui agirait comme une force négative de l’humanité. Bolaño ne se contente pas de figurer une transcendance contraignante et infernale qui se nourrirait de la faiblesse des hommes. La réalité objective d’une omniprésence luciférienne est certes justifiée par le titre du roman, mais elle n’emporte pas avec elle la totalité du propos. Ce sont d’abord les hommes qui font le Mal et non pas des voix et des entités d’outre-monde qui les pousseraient sur des chemins de malveillance. En d’autres termes, le Mal de 2666 serait moins la dénonciation d’un Dieu qui n’aurait plus d’autorité sur ses créatures et qui choisirait de les punir par l’intermédiaire du Diable, que la preuve d’une malfaisance intrinsèquement liée à l’homme. Dans cette perspective le Mal ne se conçoit plus comme une transgression de Dieu et de ses visées, mais plutôt comme une régression typiquement humaine où toute responsabilité nous appartient. Il n’est guère étonnant de ce point de vue que la Shoah occupe une place centrale dans 2666. Tel que l’a souligné avec pertinence le philosophe Didier Durmarque dans sa Philosophie de la Shoah (3), ce serait une erreur de concevoir le nazisme à l’instar d’un accident de l’Histoire (donc comme la signature hypothétique d’un événement imprévisible qui pourrait avoir surgi d’un décret occulte), parce que tout ce qui découle du génocide perpétré par l’Allemagne hitlérienne provient d’une apothéose de la raison humaine, d’un calcul terrestre duquel est exclu toute forme de délicatesse ou de spiritualité, de la mise en place attentive et scrupuleuse d’une méthode exterminatrice dont les tenants et les aboutissants ne font que révéler, in fine, les principes moteurs de la modernité, c’est-à-dire, au premier chef, le triomphe de la rationalité économique où l’individu perd son humanité faute de ne plus pouvoir être autre chose qu’un moyen au service d’une fin. Ainsi Dieu, s’il existait, aurait-il pu vouloir que les camps de la Solution Finale viennent défigurer le monde créé de sa main souverainement bonne ?
L’amplitude du roman est d’ailleurs telle que la question générale du Mal est introduite par une énorme quantité de contextes et de thèmes précis. Le Mal ne se limite pas à une présence impalpable et métaphysique qui agirait comme une force négative de l’humanité. Bolaño ne se contente pas de figurer une transcendance contraignante et infernale qui se nourrirait de la faiblesse des hommes. La réalité objective d’une omniprésence luciférienne est certes justifiée par le titre du roman, mais elle n’emporte pas avec elle la totalité du propos. Ce sont d’abord les hommes qui font le Mal et non pas des voix et des entités d’outre-monde qui les pousseraient sur des chemins de malveillance. En d’autres termes, le Mal de 2666 serait moins la dénonciation d’un Dieu qui n’aurait plus d’autorité sur ses créatures et qui choisirait de les punir par l’intermédiaire du Diable, que la preuve d’une malfaisance intrinsèquement liée à l’homme. Dans cette perspective le Mal ne se conçoit plus comme une transgression de Dieu et de ses visées, mais plutôt comme une régression typiquement humaine où toute responsabilité nous appartient. Il n’est guère étonnant de ce point de vue que la Shoah occupe une place centrale dans 2666. Tel que l’a souligné avec pertinence le philosophe Didier Durmarque dans sa Philosophie de la Shoah (3), ce serait une erreur de concevoir le nazisme à l’instar d’un accident de l’Histoire (donc comme la signature hypothétique d’un événement imprévisible qui pourrait avoir surgi d’un décret occulte), parce que tout ce qui découle du génocide perpétré par l’Allemagne hitlérienne provient d’une apothéose de la raison humaine, d’un calcul terrestre duquel est exclu toute forme de délicatesse ou de spiritualité, de la mise en place attentive et scrupuleuse d’une méthode exterminatrice dont les tenants et les aboutissants ne font que révéler, in fine, les principes moteurs de la modernité, c’est-à-dire, au premier chef, le triomphe de la rationalité économique où l’individu perd son humanité faute de ne plus pouvoir être autre chose qu’un moyen au service d’une fin. Ainsi Dieu, s’il existait, aurait-il pu vouloir que les camps de la Solution Finale viennent défigurer le monde créé de sa main souverainement bonne ? Hans Jonas, dans Le concept de Dieu après Auschwitz (4), propose un écart décisif entre la bonté permanente et nécessaire de Dieu et la nature foncièrement hasardeuse de ses créatures. En prenant le risque de la Création, Dieu a laissé aux hommes des libertés qu’ils ne méritaient peut-être pas. Dans la lignée de cette éventuelle audace du Très-Haut, Bolaño réfléchit aux façons d’être des hommes auxquels Dieu a permis la liberté, à commencer par la liberté d’être méchant et inconséquent. C’est pourquoi il est intéressant de faire de 2666 non pas une métaphore unique d’Auschwitz avec son diagnostic circonstancié et ses quelques citations mémorielles, mais la continuation de la Shoah par d’autres moyens et en d’autres lieux, la relocalisation du trou noir que fut le IIIe Reich dans la circonscription de la violence faite aux femmes mexicaines de Santa Teresa, double urbain et littéraire de Ciudad Juárez, la ville réelle où presque un millier de femmes ont été assassinées depuis le début des années 1990 (5). En superposant une Santa Teresa fictionnelle sur les ruines mentales de Juárez, Bolaño établit une métaphore initiale, un déplacement d’ordre spatial et sémantique (Juárez se dit désormais dans le langage littéraire de Santa Teresa et en fonction de la géographie inhérente à l’œuvre de fiction). Ce mouvement de départ se complète d’une métaphore historique (Santa Teresa divulgue quelque chose de la folie génocidaire nazie en même temps qu’elle suggère un lien plus ou moins évident entre l’Europe de la Seconde Guerre mondiale et l’Amérique d’aujourd’hui), et les raccords effectués par ces différents jeux métaphoriques produisent un troublant foyer de sens où le Mal du fascisme allemand se redistribue catégoriquement ou symboliquement dans des attitudes, des paroles, des actes de violence, etc.
Prenant conscience de la richesse et des multiples enjeux disséminés dans l’œuvre de Bolaño, R. Falls fait part de ses idées et de ses propres limites à Seth Bockley, un jeune auteur et dramaturge depuis lors nommé en résidence au théâtre Goodman. Les deux hommes vouent une passion égale aux travaux de Bolaño, et tout particulièrement à 2666, chapelle ardente des femmes tuées de Juárez et labyrinthe littéraire au cœur duquel habite le «monstre» du roman, le Minotaure qui attire et qui dévore les personnages et les lecteurs. Convaincu par l’énergie et l’imagination de S. Bockley, R. Falls prend la décision de collaborer avec lui, d’autant plus que S. Bockley maîtrise l’espagnol et possède par conséquent la capacité d’apporter une expertise de qualité sur le texte original de l’écrivain chilien. C’est à eux que l’on doit les cinq heures de représentation du 2666 aujourd’hui joué sur la scène anglophone, sans oublier bien sûr les acteurs ainsi que toutes les fonctions qui président à la bonne marche d’une pièce de théâtre (6).
 D’emblée il nous faut soulager l’opinion des sceptiques en affirmant que la durée de la pièce ne saurait en diminuer l’intérêt, pas plus qu’elle ne serait le signe de quelque complaisance dans la digression. On aurait plutôt émis des doutes si cette adaptation avait tenu en deux ou trois heures tant le roman de Bolaño ouvre de portes. On aurait même volontiers apprécié que la durée en soit augmentée pour que toute la nature extravagante du livre surgisse de plein fouet, ralliant de ce fait tous les fous de Bolaño, contaminant les néophytes et éliminant les petites âmes, les renfrognés ou les timides à qui ne plaisent que les œuvres calibrées, les productions oxygénées, celles-là mêmes qui désespèrent Amalfitano à la fin de la deuxième partie de 2666, lorsqu’il regrette que les gens cultivés n’osent pas plus souvent se reporter aux livres qui nous enfoncent dans l’insécurité intellectuelle et qui ont plongé leurs créateurs dans des luttes sanguinaires et acharnées. Nous n’aurions donc pas boudé notre plaisir si messieurs Falls et Bockley s’étaient entendu à édifier un monument théâtral deux fois plus long, et, du reste, si nous en croyons les informations qui circulent ici et là, il se pourrait que le prochain festival d’Avignon assiste à une mise en scène colossale de 2666, sous l’égide de Julien Gosselin, à qui l’on doit une adaptation assez remarquée des Particules élémentaires de Michel Houellebecq (7).
D’emblée il nous faut soulager l’opinion des sceptiques en affirmant que la durée de la pièce ne saurait en diminuer l’intérêt, pas plus qu’elle ne serait le signe de quelque complaisance dans la digression. On aurait plutôt émis des doutes si cette adaptation avait tenu en deux ou trois heures tant le roman de Bolaño ouvre de portes. On aurait même volontiers apprécié que la durée en soit augmentée pour que toute la nature extravagante du livre surgisse de plein fouet, ralliant de ce fait tous les fous de Bolaño, contaminant les néophytes et éliminant les petites âmes, les renfrognés ou les timides à qui ne plaisent que les œuvres calibrées, les productions oxygénées, celles-là mêmes qui désespèrent Amalfitano à la fin de la deuxième partie de 2666, lorsqu’il regrette que les gens cultivés n’osent pas plus souvent se reporter aux livres qui nous enfoncent dans l’insécurité intellectuelle et qui ont plongé leurs créateurs dans des luttes sanguinaires et acharnées. Nous n’aurions donc pas boudé notre plaisir si messieurs Falls et Bockley s’étaient entendu à édifier un monument théâtral deux fois plus long, et, du reste, si nous en croyons les informations qui circulent ici et là, il se pourrait que le prochain festival d’Avignon assiste à une mise en scène colossale de 2666, sous l’égide de Julien Gosselin, à qui l’on doit une adaptation assez remarquée des Particules élémentaires de Michel Houellebecq (7).Ceci étant, toute inclination personnelle mise à part, il est indispensable de redire distinctement ô combien cette adaptation de 2666 au théâtre Goodman est une réussite, un tour de force narratif, l’aboutissement majuscule d’un projet qui paraissait infaisable compte tenu de la générosité et du caractère inépuisable de l’œuvre de Bolaño. L’énormité des cinq heures de représentation ne fait que traduire l’énormité du livre, son côté envahissant, excessif, véhément, et les cinq parties du livres correspondent tout à fait à la configuration de cinq actes théâtraux, à ceci près que la mise en scène du Goodman s’organise comme suit, reprenant chaque fois les intitulés des différentes sections du roman en les projetant quelques secondes sur un segment du décor : 1/ «La partie des critiques», puis entracte; 2/ «La partie d’Amalfitano» et «La partie de Fate», puis entracte; 3/ «La partie des crimes», puis entracte; 4/ «La partie d’Archimboldi». L’absence de pause entre les parties consacrées à Amalfitano et à Fate s’explique d’une part en raison de la brièveté du chapitre traitant d’Amalfitano dans le texte de 2666 (une centaine de pages), et d’autre part ces deux parties agissent chacune comme des points de basculement puisqu’elles transfèrent définitivement l’histoire à Santa Teresa, se rapprochant de plus en plus du sujet fondamental (les meurtres inexpliqués des femmes), après les amorces de la première partie qui fait une incursion également déterminante dans la ville maudite.
Par ailleurs, les cinq parties du livre délimitent cinq registres littéraires, et donc cinq physionomies discursives impliquant des climats distincts, toutes restituées par le jeu théâtral sur lequel nous reviendrons et toutes solidaires de la question du Mal. On pourrait les synthétiser de la sorte : 1/ «La partie des critiques» expose la fascination de quatre universitaires pour les travaux d’un écrivain invisible, Benno von Archimboldi, pressenti pour recevoir le prix Nobel de littérature. Outre les comportements absurdes de ces universitaires impuissants à se mesurer à une œuvre qui les dépasse en genre et en nombre, il est surtout intéressant de mettre l’accent sur la moquerie des langages académiques, en contradiction totale avec la langue de la création littéraire. Le Mal est par conséquent d’ordre linguistique dans cette partie, le mal-dire étant synonyme de mal-écrire, et par extension de mal-existence de la part de ce quatuor de savants narcissiques et incompétents, ce qui met en lambeaux toute espèce d’analyse littéraire concernant les livres d’Archimboldi. L’autre manifestation du Mal dans cette partie est plus anecdotique en comparaison étant donné qu’elle repose sur l’éventualité qu’Archimboldi soit de passage à Santa Teresa, fosse commune du roman, polarité urbaine qui sera ultérieurement investie par des tempéraments autrement plus courageux que ceux de nos universitaires pusillanimes. 2/ «La partie d’Amalfitano» reproduit les errances psychiques d’un professeur de philosophie chilien, Oscar Amalfitano, qui enseigne à l’Université de Santa Teresa. En proie au contexte délétère de la ville, il compense le processus de déshumanisation ambiant par un surcroît d’activité mentale, faisant de lui un genre d’illuminé génial proche de Swedenborg. En sus de ses errements, Amalfinato doit affronter la peur qu’il n’arrive malheur à sa fille Rosa, de même qu’il fait face au souvenir de sa femme Lola, décédée du sida et jadis possédée par une impétuosité poétique qui lui fit battre la campagne espagnole à la recherche d’un rhapsode interné dans un asile. Encore une fois, Santa Teresa ne saurait être négligée dans la mesure où cette partie fait la jonction entre la réminiscence de la vie européenne des Amalfitano et la vie présente au Mexique, mais ce qui prédomine touche essentiellement au Mal psychologique. 3/ «La partie de Fate» décrit la destinée d’un journaliste spécialisé dans les questions politico-sociales et subitement envoyé à Santa Teresa pour couvrir un match de boxe.
 Parvenu dans la cité criminelle, en bordure du désert du Sonora, Oscar Fate s’aperçoit que le combat n’est qu’un épiphénomène par rapport à la situation meurtrière qui sévit là-bas. On entre ici dans la tonalité du roman noir où l’excitation de l’investigation journalistique et policière se confond avec l’évaluation de la société. Cette partie démontre le contraste incommensurable qui sépare les États-Unis du Mexique, les deux pays se tournant le dos à plusieurs égards, mais les deux se rejoignant dans une certaine idée de la violence. Si les États-Unis parviennent plus ou moins à dissimuler les conséquences désastreuses de la brutalité sociale, le Mexique semble vivre à ciel ouvert, à nu, exhibant ses chairs malades à travers la phallocratie, la médiocrité des hommes et la mort violente de ses femmes, dont les corps sont retrouvés dans des coins insalubres, abandonnés comme des carcasses animales. C’est là un Mal typiquement sociétal qui se dessine. 4/ «La partie des crimes» est une litanie insupportable, une interminable rubrique nécrologique qui s’enchevêtre aux conduites infectes de la police mexicaine, plus spécifiquement des autorités de Santa Teresa. Les commentateurs ont souvent mis en avant le fait que cette quatrième partie constituait le cimetière du roman, mais au-delà de ce faciès en pierre tombale, c’est bien l’attitude des hommes qu’il importe de mettre en exergue, le Mal de masculinité en quelque sorte, puisque ce sont les hommes qui sont en charge de résoudre l’énigme des meurtres. Les piétinements de l’enquête, associés à la nullité et à l’obscénité des hommes, produisent une image déplorable du Mexique en particulier et de l’Amérique du Sud en général, comme si Bolaño, par le biais de la fiction, continuait de régler ses comptes avec son continent natal. 5/ «La partie d’Archimboldi» fait une rupture provisoire avec Santa Teresa puisqu’elle retrace le parcours de Benno von Archimboldi, né Hans Reiter (8). La rupture est effectivement provisoire, sinon factice, parce que tous les épisodes de la vie d’Archimboldi concourent à établir une réciprocité entre l’Europe bouleversée par les guerres et l’Amérique ayant l’air de vouloir répéter les erreurs du Vieux Continent. Les louvoiements de Reiter, qui prendra le pseudonyme si bien trouvé d’Archimboldi, en référence au peintre Arcimboldo qui sut faire disparaître des objets multiples pour faire apparaître l’Un d’un autre objet (par exemple des livres entassés de manière réfléchie afin de faire naître le visage de l’homme-livre), ces louvoiements, donc, contribuent à raconter la course d’un homme qui fuit le Mal, en l’occurrence ici un Mal belliqueux, un Mal conflictuel et infini, né d’une main anthropomorphe, un Mal qui ne peut éventuellement être surmonté que par la littérature, la seule à même de dépasser le registre de l’explication, du reportage factuel, et d’entrer dans le registre de la compréhension. Aussi cette cinquième partie joue avec les codes de la biographie, voire de la monographie, et tandis que nous en apprenons davantage sur ce que les universitaires n’avaient su démêler en première instance, trop préoccupés d’expliquer et incapables de comprendre, nous nous mettons à mieux cerner l’écrivain traqué de toutes parts, tout comme nous remontons vers le paroxysme du Mal, vers le nazisme, épreuve formatrice qui transforma Hans Reiter en Benno von Archimboldi et qui fit de lui un assassin magnifique parce que son crime libéra la Terre d’un pitoyable nazi. Sans doute faut-il y voir une image de l’Europe qui est parvenue à se purger partiellement du Mal qui la rongeait (partiellement étant donné que le nazisme s’est poursuivi dans l’ère technique et bureaucratique de la gestion des corps), par opposition avec Santa Teresa qui se cherche encore, qui se couche devant le Mal et qui l’entretient de surcroît. Au final, l’excursion d’Archimboldi à Santa Teresa ne fut qu’un voyage d’écrivain qui voulut tester ses monstres anciens contre les monstres nouveaux, Archimboldi incarnant le parfait doppelgänger de Bolaño, et force est de constater que la littérature, si elle demeure le meilleur médium pour apprécier le Mal, ne peut nous en livrer qu’une apparence, un élément de réponse déjà satisfaisant eu égard à l’étendue de la question.
Parvenu dans la cité criminelle, en bordure du désert du Sonora, Oscar Fate s’aperçoit que le combat n’est qu’un épiphénomène par rapport à la situation meurtrière qui sévit là-bas. On entre ici dans la tonalité du roman noir où l’excitation de l’investigation journalistique et policière se confond avec l’évaluation de la société. Cette partie démontre le contraste incommensurable qui sépare les États-Unis du Mexique, les deux pays se tournant le dos à plusieurs égards, mais les deux se rejoignant dans une certaine idée de la violence. Si les États-Unis parviennent plus ou moins à dissimuler les conséquences désastreuses de la brutalité sociale, le Mexique semble vivre à ciel ouvert, à nu, exhibant ses chairs malades à travers la phallocratie, la médiocrité des hommes et la mort violente de ses femmes, dont les corps sont retrouvés dans des coins insalubres, abandonnés comme des carcasses animales. C’est là un Mal typiquement sociétal qui se dessine. 4/ «La partie des crimes» est une litanie insupportable, une interminable rubrique nécrologique qui s’enchevêtre aux conduites infectes de la police mexicaine, plus spécifiquement des autorités de Santa Teresa. Les commentateurs ont souvent mis en avant le fait que cette quatrième partie constituait le cimetière du roman, mais au-delà de ce faciès en pierre tombale, c’est bien l’attitude des hommes qu’il importe de mettre en exergue, le Mal de masculinité en quelque sorte, puisque ce sont les hommes qui sont en charge de résoudre l’énigme des meurtres. Les piétinements de l’enquête, associés à la nullité et à l’obscénité des hommes, produisent une image déplorable du Mexique en particulier et de l’Amérique du Sud en général, comme si Bolaño, par le biais de la fiction, continuait de régler ses comptes avec son continent natal. 5/ «La partie d’Archimboldi» fait une rupture provisoire avec Santa Teresa puisqu’elle retrace le parcours de Benno von Archimboldi, né Hans Reiter (8). La rupture est effectivement provisoire, sinon factice, parce que tous les épisodes de la vie d’Archimboldi concourent à établir une réciprocité entre l’Europe bouleversée par les guerres et l’Amérique ayant l’air de vouloir répéter les erreurs du Vieux Continent. Les louvoiements de Reiter, qui prendra le pseudonyme si bien trouvé d’Archimboldi, en référence au peintre Arcimboldo qui sut faire disparaître des objets multiples pour faire apparaître l’Un d’un autre objet (par exemple des livres entassés de manière réfléchie afin de faire naître le visage de l’homme-livre), ces louvoiements, donc, contribuent à raconter la course d’un homme qui fuit le Mal, en l’occurrence ici un Mal belliqueux, un Mal conflictuel et infini, né d’une main anthropomorphe, un Mal qui ne peut éventuellement être surmonté que par la littérature, la seule à même de dépasser le registre de l’explication, du reportage factuel, et d’entrer dans le registre de la compréhension. Aussi cette cinquième partie joue avec les codes de la biographie, voire de la monographie, et tandis que nous en apprenons davantage sur ce que les universitaires n’avaient su démêler en première instance, trop préoccupés d’expliquer et incapables de comprendre, nous nous mettons à mieux cerner l’écrivain traqué de toutes parts, tout comme nous remontons vers le paroxysme du Mal, vers le nazisme, épreuve formatrice qui transforma Hans Reiter en Benno von Archimboldi et qui fit de lui un assassin magnifique parce que son crime libéra la Terre d’un pitoyable nazi. Sans doute faut-il y voir une image de l’Europe qui est parvenue à se purger partiellement du Mal qui la rongeait (partiellement étant donné que le nazisme s’est poursuivi dans l’ère technique et bureaucratique de la gestion des corps), par opposition avec Santa Teresa qui se cherche encore, qui se couche devant le Mal et qui l’entretient de surcroît. Au final, l’excursion d’Archimboldi à Santa Teresa ne fut qu’un voyage d’écrivain qui voulut tester ses monstres anciens contre les monstres nouveaux, Archimboldi incarnant le parfait doppelgänger de Bolaño, et force est de constater que la littérature, si elle demeure le meilleur médium pour apprécier le Mal, ne peut nous en livrer qu’une apparence, un élément de réponse déjà satisfaisant eu égard à l’étendue de la question. La mise en scène proprement dite
 À suivre son étymologie, le théâtre se définit comme le lieu où tout est visible, le lieu où tous les regards sont amplifiés parce qu’ils voient distinctement ce que par exemple une page de roman ne montre qu’à l’imagination. En tant que tel, le théâtre est un complément de perception, un ouvroir d’impressions sensibles qui s’avère plus convaincant que tous les paysages imaginaires suscités par une lecture. Pourquoi cela ? Parce que les images qui s’accumulent dans l’imagination se manifestent uniformément et ne sont accompagnées d’aucune possibilité de retouche ou de perquisition. C’est ce que Sartre soutient dans L’imaginaire (9), disant que l’image est toujours le vecteur d’un monde inanimé, d’un monde figé où plus rien ne peut survenir ou se modifier. Par conséquent, j’aurai beau lire et relire 2666, j’aurai beau retrouver les images avec lesquelles j’ai eu le temps de me familiariser, je n’en obtiendrai pas pour autant une connaissance ou une matière exploitable, dussé-je posséder une faculté d’imagination reproductrice supérieure à la moyenne. En corroborant ce type de thèse, Sartre stipule que l’imagination est inférieure en qualité par rapport à la perception, qui, elle, me fournit une vue beaucoup plus enrichie du monde qui m’entoure. En suivant à la lettre cette prescription largement influencée par la tradition phénoménologique, nous pouvons partir du principe que n’importe quel roman, une fois adapté au théâtre, devient plus riche et plus significatif que ce qu’il pouvait être dans quelque imagination que ce soit – il y aurait d’abord en ce sens l’imaginaire engendré par le roman, un état sommaire de la sensation, puis sa mutation théâtrale, son élévation à l’état approfondi de la sensibilité avec pour ainsi dire une mise en chair des images. En bon illustrateur, Sartre appuie son propos en reprenant un exemple célèbre du philosophe Alain, qui demandait année après année à ses étudiants parisiens combien de colonnes composent le Panthéon. Tous les étudiants ont pu un jour ou l’autre passer et repasser devant le Panthéon, tant et si bien qu’ils ont eu le loisir d’en fixer une représentation fidèle dans leur imagination. Le problème, sitôt la question posée, c’est qu’ils ne sont pas capables de s’engager dans une réponse assurée, se rendant alors compte que leur imagination, sans l’assistance de la perception, n’est qu’un réservoir d’irréalité et de choses inconnaissables. Si nous accordons du crédit à cette façon de penser, alors nous devons reconnaître que l’adaptation de 2666 sur la scène de Chicago nous a fait voir ce qui n’était que très superficiellement fixé dans notre imaginaire, ceci en dépit de nos relectures attentives du texte. Ce type d’argument pulvérise également tout reproche approximatif qui serait formulé à l’encontre de la mise en scène.
À suivre son étymologie, le théâtre se définit comme le lieu où tout est visible, le lieu où tous les regards sont amplifiés parce qu’ils voient distinctement ce que par exemple une page de roman ne montre qu’à l’imagination. En tant que tel, le théâtre est un complément de perception, un ouvroir d’impressions sensibles qui s’avère plus convaincant que tous les paysages imaginaires suscités par une lecture. Pourquoi cela ? Parce que les images qui s’accumulent dans l’imagination se manifestent uniformément et ne sont accompagnées d’aucune possibilité de retouche ou de perquisition. C’est ce que Sartre soutient dans L’imaginaire (9), disant que l’image est toujours le vecteur d’un monde inanimé, d’un monde figé où plus rien ne peut survenir ou se modifier. Par conséquent, j’aurai beau lire et relire 2666, j’aurai beau retrouver les images avec lesquelles j’ai eu le temps de me familiariser, je n’en obtiendrai pas pour autant une connaissance ou une matière exploitable, dussé-je posséder une faculté d’imagination reproductrice supérieure à la moyenne. En corroborant ce type de thèse, Sartre stipule que l’imagination est inférieure en qualité par rapport à la perception, qui, elle, me fournit une vue beaucoup plus enrichie du monde qui m’entoure. En suivant à la lettre cette prescription largement influencée par la tradition phénoménologique, nous pouvons partir du principe que n’importe quel roman, une fois adapté au théâtre, devient plus riche et plus significatif que ce qu’il pouvait être dans quelque imagination que ce soit – il y aurait d’abord en ce sens l’imaginaire engendré par le roman, un état sommaire de la sensation, puis sa mutation théâtrale, son élévation à l’état approfondi de la sensibilité avec pour ainsi dire une mise en chair des images. En bon illustrateur, Sartre appuie son propos en reprenant un exemple célèbre du philosophe Alain, qui demandait année après année à ses étudiants parisiens combien de colonnes composent le Panthéon. Tous les étudiants ont pu un jour ou l’autre passer et repasser devant le Panthéon, tant et si bien qu’ils ont eu le loisir d’en fixer une représentation fidèle dans leur imagination. Le problème, sitôt la question posée, c’est qu’ils ne sont pas capables de s’engager dans une réponse assurée, se rendant alors compte que leur imagination, sans l’assistance de la perception, n’est qu’un réservoir d’irréalité et de choses inconnaissables. Si nous accordons du crédit à cette façon de penser, alors nous devons reconnaître que l’adaptation de 2666 sur la scène de Chicago nous a fait voir ce qui n’était que très superficiellement fixé dans notre imaginaire, ceci en dépit de nos relectures attentives du texte. Ce type d’argument pulvérise également tout reproche approximatif qui serait formulé à l’encontre de la mise en scène. De là provient selon toute vraisemblance l’idée que les personnages vus sur la scène du théâtre Goodman ont eu l’air d’être exactement ce qu’ils devaient être vis-à-vis du roman. À vrai dire, ils auraient pu être différents qu’ils nous auraient quand même paru être ce qu’ils avaient à être tant leur matérialisation, leur concrétisation, leur extraction de la page écrite leur prodigue une ossature qui ne peut que nous émouvoir. Non seulement nous les connaissons mieux sur scène, mais nous les reconnaissons littéralement, nous en obtenons un savoir plus achevé parce qu’ils n’étaient jusqu’alors que des présences fantomatiques dans notre esprit, des frusques imaginaires, et les voilà surgis tout à coup dans le réel, physiques, palpables, concupiscents pour certains d’entre eux, aussi gaillards que Bolaño nous les avait portraiturés, donquichottesques aussi pour la plupart car tous, à peu près, poursuivent une quête insoutenable qui consiste à faire de la vie un sursaut d’extravagance, un vol plané orgueilleux qui finira néanmoins par buter contre le principe de réalité. Les universitaires échoueront à mettre la main sur Archimboldi, Amalfitano se noiera dans ses divagations, Fate sera étouffé par la nature exorbitante des crimes de Santa Teresa, les flics du Mexique se prendront pour des Sherlock Holmes tout en se vautrant dans leur amateurisme pornographe et cynique, et Benno von Archimboldi, enfin, n’atteindra pas les tréfonds de ce Mal immense que toute sa vie il aura pourchassé dans sa littérature. Il était donc primordial d’accoucher de personnages aux allures de vaincus sublimes, divisés entre un pôle de véhémence et un pôle de silence, tantôt exaltés, éloquents et presque logorrhéiques, tantôt voûtés, retranchés, méditatifs devant la catastrophe de Santa Teresa et celle, plus grande encore, de la Shoah paraboliquement ressuscitée. C’est d’ailleurs l’une des réussites probantes de cette pièce de théâtre, à savoir la faculté d’avoir respecté les caractères pluridimensionnels des personnages, le soin de ne pas les avoir caricaturés malgré les nombreuses occasions qui auraient pu le justifier. La lumière a pu les irradier davantage sur la scène, elle a pu les encourager à un surplus de puissance, mais l’extinction progressive des feux, le fondu parfois utilisé, ce procédé les aura quelquefois fait taire et cogiter à bon escient. Même la police de Santa Teresa, lorsqu’elle est rejetée dans l’ombre, nous semble réfléchir à sa bêtise et à sa malpropreté morale. C’est d’autant plus le cas que ces moments de semi-obscurité sont accentués par la lumière éclatante que l’on projette sur les femmes, antithèses des hommes creux et mauvais, symboles d’innocence et de fierté.
 On commence cependant par la découverte des trois universitaires masculins, Espinoza, Morini et Pelletier, bientôt rattrapés par Norton, la fille ambitieuse et coucheuse, archétype du succès académique en Europe, vêtue d’un petit ensemble qui met sa poitrine en valeur et qui lui donne des fesses de Vénus callipyge. Les types ethniques et les traits supposés de tempérament sont admirablement rendus : Espinoza respire la morgue hispanique de celui qui estime détenir une autorité savante, Morini a l’élégance italienne en dépit sa chaise roulante due à sa maladie des muscles, Pelletier est emblématique de l’arrogance française qui ne se repose que sur un passé révolu, et Norton, la belle Norton, est une réalisation pimpante de la «touche» britannique accolée à l’arriviste, confusion de classe et de grognasse. Les quatre saltimbanques font des cabrioles verbales sur la scène, Morini faisant rouler son érudition comme il fait valser sa chaise roulante, les trois autres marchant martialement, ou alors roulant aussi, le cul sur des chaises à roulettes affectées d’un dossier vert fluorescent. Quand ils prennent la parole, ils refont d’abord le curriculum vitae de l’un d’entre eux, puis, progressivement, le «Je» se fortifie et la situation n’en devient que plus amusante. On est transporté de colloque en colloque, les lieux et les dates apparaissant sur un petit écran suspendu, les monologues érudits concernant Archimboldi se multipliant et fournissant un discours inauthentique sur le travail de l’écrivain. On pourrait arguer d’un comique de répétition, toutefois le langage est si précis et si travaillé qu’il renouvelle constamment ses objets. C’est en outre la marque du texte de Bolaño qui se fait jour : la langue de 2666 est tellement substantielle qu’elle est immédiatement sonore, théâtrale, si bien qu’il n’est guère utile de compenser par des effets tapageurs de mise en scène. La maximisation des champs lexicaux autorise les réalisateurs à proposer une scène minimaliste et dépouillée où l’attention du spectateur est obligée de se focaliser sur les mots, sur les déblatérations, les déplorations, les palabres géniales, etc. C’est un peu comme si l’on entendait le roman de nouveau et qu’on y ajoutait une perception cruciale, dispensée par les dispositifs du théâtre.
On commence cependant par la découverte des trois universitaires masculins, Espinoza, Morini et Pelletier, bientôt rattrapés par Norton, la fille ambitieuse et coucheuse, archétype du succès académique en Europe, vêtue d’un petit ensemble qui met sa poitrine en valeur et qui lui donne des fesses de Vénus callipyge. Les types ethniques et les traits supposés de tempérament sont admirablement rendus : Espinoza respire la morgue hispanique de celui qui estime détenir une autorité savante, Morini a l’élégance italienne en dépit sa chaise roulante due à sa maladie des muscles, Pelletier est emblématique de l’arrogance française qui ne se repose que sur un passé révolu, et Norton, la belle Norton, est une réalisation pimpante de la «touche» britannique accolée à l’arriviste, confusion de classe et de grognasse. Les quatre saltimbanques font des cabrioles verbales sur la scène, Morini faisant rouler son érudition comme il fait valser sa chaise roulante, les trois autres marchant martialement, ou alors roulant aussi, le cul sur des chaises à roulettes affectées d’un dossier vert fluorescent. Quand ils prennent la parole, ils refont d’abord le curriculum vitae de l’un d’entre eux, puis, progressivement, le «Je» se fortifie et la situation n’en devient que plus amusante. On est transporté de colloque en colloque, les lieux et les dates apparaissant sur un petit écran suspendu, les monologues érudits concernant Archimboldi se multipliant et fournissant un discours inauthentique sur le travail de l’écrivain. On pourrait arguer d’un comique de répétition, toutefois le langage est si précis et si travaillé qu’il renouvelle constamment ses objets. C’est en outre la marque du texte de Bolaño qui se fait jour : la langue de 2666 est tellement substantielle qu’elle est immédiatement sonore, théâtrale, si bien qu’il n’est guère utile de compenser par des effets tapageurs de mise en scène. La maximisation des champs lexicaux autorise les réalisateurs à proposer une scène minimaliste et dépouillée où l’attention du spectateur est obligée de se focaliser sur les mots, sur les déblatérations, les déplorations, les palabres géniales, etc. C’est un peu comme si l’on entendait le roman de nouveau et qu’on y ajoutait une perception cruciale, dispensée par les dispositifs du théâtre. Car la scène, insistons là-dessus, n’est pas du tout démesurée. C’est une petite scène, encastrée dans une salle confidentielle (la salle Owen (10)), avec une jolie capacité de profondeur qui sera peu à peu exploitée tout au long de la pièce. En tant que les universitaires sont en général des paradigmes de la fermeture d’esprit et des mondes clos, ils évoluent sur une scène abrégée, miroir de l’obstruction ontologique dont ils sont les dépositaires. Ce sont des êtres limités, repliés sur eux-mêmes, qui nagent pudibonds dans des textes explosifs et dont ils ne savent pas faire des interprétations adéquates. Par contraste, Archimboldi aura les faveurs d’une scène agrandie, à la hauteur de son être. La partie qui lui est relative est la plus cinématique, la plus cinétique même. Les sons et les images agrémentent sans relâche le mouvement des acteurs qui tournent autour d’Archimboldi, comme on tournerait autour d’une idole, frénétique et circonspect tout à la fois, mais d’une circonspection qui s’appuie sur des virulences intérieures tout à fait remarquables. Archimboldi dilate la scène, il revigore l’univers diégétique, tandis que les universitaires s’ébrouent tels des poissons dans un bocal, allant et revenant toujours à l’identique, meilleurs en bruits de couloir qu’en filature conceptuelle et empirique d’Archimboldi. C’est que le commérage, fût-il plaisant, ne nécessite aucune sorte de profondeur de champ. À l’inverse, la littérature et Archimboldi ont besoin d’espace, ne serait-ce déjà que parce qu’ils sont en eux-mêmes des coefficients de majoration, des extenseurs naturels.
 En comparaison derechef avec les universitaires européens qui tâtonnent et se rabougrissent, Amalfitano, originaire du Chili, profite lui aussi d’un agrandissement de la scène. Malgré toutes ses instabilités et ses névroses, il s’est approché de plus près du mystère d’Archimboldi. Il est suffisamment courageux pour vivre à Santa Teresa et y enseigner la philosophie, une discipline qui paraît pourtant superflue dans cette partie du monde. C’est un authentique cérébral, en quoi il était important de choisir un acteur physiquement en accord avec cette allure intellectuelle, le front dégarni, l’âge de la maturité, un genre de paternel des concepts susceptible d’accrocher à sa corde à linge un livre afin que la nature éprouve à sa guise la culture. L’épisode du livre épinglé arrive d’ailleurs au tout début de l’acte, comme pour parapher définitivement l’excès d’entendement du bonhomme, la distance qui le sépare des horreurs avilissantes de Santa Teresa.
En comparaison derechef avec les universitaires européens qui tâtonnent et se rabougrissent, Amalfitano, originaire du Chili, profite lui aussi d’un agrandissement de la scène. Malgré toutes ses instabilités et ses névroses, il s’est approché de plus près du mystère d’Archimboldi. Il est suffisamment courageux pour vivre à Santa Teresa et y enseigner la philosophie, une discipline qui paraît pourtant superflue dans cette partie du monde. C’est un authentique cérébral, en quoi il était important de choisir un acteur physiquement en accord avec cette allure intellectuelle, le front dégarni, l’âge de la maturité, un genre de paternel des concepts susceptible d’accrocher à sa corde à linge un livre afin que la nature éprouve à sa guise la culture. L’épisode du livre épinglé arrive d’ailleurs au tout début de l’acte, comme pour parapher définitivement l’excès d’entendement du bonhomme, la distance qui le sépare des horreurs avilissantes de Santa Teresa. Pour le professeur Oscar Amalfitano, le décor est celui d’une petite maison vétuste qui se hisse dans la poussière mexicaine. On devine à l’arrière-plan une continuité de ce paysage aride, un boyau sans fin qui nous conduirait jusqu’à l’estomac de la ville, mais cela subsiste dans une obscurité caractéristique. Les vêtements d’Amalfitano sont en outre assortis à cet entourage sec et désertique, l’homme étant représentatif d’une Amérique du Sud rude, résistante, beaucoup plus téméraire que l’Europe et ses théoriciens timides qui n’ont su se mettre au niveau d’Archimboldi. En parallèle de cette existence dévouée à la pensée, Amalfitano a tout de même une vie de famille. Il se fait du souci pour sa fille Rosa, une virevoltante jeune fille que l’on sent menacée à juste titre par Santa Teresa. Le sentiment d’une menace est d’autant plus vif que la mise en scène nous a introduit plus tôt au panorama de la ville, lorsque les universitaires (excepté Morini) sont venus y poser un pied inhibé. Nous avons alors vu le délabrement, la misère et la mort partout en maraude. Quelqu’un comme Rosa n’a pas sa place dans cet ignoble précipice et son père n’est en que trop lucide. Il n’a pas envie de perdre sa fille comme il a perdu autrefois sa femme, Lola, qui se retira du cercle familial pour suivre la trace d’un poète mentalement déséquilibré. C’était du temps où les Amalfitano vivaient en Espagne, et un simple changement de lumière, sur scène, procède à ce retour en arrière, à la résurgence de Lola expliquant sa fuite et sa démangeaison poétiques, Lola monologuant sur son épopée avec le poète, son amour pour cet homme un peu androgyne qu’elle vit un jour se passionner pour la technique masturbatoire d’un dément onaniste. D’une certaine manière, Lola était à la recherche d’une vie de sensualité, d’un quotidien organique, tout ce que ne pouvait pas lui offrir Amalfitano avec son caprice des abstractions. Morte du sida, Lola s’est conformée à sa nature, à son entrain corporel, et le spectre qui revient sur scène ne manque pas de consistance, pas plus qu’il ne manque de nous attendrir lorsqu’il repasse à l’horizon, dans le lointain du décor, avançant au ralenti, embrasé d’une lumière zénithale, adressant à son mari un ultime adieu, sincère et pur, un au revoir de femme qui n’a jamais cessé de l’aimer, ce qu’elle eût fait cependant si elle était restée à ses côtés au lieu de répondre aux injonctions de sa personnalité.
L’histoire d’Amalfitano n’est pas longue, certes, mais elle est fondamentale dans le canevas narratif parce qu’elle acclimate le spectateur aux tourments psychologiques suscités par Santa Teresa. C’est la voix intérieure d’Amalfitano qui clôture cette partie, simultanément à l’évanouissement du spectre de Lola. Cette voix est celle de l’avertissement puisqu’elle prévient Oscar que la folie est contagieuse, que les choses sont en train de mal tourner par ici. Nous sommes ainsi avisés que la suite va s’aggraver, que notre progression dans l’état du Sonora ne laissera de se rapprocher du trou noir, de ce centre annihilateur qui aspire la ville de Santa Teresa, ses hommes comme ses femmes, et qui dévore aussi peut-être le monde entier, comme le creux d’un tourbillon cyclopéen qui serait né au Mexique et qui s’apprêterait à tout engloutir, dans une intensité encore plus vénéneuse que celle d’Auschwitz.
 En complément des tribulations d’Amalfitano, les galères d’Oscar Fate nous renseignent par d’autres aspects sur les réalités de Santa Teresa. Nous passons d’une partie à l’autre par l’intermédiaire d’un écran géant qui descend sur la scène, nous déroulant un moment d’affliction et d’incertitude, Oscar étant perturbé par la mort de sa mère, que l’on voit d’ailleurs allongée dans un cercueil. La mort de la mère de Fate est un prolongement direct de la mort de Lola, la mère de Rosa. La succession de ces femmes disparues est de deux ordres au moins : d’une part il s’agit de rappeler à quel point les femmes sont vulnérables mais aussi à quel point les hommes en dépendent (sinon Amalfitano et Fate n’en seraient pas aussi traumatisés), et d’autre part il s’agit d’esquisser de plus vastes disparitions féminines, lesquelles s’annonceront bien assez tôt avec «La partie des crimes». De ce point de vue, cette troisième partie fonctionne à l’instar d’une liaison cardinale, d’un moyen terme qui entérine l’unité narrative de 2666 en dépit de ses nombreux fragments et sous-intrigues. C’est un segment à la fois festif et tragique, un condensé du Mexique dans ce qu’il a de plus réjouissant et de plus intolérablement sombre. Sur scène, les contrastes s’enchaînent, passant des ambiances de bar et de combat de boxe à des atmosphères intérieures inquiétantes, où des personnages tout à l’heure euphoriques se révèlent sous des tournures agressives, lamentables et morbides. Déboussolé par ces endroits versatiles, Fate est un intrus, un homme trop moral et uniforme, un homme dissonant au cœur de cette phallocratie bruyante. Le match de boxe pour lequel on l’avait envoyé en reportage se mue forcément en anecdote quand il se rend compte du contexte de Santa Teresa, et plus exactement du traitement réservé aux femmes. Il est épouvanté par l’envergure du désastre et par son peu de retentissement local et international. La norme de la violence semble avoir été intériorisée, telle une ratification de l’identité du XXe siècle, un siècle d’aliénation et de malédiction.
En complément des tribulations d’Amalfitano, les galères d’Oscar Fate nous renseignent par d’autres aspects sur les réalités de Santa Teresa. Nous passons d’une partie à l’autre par l’intermédiaire d’un écran géant qui descend sur la scène, nous déroulant un moment d’affliction et d’incertitude, Oscar étant perturbé par la mort de sa mère, que l’on voit d’ailleurs allongée dans un cercueil. La mort de la mère de Fate est un prolongement direct de la mort de Lola, la mère de Rosa. La succession de ces femmes disparues est de deux ordres au moins : d’une part il s’agit de rappeler à quel point les femmes sont vulnérables mais aussi à quel point les hommes en dépendent (sinon Amalfitano et Fate n’en seraient pas aussi traumatisés), et d’autre part il s’agit d’esquisser de plus vastes disparitions féminines, lesquelles s’annonceront bien assez tôt avec «La partie des crimes». De ce point de vue, cette troisième partie fonctionne à l’instar d’une liaison cardinale, d’un moyen terme qui entérine l’unité narrative de 2666 en dépit de ses nombreux fragments et sous-intrigues. C’est un segment à la fois festif et tragique, un condensé du Mexique dans ce qu’il a de plus réjouissant et de plus intolérablement sombre. Sur scène, les contrastes s’enchaînent, passant des ambiances de bar et de combat de boxe à des atmosphères intérieures inquiétantes, où des personnages tout à l’heure euphoriques se révèlent sous des tournures agressives, lamentables et morbides. Déboussolé par ces endroits versatiles, Fate est un intrus, un homme trop moral et uniforme, un homme dissonant au cœur de cette phallocratie bruyante. Le match de boxe pour lequel on l’avait envoyé en reportage se mue forcément en anecdote quand il se rend compte du contexte de Santa Teresa, et plus exactement du traitement réservé aux femmes. Il est épouvanté par l’envergure du désastre et par son peu de retentissement local et international. La norme de la violence semble avoir été intériorisée, telle une ratification de l’identité du XXe siècle, un siècle d’aliénation et de malédiction. On peut même envisager que Fate, en tant qu’afro-américain, perçoit chez les femmes mexicaines un degré de marginalisation semblable à celui qui touche les Noirs aux États-Unis. Il voudrait probablement écrire un article dans lequel il puisse discuter avec toute l’humanité, un papier dans lequel il pourrait avoir avec la totalité du monde ce que les Américains noirs appellent «the Talk» (11), c’est-à-dire la Conversation, celle que les parents finissent par avoir avec leurs enfants, pour leur expliquer de quoi il retourne lorsqu’on est un jeune noir aux États-Unis et qu’on s’apprête à entrer dans la carrière de la vie. Dans cet article conditionnel, Fate exprimerait sa honte d’être un homme, il ferait le lien entre le cas des Noirs et celui des femmes de Santa Teresa, il réveillerait la planète de son sommeil dogmatique et il livrerait en pâture le nom des responsables des crimes perpétrés dans cette cité abominable. Sauf que l’environnent est pesant et que les embûches sont innombrables, le ou les meurtriers de Santa Teresa courant toujours, un seul individu, qui plus est étranger, ne pouvant les entraver dans leur massacre systématique. Il se peut aussi que se demander qui sont les assassins de Santa Teresa ne soit pas la bonne question à poser. C’est ce que suggère Klaus Haas à Fate à la fin de ce troisième acte. Haas est un prisonnier de Santa Teresa, un bouc-émissaire de la police qui sert d’alibi aux diverses paralysies de l’enquête. Dans sa cellule dont les barreaux sont figurés par des zébrures de lumière (mais qui englobent toute la scène comme pour signifier que Santa Teresa est entièrement un cachot), Haas ressemble à un oracle, à une pythie anachronique de la bouche de laquelle sortirait toute la vérité. Ce qu’il dit à Fate, dans un air de confidence qui saisit le public, c’est que personne ne se préoccupe du meurtre de ces femmes et qu’il ne sert peut-être à rien de vouloir connaître l’identité de ces bourreaux. Toutefois, si Fate y regardait de plus près, s’il jetait un œil plus prospecteur dans cette série de crimes, il y verrait sûrement «le secret du monde», la palpitation du Mal, la composition de son organe.
 Or cette vision de proximité du Mal nous est soumise au quatrième acte, durant le sempiternel chapitre des crimes. Dès que le rideau se lève, on distingue, tout au fond de la scène, un cadavre de femme nue gisant sur la roche. S’affairent autour de ce macchabée deux policiers du cru mexicain, Galindo et Negrete. Ils sont affublés d’une imbuvable goguenardise, rompus à la rhétorique du féminicide, intervenant sur les scènes criminelles comme on pénètrerait dans un moulin. Pour autant cette entrée en matière n’est que l’arbre qui cache la forêt : pendant plus d’une heure nous verrons une alternance entre des scènes où des policiers sont appelés pour s’enquérir d’un corps et des scènes où ces mêmes policiers, revenus au bureau, s’empiffreront de propos salaces et rivaliseront de méthodes caduques. Quoi qu’il en soit la première scène suffit à se faire un avis objectif sur la situation, à savoir que la police mexicaine, masculine et autoritaire, ne souhaite pas inverser la tendance de ces meurtres abjects. Il est troublant du reste d’assister à ces échanges policiers dans la langue américaine. On a le sentiment que les individus sont interchangeables, que les hommes, au fond, sont tous de la même farine. Police mexicaine et police américaine ne valent l’une et l’autre pas mieux. On aurait même envie de supposer que cette affligeante cohorte de flics tire les ficelles de ces assassinats, que certains d’entre eux, excités par la testostérone, vont de temps en temps se soulager en tuant des femmes comme on irait tirer sur un coyote. Pablo Negrete est d’ailleurs le plus atteint de cette bande, peut-être parce qu’il est le chef de la police. D’une vulgarité ineffable, il paraît de surcroît s’enthousiasmer à chaque annonce d’homicide. Son exaltation malsaine est confortée par le texte original : dans le roman, Negrete est pris d’un coup de folie lorsqu’il est mentionné qu’il a tué un chien sans motif apparent.
Or cette vision de proximité du Mal nous est soumise au quatrième acte, durant le sempiternel chapitre des crimes. Dès que le rideau se lève, on distingue, tout au fond de la scène, un cadavre de femme nue gisant sur la roche. S’affairent autour de ce macchabée deux policiers du cru mexicain, Galindo et Negrete. Ils sont affublés d’une imbuvable goguenardise, rompus à la rhétorique du féminicide, intervenant sur les scènes criminelles comme on pénètrerait dans un moulin. Pour autant cette entrée en matière n’est que l’arbre qui cache la forêt : pendant plus d’une heure nous verrons une alternance entre des scènes où des policiers sont appelés pour s’enquérir d’un corps et des scènes où ces mêmes policiers, revenus au bureau, s’empiffreront de propos salaces et rivaliseront de méthodes caduques. Quoi qu’il en soit la première scène suffit à se faire un avis objectif sur la situation, à savoir que la police mexicaine, masculine et autoritaire, ne souhaite pas inverser la tendance de ces meurtres abjects. Il est troublant du reste d’assister à ces échanges policiers dans la langue américaine. On a le sentiment que les individus sont interchangeables, que les hommes, au fond, sont tous de la même farine. Police mexicaine et police américaine ne valent l’une et l’autre pas mieux. On aurait même envie de supposer que cette affligeante cohorte de flics tire les ficelles de ces assassinats, que certains d’entre eux, excités par la testostérone, vont de temps en temps se soulager en tuant des femmes comme on irait tirer sur un coyote. Pablo Negrete est d’ailleurs le plus atteint de cette bande, peut-être parce qu’il est le chef de la police. D’une vulgarité ineffable, il paraît de surcroît s’enthousiasmer à chaque annonce d’homicide. Son exaltation malsaine est confortée par le texte original : dans le roman, Negrete est pris d’un coup de folie lorsqu’il est mentionné qu’il a tué un chien sans motif apparent. La redondance des nuisances policières n’est toutefois pas ce qu’il y a de plus astucieux dans cette quatrième partie, même si l’ensemble est superbement rendu par les rafales verbales et quelques intrigues de périphérie (notamment à propos de la romance qui unit Elvira Campos, directrice d’asile, à Juan de Dios Martinez, un policier plus consciencieux que ses camarades). Il y a en effet une redondance bien plus essentielle, une tautologie terrifiante, et celle-ci implique les crimes. Régulièrement mais sans jamais saturer l’espace de la scène, trois femmes interviennent, interrompant le manège de la police, et elles récitent la nature et les conséquences des crimes d’une voix ferme, comme on lirait un rapport de médecine légale après une autopsie. Ceci correspond à l’architecture mise en place par Bolaño dans la quatrième partie du roman : un va-et-vient perpétuel entre des monolithes descriptifs qui radiographient les dépouilles féminines et des séquences narratives qui relatent les incohérences de la police. Si quelques-uns des lecteurs ont été révulsés par cette froide concaténation des mortes imbriquée dans les agissements suspects de la maréchaussée (et même du gouvernement devrait-on dire), il n’y a pas meilleur procédé pour marteler au spectateur et au lecteur la réalité de ce contexte délétère. En reproduisant le modèle répétitif de « La partie des crimes » tel qu’il est aménagé dans le roman, les metteurs en scène ne s’y sont pas trompés – ils n’ont pas eu le désir de falsifier l’œuvre en vue de plaire, ils ont préféré prendre le risque d’ennuyer, à tout le moins d’ennuyer ceux qui ont lu 2666 en diagonale. On ne peut pas négocier avec l’horreur, il faut la montrer dès qu’on a l’occasion de le faire, et surtout ne pas trahir le mécanisme installé par Bolaño. C’est précisément à ce moment du livre que nous entrons dans le «monstre» du romanesque, que nous effleurons la bête littéraire, la créature que Bolaño a dû affronter et face à laquelle il a dû perdre quelques litres de sang. L’horreur doit être criée, hurlée, vociférée, quitte à déborder, à rendre le roman obèse, illisible, quitte à faire monter une actrice sur le bureau d’un flic pour qu’elle prenne le spectateur à partie, qu’elle se saisisse d’un mégaphone et qu’elle débite un énième rapport d’autopsie. C’était là l’un des beaux épisodes de ce quatrième acte.
Quant au grand terminus, on a dit qu’il était rupture et qu’il ne l’était pas, puisque ce cinquième acte, tout en détaillant les étapes de la vie de Hans Reiter (alias Archimboldi), ne fait que renvoyer à l’œil du cyclone, à cette Santa Teresa par laquelle tout transite et parfois ne ressort nullement (et bien sûr cela nous renvoie à Auschwitz, double fond du livre). C’est la partie la plus profuse en effets de scène, en métamorphoses des acteurs, une polychromie solidaire d’une polyphonie, un assemblage de textuel et de visuel, une fusion de l’écriture romanesque et de l’écriture théâtrale. On aurait tendance à vouloir arguer d’une «cinécriture» pour reprendre la terminologie de la cinéaste Agnès Varda (une écriture mouvementée en quelque sorte), c’est-à-dire une mise en scène au cours de laquelle on observe l’activité hypertrophiée des personnages, comme si chacun d’eux devenait son propre créateur, atteignant de ce fait une autonomie qui nous ferait presque oublier toute intention de l’auteur. On oublie ainsi Bolaño, et même R. Falls et S. Bockley, parce que les personnages nous embarquent ici dans leur giron au fur et à mesure qu’ils prennent de l’épaisseur, au fur et à mesure qu’ils s’enroulent autour de la colonne vertébrale de Reiter, elle-même dépendante de l’orbite de Santa Teresa. Les quinze acteurs de ce cinquième acte sont certes les mêmes que ceux que nous avons croisés auparavant, mais nous avons l’impression qu’ils sont autres, que les visages se sont durcis ou radoucis, que tous ces gens ont dorénavant atteint une plénitude et que ce sont les meilleurs profils pour combattre le Mal qui n’a jamais été en sous-régime. Parmi ce groupe de fortes personnalités, ceux qui n’ont pas suffisamment de force pour se rallier au Bien doivent être ensevelis, tel ce Leo Sammer, cet avatar calamiteux des rouages nazis qui sera étranglé par Hans Reiter après s’être confié à ce dernier, en essayant de se dédouaner de ses fautes minables. L’idée possiblement dominante de cette partie terminale, c’est que deux intensités concurrentes se jaugent : d’un côté Reiter et tous ceux qu’il influence positivement, de l’autre Santa Teresa et tout ce qu’elle draine de maladif ; d’un côté les sujets qui reprennent possession d’eux-mêmes et qui s’inscrivent intensément dans l’existence, de l’autre les sujets vidés de leur substance, vampirisés, sucés jusqu’à la moelle par un Mal qu’ils ont quelquefois accueilli avec volupté.
 Cette cinquième partie signe par conséquent le triomphe de la vitalité et de la littérature, bien qu’elle ne fasse évidemment pas disparaître la source du Mal – le secret du monde reste entier, enfoui dans les charniers de l’Histoire. En outre, on peut voir en Reiter un pèlerin de la justice, un juge de l’Histoire et de ses acteurs, un titan qui parcourt le monde comme il parcourt la scène de théâtre, en améliorant les hommes et les comédiens. Il n’y a pas de demi-mesure sur sa route : soit il rencontre les bons et il les aide à optimiser leur vie (son et /ou lumière sur scène), soit il se heurte aux très mauvais et il se contente de les éviter ou de les éliminer (silence et /ou pénombre sur scène). Aussi ne peut-il pas faire connaissance des universitaires parce que ce sont des médiocres, des hommes insignifiants, des vivants rachitiques qui n’utilisent les livres écrits par Archimboldi qu’en vue de gravir des échelons, lors même que cette littérature contient en son sein la capacité d’atténuer le Mal, c’est-à-dire un tout autre dessein que celui que l’Université veut lui attribuer. Pour trouver Archimboldi, pour qu’il daigne nous rendre une visite, il faudrait s’inscrire dans un programme de moralité, ou alors carrément s’abandonner au Mal et ne pas feindre d’être un homme bon quand on ne fait que dissimuler ses vices. On passe à côté d’Archimboldi quand on ne vit qu’à moitié. On fait un bond régressif quand on rase les murs de son âme. Ainsi la pièce s’achève dans un silence de cathédrale après avoir évoqué plus d’une heure durant l’itinéraire de Reiter/Archimboldi. À la bombance d’une vie assez extraordinaire succède la morosité des vies en demi-teinte. Pelletier, Espinoza, Morini et Norton reviennent sur scène, à contretemps, se persuadant qu’ils sont dans les parages d’Archimboldi. Ils se leurrent mais ils ne trompent plus personne. Ils ne comprendront jamais ni Archimboldi, ni la gravité de ce qui se joue à Santa Teresa.
Cette cinquième partie signe par conséquent le triomphe de la vitalité et de la littérature, bien qu’elle ne fasse évidemment pas disparaître la source du Mal – le secret du monde reste entier, enfoui dans les charniers de l’Histoire. En outre, on peut voir en Reiter un pèlerin de la justice, un juge de l’Histoire et de ses acteurs, un titan qui parcourt le monde comme il parcourt la scène de théâtre, en améliorant les hommes et les comédiens. Il n’y a pas de demi-mesure sur sa route : soit il rencontre les bons et il les aide à optimiser leur vie (son et /ou lumière sur scène), soit il se heurte aux très mauvais et il se contente de les éviter ou de les éliminer (silence et /ou pénombre sur scène). Aussi ne peut-il pas faire connaissance des universitaires parce que ce sont des médiocres, des hommes insignifiants, des vivants rachitiques qui n’utilisent les livres écrits par Archimboldi qu’en vue de gravir des échelons, lors même que cette littérature contient en son sein la capacité d’atténuer le Mal, c’est-à-dire un tout autre dessein que celui que l’Université veut lui attribuer. Pour trouver Archimboldi, pour qu’il daigne nous rendre une visite, il faudrait s’inscrire dans un programme de moralité, ou alors carrément s’abandonner au Mal et ne pas feindre d’être un homme bon quand on ne fait que dissimuler ses vices. On passe à côté d’Archimboldi quand on ne vit qu’à moitié. On fait un bond régressif quand on rase les murs de son âme. Ainsi la pièce s’achève dans un silence de cathédrale après avoir évoqué plus d’une heure durant l’itinéraire de Reiter/Archimboldi. À la bombance d’une vie assez extraordinaire succède la morosité des vies en demi-teinte. Pelletier, Espinoza, Morini et Norton reviennent sur scène, à contretemps, se persuadant qu’ils sont dans les parages d’Archimboldi. Ils se leurrent mais ils ne trompent plus personne. Ils ne comprendront jamais ni Archimboldi, ni la gravité de ce qui se joue à Santa Teresa.Notes
(1) Les dates initialement prévues s’étendaient du 6 février au 13 mars. Cependant, à la demande générale et compte tenu du succès rencontré lors des premières représentations, le théâtre a décidé de se mettre au diapason de l’enthousiasme général et de prolonger les festivités jusqu’au 20 mars, en programmant quatre représentations supplémentaires.
(2) Adorno / Horkheimer, La dialectique de la raison (Éditions Gallimard, coll. Tel, 1983).
(3) Didier Durmarque, Philosophie de la Shoah (Éditions L’Âge d’Homme, 2014).
(4) Hans Jonas, Le concept de Dieu après Auschwitz (Éditions Rivages, 1994).
(5) Cette statistique est fournie par Amnesty International.
(6) Voici les noms de toute l’équipe qui donne vie au 2666 de Roberto Bolaño (à partir de la traduction américaine de Natasha Wimmer). Réalisateur : Robert Falls. Co-réalisateur : Seth Bockley. Les acteurs : Charin Alvarez, Janet Ulrich Brooks, Yadira Correa, Sandra Delgado, Alejandra Escalante, Sean Fortunato, Henry Godinez, Lawrence Grimm, Eric Lynch, Mark L. Montgomery, Adam Poss, Demetrios Troy, Juan Francisco Villa, Jonathan Weir, Nicole Wiesner, ainsi que LaFredta Lusk, Cynthia Cornelius, Velma Gladney, Beatrice Hall et Mary Moran. Assistante des réalisateurs : Samantha Mueller. Chorégraphe pour les scènes de bagarre : Chuck Coyl. Professeur de prononciation : Eva Breneman. Décorateur : Walt Spangler. Costumes : Ana Kuzmanic. Éclairage : Aaron Spivey. Ingénieurs du son et compositeurs : Richard Woodbury et Mikhail Fiksel. Concepteur des projections : Shawn Sagady. Dramaturgie : Tanya Palmer. Régisseurs : Joseph Drummond et Alden Vasquez. Directeur général du théâtre Goodman : Roche Edward Schulfer.
(7) Il est d’ores et déjà prévu deux représentations de huit heures (a priori douze heures avec les entractes) les 18 et 19 juin prochains au grand théâtre Phénix de Valenciennes.
(8) Dans la prononciation anglaise, il est tentant d’entendre «writer» (écrivain) à la place de Reiter.
(9) Jean-Paul Sartre, L’imaginaire (Éditions Gallimard, 1940).
(10) Le théâtre Goodman possède deux salles, la salle Owen, intimiste, et la salle Albert, plus vaste, plus spectaculaire, où se joue du reste en ce moment une production excellente à laquelle nous avons également eu la chance d’assister : Another word for beauty (réalisation de José Rivera).
(11) À ce sujet, nous encourageons le lecteur à consulter la toute récente parution du livre Une colère noire : Lettre à mon fils, de Ta-Nehisi Coates (Éditions Autrement, 2016).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, théâtre, 2666, roberto bolaño, goodman theatre, robert falls, seth bockley, dominique thomas |  |
|  Imprimer
Imprimer