Le grenier de Bolton Lovehart de Robert Penn Warren (03/03/2016)
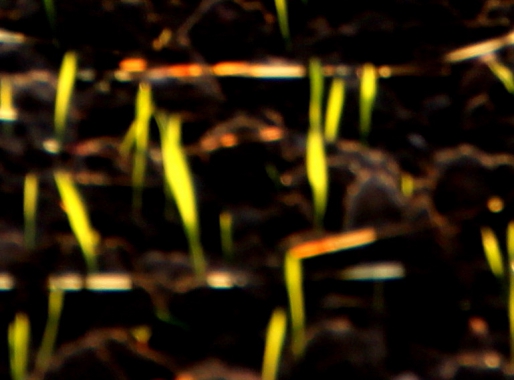
Photographie (détail) de Liz Lauren.
 Robert Penn Warren dans la Zone.
Robert Penn Warren dans la Zone.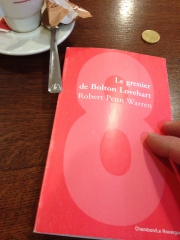 Le Grenier de Bolton Lovehart sur Amazon.
Le Grenier de Bolton Lovehart sur Amazon.Le grenier de Bolton Lovehart (1), intitulé dans sa langue d'origine The Circus in the Attic fait partie d'un recueil de nouvelles (The Circus in the Attic, and Other Stories) qui n'a pas été traduit dans son intégralité en France. Inutile de répéter ce que j'ai écrit sur le scandale que représente la rareté, chez les éditeurs, des grands romans de Robert Penn Warren.
L'ouverture de cette très belle nouvelle m'a fait penser à celle d'un texte de Malcolm Lowry, Écoute notre voix, ô Seigneur, ainsi qu'aux premières pages de Nostromo de Joseph Conrad. L'élan qui anime ces pages lui, fait irrésistiblement songer aux visions tumultueuses de Thomas Wolfe ou plutôt, à la succession incoercible de visions qui sont charriées ce géant, pressé d'englober de son regard, de ses bras, de son écriture, l'ensemble de la création se ruant vers une destination inconnue.
 Le passé est l'époque dans laquelle Bolton Lovehart vit comme, dirait-on, tous les personnages évoqués par Penn Warren dans ce très beau texte énigmatique et, sous un style froid, d'une sensibilité jamais mièvre qui est la marque des plus grands. Le monde a changé, nul ne peut le nier : il suffit de traverser le paysage (les premières pages, brûlées de lumière et de chaleur) qui mènent jusqu'à Bardsville pour s'en rendre compte. Le progrès, comme partout ailleurs, fait rage, nous ne connaissons bien sûr désormais plus qu'une époque pressée pleine des ruines du passé (combien de temps encore tiendront-elles debout ?), ne savons plus rien d'une époque pourtant proche où un homme «vivait dans la maison de rondins avec sa femme et deux enfants, et l'endroit lui appartenait, et c'était tout l'univers» (p. 14), et tel coin perdu comme Bardsville, «siège du comté de Carruthers» (p. 7), a lui aussi changé imperceptiblement, tout comme le vaste monde dans lequel certains s'élancent ainsi que Jasper Parton, mais pas Bolton Lovehart, lui, qui malgré une fugue qui lui fera découvrir, de façon éphémère puisqu'il est dit que Bolton Lovehart ne peut vivre ailleurs que dans son grenier, la vie dans sa commune et sordide brutalité, restera un sédentaire que rien ne distinguera de ses congénères, pas même ses rêves.
Le passé est l'époque dans laquelle Bolton Lovehart vit comme, dirait-on, tous les personnages évoqués par Penn Warren dans ce très beau texte énigmatique et, sous un style froid, d'une sensibilité jamais mièvre qui est la marque des plus grands. Le monde a changé, nul ne peut le nier : il suffit de traverser le paysage (les premières pages, brûlées de lumière et de chaleur) qui mènent jusqu'à Bardsville pour s'en rendre compte. Le progrès, comme partout ailleurs, fait rage, nous ne connaissons bien sûr désormais plus qu'une époque pressée pleine des ruines du passé (combien de temps encore tiendront-elles debout ?), ne savons plus rien d'une époque pourtant proche où un homme «vivait dans la maison de rondins avec sa femme et deux enfants, et l'endroit lui appartenait, et c'était tout l'univers» (p. 14), et tel coin perdu comme Bardsville, «siège du comté de Carruthers» (p. 7), a lui aussi changé imperceptiblement, tout comme le vaste monde dans lequel certains s'élancent ainsi que Jasper Parton, mais pas Bolton Lovehart, lui, qui malgré une fugue qui lui fera découvrir, de façon éphémère puisqu'il est dit que Bolton Lovehart ne peut vivre ailleurs que dans son grenier, la vie dans sa commune et sordide brutalité, restera un sédentaire que rien ne distinguera de ses congénères, pas même ses rêves.Bolton Lovehart vit sans vivre, écrit sans écrire («Il écrivait un livre. Ou plutôt, se préparait à écrire un livre», p. 49) comme Bartleby le scribe, et sa vie insignifiante et étrange «vous renvoie un éclat de soleil comme un héliographe dont vous n'auriez pas le code» (p. 7), mais il ne vit pas moins que d'autres, en apparence seulement plus vivants que lui, héros involontaires (2) comme Seth Sykes, l'ivrogne Cash Perkins ou encore comme l'ancêtre de Bolton, Lem Lovehart qui «avait fini par atteindre les grandes vallées au-delà des montagnes, poussé par un tempérament insatiable et une force obscure qu'il n'aurait pas su nommer» (p. 21). Peut-être est-ce l'image de la perfection qui le hante (cf. p 65) et, en le hantant, le paralyse.
Tous ces hommes, toutes ces femmes (qui finalement semblent bien plus vivantes que leurs compagnons) vivent cependant moins dans le passé que dans le flot d'un temps qui jamais ne s'arrête, comme des particules élémentaires livrées à elles-mêmes qui ne comprennent pas ce qu'elles font (3), et pourtant s'interrogent ou même, comme la mère de Bolton Lovehart au moment de mourir, s'indignent de partir alors qu'il leur restait tant à accomplir. Bolton Lovehart «ne se rappelait rien à cet instant, et ne pensait à rien» (p. 22), remarque ponctuelle qui vaut pour l'ensemble de son existence, alors que d'autres, au moins, comme le «redoutable lascar connu pour ses exploits à la bouteille, au couteau et à cheval» (p. 23) Tolliver Skaggs, peuvent affirmer, crânement : «Je suis arrivé ici très tôt, je suis arrivé dans les premiers. J'ai scalpé le premier Indien. J'ai abattu le dernier ours. J'ai sifflé le premier pichet de whisky, j'ai fumé le dernier ballot de tabac, et j'estime, par Dieu, que j'ai apporté la civilisation dans le comté de Carruthers !» (pp. 23-4).
L'écoulement du temps est remarquablement mimé par le rythme de l'écriture de Robert Penn Warren, qui en quelques pages parvient à faire revivre un petit coin de terre auquel il prête une signification universelle, symbolique, fascinante et inquiétante : telle chienne qui se met à suivre le jeune Bolton qui, énervé, lui lance des pierres, devient «une image de famine moyenâgeuse, d'humilité scabreuse et de mélancolique, d'infinie mansuétude» (pp. 31-2). Cet écoulement est aussi signifié par la modification d'un nom de lieu au fil des ans : «Il arrivait, dans les années quarante et cinquante, quand la structure sociale de Bardsville commençait à se durcir, que les gens qui vivaient alentour appellent la butte «Aristocrat Hill», avec un mélange d'envie et d'ironie. Et le nom, dans la bouche de ceux qui habitaient, non pas près de la place, mais tout en bas le long de la rivière, devint «Ristycrat Hill», puis, sans envie ni ironie, mais à force de passer à travers des dents jaunies et rendues à l'état de chicots dans de gros éclats de rire moustachus, «Rusty-Butt Hill». Et c'était resté «Rusty-Butt Hill» pour tout le monde sauf pour les marchands de biens et les dames qui résidaient dans les anciennes maisons de brique et accompagnaient chaque matin jusqu'au seuil leur époux en partance pour son cabinet d'assurance, son usine, son bureau, sa banque, son entrepôt ou son magasin» (pp. 24-5).
Tous, braves réels ou d'occasion, employés de banques ou, comme Bolton Lovehart, artisans amateurs créant des figurines de bois représentant le monde du cirque qu'il a découvert lors de sa fugue, tous sont pris dans le temps comme s'ils étaient tombés dans le courant puissant d'un fleuve. Ainsi, à les revoir «soixante ans plus tard, on n'a guère l'impression qu'ils se déplacent, mais plutôt qu'ils sont figés dans une photographie sur la page d'un album pour prouver quelque chose de tendre et de certain concernant le passé», et cette même immersion totale dans le temps qui fait prendre conscience à Simon Lovehart, le père de Bolton, du «réseau de vie puissant, vibrant, omniprésent qui relie la femme et l'enfant [sa femme et son fils, donc], vainqueur et victime» et quand il perçoit, poursuit Penn Warren, «la présence de ce réseau et la palpitation du million de sombres tentacules, il se sent comme au bout de quelque chose, debout sur un promontoire, perdu, tandis qu'un vent lointain se lève quelque part dans la nuit derrière lui. Il n'a plus de regrets quand il est là. Il est au-delà des regrets. Si le vent venait à souffler sur lui, il refermerait son manteau et le boutonnerait. Quand il effleure, accidentellement, dans la maison, un seul fil de ce réseau, il se fige et frissonne de tous ses nerfs» (p. 27).
C'est du reste peut-être parce que Simon Lovehart détient la vérité, une balle jamais extraite d'une de ses cuisses, «balle minuscule, pas plus grande et de même forme que l'ongle du pouce, depuis longtemps lavée et rendue comme neuve par son sang», balle qui «repose, précieuse et lourde au chaud et au secret dans l'intimité de sa chair comme un talisman ou un joyaux, et lui dit ce qu'il a besoin de savoir», c'est peut-être parce que Simon Lovehart fait ainsi partie «des bienheureux qui portent en eux l'explication de toute chose», qu'il «peut vivre loin de toutes les passions» (p. 28), comme son fils, Bolton Lovehart, qui fixe sans le comprendre le visage ou plutôt le masque du destin et qui est même peut-être, à sa façon tranquille et énigmatique, une des incarnations de ce même destin aux millions de visages impénétrables.
Lorsque Robert Penn Warren tente de nous indiquer quelle importance peut avoir sa fugue dans l'esprit d'un être tel que Bolton, sa réponse est saisissante : «Si sa fugue avait été bien préparée, il y avait toutefois derrière cette préparation une nécessité aussi impérieuse et aussi peu analysée que celle qui l'avait entraîné dans les eaux de la rivière [pour y recevoir, à son insu presque, le baptême de l'église épiscopale !]. Ou impossible à analyser; car si on l'avait analysée, puis qu'on ait analysé les composantes, n'aurait-on pas été finalement obligé d'affronter, dans l'obscurité la plus profonde», au-delà même, précise Penn Warren, «de tous les projets, intentions et justifications, au-delà de tous les livres qui furent jamais écrits, des histoires et des sermons et des prières et des explications du bien et du mal ou de l'héroïsme et de la lâcheté», le «besoin au visage impavide se balançant dans les ténèbres, enroulé sur lui-même comme le ressort de son être, l’œil sans paupière, l’œil éternel luisant d'un éclat impérieux, scrutant au plus profond de son propre œil avec la fixité hypnotique et impitoyable de la destinée ? (pp. 37-8).
Cet œil ressemble à celui, monstrueux et inexplicable, que Michel Bernanos fait surgir comme vision ultime, impossible comme une illumination noire, avant leur pétrification définitive, des explorateurs de La Montagne morte de la vie, et c'est sous le même soleil ou plutôt œil, nous l'avons dit, incompréhensible et monstrueux, que Robert Penn Warren place ses propres personnages, qui eux aussi considèrent leurs actes et ne les comprennent pas : «Mrs Lovehart le vit [son mari] s'écrouler. Elle se précipita hors de la maison et s'accroupit à côté de lui, sous les chênes, en relevant la tête pour pousser de grands cris d'angoisse qui auraient pu tout aussi bien être de grands cris de triomphe; car nul ne connaît le sens des cris que lui inspire la passion tant que la chair de la passion n'est pas depuis longtemps desséchée pour laisser voir l'austère et logique articulation des faits avec les faits dans le squelette du temps» (p. 43). Autant dire que c'est le romancier, et lui seul, encore plus que l'historien, qui peut démêler les intentions les plus obscures, contempler «le squelette du temps», en éprouvant ce que tel de ses personnages éprouve, une minuscule et éphémère illumination, un instant de déhiscence absolue, «dans la fusion et la contraction du temps, la pure, l'essentielle stupéfaction de la paix qui succède soudain au tumulte» (p. 44).
Robert Penn Warren, tout du moins son narrateur, voit ce que ses personnages ne voient pas, mais il n'est pas certain qu'il puisse voir autre chose qu'une aporie, l'absence de toute vision qui le laissera insoumis, inquiet et désireux, une fois de plus, de se mettre à la recherche de la vérité, qui seule permet à l'homme qui l'a découverte de «vivre loin de toutes les passions» (p. 28). Sara Darter se donne à Bolton Lovehart, avant de le quitter définitivement et d'en épouser un autre, et voici ce que nous savons et qui est fort maigre des raisons de sa décision : «Ce projet de départ toutefois, lui était venu brusquement à l'esprit, comme une révélation, la veille de sa dernière soirée avec Bolton Lovehart. L'ultime rencontre avec lui ne faisait pas partie du projet. Ou alors comme quelque chose qui ne s'était pas montré à la surface du fleuve, là où les scories du quotidien tournoient et s'accumulent en pleine lumière, mais se laissait ballotter par l'eau sombre et profonde au cœur même du courant, comme un vieux bout de bois noirci et gorgé d'eau, repris à la vase, et poussé en secret vers les rapides qui fusaient entre les rochers, là où les eaux bouillonnantes se précipitaient dans un dernier accès de fureur sur les calmes biefs de l'aval, et où dans la violence de cet ultime étranglement l'incontrôlable fardeau intérieur poussait et se soulevait, noir, brut, énorme et ruisselant, comme un poisson arraché à son trou d'eau et qu'on hisse en pleine lumière» (p. 56).
Obscurité, profondeur, sauvagerie, œil sans paupière qui se regarde mais aussi «miroir à l'intérieur du miroir réflecteur»; réalités contraires (vengeance et expiation) «à jamais opposées, à jamais orientées vers le dedans de soi et à jamais vers le dehors du monde, deux infinités jumelles» (p. 57); mots d'une autre que la mère de Bolton Lovehart entend lorsqu'elle comprend qu'elle va mourir, ces mots d'une autre qui ne sont portant que ses propres mots d'indignation et de peur face au gouffre noir, lancés contre cette «bestiole hypocrite et sournoise, ce coeur qui la trahissait» (p. 69) : autant d'exemples nous prouvant que la connaissance, pourtant synonyme de pouvoir selon l'auteur (cf. p. 73), est définitivement éloignée de nos personnages humbles et banals, qui semblent ne rien savoir ni comprendre d'eux-mêmes, sinon soupçonner, parfois, qu'ils ont été jetés dans le fleuve du temps qui jamais ne leur accordera plus que quelques courts instants de paix sur une berge elle-même instable.
Notes
(1) Robert Penn Warren, Le grenier de Bolton Lovehart (The Circus in the Attic, 1947, traduit de l'américain par Pierre Girard, Chambon / Le Rouergue, 2004). Je signale une bizarrerie fâcheuse, la mention, à la page 77, d'une date («automne 1917») qui est totalement incohérente avec les pages qui la précèdent et celles qui la suivent, qui décrivent la Seconde Guerre mondiale où Jason Parter, le fils de la femme que Bolton Lovehart finira par épouser, trouvera la mort.
(2) «Car Seth et Cassius n'étaient peut-être pas différents de tous les autres héros», affirme ainsi Robert Penn Warren, «des hommes ivres de whisky, ou de quelque chose de tout aussi fort qui vous monte au cerveau, et qui se jetèrent à la tête de l'ennemi, ou moururent en défendant un chargement de grain, ou n'importe quoi d'autre, produit à la sueur de leur front» (pp. 19-20).
(3) Ainsi de Lem Lovehart : «Puis il se coucha dans l'herbe, dans le grand silence que rompait de temps à autre le gazouillement liquide, somnolent, d'un rouge-gorge, ou une dernière explosion de cris d'oiseaux dans les cèdres, et sans raison apparente son cœur mollit et enfla dans sa poitrine et il pleura» (p. 22).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, le grenier de bolton lovehart, robert penn warren, éditions chambon le rouergue |  |
|  Imprimer
Imprimer