« Kant et le problème de l’éducation : suggestions pour l’édification d’un homme moral, par Gregory Mion | Page d'accueil | On ne voit décidément plus rien, ni Dieu ni diable, sans Daniel Arasse »
28/03/2015
De la Mort au matin de Thomas Wolfe
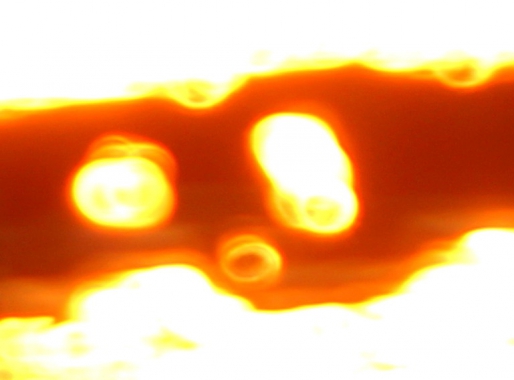
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Dans sa Préface à De la Mort au matin (From Death to Morning, Scribner's sons, New York, 1935), André Bay écrit que la «littérature américaine est plus qu'aucune autre imparfaite mais vivante. Comme Whitman, Thomas Wolfe se déclame, se crie plutôt qu'il ne se lit. C'est le flux même de la vie toute chaude qui bouillonne et palpite dans son œuvre. Ce flot de mots est un flot de globules rouges lancés à la conquête de la vie et de l'infini» (1). Je ne suis pas certain que, malgré l'excellente qualité de la traduction réalisée par Vorce et Raimbault, bien connus des amateurs de littérature nord-américaine, le lecteur doive crier le texte de Thomas Wolfe, sa lecture silencieuse pouvant tout aussi bien convenir, sinon mieux, qu'une lecture à haute voix, à l'évocation de la puissance, en effet réelle, et nous immerger dans un flux de mots, de mouvements incessants et d'une profondeur dont, pour l'heure, le monde des lettres ne semble point s'être émue, à quelques rares exceptions.
Dans sa Préface à De la Mort au matin (From Death to Morning, Scribner's sons, New York, 1935), André Bay écrit que la «littérature américaine est plus qu'aucune autre imparfaite mais vivante. Comme Whitman, Thomas Wolfe se déclame, se crie plutôt qu'il ne se lit. C'est le flux même de la vie toute chaude qui bouillonne et palpite dans son œuvre. Ce flot de mots est un flot de globules rouges lancés à la conquête de la vie et de l'infini» (1). Je ne suis pas certain que, malgré l'excellente qualité de la traduction réalisée par Vorce et Raimbault, bien connus des amateurs de littérature nord-américaine, le lecteur doive crier le texte de Thomas Wolfe, sa lecture silencieuse pouvant tout aussi bien convenir, sinon mieux, qu'une lecture à haute voix, à l'évocation de la puissance, en effet réelle, et nous immerger dans un flux de mots, de mouvements incessants et d'une profondeur dont, pour l'heure, le monde des lettres ne semble point s'être émue, à quelques rares exceptions. Thomas Wolfe est un géant taillé pour l'énormité, et ne semble jamais aussi à l'aise que lorsqu'il s'agit, en quelques mots ou bien en longues phrases, de décrire le mouvement incessant qui anime les foules de New York, sa ville romanesque d'élection, comme en témoigne la nouvelle ouvrant le recueil, intitulée Point de porte : «Eh oui, il y a eu assez de temps, même à Brooklyn il y a assez de temps étrange, obscur, secret, assez de temps mystérieux aux millions de visages, qui coule constamment devant nous comme un fleuve, même dans les sous-sols de Brooklyn il y a assez de temps, mais, quand vous essayez d'en parler à cet homme, vous ne le pouvez pas, car qu'y a-t-il à dire ?» (p. 28). Temps, mouvement et langage ont partie liée chez Thomas Wolfe, et aussi le secret qu'il faut moins percer qu'indiquer, et qui constitue le nœud gordien reliant ces autres dimensions entre elles, l'écriture ne cessant jamais de faire la navette si je puis dire entre ces prodigieuses masses qui attirent le romancier comme un puissant aimant : «Alors, pendant un instant, le vieux mystère impénétrable du temps et de la ville revient accabler votre esprit d'horribles sensations de défaite et de noyade», ce «temps aveugle, immémorial et sans date» qui vous «donne l'impression de vous noyer dans une mer d'horreur» (p. 21), ce temps dans lequel les foules, les villes, tout le monde moderne et sa formidable expansion ou bien fuite selon Max Picard, sont plongés, avec le romancier bien sûr, celui qui est emporté par les flots mais tente coûte que coûte de lutter contre le courant, c'est-à-dire de le remonter, pour approcher du mystère : «Et vous allez commencer de raconter tout cela à votre hôte, ce que vous avez vu et ressenti ce soir-là, l'odeur et le goût du vaste quai désert, les dernières lueurs du jour sur les vieilles briques rouillées des masures branlantes, et la flamboyante splendeur de ce tissu foisonnant de lumière et de couleur sur la haute proue du navire; mais, au moment de lui parler de cela, vous ne le pouvez pas, vous ne retrouvez plus la sensation de mystère, d'exaltation et de farouche tristesse que vous éprouviez alors» (p. 24).
Thomas Wolfe est un géant taillé pour l'énormité, et ne semble jamais aussi à l'aise que lorsqu'il s'agit, en quelques mots ou bien en longues phrases, de décrire le mouvement incessant qui anime les foules de New York, sa ville romanesque d'élection, comme en témoigne la nouvelle ouvrant le recueil, intitulée Point de porte : «Eh oui, il y a eu assez de temps, même à Brooklyn il y a assez de temps étrange, obscur, secret, assez de temps mystérieux aux millions de visages, qui coule constamment devant nous comme un fleuve, même dans les sous-sols de Brooklyn il y a assez de temps, mais, quand vous essayez d'en parler à cet homme, vous ne le pouvez pas, car qu'y a-t-il à dire ?» (p. 28). Temps, mouvement et langage ont partie liée chez Thomas Wolfe, et aussi le secret qu'il faut moins percer qu'indiquer, et qui constitue le nœud gordien reliant ces autres dimensions entre elles, l'écriture ne cessant jamais de faire la navette si je puis dire entre ces prodigieuses masses qui attirent le romancier comme un puissant aimant : «Alors, pendant un instant, le vieux mystère impénétrable du temps et de la ville revient accabler votre esprit d'horribles sensations de défaite et de noyade», ce «temps aveugle, immémorial et sans date» qui vous «donne l'impression de vous noyer dans une mer d'horreur» (p. 21), ce temps dans lequel les foules, les villes, tout le monde moderne et sa formidable expansion ou bien fuite selon Max Picard, sont plongés, avec le romancier bien sûr, celui qui est emporté par les flots mais tente coûte que coûte de lutter contre le courant, c'est-à-dire de le remonter, pour approcher du mystère : «Et vous allez commencer de raconter tout cela à votre hôte, ce que vous avez vu et ressenti ce soir-là, l'odeur et le goût du vaste quai désert, les dernières lueurs du jour sur les vieilles briques rouillées des masures branlantes, et la flamboyante splendeur de ce tissu foisonnant de lumière et de couleur sur la haute proue du navire; mais, au moment de lui parler de cela, vous ne le pouvez pas, vous ne retrouvez plus la sensation de mystère, d'exaltation et de farouche tristesse que vous éprouviez alors» (p. 24). L'impuissance du langage, vieux thème s'il en est qui n'aura bien évidemment pas empêché Thomas Wolfe d'écrire quelques-uns des plus volumineux romans d'Amérique du Nord, et peut-être même du monde, ni de faire fulgurer de somptueuses images (2) qui trouent ses longues descriptions comme des éclairs déchirant des pans entiers de la réalité, et nous donnent à voir ce qui d'ordinaire reste invisible, la muette compénétration de ce qui a été et de ce qui est et sera, le monde passé, présent et futur enfoui dans les réserves du temps, où l'écriture s'abouche comme un puits de forage au-dessus d'une gigantesque poche de pétrole : «Et maintenant, la lueur rougeâtre sur la vieille brique rouge des maisons couleur de rouille s'efface rapidement; il y a des voix dans l'air, de la musique quelque part, et nous gisons là, aveugles atomes, dans nos sous-sols, atomes incolores et muets dans le désert fourmillant du monde, et nous passons inaperçus, nos noms sont oubliés, nos intelligences s'effondrent comme un terrain miné; tandis que nous restons là étendus dans le soir et que le fleuve continue de rouler... et le temps noir nous ronge les entrailles comme un vautour, nous nous savons perdus et ne pouvons bouger... et là il y a des bateaux ! il y a des bateaux !... et, mon Dieu, nous sommes tous en train de mourir dans les ténèbres !...» (p. 30).
Errance des personnages (cf. p. 53) de Thomas Wolfe, toujours décrits comme des étrangers «sous un ciel étranger, au cœur de l'énorme ville indifférente» (p. 37), elle-même submergée par une foule immense, anonyme, toujours en mouvement, qui mime, dans son infatigable déplacement, le temps qui ne peut s'arrêter, sauf peut-être lorsque l'écriture lui ordonne, l'espace d'un battement de cil dont nous tirons orgueil, de s'arrêter : «D'un bout à l'autre de la grande rue, aussi loin que pouvait s'étendre la vue, la foule se déroulait comme les lentes et sinueuses évolutions d'un énorme serpent aux couleurs éclatantes. Elle semblait glisser, progresser, s'arrêter, s'enfler, se tordre à un endroit, s'immobiliser ailleurs, en une ondulation gigantesque et rythmique, d'une infinie et ahurissante complexité, mais qui paraissait pourtant avancer vers quelque but et quelque activité essentiels et inexorables. Tel était, de loin, l'aspect de cette grouillante marée d'êtres humains, mais, quand on passait tout près d'elle, ce tout se fragmentait en un million de petits tableaux et de petits drames vécus, colorés, éclatants, vivants, qui me paraissaient tous maintenant si naturels, si familiers, que j'avais l'impression de connaître tous ces gens, de tenir dans ma main toute la chaude et palpable substance de leur vie, de connaître et posséder la rue même, comme si j'en eusse été le créateur» (p. 43).
Il est évident que Thomas Wolfe, comme tant d'autres romanciers nord-américains dont la première qualité est la puissance, au premier rang desquels il ne faut pas craindre de placer William Faulkner et Robert Penn Warren, animant de puissantes foules et contemplant leur reptation infinie comme s'il n'était qu'un œil panoramique, peut à bon droit se croire le grand ordonnateur des mouvements qui animent le cœur mystérieux de la vie, que l'on entend battre au loin sans jamais pouvoir s'en approcher, car il nous englobe, il ceint le visible et l'invisible, les vivants et les morts, et qu'il est partout, y compris bien sûr dans l'écriture chargée de tout dire, le visible et l'invisible : «Je songeais que, peut-être, les cendres du grand César servent à boucher la fente d'un mur, que nos vies touchent à toutes les autres vies qui furent jamais vécues, que tout facteur insoupçonné, toute vie inconnue, toute parole perdue, tout pas dont ces pavés ont perdu le souvenir, ont vibré quelque part dans l'air qui nous entoure» (p. 46).
De fait, l'appétit de Thomas Wolfe est insatiable, et c'est toute la réalité qu'il voudrait étreindre, comme un homme désireux de retenir la maîtresse volage, ou bien amoureuse mais déjà corrompue par la mort qui gagne, la déchéance, la fatigue aussi, la banale désunion, le temps qui passe comme on dit, tout bonnement l'ennui : «Quelque chose de nous tous, le sublime et l'abject, le vil et l'héroïque, le rare, le commun, le glorieux, gît ici, mort, au cœur de la ville immortelle, et le destin de tous les vivants, oui, des rois de la terre, des princes de l'esprit, des plus puissants maîtres du langage et des immortels créateurs de vers, toute l'espérance, la faim et la soif que peut contenir d'incroyable façon l'étroite prison d'un crâne, et qui peuvent disloquer et broyer le logement exigu qui le contient, tout cela est écrit ici sur cette piètre figure de putride argile» (pp. 56-7).
Et c'est donc bien cette «putride argile» de laquelle il ne faut jamais s'estimer quitte, qu'il ne faut jamais mépriser mais bien au contraire embrasser du regard et du langage, humiliés et offensés tous réunis, protégés peut-être, sous l'arche de la parole, comme un fragile navire de Noé voguant sur la mer déchaînée du bruit et de la fureur : «Les hommes attablés appartiennent pour la plupart à cette catégorie d'êtres de classe indéfinie, qui flottent à la dérive, turbinent, errent, crèvent de faim, tantôt en prison, tantôt libérés, tantôt dégoûtants, crasseux, misérables, affamés, malchanceux, voyageant sur les tampons, dans les voitures déglinguées des trains de marchandises, happant leur pitance, la nuit, dans quelque rue chaude de la jungle des trimardeurs, tantôt faisant les farauds avec l'argent d'une éphémère prospérité, vagabonds, chemineaux, demi-clochards, cette classe innombrable, sans nom, sans foyer, déracinée, hétéroclite, qui grouille à travers la nation entière», voilà de quel courant il ne faut jamais se tenir à l'écart, dans lequel, au contraire, il ne faut pas craindre de plonger, car ils sont, tous ces hommes, «la cendre de l'humanité. Repoussants, minables, figure ridée et couturée, visage trivial, morne et émacié, tels qu'ils sont, ils ont l'air de s'être glissés ce matin de leur wagon de marchandises dans la gare d'une autre ville, ou d'être descendus dans la matinée d'une voiture de 3e classe, jetant autour d'eux un regard machinal et indifférent, porteurs d'une valise de carton contenant deux faux-cols et une cravate. Mais en eux est inscrite la légende des grandes distances» et, précise Thomas Wolfe, «une sorte de désolation moléculaire», car chacun d'eux «est une particule humaine de la rouille vagabonde et dénuée sous la désolation des cieux qui s'incurvent au-dessus de lui, sans abri sur le vaste et sauvage désert du monde à travers lequel il est précipité», comme «une molécule de gris sale et de brun terne cramponnée aux tampons d'un train de marchandises», ou bien encore, continue Wolfe, «une sorte de cendre humaine projetée à travers l'espace, sans défense, sans attache et sans nom, pour ainsi dire vidée de tout ce qu'il y avait en son existence d'individuel et de particulier, dans cet immense néant de rouille, de fer et de déchets, de distances solitaires et muettes, dans laquelle elle subsiste, à travers lequel elle a si souvent été précipitée», et les dernières lignes de ce long extrait ajoutent que «cet atome, peut-être, rencontre enfin sa destinée, en quelque lieu inconnu sur la face sauvage de la terre, pulvérisé, une tache de sang sur le ballast de pierre, un cri perdu dans le grondement des roues pesantes, un enroulement d'entrailles autour des essieux, un bref et confus éclaboussement de sang, d'os et de cervelle sur les traverses de bois, ou simplement un vieux tas informe et souillé de brun et de gris échoué au matin sous un misérable porche, sur la chaussée d'une ville, sous la substructure du métro aérien, une masse de haillon et d'os, maintenant froide et sans vie, que la police doit enfourner dans une voiture et soustraire à la vue, oubliée et sans nom dans sa mort comme dans sa vie» (pp. 81-2), «sans nom dans sa mort comme dans sa vie» mais pourtant nommée dans le texte de Thomas Wolfe, obsédé par le fait qu'une seule particule puisse échapper à la formidable mâchoire de son écriture, ne cessant de quêter les figures fuyantes par lesquelles l'humanité se donne, du moins durant quelques courtes secondes, dans son absolue et téméraire fragilité : «Il ne la revit plus jamais. Elle fut engloutie dans le vaste tourbillon de la guerre, dans le noir et vertigineux abîme, dans le grouillant chaos de l'Amérique, cette terre immense, cruelle, impassible, enchantée, où nous avons tous vécu et marché comme des étrangers, où, tous, nous avons été si petits, si seuls, si perdus, qui, enfin, nous a tous engloutis, et dans le sein ténébreux et désolé de qui tant d'hommes perdus et sans nom gisent enfouis et oubliés» (p. 88), les femmes et les hommes, si nombreux dans les textes de Thomas Wolfe et singulièrement dans la nouvelle intitulée Le Visage de la guerre de laquelle le texte précédent est extrait, apparaissant comme des lueurs tremblantes cernées de grandes masses de ténèbres que troue l'écriture comme un foret d'une longueur démesurée, et qui semble pouvoir creuser un trou sans fin, pour déboucher sur quelle vérité toujours fuyante ?
Ce que Thomas Wolfe n'arrête jamais, au fond, de proclamer, c'est l'absolue cohérence, et peut-être ressemblance, entre le temps, la vie et le langage : «il constatait soudain, comme jamais il ne l'avait fait auparavant, l'accablante unité de ce déjà connu, ce que signifiait cette identité des êtres humains qui relie tous les peuples de la terre et qui tire son principe des conditions mêmes de la vie, bien au-delà de la langue que parle un homme, de la race à laquelle il appartient» (p. 105). Il est étonnant de constater qu'un tel sentiment d'universalité n'est absolument pas le contraire de l'impression d'appartenir à une terre, considérée comme étant la patrie perdue, telle que l'écrivain la dépeint dans une nouvelle intitulée Dans la sombre forêt, mystérieuse comme le temps : «C'est le sentiment écrasant d'une découverte immédiate, imminente, tel qu'en éprouvent ceux qui pénètrent pour la première fois dans la patrie de leurs aïeux. C'est comme si l'on pénétrait dans cette contrée inconnue après laquelle nos imaginations soupiraient si passionnément lorsque nous étions jeunes, qui est la partie obscure de notre âme, le frère étranger et le complément du pays que nous avons connu dans notre enfance. Et, au moment où nous l'apercevons, se révèle instantanément à nous avec la puissante et émouvante plénitude d'une chose que l'on reconnaît sans y croire, avec cette réalité fantasque faite d'inconnue et de connu, qu'ont tous les rêves et les enchantements». Thomas Wolfe, si peu maître de ce genre de longue envolée lyrique, ne peut s'empêcher de continuer, écrivant : «Qu'est-ce donc ? Quelle est cette joie forcenée et farouche, cette tristesse qui gonfle nos cœurs ? Quel est ce souvenir que nous ne pouvons formuler, cette reconnaissance instantanée qu'aucun mot ne peut exprimer ? Nous ne saurions le dire. Nous n'avons nul moyen de le faire comprendre, nul témoignage cohérent qui puisse le prouver, et l'on pourrait nous le reprocher, avec un ironique mépris, comme une absurde superstition. Et pourtant, au moment même où nous y entrerons, nous reconnaîtrons ce sombre pays, et, bien que nous ne puissions exprimer, prouver ou faire saisir ce que nous éprouvons, nous avons ce que nous avons, nous savons ce que nous savons, et nous sommes ce que nous sommes», cette apparente aporie se concluant ainsi : «Et que sommes nous-nous ? Nous sommes les hommes déshérités, les Américains perdus. Des cieux immenses et déserts étendent leur voûte au-dessus de nous, nous charrions dans notre sang celui de dix millions d'hommes. D'où viennent-ils, cette impression de l'inconnu immédiatement reconnu, ce souvenir, qui nous hantait comme celui d'un songe et que nous arrivons presque à fixer ?» (pp. 107-8).
Dans Quatre hommes perdus, le ton de Thomas Wolfe se fait plus que jamais lyrique. Ce ne sont pas des personnages qui sont évoqués, ou si peu, mais de grands ensembles : la nuit, la guerre, «le mystère énorme de la terre» (p. 116), le passé évoqué par la «rhétorique exaltée» du père du narrateur qui lance «contre le temps présent et ses chefs» la foudre de son verbe «qui tonitruait, montait, descendait, envahissait la nuit, violait tous les coins de l'ombre avec cette puissance de pénétration qu'avait eue sa voix aux jours anciens» (p. 118), la masse des morts, dont les «figures, solennellement inexpressives et barbues, se mélangeaient, se confondaient, flottaient ensemble dans les profondeurs marines d'un passé aussi inconnaissable que la ville enfouie de Persépolis» (p. 121), la terre nord-américaine, silencieuse, solitaire, exaltée, qu'il s'agit, toujours, de dire, dont il faut s'efforcer de trouver le chiffre énigmatique au moyen de l'écriture : «Pont, haie, ruisseau et route poussiéreuse, simple et émouvante poésie du Moulin Wilson, où des soldats sont morts ce matin dans le champ de blé, indiciblement proche et lointaine, étrangère et domestique, humble et enchanteresse, pour laquelle un mot suffirait si nous pouvions le trouver, pour laquelle un mot suffirait si nous pouvions le formuler, pour laquelle un mot suffirait qui ne pourra jamais être formulé, qui ne pourra jamais être oublié, qui ne sera jamais révélé» (p. 125), l'errance enfin, la solitude existentielle fondamentale qui est la condition de l'homme, grande thématique sur laquelle se ferme ce beau texte (cf. p. 131).
Si la nouvelle suivante, intitulée Gulliver, ne présente pas un grand intérêt puisqu'elle évoque les difficultés, moins comiques qu'on ne le pense, du géant qu'était Thomas Wolfe, la nouvelle intitulée Clochards au coucher de soleil, ressemble, dans sa forme fulgurante et ses non-dits (comme ces mots que le personnage surnomme le Taureau dit au jeune homme, et qui ne nous sont pas rapportés) à l'ébauche d'un roman ou à quelque page de texte solitaire qui jamais ne se transformera en longue nouvelle.
De près et de loin est une courte parabole philosophique qui brasse intelligemment les thématiques de la vitesse, de la distance, du passé et des distorsions que sa perception implique, alors que dans la nouvelle suivante, Dans le parc, la voix de Thomas Wolfe devient de nouveau totalisante, fondant, comme dans les films de Terence Malick, la création en un vaste organisme dont tous les éléments sont dépendants les uns des autres, l'homme devant s'efforcer de comprendre et d'accueillir «la promesse inouïe» consistant dans la certitude de savoir «qu'il allait arriver on ne sait quoi de formidable, d'extraordinaire, qui participait de la nuit, du mystère et de la joie de vivre, du ravissement de l'obscurité violette, ainsi que toutes les odeurs des fleurs, des feuilles, de l'herbe et de la terre participaient d'elles» (p. 175).
La terre, mais aussi les phénomènes les plus extrêmes que sont la souffrance, la guerre ou même la mort, Thomas Wolfe nous enseigne qu'ils ne peuvent être rejetés par l'homme, encore moins maudits, puisqu'ils participent de son essence et même, plus intimement, sont composés de sa propre substance. Qu'importe que l'immense paysage, comme chez Cormac McCarthy, présente un visage indéchiffrable, hostile, à ceux qui le traversent, puisque pour le romancier, la vie de tout homme, fût-il le plus humble, est consubstantielle aux éléments, ne saurait être quelque principe individué qui leur serait opposé : «Vers l'Ouest, dans de grandes collines qu'il n'avait jamais vues, l'ombre des nuages passa sur l'immémoriale solitude, les arbres s'abattirent avec fracas dans la nuit parmi les remous bouillonnants des eaux profondes et limpides, il y eut la lueur brève et clignotante de millions de petits yeux, le frôlement, le tumulte confus, le ululement mélancolique des ténèbres; il y eut le tonnerre des ailes, la symphonie du désert, mais il n'y eut plus le pas d'un pied botté» (p. 189), l'Espagnol borgne explorant le Catawba qui lui-même fait partie de la «trame de la vie» (le titre de la dernière nouvelle composant ce recueil, de très loin la plus longue, la seule qui ne s'attache qu'à décrire des personnages et ce qui leur est arrivé, la plus faulknérienne en somme), la véritable histoire de cette terre étant celle «de millions d'hommes vivant et mourant seuls dans le désert», l'histoire de «milliards d'actes et de circonstances de leur vie passés inaperçus et tombés dans l'oubli; elle est l'histoire du soleil, de la lune et de la terre, de la mer qui écume éternellement contre ces côtes désolées, et du grand arbre qui s'abat avec fracas dans ces solitudes lointaines du désert», elle est encore l'histoire «de millions d'hommes vivant seuls dans le désert [...], qui ont vécu leurs courtes vies dans le silence sur la terre éternelle, qui ont écouté la terre et connu ses voix innombrables, dont la vie a été consacrée à la terre, dont les os et la chair sont redevenus la substance de la terre, de la terre immense et terrible qui garde ses secrets» (p. 196), ces secrets que Thomas Wolfe nous apprend à ne point considérer comme hostiles à l'homme car, finalement, ils participent eux aussi à l'errance qui emporte tout, hommes, terre, mer, feu et nuit, souvenirs et hommes, parole.
Notes
(1) De la Mort au matin (Stock, coll. Librairie cosmopolite, traductions de R. N. Raimbault et Ch. P. Vorce, 1987), pp. 11-2.
(2) «Car vous êtes ce que vous êtes, vous savez ce que vous savez, et il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'est la solitude, la noire, la douloureuse solitude, qui ronge, la nuit, les racines du silence» (p. 28).






























































 Imprimer
Imprimer