Heidegger et Maurras à Athènes, par Baptiste Rappin (09/06/2016)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
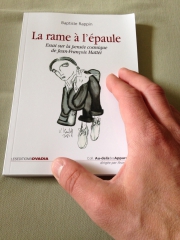 Acheter La rame à l'épaule. Essai sur la pensée cosmique de Jean-François Mattei de Baptiste Rappin sur Amazon.
Acheter La rame à l'épaule. Essai sur la pensée cosmique de Jean-François Mattei de Baptiste Rappin sur Amazon.«Gloire aux Homérides ! Ils ont surpris le grand secret qui n’est que d’être naturel en devenant parfait. Tout art est là, tant que les hommes seront hommes».
Maurras, Anthinéa (1954), p. 172.
«La langue est la poésie originelle, dans laquelle un peuple dit l’être. Inversement, la grande poésie, par laquelle un peuple entre dans l’histoire, est ce qui commence à donner forme à la langue de ce peuple. Les Grecs, avec Homère, ont créé et connu cette poésie».
Heidegger, Introduction à la métaphysique (1967), p. 176.
 On ne voudrait pas faire croire à nos lecteurs que les lignes qui suivent établissent une comparaison, critère après critère, preuve après preuve, entre le félibre martégal et le penseur souabe. Qui souhaiterait en effet faire disparaître la singularité de ces deux commencements dans un jeu d’assimilation dont l’issue est aussi louche qu’incertaine ?
On ne voudrait pas faire croire à nos lecteurs que les lignes qui suivent établissent une comparaison, critère après critère, preuve après preuve, entre le félibre martégal et le penseur souabe. Qui souhaiterait en effet faire disparaître la singularité de ces deux commencements dans un jeu d’assimilation dont l’issue est aussi louche qu’incertaine ? Oui, de ces «deux commencements» : car il y a bien de la natalité, selon l’expression de Hannah Arendt, aussi bien chez Maurras que chez Heidegger. Un pouvoir des aurores, celui des bâtisseurs; une autorité qui inaugure et fait croître, celle des génies de la pensée; une tradition de la maîtrise, celle des esprits supérieurs. Commencer, ce n’est pas seulement être une origine, c’est plutôt se tenir près de l’Origine, dans l’Origine, être irrigué de son jaillissement et séjourner dans le monde qui en sourd. Commencer, ce n’est pas seulement ouvrir une brèche, c’est se tenir dans la brèche, dans l’interstice des débuts, qui commandent leur suite rappelle Socrate à Glaucon dans La République, et l’œuvre, entre le monde et le langage, entre l’Un et le multiple. Maurras et Heidegger sont à la fondation de la pensée car ils accouchent d’une pensée de la fondation, fidèles en cela à la pensée et à la fondation de la civilisation européenne.
On ne s’étonnera donc guère de les voir s’embarquer et partir tous deux en quête de l’Origine, en Grèce, à Athènes, retrouver les parfums de la naissance et l’éclat hiératique des propylées. Revenir pour mieux repartir, se ressourcer pour mieux irriguer, s’enraciner pour mieux s’élever. Avec l’Odyssée en guise de lecture pour Maurras («Le vieil Homère, dont je ne me sépare jamais et qui est mon prophète […]», écrit Maurras dans sa première lettre d’Anthinéa), avec Ithaque comme première destination pour Heidegger («Là-dessus on commença dans l’après-midi à apercevoir les baies boisées d’Ithaque» raconte le philosophe dans ses Séjours, 1992b, p. 21). Et ce qui frappe dans les deux cas, c’est la description des colonnes des temples grecs, dont l’enracinement dans le sol n’a d’égal que l’élancement vers le ciel. Pour Heidegger (1992b, pp. 26-27), à Olympie en pleine vallée de l’Alphée, «les soubassements des temples consacrés à Héra et à Zeus d’une taille surprenante, les énormes tambours de colonnes fauchés par quelque force surhumaine mais qui, même à terre, gardaient encore en eux leur capacité de soutènement et d’élévation en hauteur – tout cela n’avait rigoureusement rien à voir avec un simple empilage de blocs d’une taille monstrueuse». Maurras (1954, pp. 191-192), quant à lui, relate l’expérience intense et intime qu’il vécut sur l’Acropole lorsque, parvenu au sommet des escaliers et se trouvant face à la première colonne des Propylées, il l’aperçoit «toute dorée, mais toute blanche, jeune corps enroulé d’une étoffe si transparente qu’on n’en saisit point la couleur, la chair vive y faisant elle-même de la lumière». Vient alors le même sentiment, déjà relevé chez Heidegger, d’un mouvement qui allie la profondeur à la hauteur, l’assise à l’élévation : «Elle montait des solides dalles de marbre, ferme sur sa racine élargie à la base», avant que le félibre ne l’étreigne puis ne l’embrasse discrètement, à l’abri du regard des touristes américains : «[…], prenant grand soin que l’on me crût en train de mesurer la circonférence, je la baisai de mes lèvres comme une amie».
La Grèce, avant que d’être la terre de la philosophie, fut et restera d’abord le royaume d’Homère, celui des exploits et du talon d’Achille, celui des épreuves et du destin d’Ulysse et de Pénélope. «Il n’y a presque rien qui ne soit grec chez Maurras» affirme ainsi justement Boutang dans sa célèbre biographie (1993, p. 77) tandis que Mattéi assure que «la parole essentielle de Heidegger est, de part en part, mythique» (1989, p. 195). Rien de moins injustifié, et d’absurde, que de vouloir ainsi saisir le tuf de leur œuvre dans la matiera primera grecque dont ils sauront se faire, malgré le stupide XIXe siècle et son rejeton totalement dément, les alchimistes avertis.
La philosophie ne fera en effet rien d’autre que passer la navette de la raison entre la chaîne et la trame de la tapisserie mythique – Maurras autant que Heidegger l’ont parfaitement saisi : héritière de l’Odyssée, elle se pratiquera sur le mode du va-et-vient, comme chez Plotin qui voit le monde alterner entre les mouvements de procession et de conversion; fille de l’Iliade, elle prendra la forme du Polemos chez Héraclite, et restera encore pour Kant un «champ de batailles». Le rationalisme ratiocineur et le logos logorrhéique étouffèrent de leur poids et de leur bêtise cette vérité native que la raison ne saurait à elle-même se donner sa propre fin, et qu’elle s’origine à tout jamais, qu’on le veuille ou non, dans la puissance des symboles. C’est ainsi, et Descartes n’arrivera pas plus à se débarrasser des analogies de la fondation que Hegel ne se privera des références à l’étoile polaire.
Quel est donc le commencement du commencement ? Par quel miracle s’ouvrent les deux magnifiques poèmes de la colère et du voyage ? Ouvrons, et lisons plutôt, ainsi que Heidegger le fait lui-même dans son cours sur Parménide (2011, p. 204) :
«Déesse, chante-nous la colère d’Achille, de ce fils de Pelée […]».
«C’est l’homme aux mille tours, Muse, qu’il faut me dire, Celui qui tant erra […]».
S’agit-il simplement, banalement, d’invoquer les dieux et les muses pour se placer sous leur protection, à l’instar de ces rituels sclérosés dont la répétition mécanique vide le geste de son sens et sa portée ? S’agit-il prosaïquement d’une formule de politesse et d’une habitude qui ne requerraient pas plus que cela notre attention ? Le philosophe écarte pourtant cette possibilité au nom d’une inversion des termes : loin que le poète invoque la déesse pour qu’elle se fasse à sa demande l’intercesseur des mondes, il se trouve bien plutôt appelé, interpelé, par le chant de l’être dont il doit se faire l’interprète. La compagnie des muses est garante de la présence de la parole, et de l’œuvre de façon plus générale; ainsi, lorsque le Phidias du Chemin de Paradis (1954, pp. 37-38), occupé à tailler le bas-relief des neuf Muses, croit pouvoir se passer de la divinité, bravant sa condition de mortel et déclarant : « Je veux que l’on me mette en croix si jamais Muse m’instruisit à tenir le poinçon», avant de répéter par trois fois : «Si jamais Muse m’assista je veux être mort tout à l’heure», alors les déesses sans hésiter se retirèrent de l’œuvre et quittèrent le jardin, laissant la matière à son informité ainsi que cela se produit à chaque fois que l’âme n’anime plus le corps. Quelle incroyable scène ! : «Un soupir grave, long, profond et déchirant, s’exhala par tout le jardin. Les travaux furent suspendus et l’on se regarda avec incertitude. Phidias se tourna. Il vit les Muses adorables se déployer comme un nuage au-dessus des bosquets pâlis. Des yeux, il les suivit qui se retiraient de son œuvre. Il voulut conserver un beau visage indifférent. Mais, la flûte aux doigts de l’éphèbe s’étant rompue aussi, le visage d’Io s’éteignit comme une lumière sur le passage d’un grand vent».
Les Muses sont au commencement car elles sont le commencement : c’est pourquoi elles participent de toute œuvre, appelée elle aussi à être une origine et à former un cadre habitable pour les générations qui se succèdent. Mortels, nous dépassons notre finitude en laissant une trace dans le temps, celle de la permanence de nos ouvrages et de la pérennité de nos créations, vivants relais de la chaîne de la communauté qui nous précèdent lorsque nous venons au monde. N’oublions pas que les dieux, titre réservé à la troisième génération d’êtres immortels que sont les Olympiens, n’ont guère connu les débuts du monde : les Muses, filles de Mnémosyne et petites filles de Terre et Ciel, sont seules en possession de ce dépôt des aurores qu’elles cultivent précisément à travers les arts, de la poésie à la danse, de la musique à l’histoire, du théâtre à l’astronomie. C’est pourquoi Heidegger (1999, p. 36), fidèle à la réminiscence platonicienne, décrit la désolation moderne, cette croissance du désert qui ensable l’esprit et empêche toute nouvelle édification, comme une perte de mémoire et une absence de souci pour l’origine : «La désolation est, à la cadence maxima, le bannissement de Mnémosyne». Et voilà que l’amnésie, devenue produit marchand et opération programmée, se montre à lui pendant son voyage, et s’étale sous ses yeux dans l’invention du loisir de la consommation : le tourisme organise en effet la visite de l’espace en interdisant l’habitation des lieux. Les guides agitaient-ils déjà frénétiquement à cette époque leur pancarte, nouveau totem autour duquel se rassemblent les zombies photographes munis de leurs postmodernes mitraillettes, et derrière laquelle marchent les bovins «perdus dans les entraves de la planification qui compte» (1992b, p. 67) ? Ces bovins ne sont pas de ceux que Nietzsche appelle de ses vœux : de livres, en effet, ils ne ruminent point, occupés à se distraire et à redoubler l’aliénation de leur vie quotidienne. Ils ressemblent, hordes prises de «frénésie de voyage», à ces spectres qui ne connaissent guère le repos, à ces mânes vagabondes qui errent alors qu’elles n’ont jamais été autant assignées à leur identité : «La technique moderne et l’industrialisation scientifique du monde dont elle s’accompagne s’apprêtent, avec ce qu’elles sont d’irrésistible, à effacer toute possibilité de séjours» (1992b, p. 81).
Tout comme les Olympiens édifièrent un cosmos, un ordre du monde, en maîtrisant Géants et Titans, les arts mettent en forme, par la mesure, la cadence et le rythme, le mouvement permanent de la vie : «La vie m’est échue comme une surprise extraordinaire, je ne m’y suis jamais bien accoutumé, ni parfaitement reconnu. Mais j’ai toujours cherché, comme l’unique moyen de m’y adapter, les lois suprêmes qui la règlent pour cadencer le mouvement de cette aventure inouïe» (Maurras, dans Giocanti et Tisserand, 2011, p. 53). Que le fond du monde et de la vie soit l’indéfini, ce qui ne possède ni limites ni contours, donc ni début ni fin, c’est ce qu’Anaximandre avait déjà noté sous les traits de l’apeiron, trame sur laquelle viendra se tisser les motifs du monde à partir du jeu des quatre éléments. Le mètre et le vers en poésie, le rythme en musique, la logique dans le raisonnement sont autant de moyens de maîtriser la démesure, d’articuler la parole au monde, surtout celle des sophistes qui se lancent dans des discours incohérents et sans fin au détriment de toute mesure. Heidegger, lui aussi, retrouvera dans la musique et la poésie la vérité de la langue : consacrant plusieurs analyses et commentaires aux poèmes de Hölderlin, le philosophe se servira de la Stimmung comme d’un diamant à la pointe herméneutique. Stimmung dit bien l’ambiance, ou la tonalité affective, mais aussi l’accord musical, si bien qu’il faille aussi entendre la tonalité en ce sens : l’ordonnancement structuré et hiérarchisé d’un ensemble de notes à un ton qui oriente la gamme et lui donne sa couleur. Comme le philosophe l’écrit (1992a, p. 108), «une tonalité est une modalité, non pas simplement une forme ou un mode extérieur, mais un mode au sens musical de la mélodie. Et celle-ci ne flotte pas au-dessus de la façon dont l’homme se trouve, soi-disant au sens propre, être là. Elle donne au contraire le ton pour cet être, c’est-à-dire qu’elle dispose et détermine tonalement le mode et le comment de cet être». Au fond, tant Maurras que Heidegger retrouvent la sentence de Platon selon laquelle la musique constitue la plus haute philosophie, héritage pythagoricien reposant sur l’hypothèse d’une structure mathématique du réel dont les rapports se reproduisent, par le jeu de l’analogie, dans l’ensemble des domaines et des degrés de la réalité.
Heidegger et Maurras à Athènes : aussi différents soient les deux hommes et leurs pensées respectives, ils se sont montrés sensibles à un même appel, celui de l’initial qui conjugue Vérité et Beauté. Aussi ne faudrait-il pas y voir une obsession de la Grèce, pourvue de privilèges aussi exorbitants qu’irrationnels, mais plutôt la reconnaissance de l’éclat méditerranéen et un sens certain du classicisme : «Ce que je loue n’est point les Grecs, mais l’ouvrage des Grecs et je loue non d’être grec, mais d’être beau. Ce n’est point parce qu’elle est grecque que nous allons à la beauté, mais parce qu’elle est belle que nous courons à la Grèce», précise ainsi Maurras dans la Préface d’Anthinéa. Mais ont-ils tous deux répondu semblablement à ce même appel ?
Heidegger choisit de s’embarquer pour une croisière, partant de Venise pour gagner Ithaque et poursuivre le périple : quel drôle de choix pour ce qui pourrait ressembler à un pèlerinage ! Est-il alors étonnant de lire le doute et la déception s’installer progressivement dans les pages des Séjours ? Accostant non loin des rivages de l’île, surgit d’emblée la première interrogation : «La patrie d’Ulysse ? Cette fois encore beaucoup de choses ne collaient décidément pas […]» (1992b, p. 21) ; maintenant tout d’abord, malgré les soupçons, l’espoir d’enfin accéder à la Grèce («Cette fois, il ne pouvait manquer de venir – le lieu où se rassembla autrefois la Grèce tout entière […]», 1992b, p. 25), Heidegger est bien obligé de se rendre à l’évidence et de laisser la méfiance se substituer à la perplexité : «Quant à lui, le doute revint à la charge sur le point de savoir si cet être grec, objet de longues méditations, de réflexions approfondies et répétées, n’était pas sorti d’une représentation arbitraire – dénuée de point d’appui dans la réalité de l’être été» (1992b, p. 25). Au tourisme qui visite sans habiter font écho les musées qui conservent sans sauvegarder : les temples, les sculptures et les autres œuvres d’art, dont la Beauté s’est un jour faite l’épiphanie de la Vérité, sont désormais soumis au régime du développement durable et assignés à des normes techniques qui en ont épuisé l’âme. Ils ne sont plus que vestiges, sans autre sens que celui de contenter la mémoire morte des appareils photos et de leurs cartes SD.
Maurras, quant à lui, se montre autrement plus enthousiaste; prolongeant le séjour au-delà de la couverture des Jeux Olympiques, il y respire allègrement le parfum de la «fleur du monde», puisque telle est l’étymologie poétique dont il affuble Athènes et qui donne le titre au récit de son voyage : Anthinéa. Aussi les situations de Heidegger et de Maurras semblent-elles se répondre comme les images inversées en un jeu de miroir : alors que le premier n’eut de cesse de se rapprocher de l’origine en Allemagne et qu’il vécut son périple grec comme un trouble voire une perte d’identité, Maurras partit en Grèce sans savoir que jamais plus il ne se trouverait peut-être aussi près de l’aurore, remontant avec Socrate le long de l’Ilissos pour observer les premières lueurs et «la couleur du matin profond». C’est certainement là qu’il fit l’expérience de l’essentiel, un sentiment qui allie le beau et le vrai auquel il restera fidèle tout au long de son œuvre : «C’est pourquoi mon esprit goûtait avec une douceur inexprimable ce que mes yeux charmés ne se lassaient point de connaître. Ainsi l’intelligence me débrouillait sans peine le monde troublé du plaisir. La volupté qui me pénétrait d’une onde puissante, je l’honorais presque autant que je l’éprouvais, bien certain que jamais tressaillement plus juste ne se ferait dans mes entrailles. Un exercice ordinaire de la pensée montre souvent comme il est triste ou honteux d’être un homme sujet au mal et à la mort, mais j’éprouvais ici la noblesse de notre essence; les plus hautes disciplines de la raison rapprochaient de moi la beauté» (1954, p. 193).
Références
Pierre Boutang, Maurras. La destinée et l’œuvre (Éditions de la Différence, coll. Essais, 1993).
Stéphane Giocanti et Axel Tisserand (dir.), Maurras (Éditions de L’Herne, 2011).
Martin Heidegger, Introduction à la métaphysique (Éditions Gallimard, coll. Tel, 1967).
Martin Heidegger, Les concepts fondamentaux de la métaphysique. Monde – finitude – solitude (Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque de Philosophie, 1992a).
Martin Heidegger, Séjours (Éditions du Rocher, 1992b).
Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ? (Presses Universitaires de France, coll.Quadrige, 1999).
Martin Heidegger, Parménide (Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque de Philosophie, 2011).
Homère, Iliade / Odyssée (Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1955).
Jean-François Mattei, L’ordre du monde. Platon – Nietzsche – Heidegger (Presses Universitaires de France, 1989).
Charles Maurras, Œuvres capitales. I : Sous le signe de Minerve (Flammarion, 1954).
Lien permanent | Tags : philosophie, littérature, grèce, homère, martin heidegger, platon, charles maurras, baptiste rappin, jean-françois mattei |  |
|  Imprimer
Imprimer