Actualités de la Gnose autour de La poésie et la gnose d’Yves Bonnefoy, par Baptiste Rappin (05/12/2016)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
(Bonnefoy, 2016, p. 51-52).
«Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige,
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir !
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.»
(Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Harmonie du soir, 1980, p. 35).
Y a-t-il actualité plus brûlante que celle de la Gnose ? Assurément non. Certes, l’homme occidental vit, aujourd’hui comme toujours dans les oligarchies partisanes et ploutocratiques, au rythme des risibles spectacles électoraux français et américains; certes, il livre par procuration une guerre au grand méchant État Islamique, ce fétu de paille que l’Europe devrait laisser au triste sort de ses créateurs; certes, il constate, las et chagrin, la baisse de son pouvoir d’achat qui le privera de ses prochaines escapades disneylandisées. Oui, l’homme occidental se baigne dans cette écume des jours, d’où surgit l’Aphrodite postmoderne qui traîne son désir à hue et à dia selon les spasmes de l’actualité et de l’innovation techno-managériale.
Mais que peut bien valoir cette fugace poussière des événements face aux grands conflits métaphysiques et théologiques qui, tels ces courants sous-marins d’autant plus puissants qu’invisibles, agitent les vaguelettes de la surface comme le montreur tire dans l’ombre les fils des marionnettes pour laisser accroire à l’existence de leur conscience ? Écume des jours, en effet, que cette désinformation continue qui ne pèse que de peu de poids face au conflit des fondements, à l’affrontement des grandes puissances symboliques et au heurt des titans de la civilisation.
Faut-il alors de ce point de vue considérer la dernière livraison d’Yves Bonnefoy comme un fruit du hasard et une banale contingence ? Ah, que nenni ! Il nous faut aujourd’hui pleinement assumer la valeur testimoniale de La poésie et la gnose et prendre au sérieux le péril de la gnose : que Plotin aussi bien que Saint Augustin prirent le temps, la peine et le soin de combattre frontalement le gnosticisme atteste, si besoin s’en faut, qu’hellénisme et christianisme, quoiqu’intérieurement tiraillés entre l’appel de l’Ailleurs et le souci du cosmos, protégèrent le monde contre toutes les perpétrations d’annihilation. C’est d’ailleurs en dansant sur cet étroit fil, qui relie la rive de la matière à la berge des Idées, que la tradition européenne persévère dans son être et parvient à maintenir son identité à travers les soubresauts de l’histoire. S’il s’avérait donc, comme l’écrit Bonnefoy (2016, p. 15), que la poésie «lutte contre le rêve gnostique», alors ne serions-nous pas en toute logique amenés à conclure que l’art poétique, peut-être celui de l’écriture de façon plus générale, constitue aujourd’hui la stratégie obsidionale la plus efficace pour lutter contre les assauts renouvelés de la gnose ?
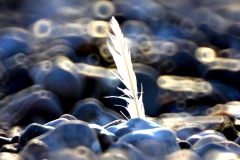 Mais qu’est donc la gnose pour que nous lui portions une telle considération et lui accordions une attention si poussée ? Ne dramatisons-nous pas quelque peu les termes et l’enjeu du débat ? Question toute rhétorique tant l’essentiel ici se situe. Bonnefoy relève que l’attitude gnostique se trouve toute entière dans le mépris et la haine du monde, lambeau ou chute d’un tissu primordial et parfait dans lequel les âmes humaines se trouvent enferrées; c’est la raison pour laquelle le gnostique se sent étranger au monde qu’il cherche à tous prix, ceux de l’ascèse et du libertinage en particulier, à quitter pour se défaire de ces pesants liens charnels : «l’expérience fondamentale des gnostiques reste l’horreur de ce qui est, ici, maintenant, et le regret lancinant, de ce qui aurait pu être» (Bonnefoy, 2016, p. 17-18). Tout, dans le gnosticisme, se vit sous le mode de la séparation et de la rupture : ligne brisée du temps, sujet clivé, monde déchiré, à tel point que le gnostique se place, éthiquement (par son absence de mesure et sa haine du juste milieu) et ontologiquement (son être-à-l’immonde), sous le régime de l’ex-centricité. Sans repères dans cet univers défectueux qui ne saurait lui en fournir, le gnostique se réfugie dans les marges et les excès en espérant y gagner son salut. Il quitte délibérément les régions centrales, le sol natal et l’origine mystérieuse à partir desquels l’Être darde ses rais, pour réintégrer l’Unité Primordiale corrompue par la matière (1).
Mais qu’est donc la gnose pour que nous lui portions une telle considération et lui accordions une attention si poussée ? Ne dramatisons-nous pas quelque peu les termes et l’enjeu du débat ? Question toute rhétorique tant l’essentiel ici se situe. Bonnefoy relève que l’attitude gnostique se trouve toute entière dans le mépris et la haine du monde, lambeau ou chute d’un tissu primordial et parfait dans lequel les âmes humaines se trouvent enferrées; c’est la raison pour laquelle le gnostique se sent étranger au monde qu’il cherche à tous prix, ceux de l’ascèse et du libertinage en particulier, à quitter pour se défaire de ces pesants liens charnels : «l’expérience fondamentale des gnostiques reste l’horreur de ce qui est, ici, maintenant, et le regret lancinant, de ce qui aurait pu être» (Bonnefoy, 2016, p. 17-18). Tout, dans le gnosticisme, se vit sous le mode de la séparation et de la rupture : ligne brisée du temps, sujet clivé, monde déchiré, à tel point que le gnostique se place, éthiquement (par son absence de mesure et sa haine du juste milieu) et ontologiquement (son être-à-l’immonde), sous le régime de l’ex-centricité. Sans repères dans cet univers défectueux qui ne saurait lui en fournir, le gnostique se réfugie dans les marges et les excès en espérant y gagner son salut. Il quitte délibérément les régions centrales, le sol natal et l’origine mystérieuse à partir desquels l’Être darde ses rais, pour réintégrer l’Unité Primordiale corrompue par la matière (1).La tentation gnostique n’est pas absente de la poésie, ou plutôt de l’âme des poètes ; et Bonnefoy (2016, p. 18) rappelle fort à propos, dès les premières pages, que «les poètes de toute époque ne sont pas loin d’éprouver ces sentiments, ce qui explique déjà qu’on rapproche la poésie de la gnose». Quelle meilleure illustration de cette ambiguïté, de cette équivoque et de cette possible confusion que la magnifique étude que Pierre Boutang consacre à William Blake ? En effet, dans ce chef d’œuvre, le bouillant philosophe démontre que l’œuvre du poète-graveur n’est pleinement intelligible qu’à la lumière du manichéisme : «Nous avons la conviction d’avoir établi dans ce premier livre que l’ignorance de l’hérésie privilégiée du Christianisme rendait impossible la compréhension de la personne et de la poésie de Blake» (Boutang, 1990, p. 107). Si une lecture pressée et superficielle s’autorise à lancer des ponts entre les propos du poète et le dogme, un examen scrupuleux et attentif laisse pourtant voir la parodie que constituerait ce rapprochement ; en effet, Blake conteste la toute-puissance de Dieu, nie la Trinité en affirmant que Jésus est le seul Dieu et atteste que seul l’homme possède la qualité divine, tous propos qui le placent de facto du côté des hérétiques. Mais Boutang n’en reste pas là, et affine son analyse. Pour lui, le vrai clivage entre l’orthodoxie et l’hérésie ne concerne pas le nombre de Principes, en l’occurrence le conflit entre le monothéisme trinitaire et le dualisme de la disjonction propre au gnosticisme, mais «la manière d’avancer, de se purifier, pour l’homme qui naît et qui meurt : le Manichéen cherche et ordonne la séparation parfaite et complète du bien et du mal au cours de la vie de l’homme, et ce souci du criblage se substitue à tout autre chez les Élus, et en particulier à l’amour de Dieu et du prochain» (Boutang, 1990, p. 235).
On peut bien sûr suivre cette veine interprétative boutangienne qui place le propos sur le terrain de l’éthique : à ne penser qu’à son salut individuel, le gnostique omet le souci de l’autre. On glisse alors aisément vers le corollaire politique, puisque l’urgence immanente de la préoccupation eschatologique place l’ascétique et le libertin en dehors de la vie politique et de la cité. Le bien particulier se substitue intégralement au bien commun, et l’individu s’exclut de la communauté naturelle.
Ne s’agit-il toutefois que d’âme et de salut individuel ? Pour Platon, la philosophie, avant toute autre chose, servait la finalité de sauver les phénomènes en dégageant de la gangue du sensible son noyau intelligible. Il y a en effet derrière les apparences, qui vont et viennent comme les feuilles des arbres, une structure métaphysique d’ordre mathématique qui, elle, demeure immuable et inlassablement gouverne les rapports analogiques du cosmos. On trouve un éclatant témoignage de cette tradition grecque dans ΣΟΖΕΙΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ouvrage écrit par le physicien catholique Pierre Duhem en 1908 dans lequel il assigne à la théorie physique la modeste mission de sauver apparences, plutôt que de se mettre en quête de la Vérité ultime, domaine réservé à la métaphysique et à la théologie, quitte à prendre parti pour le Cardinal Bellarmin contre Galilée.
Quoi qu’il en soit, les arguments que déploient Plotin et Saint Augustin contre le gnosticisme ne se limitent guère à la manière de vivre mais s’étendent au souci du monde; ils débordent l’éthique pour se placer sur le terrain à proprement parler cosmologique et ontologique. Dans son célèbre Contre les gnostiques, le disciple d’Ammonios Saccas déclare qu’ «il ne faut pas non plus concéder que notre monde a une origine mauvaise sous prétexte qu’il existe en lui beaucoup de choses pénibles» (Plotin, 2006, p. 207) avant d’affirmer que «l’ordonnancement de l’univers manifeste avant tout la grandeur de la nature intelligible» (ibid., p. 214). Comment alors rendre compte des délires gnostiques ? Par l’ignorance, réponse socratique s’il en est : «ils ne connaissent pas l’ordre dans lequel se succèdent les choses qui viennent en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu et ainsi de suite jusqu’aux dernières, et ils ignorent qu’il ne faut pas injurier celles qui sont inférieures aux premières, mais accepter toutes choses avec mansuétude» (ibid., p. 225). C’est parce que les gnostiques ne saisissent pas l’ordre du monde, c’est parce qu’ils sont aveugles à sa beauté, c’est parce qu’ils sont incapable de porter sur lui un regard (theoria) qu’ils le méprisent plutôt que de l’aimer et de veiller à sa sauvegarde. Plus d’un siècle plus tard, Saint Augustin reste en ce sens fidèle à cette tradition grecque et païenne, et reprend l’argument à l’accent tout pythagoricien : «Car, outre le témoignage des prophètes, le monde lui-même, par l’ordre de ses révolutions et la constance de ses vicissitudes, par la beauté de tous les objets visibles, proclame en silence qu’il a été créé, et n’a pu l’être que par un Dieu ineffablement et invisiblement beau» (Augustin, 1994, p. 19).
On peut alors estimer que la tradition philosophique et la théologie chrétienne convergent, malgré d’évidentes oppositions qui ne vont pas sans querelles et conflits, vers un lieu commun : celui du maintien du monde (le fameux katechon de Saint Paul repris par Carl Schmitt contre les messianismes modernes de tous vents) qu’il revient à l’homme, par le travail, le soin et la culture, d’entretenir et de perpétuer. C’est bien sur ce terrain que Bonnefoy se situe car, chez lui, la poésie ne cherche aucune sorte de délivrance transcendante, mais «vise à une parole libre à nouveau d’aller droit aux choses du lieu, qui en reviendraient, de ce fait, nos proches» (Bonnefoy, 2016, p. 26-27). Oui, nous sommes bien coupés du monde, il y a bien une dysmétrie première, originelle et péremptoire, ne serait-ce que par la faculté du langage qui, maniant les signes, crée de fait une infranchissable distance entre l’être humain et la réalité. Mais cette scission originelle, lot de la finitude humaine, demande à être suturée par les lacets de la parole comme la tapisserie toujours remise sur le chantier de Pénélope; alors peut s’engager le retour à l’origine et au jaillissement de l’être, non pas dans un Ailleurs extra-mondain mais hic et nunc, car le poète, par les mots, opère «dans son existence ordinaire la rénovation de l’ici» (Bonnefoy, 2016, p. 26). Par la parole se saisissent la consistance et la proximité des choses; se laisse voir et sentir un concret qui n’est pas la célébration techno-managériale des objectifs atteints, mais le tissu des éléments, leur enveloppe, qui donnent à deviner leur chair ; se font entendre la musique originelle du monde et la symphonie des éléments. «La poésie, constatons-le, c’est moins l’expérience actuelle de la présence dans ce qui est qu’une obstination à réaffirmer le bien qu’est cette présence et le besoin qu’on en a et le projet d’y atteindre, par un travail tout de suite recommencé», écrit ainsi Bonnefoy (2016, p. 45-46) pour ancrer la transcendance dans des racines terrestres.
Que Bonnefoy, par la vocation qu’il assigne à la poésie d’initier «la voie du retour» (Bonnefoy, 2016, p. 27), s’inscrive dans cette filiation de lutte contre le gnosticisme, ne fait pour nous – et pour le lecteur que nous espérons avoir convaincu – plus guère de doute. Mais la question est-elle urgente ? Actuelle ? Contemporaine ? Ne s’agit-il donc que de ressasser les vieilles lunes des débuts de notre ère ?
En 1974, Raymond Ruyer, professeur à l’Université de Nancy, publie un ouvrage resté célèbre : La gnose de Princeton, dans lequel il révèle les thèses du courant néo-gnostique de Princeton et de Pasadena; celles-ci, loin de se rallier au paganisme traditionnel comme le laisse penser l’auteur au détour de certaines phrases, font état d’un spiritualisme accentué et univoque : «Le monde est dominé par l’Esprit, fait par l’Esprit, ou par des Esprits délégués. L’Esprit trouve (ou plutôt se crée lui-même) une résistance, une opposition : la Matière» (Ruyer, 1977, p. 57). Mais au lieu que la seconde s’évapore dans le premier, comme le fantasmaient les gnostiques antiques, les modernes prennent appui sur la science contemporaine pour mettre en exergue le trajet inverse : la diffusion de l’Esprit dans la Matière, de telle sorte qu’ils en viennent à prôner un panthéisme idéaliste et un animisme de l’information. Les néo-gnostiques offrent ainsi l’image symétrique de leurs aînés car, au lieu que la Matière soit aspirée par le haut, s’évanouissant sous l’effet d’une ventouse absolument transcendante, elle disparaît désormais en se résorbant dans l’Esprit qui la recouvre et qui est, seul, la véritable étoffe de l’univers. Dans les deux cas, inspiration de la Matière ou Expiration de l’Esprit, le monde charnel se trouve dépossédé de sa vérité propre si bien que le chemin du retour auprès des choses et de leur présence concrète semble une aventure tout bonnement impossible. Cette gnose de Princeton, qui n’est pas sans faire penser au Tao de la Physique de Fritjof Capra publié un an après en 1975, concentre en elle les poncifs du Nouvel Âge, mélange syncrétique et abrutissant de techniques spirituelles mondialisées et d’avancées scientifiques américaines qui prend son essor à l’Institut Esalen sur la Côte Californienne, au début des années 1960, sous la houlette d’Abraham Maslow, de Carl Rogers, d’Arnold Toynbee, de Paul Tillich et d’Allan Watts. C’est ce savant métissage de méditation, d’exercices de visualisation, de thérapies brèves, de techniques de communication que l’on connaît encore aujourd’hui sous le nom de «développement personnel» ou de «coaching» et qui, sous couvert d’épanouissement personnel et de bien-être, accomplissent la grande conversion de l’être humain en processeur d’informations logiques et abstraites.
Avançons plus outre : car cette rencontre bénie de la Science et de l’Esprit ne fut rendue possible que par l’apport décisif de la cybernétique, méta-science du mitan du XXe siècle qui théorise la transition du moderne vers le postmoderne, de l’industriel vers le postindustriel, de l’énergie vers l’information. Sur la base de la révolution logique moderne portée par les Boole, Frege, Russell, Whitehead, Peano ou encore Wittgenstein, qui se proposent tous de réduire la parole à une logique idéographique, fonctionnelle et principalement binaire, Norbert Wiener et ses acolytes des Conférences Macy reformulent l’ensemble du savoir scientifique en posant la nature informationnelle de l’«organisation», catégorie générique qui sert désormais à désigner toutes les formes de réalité, que celle-ci soit physique, biologique, psychique ou sociale. L’immatériel s’émancipe alors radicalement du matériel au sein même de la science; comme le résume admirablement Gotthard Günther (2015, p. 69), thuriféraire du mouvement, «la cybernétique n’est pas liée aux propriétés que l’on rencontre dans la matière terrestre, non plus qu’elle n’en tire les lois qui la régissent. / Il est particulièrement important de souligner l’indifférence de la cybernétique face à la question de la matérialité, car c’est bien par là que l’on accède au cœur même de sa philosophie et à la conception novatrice du monde qu’elle implique». De ce point de vue, le projet postmoderne constitue comme le saut de la modernité dans l’ère de l’immatériel, de la dématérialisation, du virtuel, du conceptuel, du numérique et du digital : dirons-nous alors que la gnose n’aura jamais été aussi présente que dans cette noosphère tout ensemble teilhardienne, morinienne et attalienne, qui organise minutieusement le déracinement des corps et des âmes pour s’adonner allègrement à l’entreprise totalitaire de fabrique postindustrielle d’un homme nouveau et ectoplasmique ?
Digne héritier des Grecs, Heidegger, que l’on croyait, image aussi facile qu’erronée, coupé des progrès scientifiques de son temps, avait finement saisi l’enjeu ontologique d’une perversion de la parole dans l’information : «La parole ainsi mise en position devient information. Elle s’informe sur elle-même, afin d’assurer sa propre démarche par des théories informatiques. Le Dis-positif, déploiement partout régnant de la technique moderne, se rend disponible la langue formalisée, genre de l’information par la force de laquelle l’être humain se voit formé au déploiement technique et calculateur, c’est-à-dire installé en lui, abandonnant peu à peu la "langue naturelle". […] Car la "langue naturelle", dont on doit encore parler, est d’emblée mise en jeu comme la langue non encore formalisée, mais promise à la formalisation» (Heidegger, 1976, p. 252). Mise en codes ou captive des jeux de structures, la parole devient langage technique et opératoire, plus soucieux de performativité que de vérité, et quitte le commerce du monde pour mieux le maîtriser et le subsumer dans l’abstraction de l’information. Cette digestion logique, qui coupe tout lien avec la réalité si ce n’est la mesure de l’efficacité visible, conduit à la création d’une gigantesque bulle spéculative et autoréférentielle : non plus une cage de fer, mais une confortable et transparente cellule de silicium qui pourrait bien être notre prison gnostique.
Faut-il alors s’étonner que, face à ce péril cybernétique et logique, Heidegger s’en remette non plus à la philosophie, qui se prend les pieds dans le tapis de l’univocité depuis Duns Scot jusqu’à en mourir dans la philosophie analytique américaine, mais à la poésie ? Si le logos consiste bien à cueillir, à recueillir et à accueillir dans les mots le monde tel qu’il se donne dans sa manifestation, alors charge à la poésie de se faire à présent la gardienne du cosmos, du sens du ciel et de la terre, ainsi que du Verbe fait Chair. À elle de nous dire la vérité du monde et de sa beauté, de nous ramener à la proximité et à la simplicité des choses, de ne plus être «une occupation littéraire» mais bien d’exprimer «la clameur que lance le monde à l’appel du dieu» (Heidegger, 1991, p. 132).
Alors non, décidément non, Bonnefoy n’aurait pu nous livrer d’autre leçon testimoniale que celle qui rappelle la poésie à son devoir : «la poésie, c’est ma conviction, n’est pas la gnose. Elle est même, dirai-je, l’anti-gnose […]» (Bonnefoy, 2016, p. 15); au couchant de sa vie, le poète ne put avoir d’autre dessein que de nous laisser à lire l’essentiel : à savoir que la garde du monde se heurte à toutes les entreprises gnostiques réactualisées et amendées, parfois même par le soi-disant progrès scientifique. À ceux qui, las de la part de pesanteur de notre cosmos, se laisseraient tenter par une telle évasion, Bonnefoy suggère modestement de prendre le chemin de l’arrière-pays pour à nouveau faire l’expérience de l’évidence : que si la condition humaine se révèle indéniablement tragique, le monde, pour sa part, nous offrira éternellement sa tendre présence.
«J’aime la terre, ce que je vois me comble, et il m’arrive même de croire que la ligne pure des cimes, la majesté des arbres, la vivacité du mouvement de l’eau au fond d’un ravin, la grâce d’une façade d’église, puisqu’elles sont si intenses, en des régions, à des heures, ne peuvent qu’avoir été voulues, et pour notre bien. Cette harmonie a un sens, ces paysages et ces espèces sont, figés encore, enchantés peut-être, une parole, il ne s’agit que de regarder et d’écouter avec force pour que l’absolu se déclare, au bout de nos errements. Ici, dans cette promesse, est donc le lieu.»
(Bonnefoy, 2005, p. 10)
Note
(1) Le lecteur soucieux de se renseigner davantage sur le gnosticisme pourra se reporter aux ouvrages suivants : Écrits gnostiques (Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 2007); Hans Jonas, La religion gnostique. Le message du Dieu Étranger et les débuts du christianisme, traduit de l’anglais par Louis Evrard (Flammarion, coll. Idées et Recherches, 1978); Henri-Charles Puech, En quête de la gnose, tomes 1 et 2 (Éditions Gallimard, coll. Bibliothèque des Sciences Humaines; 1978); Simone Pétrement, Le Dieu séparé. Les origines du gnosticisme (Les Éditions du Cerf, coll. Patrimoines, 1984).
Bibliographie
Baudelaire Charles, Œuvres complètes (Robert Laffont, coll. Bouquins, 1980).
Bonnefoy Yves, L’arrière-pays (Éditions Gallimard, nrf, 2005).
Bonnefoy Yves, La poésie et la gnose (Éditions Galilée, coll. Lignes fictives, 2016).
Boutang Pierre, William Blake manichéen et visionnaire (La Différence, coll. Mobile matière, 1990).
Capra Fritjof, Le Tao de la Physique (Sand, 1985).
Duhem Pierre, Sauver les apparences. Sur la notion de Théorie physique (Librairie Philosophique J. Vrin, coll. Bibliothèque des textes philosophiques, 2003).
Günther Gotthard, L’Amérique et la cybernétique. Autobiographie, réflexions, témoignages, traduit par Danièle Laurin (Éditions Petra, 2015).
Heidegger Martin, Acheminement vers la parole, traduit de l’allemand par Jean Beaufret, Wolfgang Brokmeier et François Fédier (Éditions Gallimard, coll. Tel, 1976).
Heidegger Martin, Aristote, Métaphysique Θ 1-3. De l’essence et de la réalité de la force, traduit de l’allemand par Bernard Stevens et Pol Vandevelde (Éditions Gallimard, nrf, coll. Bibliothèque de Philosophie, 1991).
Plotin, Ennéade II, 9, traduit par Richard Dufour dans Traités 30-37 (Flammarion, coll. G-F, 2006; Traité 33 dans la nouvelle classification de Luc Brisson et Jean-Luc Pradeau).
Ruyer Raymond, La gnose de Princeton (Fayard, coll. Pluriel, 1977).
Saint Augustin, La Cité de Dieu, Tome 2 : Livres XI à VXII (Paris Éditions du Seuil, coll. Sagesses, 1994).
Lien permanent | Tags : littérature, poésie, philosophie, gnose, gnosticisme, critique littéraire, yves bonnefoy, baptiste rappin |  |
|  Imprimer
Imprimer