Blade Runner de Philip K. Dick (09/01/2017)
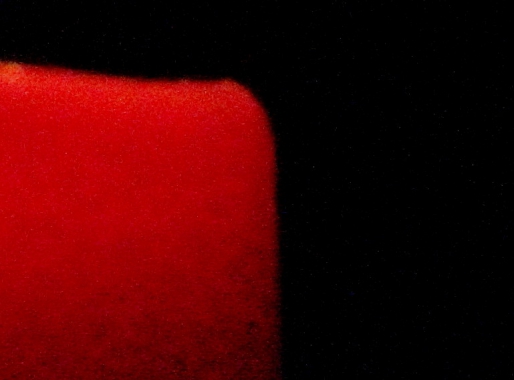
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Philip K. Dick Dans la Zone.
Philip K. Dick Dans la Zone. Acheter Blade Runner sur Amazon.
Acheter Blade Runner sur Amazon.Au moment de lire La Route de Cormac McCarthy, je ne me souvenais plus que Blade Runner (en fait Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?) évoquait un paysage de désolation qui n'était pas sans présenter certaines caractéristiques communes avec celui que traversent le père et son fils. Dans le roman de Dick, paru en 1968, le «legs de la Dernière Guerre mondiale», même s'il a perdu de sa puissance, n'en continue pas moins de bouleverser le monde : «ceux qui n'avaient pas résisté à la poussière étaient tombés dans l'oubli bien des années plus tôt, et la poussière, moins radioactive et confrontée à des êtres plus résistants, se bornait désormais à dérégler esprits et patrimoines génétiques» (1) et, aussi, plus prosaïquement, à nous empêcher de voir, la nuit, les étoiles (cf. p. 251). Le roman de Cormac McCarthy, nous le savons, est pour le moins franchement avare en détails, et nulle part il ne nous est ainsi précisé quelle est la nature exacte de la catastrophe qui a dévasté le monde, et qui a supprimé, hormis les hommes, toute trace de vie animale ou végétale. Pas davantage les personnages ne semblent avoir été contaminés par quelque substance que ce soit, où mourir lentement à cause de la radioactivité. Le monde que décrit Dick est en fin de compte moins affecté que ne l'est celui de McCarthy, plus optimiste peut-être, moins radical si l'on veut, bien que la ruine, «le bouleversement ultime de toute forme, l'absence qui allait tout engloutir» (p. 234) ne cesse de s'étendre, mais il faut toutefois remarquer que, à de très rares exceptions près qui sont alors monnayées des fortunes, il n'existe plus d'animaux vivants dans le San Francisco qu'évoque Dick, les humains, eux, qui sont restés sur notre planète étant finalement les moins chanceux, puisque l'émigration vers Mars (cf. p. 19) peut, à tout le moins, préserver les colons des dangers de la poussière radioactive, qui fait se déplacer des populations entières (cf. p. 29).
Ce monde, cette planète devenant un «dépotoir» (p. 105) est lentement dégradée, rongée, non point par la «rongeasse» visible dans Glissement de temps sur Mars par le biais de Manfred Steiner, mais par la «tropie», dont le «spécial» John Isidore perçoit la progression inexorable et maligne : «La tropie, ce sont les objets inutiles, les imprimés publicitaires, les boîtes d'allumettes vides, les papiers de chewing-gum ou les journaux de la veille. Quand il n'y a personne dans le coin, la tropie en profite pour se reproduire. Par exemple, si vous allez vous coucher en laissant de la tropie dans votre appartement, vous en trouvez le double à votre réveil le lendemain matin. Elle n'arrête pas de croître, encore et encore» (p. 83), comme le monde cassé décrit par McCarthy, lui aussi, ne cesse de chuter dans la décomposition. Quelques lignes plus loin, Dick écrit que «Personne ne peut gagner contre la tropie», ou «alors provisoirement, à un endroit donné. Chez moi, par exemple, j'ai réussi à créer une espèce de stase entre la pression de la tropie et de la non-tropie. Mais je finirai par mourir, ou par m'en aller, et la tropie reprendra aussitôt le pouvoir. C'est un principe universel, à l’œuvre dans l'univers tout entier; c'est l'univers dans son ensemble qui s'achemine vers un état d'absolue tropie» (pp. 83-4), même si John Isidore conclut que seul le culte de Wilbur Mercer résiste à cette dernière, peut-être parce qu'elle rejoue, quoi qu'en dise Étienne Barillier qui parle tout de même de «personnage ouvertement messianique» (p. 281), la geste du Christ souffrant. Il importe finalement assez peu que Wilbur Mercer ne soit qu'un figurant à la retraite, et «le monde dans lequel il accomplit son ascension [...] un minable studio d'Hollywood qui a disparu depuis des années dans la tropie» (p. 231, l'auteur souligne), s'il possède le pouvoir de régénérer les morts (cf. pp. 36 et sq.), et s'il permet de lutter contre «l'haleine du vide qui séparait les mondes habités» (p. 85 caractérisant selon John Isidore la froideur des androïdes. Dans un régime où tout n'est que faux-semblant, où même le catalogue établissant le prix des répliques d'animaux disparus est sujet à caution (ou bien renvoie à une autre réalité, comme La sauterelle pèse lourd dans tel autre grand roman de Dick, cf. p. 57).
C'est dans cette société disloquée, que John Isidore, l'un de ces «milliers d'autres spéciaux présents sur Terre» dont le sort est aussi peu enviable que celui d'un simple d'esprit corvéable à loisir, voit s'acheminer «vers le tas de cendres» et se transformer «peu à peu en tropie vivante» (pp. 90-1), que les chasseurs de primes comme Rick Deckard ont pour mission de détruire («retirer», p. 45) les androïdes venus illégalement sur Terre. Ils n'étaient, à l'origine, que des outils sur lesquels «reposait l'ensemble du programme de colonisation» (p. 28), les plus intelligents d'entre eux ayant toutefois fondé une espèce de communauté secrète qui sera décimée, à l'exception de la belle Rachael Rosen, par Rick Deckard.
Détruire un androïde n'est pas un crime, ni même une chose plus effrayante, dans ce monde sans vie, que le fait de couper quelques pattes à une araignée (peu importe même qu'elle soit bien réelle ou qu'il ne s'agisse que d'un robot). Rick Deckard n'aura finalement qu'assez peu d'états d'âme, du moins au début du roman, puisque le Mercérisme, ayant évolué en une théologie complète, nous dit l'auteur, donne le droit de tuer les tueurs : «Pour Rick Deckard, un robot humanoïde en fuite, un robot qui avait tué son maître, qu'on avait équipé d'une intelligence supérieure à celle de bien des êtres humains, qui n'avait aucun égard pour les animaux et aucun moyen de ressentir une quelconque empathie pour une autre forme de vie, dans ses joies comme dans ses peines», un tel artefact «personnifiait parfaitement les Tueurs» (p. 46).
Deckard, aussi froid qu'un de ces robots, n'a donc pas le plus petit doute sur le bien-fondé de sa mission : «Un robot humanoïde ne diffère en rien des autres machines», car il «peut passer en un clin d’œil de bienfait à danger. Tant qu'il reste un bienfait, ce n'est pas de notre ressort» (p. 56).
Cette belle assurance vacillera, comme tant d'autres certitudes (2) chez Dick, lorsque Deckard découvrira Rachael Rosen, très belle femme mais surtout l'un des représentants de la dernière génération d'androïdes, de loin la plus complexe et qui plus d'une fois donnera du fil à retordre à Deckard, baptisée Nexus-6. Comme toujours chez Dick, la réalité n'est pas celle que l'on croit, et, quelques minutes, Deckard pense que cette femme est tout ce que l'on voudra (une saloperie, finira-t-il par découvrir après avoir couché avec elle), sauf un androïde. Mais le test Voigt-Kampff est pour l'heure infaillible, qui permet au tueur de débusquer les tueurs synthétiques, justement parce que ce mécanisme mesure l'empathie, dont les robots sont dénués.
Les doutes surgissent dans l'esprit de Deckard, et il n'est pas étonnant que ce soit, de nouveau, l'image de la poussière (ce livre eût pleinement mérité le titre génial de John Fante, Ask the Dust) et de la tropie qui décidément représente la thématique essentielle de ce roman (3), qui cristallise les interrogations du chasseur de primes : «Un jour, le nom même de Mozart aura été oublié, la poussière aura gagné. Sinon sur cette planète, du moins sur une autre. On peut y échapper quelque temps. Tous comme les andros peuvent m'échapper et s'accorder un court répit. Mais on finit toujours par les avoir, moi ou un autre chasseur de primes. D'une certaine façon, comprit-il, je fais partie du processus entropique de destruction de la matière. La fondation Rosen [qui construit les androïdes] crée des choses que moi je défais. C'est en tout cas l'impression que ça doit leur donner» (p. 116, l'auteur souligne).
Deckard fera la connaissance d'un autre chasseur de primes, implacable et froid, qui se révélera être un androïde, occasion pour le tueur de s'interroger sur la «distinction entre les êtres humains authentiques et les artefacts humanoïdes» (p. 162, l'auteur souligne). John Isidore, le spécial, émet lui aussi des doutes sur l'humanité des chasseurs de primes : «Il en avait une image très vague, indistincte, sinistre : une chose sans pitié, nantie d'une liste imprimée et d'un pistolet, qui accomplissait telle une machine sa tâche meurtrière platement bureaucratique. Une chose dénuée d'émotions, de visage, une chose qui, lorsqu'elle périssait, était immédiatement remplacée par une autre en tous points identique. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier être vivant ait été abattu» (p. 179).
Pour sortir de la logique perverse du simulacre et de l'artefact, pour oser se prétendre plus qu'une machine, dont les exemplaires identiques (Rachael Rosen est Pris Stratton) emboutis «à la chaîne comme des capsules de bouteille» (p. 210) semblent toutefois vivre un sort plus enviable que celui du spécial John Isidore, méprisé de tous (cf. p. 227), il faut accepter d'être blessé, recevoir la pierre qui toujours touche celui qui monte la colline, avec le mal aux trousses : Rick reçoit ainsi la pierre destinée à sa femme, Iran (cf. p. 200), et devient, d'une certaine façon, Mercer lui-même (4), dont l'Ami Buster, qui n'est lui-même qu'un androïde (cf. p. 233) a révélé la supercherie.
Même éventé, le mercérisme continue, parce que les humains, à la différence des androïdes, ne sauraient se passer d'une figure qui les surpasse, subsume leurs souffrances, une entité, fût-elle elle-même un simulacre, toutefois capable de percevoir, à l'instar de Mercer, «dans chaque cendre de l'univers des traces de vies [sic] discrètes, presque invisibles» (p. 263, l'auteur souligne), qu'importe même qu'il semble avoir été privé de ses pouvoirs consistant à «ramener des choses à la vie» (p. 267). En ce sens, Étienne Barillier a raison de dire que Blade Runner «ne parle pas du futur de l'humain, mais de ce qu'est l'humain» (p. 273), et ce que nous dit Philip K. Dick de ce dernier n'a pas de quoi nous réjouir, puisqu'un chasseur de primes peut finalement être confondu avec un froid androïde, victime d'un «aplatissement de l'affect» (p. 182, comme les schizophrènes, précise Dick), comme le pense le personnage qui est finalement le plus humain de ce roman, le spécial John Isidore.
Notes
(1) Ce passage se trouve à la page 18 de l'édition donnée par J'ai lu en 2014, traduction de l'anglais par Sébastien Guillot et postface, assez intéressante, d’Étienne Barillier, bon connaisseur des romans de Philip K. Dick. Si la nouvelle couverture, comme désormais toutes celles des romans de Dick, se signale par son graphisme réuni, il n'en reste pas moins que J'ai lu pourrait soit relire les textes imprimés, soit payer un correcteur efficace. Quelques erreurs : «ne» inutile p. 97, l. 10, «-il» (finit-il» au lieu de finit) qui n'est pas nécessaire à la p. 108, l. 20, absence de «à» à la première ligne de la page 149, page 195, d'un ton insistant et non instant, survoltée et non «survolté», p. 221, etc.
(2) Dans un monde où «les copies d'animaux commencent à faire sacrément réelles, avec ces circuits de maladie qu'ils installent dans les nouveaux» (p. 96), comme ne point tout suspecter ? Plus d'une fois, des doutes sont émis, par d'autres personnages (comme par hasard, des androïdes) sur le fait que Deckard soit, ou non, un des leurs (cf. p. 119). C'est au chapitre 11 que Dick plongera son personnage dans une espèce d'univers parallèle au nôtre, qui sera cependant vite éventé, au chapitre suivant, comme si Dick avait finalement manqué des ressources imaginatives pour consolider l'existence d'un univers totalement décorrélé du nôtre (à l'instar du célèbre tableau de Munch, mentionné à la page 150) et qui ne s'effondre pas deux jours plus tard. Ailleurs, Dick parviendra une fois encore à dédoubler la réalité au moyen d'un excellent artifice, certains androïdes étant amateurs de ce qu'ils appellent la «fiction précoloniale» (p. 170, à savoir «des histoires écrites avant les voyages spatiaux, mais sur les voyages spatiaux» (p. 171), autant dire de bons romans de science-fiction décrivant une réalité plus idyllique que celle dans laquelle tentent de survivre nos personnages !
(3) «La force du roman, écrit Étienne Barillier, tient peut-être dans sa capacité à ressentir presque physiquement la destruction entropique des êtres et des choses» (p. 275)
(4) «C'est étrange, reprit Rick. J'ai eu l'illusion absolue, totale, incroyablement réelle que j'étais devenu Mercer et que des gens me bombardaient de pierres. Mais c'était différent de ce qu'on expérimente avec les deux mains sur les poignées d'une boîte à empathie. Dans ce cas-là, on se sent avec Mercer. Alors qu'il n'y avait personne avec moi. J'étais complètement seul» (p. 259, l'auteur souligne).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, science-fiction, philip k. dick, blade runner, cormac mccarthy, la route, éditions j'ai lu, étienne barillier |  |
|  Imprimer
Imprimer
