Au-delà de l'effondrement, 60 : Fiskadoro de Denis Johnson (22/05/2017)
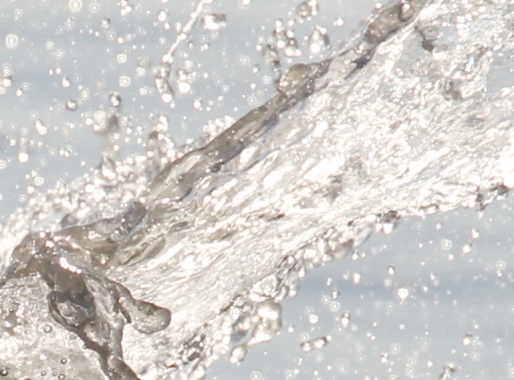
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Tous les effondrements.
Tous les effondrements. Acheter Fiskadoro sur Amazon.
Acheter Fiskadoro sur Amazon.Fiskadoro laisse une impression assez étrange, comme celle d'un roman qui hésite entre plusieurs voies, n'en choisit aucune, et plante son lecteur au beau milieu de chemins qui ne mènent nulle part. S'agit-il d'un roman post-apocalyptique ? Incontestablement, mais comme par défaut, sans trop vraiment y croire, ni même désirer, sur ce terrain-là, paraître crédible : quelques expressions comme «la Quarantaine» ou le «tu-m'-tues» désignent assez que ce monde ravagé par un désastre atomique reste dangereux, comme le prouvent encore des hordes errantes de «gens sans bras, des bandes de microcéphales guidés par leurs cousins catatoniques, des tordus, des aveugles et des sourds, des êtres contraints de se couvrir le visage de sacs de jute pourris, de mousseline grisâtre, afin de n'imposer à personne le spectacle des portraits terrifiants que les gènes étaient capables de peindre» (1).
C'est du reste l'aspect le moins intéressant de ce roman assez peu structuré, dont nous ne décelons guère l'enjeu principal si ce n'est, peut-être, le motif, bien qu'assez décousu, qu'est la mémoire, Mr. Anthony Terrence Cheung, professeur de clarinette de Fiskadoro et régisseur de l'Orchestre symphonique de Miami déclarant ainsi croire en son importance : «Il était capable de réciter, sans tout à fait pouvoir les expliquer, le texte de plusieurs discours et documents célèbres» (p. 21), peut-être parce que «parfois nous vient l'envie de raconter des histoires dont le dessein le plus sacré est de nous faire frémir par des images de périls et de chaos» (p. 23), peut-être parce qu'il est un des rares à pouvoir mesurer «la vérité de sa propre extinction à venir» (p. 59).
Le thème de la mémoire est assez bellement incarné dans le personnage de la grand-mère Wright, qui un jour lointain s'appela Marie, et qui ne cesse de revivre son passé, puisque dans sa vieille tête «le filament du temps jamais ne s'emmêlait» (p. 148), notamment tel épisode, excellemment raconté, où elle parvient à quitter Saïgon, préfiguration, en somme, de l'Effondrement dont la nature ne nous est pas expliquée : «Chaque fois que lui défilaient dans la tête, contre son gré, cette marche triomphale de la mort de par le monde, les hordes de squelettes traînant derrière eux les sacs de leur peau dans les rues en proie aux flammes, les amas structurés de crânes, les uniformes vides qui déferlaient inexorablement sur les champs, les corps d'enfants tout transpercés des couteaux et des fourchettes jaillis du cœur des bombes», soit «le tréfonds de tout, la fin du monde, une grande absence grise que nul n'était plus là pour se rappeler, vision décrite, transmise, préservée par nul être», «alors c'était dans cette ville [Saïgon] qu'elle en voyait le spectacle, dans la ville où son père avait connu la mort» (p. 89).
Cette mémoire, il faut l'entretenir bien sûr comme on entretient un feu dans une poêle, car, s'il a bien fallu brûler «un exemplaire de la Constitution et tous les livres pour demeurer en vie», ce n'est tout de même qu'après avoir «appris la Constitution par cœur» (p. 152), raison pour laquelle les livres, y compris évoquant l'événement ayant eu lieu à Nagasaki et qui est l'objet de bien des spéculations de la part de nos survivants, peuvent être monnayés à prix d'or. Nous apprenons même qu'il existe à Deerfield des machines qui impriment des livres (cf. pp. 192-3), comme si «l'histoire du monde [était] de nouveau en train d'avoir lieu» (p. 193).
 La mémoire : non plus fleuve mais ruisseau qu'il s'agit de protéger d'un assèchement définitif, raison pour laquelle Mr. Cheung se «dresse contre les forces de la destruction, contre toutes les forces qui ont emporté les machines» (p. 145), sauf à ce que ces femmes et ces hommes d'après l'Effondrement ne redeviennent, comme ils le craignent, des singes (cf. p. 143), des «hommes des cavernes primitifs» (p. 144) ou des enfants parlant un étrange mélange d'anglais et d'espagnol appauvris, comme Fiskadoro qui vit dans l'éternel présent de l'animal (cf. p. 221), cette thématique de la mémoire a pour corollaire logique l'attente eschatologique, et cela d'autant plus que de nouvelles croyances, comiquement amalgamées, sont nées sur les anciennes : «Et, pourtant, les événements de cette soirée, si différents de l'ennui habituel, des discussions sans intérêt, le regard perdu dans les flammes, retournaient plus d'un estomac, et hommes et jeunes gens essayaient déjà d'oublier cette rencontre au moment où elle s'achevait. Ils avaient toujours été convaincus que la mer leur ramènerait un guerrier, que le sable s'élèverait dans les airs pour donner forme à un président et que de temps à autre au cours de leur vie les gens rencontreraient ceux qui devaient leur montrer le chemin» (p. 133). Plus loin, Mr. Cheung attend comme les autres «le moment où un regain de demande provoquerait la venue du grand homme qui arracherait les planches aux fenêtres et les conduirait durant le cycle de vie confuse et de mort prématurée qui était généralement celui dont jouissaient les entreprises tout le long des Keys» (p. 185).
La mémoire : non plus fleuve mais ruisseau qu'il s'agit de protéger d'un assèchement définitif, raison pour laquelle Mr. Cheung se «dresse contre les forces de la destruction, contre toutes les forces qui ont emporté les machines» (p. 145), sauf à ce que ces femmes et ces hommes d'après l'Effondrement ne redeviennent, comme ils le craignent, des singes (cf. p. 143), des «hommes des cavernes primitifs» (p. 144) ou des enfants parlant un étrange mélange d'anglais et d'espagnol appauvris, comme Fiskadoro qui vit dans l'éternel présent de l'animal (cf. p. 221), cette thématique de la mémoire a pour corollaire logique l'attente eschatologique, et cela d'autant plus que de nouvelles croyances, comiquement amalgamées, sont nées sur les anciennes : «Et, pourtant, les événements de cette soirée, si différents de l'ennui habituel, des discussions sans intérêt, le regard perdu dans les flammes, retournaient plus d'un estomac, et hommes et jeunes gens essayaient déjà d'oublier cette rencontre au moment où elle s'achevait. Ils avaient toujours été convaincus que la mer leur ramènerait un guerrier, que le sable s'élèverait dans les airs pour donner forme à un président et que de temps à autre au cours de leur vie les gens rencontreraient ceux qui devaient leur montrer le chemin» (p. 133). Plus loin, Mr. Cheung attend comme les autres «le moment où un regain de demande provoquerait la venue du grand homme qui arracherait les planches aux fenêtres et les conduirait durant le cycle de vie confuse et de mort prématurée qui était généralement celui dont jouissaient les entreprises tout le long des Keys» (p. 185). Un jour c'est certain, la Quarantaine sera abrogée, l'espoir renaîtra, et c'est alors qu'apparaîtra peut-être à l'horizon un «vaisseau fantôme», et «l'homme qui se tenait debout sur la proue était un fantôme aussi, qui venait les chercher, tout cela était clair si l'on prêtait attention au tirant d'eau de ce navire très très blanc», tout cela est «parfaitement clair au spectacle d'une telle majesté, à ce sentiment qu'il flotte dans les airs et non sur les eaux de ce monde» (pp. 252-3). Dès lors, comme Mr. Cheung le pense et le craint en contemplant le jeune Fiskadoro qui a été (cruellement) initié par les gens des marais et qui, ainsi né de nouveau à lui-même, va devenir tout autre, nouveau guide qui sait, «Tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes aura une fin, sera vaincu, récupéré, emporté. Mais tout a déjà connu une fin. Et tout va maintenant recommencer. De bien nombreuses fois. Encore et encore. Quelque chose s'en vient, quelque chose s'en va» (p. 251), juste cours des choses, comme si la présence de la grand-mère, qui semble avoir survécu à toutes les épreuves par le plus grand des hasards (2), n'avait finalement pas une si grande importance que cela, quoi qu'en dise l'écrivain.
Notes
(1) Denis Johnson, Fiskadoro (traduction de l'américain par Marc Chénetier, 10/18, coll. Domaine étranger, 2001), p. 51. En 2007, Denis Johnson a reçu le National Book Award pour Arbre de fumée.
(2) Sentiment d'absurdité et de hasard qu'évoquent ces lignes : «sauvée non parce qu'elle n'avait pas abandonné, car elle avait abandonné et ne conservait en fait aucun souvenir de la deuxième nuit et ne parvenait pas à croire, jusqu'à ce jour, qu'elle eût passé vingt heures à demeurer en vie, souffle après souffle, sans en savoir assez pour le désirer; sauvée non parce qu'elle avait résisté assez longtemps, car rien n'indiquait ce que c'était qu'assez longtemps; sauvée parce qu'elle avait ét sauvée, sauvée parce qu'on lui avait jeté une corde, mais elle n'avait pas eu la force alors de lever la main pour s'en saisir; sauvée parce qu'un marin avait sauté du bateau, ses pieds nus, tout blancs, pendant des jambes de son pantalon kaki, et l'avait tirée jusqu'à l'échelle; sauvée non parce que ses mains s'étaient tendues; sauvée parce que d'autres mains que les siennes s'étaient tendues vers elle et l'avaient sauvée» (p. 250).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, post-apocalyptisme, denis johnson, fiskadoro, au-delà de l'effondrement, éditions 1018 |  |
|  Imprimer
Imprimer