Léon Bloy ou le pont sur l'abîme de Jacques Vier (14/07/2018)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Léon Bloy dans la Zone.
Léon Bloy dans la Zone.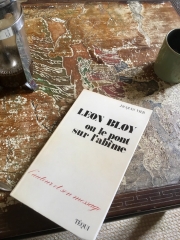 S'il reste des éditeurs courageux dans ce pays ou, plus simplement, des hommes conscients du fait que la plus grande partie de la production de livres, en France, mériterait non seulement d'être recyclée au plus vite mais n'aurait jamais dû être produite, je leur suggère de rééditer, débarrassé de ses coquilles, cet excellent petit ouvrage de Jacques Vier paru en 1986 aux éditions Téqui dans la collection intitulée L’auteur et son message. Ce livre constituera ainsi une excellente introduction aux textes subtils et rugissants de Léon Bloy, bien davantage que l’étude journalistique à souhait, donc faisant la maline comme disait Charles Péguy, de François Angelier, récemment parue et dont j'ai rendu compte ici.
S'il reste des éditeurs courageux dans ce pays ou, plus simplement, des hommes conscients du fait que la plus grande partie de la production de livres, en France, mériterait non seulement d'être recyclée au plus vite mais n'aurait jamais dû être produite, je leur suggère de rééditer, débarrassé de ses coquilles, cet excellent petit ouvrage de Jacques Vier paru en 1986 aux éditions Téqui dans la collection intitulée L’auteur et son message. Ce livre constituera ainsi une excellente introduction aux textes subtils et rugissants de Léon Bloy, bien davantage que l’étude journalistique à souhait, donc faisant la maline comme disait Charles Péguy, de François Angelier, récemment parue et dont j'ai rendu compte ici.Jacques Vier est aujourd'hui bien oublié, alors qu’il a énormément commenté des écrivains comme Gide, Barrès et tant d’autres, été le maître d’œuvre de plusieurs anthologies et publié plusieurs volumes d’une Littérature à l’emporte-pièce qui doit achever de pourrir dans un fond de cave humide. Ayant collaboré des années durant aux Cahiers du monde moderne en tant que critique littéraire, il était agrégé de lettres et, comme on le disait encore naguère, docteur ès lettres. Pour une fois, je ne vois point de contradiction entre ces deux mondes si différents, car il est évident que Jacques Vier n'a pas peur d'appeler un chat un chat, au rebours de tant de ses si doctes collègues, comme le montre cette anecdote au sujet de l’un d’entre eux qui eût pu être croqué en une ligne de ce livre que Jacques Vier ni même Léon Bloy qui en caressa un temps l’idée jamais n’écrivirent, intitulé Les Impuissants : «Un sot, qui fut pendant un temps interminable, professeur d’histoire en Sorbonne, faisait, il y a un demi-siècle, de grands éclats de rire en parlant de la double mutilation de la jeune femme», l’inoubliable Véronique bien sûr du Désespéré ; «Il ignorait poursuit Jacques Vier, que le duc de Mazarin, dans son hyper-jansénisme, avait voulu imposer à ses filles le sacrifice de leur chevelure et de leurs dents» (p. 160). Nous le voyons ainsi, dans son beau texte sur Léon Bloy, ne point se voiler la face ou bien se boucher le nez d'un geste délicat lorsqu'il s'agit de jeter quelques vérités bien senties, non seulement sur tel ou tel écrivain, comme Anatole France, mais aussi sur Léon Bloy qu'il célèbre à sa juste valeur, qui est colossale, non sans taire tel de ses défauts les plus visibles, comme une certaine faculté de mauvaise foi, que pour notre part nous lui avons toujours pardonnée, tant il est monstrueusement, c'est le cas de le dire, drôle et méchant. Ainsi, «le brasier des colères» de Léon Bloy «ne purifie pas toujours tous ses tisons, lesquels retombent éteints et noircis» (p. 38) mais, plus intéressant puisque l'observation suivante touche à une généralité historique et métaphysique profonde : «Dans les différents passages où il montre Satan tapi au centre de l'Irrévocable, prison colossale où le genre humain demeurerait bel et bien incarcéré, si Dieu n'avait pas prévu l'échappatoire de la liberté, ne dirait-on pas qu'il a prévu l'acte de vassale soumission dont le monde moderne s'acquitte dans les mains de son Suzerain ? Depuis la Révolution française, en effet, le genre humain paie par le massacre légal, puis par le génocide organisé, le prix fort de cette irréversibilité, qu'il aime tant proclamer, de ses dogmes, de ses lois, de ses modes et qui n'est que le contraire de la réversibilité, essence même du christianisme» (p. 288, l'auteur souligne) (1).
Jacques Vier a compris la seule chose je crois qu’il importe de bien comprendre lorsque l’on découvre pour la première fois un texte de Léon Bloy, et qu’à bon droit nous pourrions considérer comme son motif dans le tapis (2) : «Léon Bloy ne peut pas faire un pas sans véhiculer la transcendance» (p. 7) et aussi, alors que, comme un buveur, l’écrivain connaît une «véritable ébriété scripturaire» qui jamais ne semble devoir être interrompue par quelque salutaire dégrisement, puisqu’il a écrit un «vaste négatif, qui ne peut être interprété positivement que dans le filigrane de l’Esprit-Saint» (p. 8).
Véritable «enlumineur de la théologie» qui est allé de «l’équarrissage à l’élection» (p. 15), et même s’il est parfaitement clair cependant pour Jacques Vier que le «brasier de ses colères ne purifie pas toujours tous ses tisons, lesquels retombent éteints et noircis» (p. 38), il est tout aussi visible que «Léon Bloy frappe non par orgueil satanique», «mais parce qu’il ne saurait endurer que l’on soit infidèle à sa vocation» (p. 43). D’où «la réussite, ajoute notre commentateur, d’une main qui fût prodigieusement exercée» à la césarienne, puisque «l’âme ne peut être opérée du péché» (p. 111) que grâce à cette opération, qu’il pratiqua à vrai dire sans bien demander l’autorisation, ni même l’avis, de ses contemporains.
Je ne détaillerai pas les différentes parties du livre de Jacques Vier, qui évoque ainsi Léon Bloy au sein de l’Église, bassement composée de demi-soldes du journalisme ou brillant de tous les feux des mystiques, mais aussi parmi ses contemporains artistes, pour lesquels il a pu montrer qu’il était «à peu près infaillible dans ses jugements de littérature et d’art» (p. 134). C’est pour Jacques Vier l’occasion d’évoquer Georges Bernanos que Léon Bloy semble annoncer de tous ses pores, mais aussi les expériences pour le moins peu concluantes de l’écrivain dans le monde de la presse (cf. pp. 187-201), ce dernier étant, c’est clair, «rigoureusement dépourvu du sens des «media» et que s’il en souffre, c’est sur le dos de ceux qui disposent d’une clef qu’il ne découvrira jamais» (p. 193). Jacques Vier pense que «sans le journalisme et les journalistes, Guignols à massacre, Léon Bloy eût manqué d’humour dans la férocité et de férocité dans l’humour» (p. 201).
Nous savons tous que Léon Bloy fut un extraordinaire pamphlétaire, génialement portraituré par Georges Darien (4), l’auteur de La Belle France évoquée ici, mais nous savons moins que sa réelle passion fut le déchiffrement de l’histoire, dans la trame complexe de laquelle l’écrivain voyait Dieu écrire sa phrase prodigieuse, qui certes avait tendance à répéter les mêmes mots sanglants, «comme si les infidélités et les apostasies croissantes maintenaient le Golgotha, oserait-on dire, au préjudice de la Résurrection» (p. 215).
«Tous les poètes, on le sait, combattent contre le temps», écrit bellement Jacques Vier, «mais quand on définit le temps par le péché, on indique la route du Buisson ardent» (p. 217), et on admet, fût-ce implicitement, que le péché sinon la main (gauche ?) de Dieu écrit la geste des hommes. Ainsi Léon Bloy «ne manque pas une occasion de reconduire [ères et événements] à leur source» car, «pour lui, enfin, enraciné comme il l’est dans son siècle, l’histoire est un genre littéraire» : «sur la route des catacombes aux rosaces, les images se multiplient à l’infini» (p. 241). Les images et les figures, comme celle de Napoléon, qui l’aura fasciné sa vie durant, la destinée du grand homme, au sens que Carlyle donnait à cette expression, marquant l’écrivain par son échec colossal, alors même que son histoire naturelle et surtout, aux yeux de Bloy, surnaturelle, ne signifiant «pas autre chose que la clôture définitive du monde aux vocations surnaturelles» (p. 244). Jacques Vier affirme qu’il «faut voir en Léon Bloy un homme qui se dit historien et proclame maintes fois sa vocation parce qu’il se veut peseur d’âmes» (p. 255), et même un historien bien davantage qu’un écrivain, puisque «l’histoire contient le principe et, peut-être, l’espérance de sa propre purification, au lieu que la littérature est une tempête maudite de basses et monstrueuses rébellions où il faut entrer comme Neptune imposant silence aux vents déchaînés, un trident à la main» (p. 261).
Dans les deux cas, histoire ou littérature et même, osons-le, journalisme, «Dieu se cache sous les haillons verbaux» (p. 278) aux yeux de notre «enlumineur professionnel» doublé d’un «équarrisseur bénévole» (p. 280). Comme chez tout grand écrivain, les «rayons et les ombres se battent chez Léon Bloy mais il reste toujours maître de son athanor et, quand Dieu le permet, l’or surgit» (p. 286) et, comme chez tout grand écrivain, la lucidité, bien davantage que l’espérance, est primordiale, qui lui fait écrire qu’il faisait «des livres qui vivront et qui ne [le faisaient] pas vivre», alors même que nous toucherions sans doute la vérité, «si l’on s’accordait à comprendre et à admettre que la substance poétique de l’œuvre de Léon Bloy provient du désir passionné de contraindre toutes les puissances de l’Art à célébrer la surnature» (p. 227), alors même encore que Jacques Vier conclut son bel essai en affirmant que, quoi que l’on pense de ce formidable rétiaire, «l’on se heurtera toujours à l’expectance qui, de vingt à soixante ans, fut la sienne sous une infinité de formes» (p. 291).
Notes
(1) Sur la notion d'irrévocabilité comme caractéristique première du démon, voir ce que Léon Bloy écrivit dans son Révélateur du Globe, dont j’ai rendu compte dans cette longue note où j’évoque également l’un des textes de Roselly de Lorgues sur le grand marin.
(2) «Chaque écrivain n’a-t-il pas une chose particulière de ce genre, la chose qui le pousse le plus à s’appliquer, la chose sans quoi, s’il n’y avait pas l’effort de la réussir, il n’écrirait même pas, le centre même de sa passion, la part de son entreprise dans laquelle, à ses propres yeux, brûle le plus intensément la flamme de l’art ? Eh bien, il s’agit de ça !», in Henry James, Le Motif dans le tapis (traduction par Jean Pavans, présentation par Julie Wolkenstein, Flammarion, coll. GF, 2004, p. 51).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, léon bloy, jacques vier, éditions téqui, georges darien, georges bernanos |  |
|  Imprimer
Imprimer
