Locus Solus de Raymond Roussel : où la mort ne se regarde pas en face, par Gregory Mion (12/10/2019)

Crédits photographiques : Matt Cowan (Reuters).
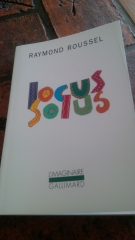 Acheter Locus Solus sur Amazon.
Acheter Locus Solus sur Amazon.«Pour ne pas penser à la mort, un seul remède : écrire un livre sur la mort.»
Vladimir Jankélévitch.
Perspectives critiques : ce que l’intelligence est susceptible de faire à la réalité
La lecture de Raymond Roussel aujourd’hui peut devenir un acte de résistance à l’encontre d’un siècle français qui a perdu sa raison et ses lettres. On ne peut être que sidéré par un texte comme Locus Solus (1) tant le niveau de langue y est élevé, inventif et délectable, à tel point que ce roman paraît avoir été écrit depuis une autre galaxie, voire depuis un temps parallèle où rien n’a pu se créer en fonction d’un calendrier commercial ou d’attentes sordidement populacières. En cela déjà le titre choisi par Raymond Roussel rencontre sa justification : nous sommes tout à fait en présence d’un livre qui déploie un terrain unique de littérature, un genre de chez-soi romanesque, doué d’une indépendance forcenée qui n’a pas la cupidité des consensus à la mode. Il y avait même quelque chose de destinal dans ce titre, comme s’il s’agissait d’un roman assigné à la résidence de son exclusivité, de sa stricte singularité persévérante, un livre condamné à n’être lu que par des poignées de lecteurs capables d’y percevoir un amour débordant de la littérature et de ses moyens créatifs – un livre, encore, où le lecteur est sommé de pressentir un peu plus que cela parce que la virtuosité des mots ne suffit pas à authentifier une œuvre maîtresse. C’est dire que l’on n’entre pas dans ce Locus Solus à la légère. On n’y entre pas non plus par hasard. Nous y sommes d’une certaine manière conviés par de secrètes connivences, tels que le sont les personnages du roman, petite troupe de visiteurs privilégiés, réunis par l’ingénieux Martial Canterel dans sa villa de Montmorency où il va les initier aux ultimes prodiges issus de ses remarquables travaux scientifiques et de son atypique mécénat.
Baptisée Locus Solus, la maison de Martial Canterel suppose à la fois l’exception architecturale et l’utopie réalisée. Plus précisément, le registre utopique visé concerne le domaine du savoir, qui, dans le cas de Martial Canterel, atteint des proportions encyclopédiques et méta-prométhéennes. Son étonnante demeure traduit alors le sans-lieu possible devenu un lieu réel et partout ailleurs introuvable, la naissance d’une réalité que l’on croyait impossible – autrement dit l’accès à une quantité de savoirs qui jusqu’alors paraissait inenvisageable. Cette maison suppose aussi la doublure du roman et de son auteur, le livre de Raymond Roussel n’étant pas autre chose que cette féérique propriété où tout conspire à susciter l’ahurissement, et le propriétaire des lieux n’étant nul autre que le romancier lui-même, créateur inassouvi et frénétique, assoiffé de trouvailles comme peut l’être le savant relativement fou qu’il met en scène. Le site du roman se veut donc aussi rare que le site physique du livre que nous tenons entre nos mains, et le locuteur Martial Canterel, sorte de Monsieur Loyal prolixe et néologisant à l’occasion, régnant sur son cabinet de curiosités dissipé à même le grand parc de sa villa, incarne le stupéfiant porte-parole de Raymond Roussel dans l’univers de la fiction, celui-ci étant l’inspirateur de celui-là comme un marionnettiste anime ses figurines avec la rage de leur donner une vie crédible, peut-être ici pour se libérer d’un monde de plus en plus inhospitalier, linguistiquement et humainement défaillant. Paru en effet au début de l’année 1914, Locus Solus, par le jeu de l’hypothèse, suggère un espace de quarantaine protégé des incubations de la guerre et des sujets de conversation où ne surgit aucune intrépidité de langage. C’est du reste par ce biais que nous verrons peu à peu la critique potentielle d’un texte où l’excès des puissances intellectuelles finit par se détourner de la chair du monde (2) d’une part, en l’occurrence du présent le plus immédiat, et d’autre part des expériences conséquentes de la vie ordinaire. Telle serait ainsi la face cachée de Locus Solus, le sujet central qu’il faudrait exhumer derrière le rideau attrayant du langage : le refus d’affronter la réalité ambiante par un surcroît de maîtrise qui n’est pas disposé à négocier avec l’imprévisibilité du monde, ou, si l’on préfère, l’installation d’un fanatisme de la nécessité au détriment d’une sage observation de la contingence (3), aggravé en outre d’une préférence pour l’extraordinaire et d’un rejet indirect de la banalité.
Il n’empêche que la première impression qui nous frappe dès que l’on pénètre à l’intérieur de ce royaume de la connaissance et de l’innovation est une impression de fascination. Tout ce que l’on s’apprête à voir ou entendre à Locus Solus devra faire l’objet d’une explication de la part du «maître» tant il existe un décalage entre l’ordinaire de la perception et les mystères que Martial Canterel a réussi à insuffler dans les mots, les choses et les êtres passés au crible de sa gouvernance. Il ne serait pas exagéré de penser que toute visite à Locus Solus revient à mettre les pieds dans une toile de Salvador Dalí, et plus particulièrement dans ce tableau où le génie de Figueras a représenté un palais de l’Escurial plein de contorsions, la pierre se tirebouchonnant afin d’atteindre une forme nouvelle. Pareillement, au fur et à mesure que la visite de Locus Solus va se compléter, on aura ce sentiment d’un lieu qui se tord, qui se reconstitue à perpétuité, non seulement pour préserver son statut d’endroit insaisissable, mais aussi pour fortifier l’allégorie d’une cervelle en ébullition (celle de Martial Canterel) qui semble décréter en permanence la configuration idéale de l’univers, bien avant de se demander si cette tâche n’appartient pas plutôt à un dieu ou aux décrets incommensurables de la nature. On aurait là l’œuvre d’un facteur Cheval beaucoup moins diaprée d’intentions naïves, l’œuvre d’un Howard Hughes de l’encyclopédisme, prêt à tout sacrifier dans le but de toucher au fin fond du savoir qu’il est humainement possible de thésauriser (et pourquoi pas inhumainement). Il s’agit pour Marial Canterel de repousser les frontières de nos facultés de connaître indépendamment de toute considération éthique, avec ce désir à peine voilé de supplanter le périmètre des phénomènes (les choses telles qu’elles nous apparaissent à travers l’imperfection de nos sens) en vue d’aborder le pays interdit des choses en soi (ce qui nous est en principe inconnaissable) (4).
Il se peut ainsi que cette villa de Montmorency ne soit qu’une espèce de «folie» Almayer, et que, à l’image de la bâtisse qui trône dans le roman de Joseph Conrad (5), ce Locus Solus ne soit que l’immense et faramineux témoignage des ambitions démesurées de son propriétaire, voire, en filigrane, la repentante confession de Raymond Roussel eu égard à un projet littéraire uniquement fomenté à l’attention des happy few. Mais que faut-il estimer davantage ? L’outrance ou la platitude ? La radicalité ou la modération ? La réponse qui se dégage du roman est assez claire : Martial Canterel est un homme qui réalise tout ce qu’il est techniquement possible de réaliser, au risque de franchir plusieurs limites, et Raymond Roussel est un auteur qui ne recule devant aucun esprit de conquête dans l’art d’écrire. D’un côté nous pouvons blâmer le personnage de fiction, mais, de l’autre, nous saluons bien volontiers l’écrivain qui dépasse constamment les ordres établis. De nos jours, malheureusement, les rapports se sont inversés : nous avons trop de Martial Canterel dans la réalité et nous manquons cruellement de Raymond Roussel dans l’écriture. Il s’ensuit que la technique encombre le monde, comme si la villa de Montmorency de Canterel s’étendait maintenant sur tout le territoire planétaire, et, en contrepartie, cette épidémie technocratique rend vulnérable le pôle de l’imaginaire et de la sensibilité. On y a certes gagné un esprit de conquête qui a par exemple abouti au transhumanisme, mais, plus sévèrement, on y a perdu le goût de conquérir des formes de progrès désintéressées. On doit alors se demander si Locus Solus, par-delà ses insondables fantaisies et ses plus apparentes volontés, n’est pas un discret réquisitoire contre la science triomphante et un tout aussi discret plaidoyer pour la seule compétence qui vaille la peine d’être alimentée – le pouvoir de créer des mondes littéraires pour nous désencombrer des mondes pesants de la vie moderne.
La suite de ce texte figure dans J'ai mis la main à la charrue.
Ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur, ici ou bien, avec un bien meilleur résultat, chez Amazon, là.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, raymond roussel, locus solus, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer
