Crépuscule de Juan Branco (08/03/2020)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
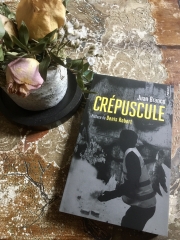 Ce n'est évidemment pas comme une enquête sourcée voire sérieuse qu'il faut lire Crépuscule de Juan Branco, des journalistes ayant fait, dans ce domaine qui ne nous concerne guère, leur travail, pour une fois semble-t-il, à moins bien sûr qu'il ne s'agisse de mauvaise foi et de petits règlements de compte, en relativisant certaines prétentions de l'auteur à établir des concaténations dignes d'un épisode de la série X Files, dans plusieurs articles dont je ne citerai que trois exemples, parus sur Slate, Marianne et Mediapart. De cette dernière recension, Juan Branco dira d'ailleurs qu'elle est un «monument de haine» (p. 256), et je ne serais absolument pas étonné qu'il dise vrai. Toutes le sont sans doute en effet, haineuses, à des degrés divers, et bien sûr toujours sous couvert du plus strict professionnalisme; nous sommes là en terrain couru, le journaliste parisien étant par définition l'être qui est de toute éternité si je puis dire, par essence, incapable de vous surprendre favorablement. Il est aussi bien clair que le personnage peut insupporter au plus haut point, raison peu avouable pour laquelle, avant même que de l'avoir lu, Juan Branco sera voué au bûcher, les plus empressés à attiser les flammes n'étant bien évidemment pas les derniers à avoir, ici ou là, flatté les immenses qualités de la Macronie et de ses serviles caniches nains, censée insuffler une vitalité inouïe à une sphère politique française moribonde, à l'électroencéphalogramme au moins aussi plat qu'est vide le crâne d'un Gilles Le Gendre.
Ce n'est évidemment pas comme une enquête sourcée voire sérieuse qu'il faut lire Crépuscule de Juan Branco, des journalistes ayant fait, dans ce domaine qui ne nous concerne guère, leur travail, pour une fois semble-t-il, à moins bien sûr qu'il ne s'agisse de mauvaise foi et de petits règlements de compte, en relativisant certaines prétentions de l'auteur à établir des concaténations dignes d'un épisode de la série X Files, dans plusieurs articles dont je ne citerai que trois exemples, parus sur Slate, Marianne et Mediapart. De cette dernière recension, Juan Branco dira d'ailleurs qu'elle est un «monument de haine» (p. 256), et je ne serais absolument pas étonné qu'il dise vrai. Toutes le sont sans doute en effet, haineuses, à des degrés divers, et bien sûr toujours sous couvert du plus strict professionnalisme; nous sommes là en terrain couru, le journaliste parisien étant par définition l'être qui est de toute éternité si je puis dire, par essence, incapable de vous surprendre favorablement. Il est aussi bien clair que le personnage peut insupporter au plus haut point, raison peu avouable pour laquelle, avant même que de l'avoir lu, Juan Branco sera voué au bûcher, les plus empressés à attiser les flammes n'étant bien évidemment pas les derniers à avoir, ici ou là, flatté les immenses qualités de la Macronie et de ses serviles caniches nains, censée insuffler une vitalité inouïe à une sphère politique française moribonde, à l'électroencéphalogramme au moins aussi plat qu'est vide le crâne d'un Gilles Le Gendre.Je n'aurai donc pas besoin de moquer, comme d'autres l'ont fait, telle ou telle prétendue découverte réalisée par notre intrépide opposant et défenseur des Gilets jaunes, auquel on reproche d'avoir subitement pris connaissance de l'existence de la Lune consanguine sous la lumière pâle de laquelle pousse une végétation dont l'intéressé détaille les particularités de plusieurs efflorescences plus ou moins dolentes mais, toutes, acharnées à pousser et se pousser et se repousser et s'empousser et se compousser, quitte à partager de nombreux rhizomes pour épaissir le coussin sur lequel se reproduire le plus vite possible, en exhalant de magnifiques spores qui donneront vite naissance à de bizarres concrétions gélatineuses que l'on appelle des femmes et des hommes de progrès.
Le livre de Juan Branco m'a fait en tout cas immédiatement, donc superficiellement, songer au Monde libre d'Aude Lancelin : cette dernière, ayant patiemment gravi, un à un, durant des années d'opiniâtres efforts, les échelons d'un grand journal de presse situé à gauche, s'est soudainement découvert une âme d'Amazone intraitable une fois éjectée, selon ses dires par le fait du ou des princes qu'elle indisposait par sa verve polémistique et sa droiture journalistique incontestable, d'un média qui, jusqu'alors, ne lui servait que de commode marchepied et qu'il fallait aussitôt vouer aux gémonies, jeter au caniveau. Juan Branco, lui aussi, semble être revenu de tout, du moins des cénacles stratosphériques dans lesquels, selon ses propres dires plusieurs fois répétés dans son ouvrage, il n'a jamais eu de mal à être introduit ou à s'être introduit, ce qui revient au fond au même, cette infiltration assumée suivie d'une auto-exfiltration salvatrice lui ayant conféré la capacité de bien connaître cela (l'univers de l'entregent et de la reconnaissance népotique) avec quoi il a pris ses distances et qu'il critique désormais avec une saine virulence ou, diront ses contempteurs, avec une alacrité qui n'est que de façade, un homme appartenant au sérail ne pouvant oser prétendre l'avoir quitté qu'à ses moments de plus intime relâchement ou bien par pur calcul opportuniste. En me forçant un peu et non sans quelque ironie que l'on me pardonnera, j'avoue beaucoup aimer ces résistants de la vingt-cinquième heure qui se retrouvent, «du fait d'une erreur de casting», parmi une «centaine d'invités triés sur le volet» (p. 34) à une modeste réception donnée par Bernard Arnault en personne «au cœur du Ritz, à l'abri des regards et sous une escorte renforcée» (p. 33) ou que ne gênent pas les gueux en train de manifester alors qu'ils sirotent tranquillement, comme notre auteur, un verre à la terrasse du «Flore, où [il n'a] jamais cessé d'aller» (p. 52, l'auteur souligne), chacune de ces preuves de corruption plus ou moins passive (dans l'esprit de l'auteur bien sûr) étant mise sous nos yeux «avec l'aplomb de celui qui en a été» (p. 54, l'auteur souligne) mais qui, il nous le répète suffisamment aussi, n'en est absolument plus. Nous savons bien que l'on ne déteste jamais autant que ce qu'on a adoré naguère et jusqu'à la folie, cette règle universelle étant valable des attentions que nous prodiguons dans la chambre à coucher jusqu'au boudoir germanopratin, ce qui est au fond, là encore, une seule et même chose. Si Juan Branco est sincère, alors il faut saluer cette prise de conscience et, s'il ne l'est pas, il n'en faut pas moins saluer la hargne avec laquelle cet opposant affronte un ennemi aux innombrables séides, qui par tous les moyens tenteront de le déstabiliser et, cela est évident, de la salir.
Ce culot ne me gêne donc absolument pas et, si cela ne tenait qu'à moi, ce n'est pas un mais dix ou cent Juan Branco que j'aimerais voir attaquer tous les avachis arrivistes de la Macronie, ce n'est pas dix ou cent mais mille Juan Branco que je souhaiterais voir moquer mes amis journalistes qui représentent, après les animalcules mentionnés auparavant, la cible favorite sur laquelle notre franc-tireur ajuste ses tirs. Ils ne sont jamais assez puissants à mon goût, même si l'homme, il suffit pour s'en convaincre de visionner l'une des innombrables vidéos de ses confrontations avec nos échotiers de l'insignifiance, est à quelques franches coudées au-dessus du lamentable niveau de la plupart de ces écrivants martialement dressés sur leurs ergots mais, en vérité, rampants sous le copinage et la flatterie ! Cette remarque ne vise personne précisément, un journaliste en valant un autre à mes yeux, Juan Branco désignant du reste, sans qu'on le prie, et très précisément pour le coup, celles et ceux qu'il conspue, mais vaut pour l'ensemble de nos lémures, hommes politiques sans beaucoup de relief, conseillers de l'ombre sans colonne vertébrale, cumulards multi-millionnaires des conseils d'administration des sociétés où il fait bon caler ses fesses de ploutocrate consommé, entremetteuses torves et franches catins se tenant suggestivement à l'orée entre le putanat et la communication ou mélangeant allègrement les genres, journalistes plus ou moins célèbres, bien souvent hideusement beaux d'un cancer à la langue, mais tous, la queue basse et l’œil sanieux d'excitation, bouffant à la même écuelle, et, je vous prie de croire que je suis navré d'indisposer les défenseurs de la cause canine par cette comparaison peu flatteuse pour le meilleur ami de l'homme, tous s'empressant de lécher leur prochain, reniflant jusqu'à l'intumescence de leurs naseaux leurs aimables congénères, chiennes et chiens comme eux, caniches ou bassets, hyènes même, afin d'identifier le plus vite possible tel potentiel rival : «Tous, qui se croient libres et indépendants, sont dans les faits partiellement inféodés, et prennent à un moment garde à ne pas exposer l'un des blocs oligarchiques auxquels ils sont assujettis» (pp. 125-6), ce qui revient à dire que nos prudents sont, avant tout, des lâches et réciproquement ou bien encore : «à quoi servent nos médias, désengagés de toute pensée, incapables de traiter l'information au-delà du flux, au nom d'une supposée objectivité qui les écarte de toute discours global, de la politicité nécessaire pour saisir et comprendre ce qui se jouait ?» (p. 148). Je demande ici un peu de mansuétude à Juan Branco qui ne facilite pas la tâche des journalistes en employant des mots dont ils ont probablement découvert l'existence en le lisant.
On a accusé Juan Branco de complotisme et d'être obsédé par la révélation au grand jour d'un réseau opaque composé d'une multitude d'intrigues plus ou moins cousues de fil blanc, puisqu'il est bien vrai que «mille invisibles relais ont porté Macron sans mot dire», tous l'ayant fait «de bonne grâce, s'appuyant pour cela sur les moyens que leur donnait l’État» (p. 219). Cette accusation est en partie fondée mais il n'en reste pas moins que nous n'avons guère besoin de tenter de le discréditer par ce pauvre moyen car telle remarque, juste à mon sens, plus d'une fois déclinée dans Crépuscule, balaie toute obsession de conspirationnisme, et rappelle qu'une démocratie liquide comme la nôtre est traversée de courants ou d'ondes qui suffisent largement à expliquer comment certains surnages, d'autres coulent à pic et, quelques-uns seulement, voguent sur le dos des sirènes vers les îles fortunées de la réussite sociale : «Les plus dangereux ne sont pas en haut : ils se trouvent à l'horizontale, auprès de ceux qui, se désolidarisant pour dire la vérité, menacent de les désigner» (p. 188), Branco ayant parfaitement compris qu'il n'y a nul besoin de tenter de débusquer tel improbable homme à la cigarette qui agiterait les fils des marionnettes les plus en vue, puisque ce sont les marionnettes elles-mêmes qui s'agitent les unes les autres, s'aident les unes les autres, se trahissent les unes les autres, se manipulent les unes les autres, comme si l'universelle duperie, la rayonnante compromission incubant dans la matrice parisienne, étaient les choses les mieux partagées du monde, du moins de ce que l'auteur appelle le «Petit-Paris». De fait, c'est l'inverse même du conspirationnisme que je vois dans ces quelques lignes : «On tremble parce que soudain, on commence à se sentir bizarrement encerclé, pour peu qu'on ne serve nul intérêt, ou nul relais qui pourrait un jour être, par l'un de ceux-là, mobilisé. On tremble car l'on sait qu'à tout cela s'ajoutent les intérêts corporatistes, la crainte pour les journalistes de paraître complotistes, les difficultés à se désolidariser, la peur d'être un jour excommuniés» (p. 192). Si ces quelques lignes et tant d'autres trahissent un esprit dévoré par de brumeuses théories conspirationnistes, alors je dois avouer que moi aussi, sans avoir pourtant fréquenté aucun des lieux dorés qu'évoque Juan Branco, j'ai bien des fois constaté cette cooptation silencieuse, ce geste en apparence anodin qui fait que deux personnes se reconnaissent immanquablement et excluent tout aussi immanquablement tel qui prétendait faire partie du cénacle. Les journalistes sont passés maîtres dans cet art essentiellement mutique consistant, de fait, en une espèce de privation ontologique : point n'est besoin de moquer tel ou tel puisqu'il suffit de ne jamais l'évoquer, de taire son travail, pour faire comme s'il n'existait pas.
J'ai commencé ce court article en disant que je n'avais au fond aucune compétence particulière pour critiquer le sérieux des investigations menées par Juan Branco, infirmer, preuves à l'appui, la validité des révélations qu'il prétend absolument originales, l'auteur ne manquant pas, d'ailleurs, de remercier ses discrets indicateurs dans la postface de son ouvrage. Mon expertise (voici que, moquant les journalistes et les conseillers en communication qui pullulent, pas seulement autour de Macron, j'emploie les mêmes termes que ces pitres), mon expertise donc porte plutôt sur la dimension la moins commentée de Crépuscule et qui est pourtant la plus patente. Cette dimension est littéraire, non point stylistique même si je pourrais scandaliser quelques imbéciles en affirmant que le texte de Juan Branco, aussi apprêté, parfois, qu'on le voudra, est quand même bien mieux écrit que tel récent navet springorien produit à quatre pieds et qui a pourtant fait rouler des yeux le tout-Paris (pardon : le Petit-Paris) de la critique dite littéraire journalistique. Là n'est pas ce qui retient notre attention, le style de Branco étant de toute façon agréable (2) je l'ai dit. Nous avons bien davantage été attentifs à l'impression d'étouffement, assez vive pour être notée, que provoque intelligemment, certes parfois un peu trop facilement (via la cheville : «Respirons. Soufflons», réutilisée à quelques pages d'écart, cf. pp. 212 et 215), le texte de Juan Branco. Ce sentiment, je le note avec une pointe de surprise et d'amusement, a été le nôtre toutes les fois que nous avons lu un roman de Philip K. Dick. Cette universelle pourriture, la rongeasse de Dick !, cette corruption exsudant de «l'aristocratisation d'une bourgeoisie sans mérite» (p. 233), cette «dérive, ontologique» (postface, p. 238) qui gagne les lieux que l'on croyait les plus sûrs, même s'il faut s'amuser du fait que Juan Branco semble tout à coup découvrir que la putain républicaine est non seulement vérolée mais putréfiée, cette évidence douloureuse donc, souvent paranoïaque (et même, dirait-on aujourd'hui, bien souvent complotiste), que la réalité n'est pas vraiment celle dans laquelle nous nous mouvons et où nous respirons quotidiennement, mais surtout cette certitude que l'on est le seul ou presque à voir au-delà des apparences, comme le maître du Haut Château, et que cette si bonhomme démocratie est en fait une oligarchie redoutable, sous ses dehors dialogiques qui ne font que masquer une prise de parole autoritaire, puissance agissant sous les yeux de tous mais difficile à personnifier (3), nous les trouvons chez Dick comme chez Branco, raison pour laquelle j'ai dit que je n'avais pas lu Crépuscule comme une enquête ni même comme un pamphlet, mais comme un roman et, plus précisément, comme une dystopie ayant pour originalité de ne point du tout revendiquer cette dimension. Ce que décrit Juan Branco, ce n'est pas tel avenir supposément proche de la France basculant dans la dictature, c'est notre présent qui s'effrite, la Macronie n'étant du reste à ses yeux qu'une forme de dictature molle, qui ne dit pas son nom, d'autant plus coercitive qu'elle se grime sous le masque du progressisme.
Cette dystopie est la nôtre, ce «réseau de solidarité et de redistribution de prébendes» (p. 230), ces «réseaux d'allégeance et de contre-allégeance» (p. 226) desquels Juan Branco nous assure s'être «arraché» (p. 229), conditionnent les individus sans même qu'ils s'en rendent compte, puisqu'il s'agit à tout prix de s'entrelécher et de se coopter «afin de s'assurer de la préservation d'un monopole sur le bien commun» (p. 221), afin de perpétuer de la sorte et le plus longtemps possible cette «endogamie avariée» (p. 218) ou encore cette «endogamie galopante» (p. 210) qu'est devenue l'élite intellectuelle de notre pays. Dans ce pays, le nôtre, si faussement démocratique que le peuple s'est «vu imposer ses gouvernants par une petite coterie satisfaite de ses manipulations», cette supercherie exposant «notre régime politique dans sa nature» (p. 45) qui n'est autre que «la distorsion d'un espace démocratique toujours plus avarié» (p. 179), Juan Branco me paraît encore timoré lui qui, loin de demander «une violente réclamation d'approfondissement démocratique» (p. 49), ce qui est à peu près aussi ridicule qu'un slogan institutionnel ou le morne rabâchage des éléments de langage péniblement mémorisés par une si bête Ndiaye, devrait appeler de ses vœux les plus intimes une véritable purgation, devant laquelle, bien curieusement, il recule. C'est en cela que Juan Branco trahit son petit milieu, encore plus qu'un Antonin Bernanos qui, lui au moins, n'a pas peur de casser des nez, et qu'il y a encore loin de sa colère somme toute méticuleusement orchestrée à la fureur dévastatrice d'un Georges Darien dans La Belle France. Car enfin, s'il faut un certain panache pour affirmer, contre l'avis de tous les imbéciles réunis en chœur, que notre démocratie n'est plus guère que «formelle, là où elle était réelle» (p. 171), c'est s'arrêter au milieu du gué que de n'aller plus loin, en étant apparemment incapable de comprendre que c'est justement ce régime salopé depuis quelques lustres tout de même par le règne infini de la palabre, comme le disaient plus poétiquement que moi un Donoso Cortés ou un Carl Schmitt reprenant le grand diplomate espagnol, qui corrompt jusqu'au plus intraitable de ses contempteur. Ce n'est pas la Macronie qui se sert de la démocratie française pour asseoir son pouvoir de paltoquet ou, si elle le fait, ce n'est là que payer une putain pour un service : c'est bien davantage la démocratie elle-même qui a pu rendre possible et même parfaitement logique l'éclosion d'un Emmanuel Macron, la putain enfantant par le siège ses avortons et pondant les œufs innombrable de ses vassaux et commis qui perpétueront sa morganatique purulence, selon le phénomène bien connu de la génération spontanée que nos savants, voici encore assez peu de temps finalement, croyaient être à l'origine de la reproduction des mouches.
Juan Branco, ce nom inconnu que mon correcteur orthographique électronique souligne rageusement d'un trait ondulé carmin en me proposant de le remplacer par Franco ou Bronca allez donc savoir pourquoi, a la démocratie chevillée à la bouche et au verbe. C'est à mes yeux sa faiblesse la plus criante et c'est aussi la raison pour laquelle, bien que située à quelques coudées au-dessus de la novlangue journalistique, sa prose n'en restera qu'à un lyrisme de remise des prix pour premier de la classe ayant fini par décoller ses fesses du banc où il les posait jusqu'alors sagement. Juan Branco est au fond si naïvement, si radicalement, si irrécusablement, si macroniennement aussi, il faut hélas bien le dire, démocrate, lui qui ne cesse de se lamenter sur telle «crise démocratique majeure» (p. 54) ou encore telle «déprise démocratique» (p. 65), qu'il parle prudemment d'un crépuscule jaunâtre là où il aurait fallu espérer voir surgir une aube, fût-elle rouge sang, ainsi que l'arrivée tonitruante des Cosaques qui, démocrates, le sont aussi à leur façon simple, puisqu'ils auraient unanimement raccourcis d'une saine longueur, à la slave, quelques têtes que nous n'en finissons plus de voir se dresser le long de cous grêles, et débiter, à longueur de journée, parfois depuis des années ou même des lustres, d'inanes balivernes.
Hélas, nous sommes là, avec Juan Branco ou d'autres contempteurs de la Macronie, qu'entre gens de bonne compagnie républicaine, adversaires acharnés si l'on y tient, pinaillant quelques virgules d'un texte démocrate, consensuel donc, médiocre, au fond accepté par tous, adversaires mais certainement pas ennemis. Mais nous, comme Nabe moquant les Gilets jaunes, nous les attendons, les Cosaques, et ne voyons rien venir.
Notes
(1) Juan Branco, Crépuscule (préface de Denis Robert, postface inédite de l'auteur, Points, 2019).
(2) Que Denis Robert ait retravaillé le texte de Juan Branco prouve qu'à l'évidence il pourrait songer à se reconvertir et ferait même assez vite fortune en proposant ses talents à bien des gloires pseudo-littéraires devant lesquelles se pâment les mauvais lecteurs !
(3) Comme tel autre de ses commis, Emmanuel Macron n'est probablement qu'un «être construit et institué par et pour servir la classe qui l'a créé» (p. 100).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, emmanuel macron, gilets jaunes, juan branco, crépuscule, georges darien |  |
|  Imprimer
Imprimer
