Dans le château de Barbe-Bleue de George Steiner (18/04/2021)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 George Steiner dans la Zone.
George Steiner dans la Zone.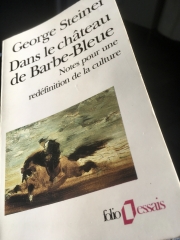 Acheter Dans le château de Barbe-Bleue sur Amazon.
Acheter Dans le château de Barbe-Bleue sur Amazon.Publié en 1971 sous le titre In Bluebeard's Castle. Some Notes towards the Redefinition of Culture, Dans le château de Barbe-Bleue (traduction de Lucienne Lotringer, Gallimard, coll. Filio Essais, 1997) s'inscrit sans aucune ambiguïté dans le sillage du texte que le grand T. S. Eliot fit paraître en 1948 sous le titre Notes pour une définition de la culture. Fidèle à son goût pour les comparaisons et métaphores surprenantes, bondissant d'un coup sur des intuitions plus ou moins aventureuses que l'essayiste aura ensuite le plus souvent bien du mal à étayer, George Steiner se montre aussi cultivé que provocateur avec un livre qui pourrait être décrit, si nous étions journaliste, comme relevant d'une brûlante actualité, tant nous paraissons patauger dans le marasme que, depuis son îlot de culture supérieure, le penseur pouvait décrire, sans peut-être même daigner se mouiller un seul doigt de pied.
L'essai de George Steiner, aussi bref soit-il, peut-être pour cette raison d'ailleurs, aura du reste choqué un bon nombre d'imbéciles tenant pour un fait assuré que la culture, pour élever l'humanité vers un idéal civique et humaniste rayonnant d'aménité, doit être, forcément, de masse. S'écarter un tant soit peu de cette bêtise considérée comme un dogme expose au bûcher. George Steiner pense bien évidemment le contraire, et a raison de le penser : «Le simple fait d'énoncer des vues élitistes a quelque chose de suspect ou de boursouflé» et, bien pire encore : «une telle doctrine de la haute culture doit soutenir fermement ce paradoxe que l'incendie d'une grande bibliothèque, la mort d'Evariste Galois à vingt et un ans, la disparition d'une partition de valeur sont des catastrophes sans commune mesure avec la mort d'êtres humains, même innombrables» (p. 101).
En lisant cette dernière assertion joyeusement scandaleuse, l'imbécile aura manqué de s'étouffer, sans hélas y parvenir ! Il ne faut jamais craindre de choquer les thuriféraires du lieu commun qui sont, consusbstantiellement, des progressistes bien souvent béats, mais ce n'est là que l'écume du propos de ce petit livre polémique en bien de ses points, voire parfaitement illisible aux yeux d'un lectorat chrétien par exemple qui, on me le concèdera facilement après les saillies d'un Bloy, d'un Péguy, d'un Bernanos ou même d'un Julien Green, peut renfermer une grande majorité de crétins consommés. Il y a davantage encore, de quoi tourmenter le plaintif fantôme de George Steiner et le condamner à une éternité de supplices, lorsqu'il évoque la question de ces «mages et camelots occidentaux qui chantent le nouvel œcuménisme de la pénitence, qui se proclament esprits frères des âmes irritées ou vindicatives de l'Asie ou de l'Afrique» (p. 79) et, ainsi, prétendent rabaisser le passé «en essayant de maîtriser les furies du présent» (p. 78). Ces lignes, je le rappelle, ont été écrites en 1971, et condensent brillament l'essentiel du bruit médiatique à peu près constant dans lequel la France trompe son monumental ennui.
Il se pourrait bien, aussi, que l'auteur, George Steiner, n'ait jamais fait que répéter, bien sûr en les développant, de livre en livre de plus en plus répétitif, quelques-unes des différentes propositions qu'il a exposées dans ce court texte qui, à plus d'un égard, frappe par sa pertinence et, même, annonce bien des pseudo-débats dans lesquels nous sommes présentement englués, qu'il s'agisse de ceux sur la prétendue supérioté de telle race sur telle autre ou encore de ces pathétiques stupidités propulsées sur le devant de la scène médiatique par la vogue délétère des gender studies, aboutissant à l'accusation la plus grandiosement stupide qu'est l'irrépressible, réactionnaire et paternaliste, autoritaire dans tous les cas, prétendue masculinité arrogante de la langue française. Contre ces imbéciles analphabètes mais hélas point aphones, l'auteur répètera qu'une grammaire est, toujours, une «soumission à l'ordre» qui sera «d'autant plus impérieuse qu'elle [sera entrée] en vigueur plus tôt dans la vie individuelle». Plus même, il va jusqu'à se rendre coupable d'une profession franchement réactionnaire, au rebours des consternantes fadaises d'un Roland Barthes sur le prétendu fascisme de la langue, puisque notre essayiste lie explicitement l'affaissement de la puissance européenne, voire occidentale, au relâchement puis véritable démantèlement de sa grammaire : «La charpente du discours a collé fidèlement aux rapports d'autorité du monde occidental, les a tour à tour raffermis et fait progresser» (p. 128). Sans charpente bien sûr, il y a fort à parier que la maison s'écroule, mais nous ne semblons nullement impressionnés par la catastrophe et il nous sera toujours possible d'invoquer le génie retrouvé de la France lorsque celle-ci sera généreusement déconfinée n'est-ce pas ?
George Steiner n'a évidemment pas de don spécial de prescience mais, ayant enseigné outre-Atlantique, a il a assez tôt constaté, bien plus vite en tout cas que nos ridicules éditocrates, les ravages que provoquait l'enfant dégénéré de la déconstruction derridienne : un doute généralisé, parfois violent, professé publiquement contre toute forme de domination jugée phallocratiquement répressive, et répressive parce que normée, normative, ordonnée, verticale, dont la cancel culture n'est que l'une des chimères les plus grimaçantes et connues, qu'aucune mesure de confinement préventif, hélas, ne semble avoir pu empêcher de débarquer dans les universités françaises et, maintenant, d'infecter le plus grand nombre possible de consciences.
La sensibilité steinerienne à ce qui, alors, n'était déjà plus des épiphénomènes de l'accélération d'une destruction de la culture ou plutôt : de l'effritement rapide de l'assise marméorenne sur laquelle cette dernière érigeait sa statue de taille écrasante, n'est du reste pas l'intérêt principal de ce mince et riche ouvrage qui, comme tant d'autres à sa suite je l'ai dit, est attiré immanquablement, est, même, véritablement fasciné par l'énigme du Mal, certes sous sa forme concentrationnaire, datée, passée, historique, donc pleinement incarnée dans une époque précise, mais aussi en tenant compte d'une portée ontologique qui subsume tout événement, puisque l'auteur n'hésite pas à convoquer, pour expliquer le déchaînement de l'horreur, l'hypothèse de la Chute, sur les brisées de Joseph de Maistre, un de ces génies qu'il qualifiera ailleurs de logocrates, en le flanquant de Martin Heidegger et de Pierre Boutang, il y a tout de même de plus mauvaises compagnies que celles-ci : «Il ne nous est que trop facile, désormais, de reconnaître avec de Maistre que notre jungle politique, l'acquiescement de l'homme cultivé et assoiffé de technique au massacre, accomplissent la prédiction de la Chute» (p. 93).
Venons-en maintenant à la thèse principale de George Steiner, absolument point originale mais martelée dans presque chacun de ses textes, dont celui qui nous occupe : «Je maintiens que certains germes de l'inhumain, certaines causes de la crise contemporaine qui nous contraint à redéfinir la culture, s'élaborent dans la longue paix du dix-neuvième siècle et se tapissent dans la trame complexe de la civilisation» (pp. 19-20). Cette thèse, que ses contempteurs nommerait d'un mot beaucoup moins noble n'est, il est vrai, paradoxalement, jamais mieux indiquée que lorsque le vocabulaire précis de la définition conceptuelle est abandonné pour l'image ou la métaphore, dont George Steiner fait un usage aussi frappant que riche dans son ouvrage. J'ai parlé d'une fascination, que l'auteur évoque lui-même, à l'endroit des ténèbres; c'est bel et bien la sienne, tel ou tel écrivain qu'il citerait alors (et il en a tant cité, qui furent, comme lui, plus que lui, fascinés par ce mystère) ne lui servant en l'occurrence que de commode paravent puisque, à «scruter trop longtemps la hideur, on est curieusement attiré. Par une étrange aberration, l'horreur capte l'attention et donne à nos pauvres facultés une résonance artificielle. Les derniers poèmes de Sylvia Plath sont l'exemple le plus pur de cette tentation, de ce vertige. Quels que soient les scrupules qui l'animent, je doute que quiconque consacre son temps et les ressources de sa sensibilité à ces lieux obscurs puisse (ou même doive) les quitter intact. Et néanmoins ces terres d'ombre sont au centre de tout. Les contourner, c'est renoncer à parler sérieusement des virtualités humaines» (p. 41). George Steiner s'est plus d'une fois, et pas seulement sous la forme d'essais mais d'un roman significatif, avancé sur ces terres d'ombre mais en est toutefois sorti sans trop de peine, selon toute apparence du moins, sans doute parce qu'il n'aura jamais été qu'un essayiste, et cela à son plus grand regret. Il est bien évident qu'il ne peut y avoir nulle trace de mépris chez moi lorsque je parle de Steiner comme d'un essayiste, car l'art de l'essai est l'un des plus difficiles et nobles mais, si nous adoptons le point de vue de l'auteur, qui constitua une espèce d'écharde plus ou moins secrète dans sa chair, il est tout aussi évident qu'un véritable créateur se fût soumis entièrement à l'impératif catégorique venant des ténèbres, quitte à y risquer sa santé mentale (et son âme ?). Pour reprendre une des belles images de l'auteur, je pourrais dire que plus d'une fois George Steiner s'est tenu derrière «la dernière porte du château», sachant mieux que nul autre qu'elle ouvre «sur des réalités hors de portée de la compréhension et de l'autorité humaines» (p. 155), sans jamais, toutefois, oser vraiment s'aventurer au-delà du seuil fatidique (1).
Ils ne sont en fait pas si rares que cela, au rebours de l'affirmation de George Steiner, «ceux qui ont interrogé ou scruté les correspondances étroites qui existent entre les structures de l'inhumain et la matrice environnante des civilisations avancées» (p. 40) et, pas davantage, sont rares ceux qui prétendent qu'en «tuant les juifs, la culture occidentale [a éliminé] ceux qui avaient «inventé» Dieu et s'étaient faits, même imparfaitement, même à leur corps défendant, les hérauts de son insupportable Absence. L'holocauste est un réflexe, plus intense d'avoir été longtemps réprimé, de la sensibilité naturelle, des tendances polythéistes et animistes de l'instinct» (p. 52). C'est là une des trois raisons (2) que donne George Steiner à la haine que la plupart des nations européennes majeures, sinon toutes, ont témoigné à l'égard des inventeurs du monothéisme, mais aussi à celui des inventeurs (et promoteurs passionnés) du marxisme ou plutôt, comme il l'appelle, du «socialisme messianique» (cf. p. 54), tout comme aux zélés propagateurs de l'hérésie purement juive (ainsi fut-elle perçue au départ) qu'était l'adoration du Christ, mais c'est à la première de ces inventions que George Steiner rattache directement la Shoah qu'il avoue sans peine avoir placée directement au centre de sa réflexion : «Je trouve dérisoire toute théorie de la culture, toute analyse des conditions présentes qui ne place pas, au centre, les mécanismes de terreur qui menèrent à la mort, en Europe et en Russie, du début de la première guerre mondiale à la fin de la seconde, par la faim ou par des massacres systématiques, soixante-dix millions d'êtres humains» (p. 40). En écrivant ces mots, il vise, d'abord, celui dont il s'est inspiré, T. S. Eliot (3) mais là n'est évidemment pas l'intérêt de la thèse, pour le moins polémique, de George Steiner, qui procède indifféremment par pas prudents et à coups d'intuitions poétiques, comme je l'ai indiqué dans mes textes sur cet auteur. Avançons-nous, si nous le pouvons, jusqu'au centre des ténèbres, ce nexus infernal que George Steiner n'aura cessé, sa vie de penseur durant, d'évoquer de multiples façons, et, ici, par ce qu'il nomme lui-même une «métaphore théologique» : «on peut dire que l'holocauste est une réédition de la Chute. On peut y voir l'abandon volontaire du Jardin d'Eden, la politique de la terre brûlée habituelle aux fuyards. De peur que le souvenir de l'Eden ne continue d'empoisonner de rêves débilitants ou de remords les vertes années de la barbarie» (pp. 57-58). Dans tous les cas, «le mystère, au sens théologique du terme, est celui d'une haine qui survit à son objet» (p. 46). Quel incroyant aura si obstinément invoqué Dieu pour soutenir l'édifice des humanités, sans l'assise duquel elles ne sont qu'un jeu minable subventionné par les édiles, que George Steiner ?
Nous pourrions, ici, multiplier les exemples, car George Steiner n'est pas disert, justement, sur ce mystère, en notant que «l'univers concentrationnaire [en français dans le texte] n'a pas de contrepartie exacte sur le plan séculier. L'enfer est son homologue» (p. 65), univers concentrationnaire ayant été comme annoncé, préfiguré par certaines productions littéraires européennes comme celles de Sade (cf. p. 61) ou, mais cela a été remarqué bien des fois, de Kafka. Dans tous les cas, «amorphe, envahissante, notre familiarité avec l'horreur représente pour l'humanité une défaite absolue» (p. 60). Force est de constater, quelles que soient les comparaisons ou métaphores retenues par l'auteur, toutes plus ou moins volontairement choquantes, que la racine est bernanosienne (Bernanos, ce génie que Steiner semble avoir eu toutes les peines du monde à citer ne serait-ce que marginalement), puisqu'elle réside dans la survie résiduelle, difforme, contrefaite, parodique, de la sphère religieuse : «C'est du côté de la survie ambiguë du sentiment religieux dans la culture occidentale qu'il nous faut chercher, en direction des énergies malignes libérées par le pourrissement des formes religieuses naturelles» (p. 64), pourrissement qui, «dans notre barbarie présente», a créé le surgeon pourri d'une «théologie défunte», d'un «ensemble de références à la transcendance qui, dans leur mort lente, ont donné lieu à des formes parodiques, des succédanés»; c'est ainsi que l'absence des damnés, due elle-même à la disparition des Enfers rabaissés au banal «rang de métaphore» «a créé un appel d'air, qu'est venu combler l'Etat totalitaire moderne. N'avoir ni paradis, ni enfer, c'est se retrouver intolérablement privé de tout, dans un monde absolument plat. Des deux, l'enfer est apparu comme le plus facile à reconstituer. Il faut dire que ses descriptions avaient toujours été plus détaillées» (pp. 66-7). George Steiner le répète encore : «Dans les camps a fleuri l'obscénité millénaire de la peur et de la vengeance, cultivée dans l'esprit occidental par les doctrines chrétiennes de la damnation» (p. 66).
Nous pourrions, à ce stade de notre étude, noter un flottement dans l'explication du surgissement de la Solution finale au sein de l'Europe, le continent qui, à cette époque point si lointaine que cela, se voulait (et avait raison de se vouloir ainsi) le plus civilisé du monde, mais cette difficulté peut être résorbée en invoquant, comme nous l'avons fait, telle théologie du fantôme selon Michel de Certeau, parodique donc, qui n'en finira pas, comme une monstrueuse graine, d'enfler et de contaminer la moindre parcelle saine qui l'entoure. Nous sommes là, et pour citer une fois encore Georges Bernanos, dans le régime du mauvais rêve. Nous pensons ainsi lire Sebald ou Kertész lorsque George Steiner note la destruction de «la cohérence d'une chose ancienne» qui est peut-être «une harmonique de la durée» que prétend reconstruire à l'identique une volonté toute moderne de rebâtir ce qui a été détruit. Hélas, la «reconstruction, dans toute sa perfection, a un éclat de laque», comme si «la lumière des corniches n'avait pas été rétablie, comme si l'atmosphère ne convenait pas et conservait des relents d'incendie»; de fait, même quand, «dans les meilleures conditions», on ne distingue pas la copie de l'original, à savoir la Vieille Ville de Varsovie reconstruite après qu'elle a été rasée, «la reproduction n'est jamais la forme vive» (p. 72), autrement dit la réelle présence comme il ne cessera de le répéter dans son essai le plus célèbre.
Du reste, George Steiner, moins qu'il ne démontre, constate la coexistence du plus grand savoir, de la plus grande habileté et même génie à forger des concepts, avec ce qu'une autre magnifique intelligence, qui d'ailleurs fut assez étroitement liée à la précédente, appellera la si fameuse banalité du Mal : «L'une des oeuvres marquantes de la philosophie du langage, la lecture sans doute la plus parfaite de la poésie de Hölderlin, vit le jour pour ainsi dire à portée de voix d'un camp. La plume de Heidegger ne s'est pas arrêtée, son esprit ne s'est pas tu» (p. 91). Curieux reproche tout de même, reproche qui a été répété des milliers de fois, qu'un Paul Celan en personne n'a même pas osé adresser à son correspondant : Auschwitz, de fait, n'a empêché absolument personne d'écrire après sa monstrueuse survenue, qu'il s'agisse de Heidegger, que tant de nos plus fameux intellectuels tiennent pour louche dans le meilleur des cas, ou même de Steiner, alors qu'à l'inverse, l'irruption du nazisme, que Karl Kraus aura stigmatisé tout au long des dernières années de sa prodigieuse carrière de râleur, n'aura jamais empêché ce dernier d'écrire, sa très passagère sidération, qui tant et tant de fois lui fut reprochée, n'étant que la façon la plus ironique de répéter que, sur la Bête, il avait absolument tout dit et écrit, et qu'il ne pouvait donc plus que se répéter.
Cet essai stimulant, qui cherche à définir ce que Steiner nomme l'après-culture, autrement dit «une culture diminuée» (p. 43) qui est d'ores et déjà la nôtre, n'est bien sûr point dépourvu de défauts, et un lecteur facétieux, rompu aux argumentations dialecticiennes point toutes dépourvues d'une salutaire mauvaise foi, pourrait objecter à l'auteur que tel ou tel de ses arguments relève, lui aussi, d'une forme castratrice de cancel culture : pour ne prendre qu'un seul exemple, mais essentiel dans la structure même dans laquelle Steiner déploie sa pensée, ne pourrions-nous le tancer de prétendre qu'il faut faire le pari d'un art, d'une culture, qui se détache de la sphère chrétienne, au motif, selon l'essayiste, que celle-ci est la responsable directe de l'extermination de plusieurs millions de Juifs ? Voici ce qu'écrit George Steiner : «Ne serait-ce qu'à cause de ses rapports hautement ambigus avec l'holocauste, le monde chrétien ne peut se placer au centre d'une redéfinition de la culture»; dès lors, il faut bien trouver à ce coupable un remplaçant, Steiner affirmant qu'il entend le mot religieux dans un sens spécial, beaucoup plus ancien» que le seul cadre étriqué de ce que fut le trétrograde, passéiste voire criminel «ordre chrétien» (p. 102) sur lequel T. S. Eliot a bâti sa propre démonstration. Il est amusant de remarquer que, dans ses textes moins anciens, George Steiner, pour essayer, une nouvelle fois, de combler le vide, aura recours à la métaphore de la réelle présence directement empruntée à la théologie de l'eucharistie... J'ai évoqué ces questions dans un long article assez peu amène avec les propos de George Steiner, ici, de manière plus insistante encore dans le chapitre de mon livre sur l'essayiste, intitulé Auschwitz et le Golgotha (4).
Ce n'est là qu'une des bizarreries, nous dirions même : une des faiblesses de l'essai en question; d'autres ambiguïtés demeurent, car notre penseur échoue visiblement à «identifier le point de départ de cette aspiration perverse, de cette passion du chaos» (p. 21) revendiquée par tant d'écrivains en mal de sensations extrêmes, symbolisées par les personnages les plus célèbres de Huysmans, Des Esseintes ou Durtal, ou bien il ne nous dit par exemple pratiquement rien sur le point suivant, pourtant central puisqu'il s'agirait en somme de parier sur l'émergence d'un art revenu de tout comme on dit, assurément de l'horreur infernale, d'un art qui serait foncièrement pessimiste et n'aurait plus vraiment le droit, sinon de façon purement métaphorique, de recourir à la sphère religieuse, coupable nous l'avons vu et, même si elle n'était point coupable, disparue depuis quelques lustres tout de même de l'horizon d'attente des hommes : «Concevoir une théorie de la culture qui puisse tenir en l'absence de tout dogme ou d'un impératif métaphorique de perfectibilité et de progrès me paraît l'une des tâches les plus difficiles qu'il nous revienne d'affronter» (p. 86). Sur ce point, George Steiner n'en reste dans ce livre qu'à des généralités, évoquant, comme corollaires et peut-être même remplaçant les lettres les mondes parfaits, les langages absolument purs de la musique et des mathématiques.
Ne pas vouloir faire le pari d'un horizon transcendant convoqué immanquablement par l'art serait tomber, pour George Steiner, dans un monde plat ayant aboli le «système d'échelons fondant la valeur» (p. 95), s'enfoncer, donc, dans un univers rigoureusement communiste au sens premier du terme, mais aussi dans l'insignifiant, dans un insignifiant, subtilité de notre époque sans force réelle mais glosant sur cette absence, au carré voire au cube, en raison de la propagation galopante des commentaires d'ouvrages, des métalangages ou langages seconds comme les appelait Merleau-Ponty, fleurissant sur les textes essentiels, après tout significativement peu nombreux (5). Nous nous retrouverions alors coincés entre, d'un côté, un «populisme» qui serait la marque d'une «semi-culture ou une sous-culture, où le poème ne peut survivre nu, imprimer seul sa marque propre» et, de l'autre, une «rigueur académique» qui ne serait rien de plus qu'un «dynamisme affecté, qui étouffe la pulsation originelle dans une atmosphère d'archives» (p. 121). Il faut donc faire comme si, comme si Dieu existait, comme l'a plus d'une fois admis l'auteur, comme si, toujours, et en dépit même de la certitude que la cohérence s'est enfuie, que le «centre de rayonnement» (p. 19) a disparu, existait une verticalité, un sens, une réelle présence, car autrement, nous n'aurions plus qu'à désespérer, nous morfondre dans un ennui pire que celui qui a dévoré les artistes du 19e siècle après Waterloo selon Steiner (6) et dès lors stupidement attendre l'apparition, à un horizon qui ne cesse plus de se rapprocher depuis que l'ordre chrétien, sur lequel T. S. Eliot appuyait sa réflexion, s'est effondré, des nouveaux Titans qu'a évoqués Ernst Jünger : «si le pari sur la transcendance ne semble plus valoir la peine et si nous nous dirigeons vers une utopie de l'immédiat, les valeurs de notre civilisation vont se modifier, après au moins trois millénaires, de façon imprévisible» (p. 106).
Notes
(1) Rappelons le contexte dans lequel l'auteur inscrit sa comparaison : «Nous en sommes, vis-à-vis d'une théorie de la culture, au même point que Judith quand elle demande à ouvrir la dernière porte, donnant sur la nuit» (p. 139).
(2) «Le monothéisme au mont Sinaï, la chrétienté primitive, le socialisme messianique : trois instants suprêmes où la culture occidentale affronte ce que Ibsen appelait «les exigences de l'idéal»» (p. 55).
(3) «Est-il concevable de se faire [T.S. Eliot], avec un tel luxe de détails, l'avocat d'un ordre chrétien, quand l'holocauste avait remis en question la nature même du christianisme et de son rôle dans l'histoire européenne ?» (p. 44).
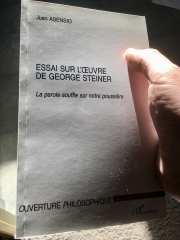 (4) Ce dernier est toujours disponible à la vente, et peut être commandé auprès de l'éditeur, L'Harmattan, ou bien directement sur Amazon, ici.
(4) Ce dernier est toujours disponible à la vente, et peut être commandé auprès de l'éditeur, L'Harmattan, ou bien directement sur Amazon, ici.(5) «Jamais les métalangages des grands-prêtres n'ont fleuri si dru, jamais leur jargon n'a été plus épineux autour de la signification vite bâillonnée» (p. 121).
(6) Cf. Le grand ennui, premier chapitre du livre : «Comment un intellectuel pourrait-il se résoudre à n'avoir sous les yeux que le clinquant de la bureaucratie quand il découvre en lui-même l'étincelle d'un Bonaparte, une parcelle de cette puissance infernale qui le mena de l'obscurité à l'Empire ? Raskolnikov rédige son essai sur Napoléon avant d'aller tuer la vieille femme» (p. 28).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, langage, dans le château de barbe-bleue, george steiner |  |
|  Imprimer
Imprimer
