La Grande Pâque de Jacques Besse : un cri en provenance du désert, par Gregory Mion (06/09/2021)

Crédits photographiques : Sarah Gilbert (The Guardian).
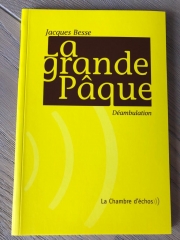 «La Grille est un moment terrible pour la sensibilité, la matière.»
«La Grille est un moment terrible pour la sensibilité, la matière.»Antonin Artaud, Le Pèse- nerfs.
«Cochons stupides, hurlai-je, en me levant, vous salissez l’esprit même de l’amour.»
Antonin Artaud, L’Art et la Mort.
À la fin de la Semaine sainte de l’année 1960, dans le «Paris des princes dérisoires de la nuit» et des «beaux étalons castrés» (1), Jacques Besse amorce une promenade éthylique et la prolonge trois jours, formant ainsi une ambulante trinité de visions et de divinations, jusqu’au moment où il atteint le lundi de Pâques, rassasié d’ivresses inimitables et de sobriétés opportunes, repu de cette heureuse alternance, fol-en-Christ étant parvenu au bout de lui-même et des vérités les plus essentielles. Il raconte ce que furent ces jours de gloire dans La Grande Pâque (2), un texte unique où se révèlent tout à la fois le fond du volcan de Malcolm Lowry et les meilleures inspirations d’un homme à part, naguère khâgneux, promis à des ascensions sociales idoines, puis lentement débarqué de la blême conformité existentielle, un temps compositeur pour le cinéma – pour le théâtre aussi – et interné psychiatrique régulier. Décédé pratiquement anonyme non loin de Blois à la clinique de La Borde, rendu à Dieu le 30 mai 1999, Jacques Besse avait soixante-dix-huit ans et semble à présent totalement oublié, de surcroît dans un pays qui n’admet plus vraiment la liberté foudroyante et dont les créations culturelles, si tant est que ce terme soit encore valable, se sont alignées sur les doléances les plus crapuleusement boutiquières. En cela, du point de vue d’aujourd’hui et d’hier, Jacques Besse fait partie de ces terribles suicidés de la société, de ces crucifiés quasiment inconcevables, de ces individus que l’on retrouve dans les ossuaires de nécessiteux ou sur des registres réservés aux bohémiens de la vie, annales de nécropoles inquiétantes ou d’hospices méconnus pour les incurables. Tous les brillants désaxés qui appartiennent à ces catacombes clandestines, autodétruits ou sacrifiés, tous ont essuyé les plâtres d’une phtisie intégrale, d’une chute inévitable de tous leurs constituants, assortie d’un effondrement du mensonge social au profit d’une mortelle édification de la parole authentique, évangélique. Lire Jacques Besse, donc, c’est forcément lire entre les lignes des Écritures, tel qu’on le fait toujours en lisant par exemple des martyrs comme Antonin Artaud bien sûr, Vincent La Soudière ou Béatrice Douvre, autant d’âmes exceptionnelles qui n’ont pas craint la «cabale» et le «sabotage», qui n’ont pas prêté la main, n’ont pas levé le moindre petit doigt à la faveur de ce monde moderne où les applaudissements reposent sur «les intérêts les plus vulgaires» et ont par conséquent la valeur d’un sale «encouragement» ou d’un vilain «témoignage d’alliance» (3). Ces élus du Royaume doivent être célébrés, sanctifiés, remémorés à la hauteur de leurs souffrances et des provisions spirituelles qu’ils nous ont léguées. En eux s’affirme la vertu spéciale d’un Nathanaël, la vertu de ceux en qui ne gît aucune qualité frauduleuse, la chasteté de ceux qui ont sans doute succombé à l’escroquerie générale de leur époque déjà (presque) perdue.
Suivre Jacques Besse dans sa déambulation «d’insecte solitaire» (p.7), prendre le risque de le talonner assidûment, ce n’est pas autre chose que franchir le seuil du «surréel» (p. 69) et partager sa «passion du devenir» (p. 7), sa plénitude héraclitéenne qui va où souffle «le vent-de-toujours» (4) et qui fuit les «mesquines pelouses» du «square où tout est correct» (5). On se rapproche alors de la compétence mystique, de la répudiation de la blafarde mamelle d’où s’écoule en éjaculats insipides le lait de la bourgeoisie, et, chemin faisant sur les pavés anamorphosés du Paris dipsomaniaque, on se déleste comme Jacques Besse de nos titres de noblesse et de nos lourds bagages académiques. À l’instar de celui qui fut deux fois second au Concours Général – en philosophie et en lettres – et qui eut Sartre comme professeur de Terminale, nous abandonnons en cours de route toutes les assignations de l’identité, tous les principes fixateurs qui refusent l’embardée suprême, l’accident émancipateur. On se demande du reste si Jacques Besse ne serait pas un Roquentin amélioré, tête brûlée, une version courageuse de l’irrésolu personnage sartrien, ne refusant pas les appels définitifs de la racine du marronnier – ce call of the wild qui guérit des appétits hygiénistes du centre-ville et des introspections civilisées. À l’inverse de Roquentin qui est plus ou moins revenu parmi les normes et les points de repère du langage essentialiste, Jacques Besse, lentement, opiniâtrement, nous guide en direction du délire bachique où tout échappe à l’Être et baigne dans le rimbaldien Poème du mobilisme universel.
Aussi ne faut-il pas interpréter avec empressement telle ou telle étrange subdivision de cette errance (avec la tentation d’y voir une affabulation à neutraliser), ni d’ailleurs se décourager avec telle ou telle phrase désarmante ou instable (en se disant que ce n’est là, parfois, qu’un solipsiste et illisible exercice de style). Il s’agit avant tout de sensations que nos organes ne sont pas en mesure d’assimiler à la proportion de ce qui est vécu par ce remarquable itinérant. Sa langue est celle d’un aéronaute du devenir, en osmose avec l’invincible flux vivant, et elle outrepasse la nôtre, trop prisonnière des empires taxinomiques. Le surnaturel degré de perception et d’expression de Jacques Besse est de plus avivé par des philtres capiteux dont nous ne possédons pas les secrets de fabrication. L’homme est à cet égard absolument stochastique au sein d’une civilisation dogmatique ou sur le point de l’être sans espoir de retour en arrière. Au maillage des rues et des avenues, à la logique aristotélicienne qui a largement colonisé la psyché occidentale, Jacques Besse réplique par ses égarements sismographiques, par la sainte diffraction de sa lumière individuelle, «ivre comme un Anglais», animé d’aucun «geste qui ne soit de [sa] conscience» (p. 9). Il a l’impureté d’un sujet fascinant qui non seulement n’est pas transparent pour autrui – tout au moins pour les nombreux locataires de la stabilité – car il est tout agité de ce que la majorité a trivialement refoulé, mais, aussi, il est cette espèce de loup-garou qui hulule à la pleine lune des lampadaires, un genre de surhomme qui redescend peu à peu dans les voies détournées de la créature zoologique, «joyeux comme un animal» confesse-t-il (p. 11), content d’être attaché au «piquet de l’instant» tel que l’eût dit Nietzsche (6) et libéré par là même des sédatifs horaires de bureau, des monuments de la temporalité humaine devant lesquels viennent s’agenouiller les troupeaux, en processions atomisées de pénitents frivoles.
Vêtu de puantes loques inchangées depuis plusieurs semaines, Jacques Besse n’a cure d’indigner le nez des élégants, et, assurément, il eût donné envie à l’absurde Kovaliov de perdre à nouveau le précieux appendice de l’olfaction (7). Contre les vents et les marées de la bienséance, Jacques Besse possède «toute [sa] force de poète» (p. 12). Il est insensible au grégarisme des bonnes manières et aux dispositifs régulateurs, antipoétiques en diable. Au hasard des rencontres hallucinées ou positives, entre le rêve et l’insomnie, entre des sommeils incertains et des veilles titubantes, il soulage sa mendicité ou ses vestiges d’excitation sexuelle. Les uns ou les autres lui offrent de quoi se payer une tambouille à l’improviste, de quoi minimiser légèrement son étiage de «la condition humaine» où le «froid» et la «faim» (p. 19) l’acculent à ces désolations du ventre que Paul Auster a si bien caractérisées dans son œuvre, notamment dans l’emblématique Moon Palace ou lors du difficile périple d’Anna Blume au Pays des choses dernières, une sorte de métaphore filée de l’univers concentrationnaire. Quant aux femmes approchées au propre comme au figuré, ce sont de généreuses princesses pour les rois déchus, des libertaires de la nuit qui acceptent les coïts inachevés des étalons fatigués, les ardeurs fluctuantes des mâles dont le corps est amplement détruit et l’esprit tout à fait ailleurs. On comprend d’autant mieux la situation lorsque Jacques Besse avoue qu’il «travaille à freiner [son] flot intérieur accéléré des coups d’on ne sait quelles forces obscures» (p. 17), probablement appelé, attiré par la mania des vrais artistes, par la folie de ceux qui ne font pas semblant d’aller mal ou qui n’entretiennent pas une fausse réputation de dissolu. Sans se farder et sans nous exposer la fiction d’un Moi présentable, Jacques Besse, radicalement, poursuit son échappée formidable, marchant «droit au travers de destins tournants qui [le] mettraient à genoux dans la rue [s’il obéissait] à l’hypnose» (p. 26). L’intuition qui est la sienne paraît nous apprendre ceci : que l’organisation orthodoxe de la société, à l’extérieur, ne dispense pas le troupeau d’être victime d’un chaos intérieur, tandis que lui, s’il est en apparence chaotique, n’en est pas moins parfaitement solide et résolu dans son intériorité extravagante. Reformulons d’emblée : le signe pathologique d’une société qui se vante d’être disciplinée, c’est sa maladie de l’âme, voire son absence d’âme, et les vagabonds comme Jacques Besse, au milieu de cet ordre qui dissimule un dangereux désordre, insinuent un désordre protecteur qui montre des âmes ordonnées, puissantes et législatrices d’un avenir supportable.
Aussi, tout chancelant soit-il sous ses allures de rossinante, Jacques Besse incarne le bon cheval de Troie qui amène le printemps rédempteur au cœur d’une Babylone continûment hivernale. Son pèlerinage est à maints égards une invasion barbare qui fait tomber le limes de la décadente et arrogante romanité parisienne. Ses coups d’éclat aux relents alcoolisés défont les lacets de l’abstinence malheureuse qui n’est que la religion du Capital éprouvé en pleine lucidité. Cet homme iconoclaste, en provisoire état sommital d’ébriété et d’animalité, indique aux sobres salariés les chemins opposés à «l’amour des grandeurs», désigne la fuite devant l’appât du gain, personnifie en substance «le devoir essentiel du chrétien» qui consiste à «réprimer son ambition» (8). L’ancien des classes préparatoires aux grandes écoles propose un happening du déclassement et une école buissonnière où l’intelligence s’enfonce dans la matière même des choses, en-deçà de leurs essences respectives. On pourrait volontiers parler d’un ré-enracinement, d’un vital retour aux sources, d’une archaïsation décisive en un siècle qui commence à mourir de ses idéologies technocratiques. Ce que préconise librement Jacques Besse, ce qu’il voudrait que l’on trouve sans qu’on ait à le chercher méthodiquement, c’est, tout compte fait, les coordonnées d’une existence qui puisse appréhender l’impasse et la menace du paradigme du propriétaire accompli, les divines dimensions d’une existence qui puisse être révulsée par le modèle avilissant du fonctionnaire qui ramasse de bonne foi le javelot lancé par Eichmann. Hors de toute ambiguïté, Jacques Besse accuse «le mensonge du travail» (p. 38), il pressent déjà la mythologie d’une méritocratie infâme, soupçonnant l’épaisse perfusion du népotisme, et il n’est guère compliqué de se représenter son effroi, ou du moins de le déduire, lorsqu’il dut saisir très tôt l’évidence de ce qu’allaient devenir ses camarades d’études, ses partenaires en humanités qui n’étaient finalement que des agents doubles, des élèves soi-disant doués qui se préparaient à débourser furieusement pour l’inhumanité. Il est par conséquent impératif de supposer que les troubles psychiatriques de Jacques Besse se sont manifestés moins pour des raisons intrinsèques – dépendantes d’une sorte démence congénitale – que pour des raisons extrinsèques – appuyées sur le dégoût abyssal de sa génération, triste et consternante génération dont on pourrait affirmer qu’elle fut entièrement à son aise dès les prémices de la Seconde Guerre mondiale. Ange radieux désorbité parmi les bêtes noires, Jacques Besse a souffert là où la plupart de ses contemporains ont surmonté l’insurmontable, là où l’arrivisme a rapidement exploité l’inexploitable, et la révélation de cette si sordide résilience s’est encore accentuée lors d’une longue marche qui l’a conduit jusqu’en Algérie en 1950, jusqu’au soleil de justice de la Bible, jusque sur ces terres fécondes où aucune mentalité crépusculaire n’est admise.
C’est pourquoi malgré ses «petits trente-neuf ans» et sa «gueule de repris de justice» (p. 32), Jacques Besse détient le pouvoir de raviver l’espérance bernanosienne, le pouvoir inouï de réveiller les mendiants dont le glorieux cortège est susceptible de faire trembler le monde (9). C’est d’abord une question d’optique, une fraternelle volonté d’agir sur notre relative cécité, sur l’ophtalmopathie de nos méchants idéaux ascétiques, et, ce faisant, Jacques Besse nous soumet une vue d’ensemble du monde qui atténue les mirages habituels que nous prenons vite pour argent comptant. Sa perspective est celle-ci : nous exhiber un monde «déplacé, étranger, [dévoilant] ses fissures et ses crevasses, tel que, indigent et déformé, il apparaîtra un jour dans la lumière messianique» (10). Il n’y a que l’angle de vue du paria, du lépreux, du gitan, du larron, du premier de la classe ayant accouché d’un sauve-qui-peut en Abyssinie, du prodige ayant inventé son désert par lassitude des foules, il n’y que cet angle-là, cet angle vif, qui est à même de nous aider à découvrir la silhouette de la vérité par-delà les montagnes de fictions utiles qui alimentent les contrats sociaux. Un tel misérable accompagné de Dieu est capable de se diriger vers «le grand jour de la Pâque chrétienne» (p. 47) en dépit des «filles pleines d’argent» (p. 50) qui le dédaignent, en dépit également des accablants «délires de la faim» qui l’ont «rarement [fait se sentir] aussi profondément sous-homme» (p. 59). Et nécessairement, il fallait que ce sublime réprouvé fût du côté de l’Algérie occupée, du côté du FLN impatient de se débarrasser de l’envahisseur hexagonal (cf. p. 81). Comme un Arabe en France pendant les «événements» de la guerre d’Algérie, Jacques Besse ressent la persécution, la prévarication des autorités françaises, l’investiture d’une usurpation à tous les niveaux. Il est sidéré par ces Algériens qui rasent les murs de Paname et qui n’osent même pas – pour certains – toucher le fond de la clochardisation tant ils craignent les représailles de la police, voire les châtiments de cette frange avilie du peuple français qui pourrait être admirative du préfet Papon, fanatisée par ce pisse-copie si représentatif de la filouterie bourgeoise qui s’est adaptée aux concours de la République afin de répandre licitement ses vices. Ce sont les ronds-de-cuir de la haute administration qui sèment le Mal et qui prétendent impudemment le combattre, et, encore une fois, Jacques Besse ne pouvait pas conclure son cursus honorum de jeunesse en gravissant les ultimes échelons qui exacerbent l’injustice. Il rejette en bloc «la division de notre Humanité en élus et en damnés» (p. 75), d’où, évidemment, sa sympathie pour les maudits du Maghreb et pour tous ceux «qui ne participent pas aux horreurs de la guerre d’Algérie» (p. 80). Depuis les stations et les mouvements de son jubilé pascal, il a entraperçu la dégradante postérité de la xénophobie, l’universalisme fallacieux de la France, le socle perverti d’une nation en voie de sombrer, contaminée par des élites pourrissantes. Ainsi les passages concernant les répercussions de la guerre d’Algérie ne sont d’une certaine manière que les mauvais présages de ce qui surviendra le 17 octobre 1961, lorsque des Algériens seront jetés dans la Seine par des policiers envoûtés, médiocres, instruments serviles de l’homme le plus abject du pays – Maurice Papon tel qu’en lui-même la décadence le spécifie.
Ces condamnations oraculaires une fois retombées, à l’aurore du lundi de Pâques, une forme de sérénité enveloppe un Jacques Besse en quelque sorte ré-apprivoisé : «je me sens très proche d’où je suis, je rêve moins, je suis plus près de l’homme de surface que de la bête marine des grands fonds» (p. 70). Il a vu l’abîme océanique des cités millénaires englouties où règnent les courants ignés d’Héraclite, il a subodoré une vitalité qui ne se dénonce que pour les explorateurs des souterrains élémentaires, pour les scaphandriers qui s’immergent under the volcano, à l’endroit où l’effervescence d’une forge de Vulcain se profile, quelque part entre le Popocatepetl et l'Iztaccíhuatl, rejoignant une galerie cryptique dont la reptation caverneuse s’étend peut-être jusqu’aux vastitudes insondable de la Buenos Aires décrite par Ernesto Sábato dans Héros et Tombes. De cette catabase picaresque, de ce tropisme d’argonaute sud-américain que nous lui prêtons de bon gré, Jacques Besse est un peu revenu, remonté parmi les siens, «après trois jours tout en bas de [sa] ville natale, de cet immense Paris qui promène [son] nom en affectant de [l’ignorer]» (pp. 77-8), de cette ville qui pourrait être n’importe quelle métropole tourmentée, indifférente à ses prophètes, mais pas pour autant irrachetable.
La preuve en est : épinglé par la maréchaussée, possiblement à cause d’un aspect de va-nu-pieds, puis envoyé au poste de police où «rôde déjà comme une odeur de gégène» (p. 82), un «affreux arrière-poste de la place Saint-Sulpice» (p. 83), Jacques Besse est ensuite relâché, non sans avoir été transféré un moment au «commissariat de la rue de l’Abbaye», synonyme du «commissariat de Saint-Germain-des-Prés» (p. 83). Ce contrôle de routine vérifie que les déviants perturbent l’axiomatique de l’illégitime oligarchie française, qu’ils parasitent le système de consanguinité parisienne du Sixième Arrondissement, mais les gens comme Jacques Besse circulent encore, erratiques et prophétiques, offrant à la lie humaine l’infime chance d’une rédemption, la petite éventualité de percevoir l’Essentiel colporté par ces individus dont le moindre des actes, la moindre des paroles, est une nette conjuration de l’Inessentiel (cf. pp. 87-8). Ce que désire Jacques Besse, ce qu’il souhaite bien davantage que tout salut personnel, c’est la liberté absolue de proclamer l’oxygénant gouvernement de Dieu, la licence de crier par monts et par vaux le pronunciamiento de l’Enthousiasme (cf. p. 91). Et cela Jacques Besse le veut ardemment malgré sa répétitive contention «en la neutralité […] d’un asile clinique» (p. 88). Il continue de le vouloir au mépris de ses désespérantes observations du quartier de Saint-Germain-des-Prés, se demandant toutefois «de quel poids d’Amour, de quel impôt d’Amour qui ne soit pas l’impôt du sang, nous devrons payer la nécessité de tous nos actes prosaïques en face du Ciel qui nous convie, nous, le plus absurde des peuples, à la plus poétique des Alliances !» (p. 93). Mais, tout de même, il y a dans cette péroraison au style psalmiste une folle conviction de délivrance à venir, une impression de futur syncrétisme triomphant, et quoique ces mots proviennent d’un solitaire quelquefois désabusé, ils sont ancrés dans cette certitude qui nous apprend que «si tout finit au désert, tout y commence» (11) également. Excommunié dans l’étendue désertique des zonards psychiatriques, Jacques Besse n’est pour les uns qu’un atome intempestif flottant sur les innumérables dunes de son Sonora mental, mais, pour les autres, il symbolise un point de départ, un drapeau que l’on plante au milieu de nulle part et autour duquel pourrait s’ériger un paradis.
Notes
(1) François Esperet, Larrons.
(2) Éditions La Chambre d’Échos (1999).
(3) Theodor Adorno, Minima moralia.
(4) Jean Giono, Regain.
(5) Rimbaud, À la musique (Les Cahiers de Douai).
(6) Cf. Nietzsche, Considérations inactuelles (Deuxième partie : De l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la vie).
(7) Cf. Nicolas Gogol, Nouvelles de Pétersbourg (Le Nez).
(8) Bossuet, Sermon sur l’ambition.
(9) Cf. Georges Bernanos, Monsieur Ouine.
(10) Theodor Adorno, op. cit.
(11) Bernard Charbonneau, Le Jardin de Babylone.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, jacques besse, la grande pâque, la chambre d'échos |  |
|  Imprimer
Imprimer