« Orgueil et préjugés de Jane Austen, par Gregory Mion | Page d'accueil | Qu’avons-nous fait de Marc-Édouard Nabe ?, par Guillaume Sire »
01/04/2020
Larrons de François Esperet : une croix pour les malfrats, par Gregory Mion

«Vous pouvez constater, en me lisant, quelle intelligence j’ai du mystère du Christ.»
Paul de Tarse, Épître aux Éphésiens.
Station initiale
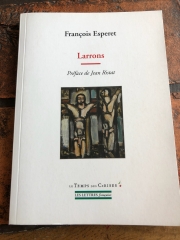 Dans sa préface sublimement désespérée aux Propos d’un entrepreneur de démolitions, Léon Bloy constate la disparition des œuvres colossales, la calamiteuse abrogation des états d’ébriété mystiques d’où peuvent jaillir les grands textes, et il termine en formulant le souhait de «contempler encore un enthousiaste, un fanatique, un adorateur de quelque chose…» Gageons que le Mendiant Ingrat eût reconnu en François Esperet un soupirant de tous les infinis et qu’il eût rédigé sur les Larrons (1) un article complètement fiévreux de dithyrambes. Car ce recueil poétique de quatre chants démentiels se révèle fondamentalement bloyen par ses torrents prédicatifs, mais aussi par ses rédemptions magnifiques, ceci dans la mesure où le Christ, subtilement omniprésent au fil de ces pages, répand la délivrance sur les bandits de grand chemin comme il a racheté les malfaiteurs crucifiés au Golgotha. Qu’il soit bon ou mauvais, qu’il soit à la droite ou à la gauche du Christ, le larron est admissible au Royaume parce que nous pouvons exhumer de lui la meilleure part de son cœur. Cette approche indulgente de l’humanité culmine tout au long de la poésie de François Esperet et pas seulement dans ces Larrons fabuleux. Les putains de Gagneuses, les bâtards de Sangs d’emprunt et les imperfections recensées dans les Visions de Jacob, tout cela, tout ce quota d’humanité mortifiée, a droit de participation aux prolongements de Dieu sur Terre.
Dans sa préface sublimement désespérée aux Propos d’un entrepreneur de démolitions, Léon Bloy constate la disparition des œuvres colossales, la calamiteuse abrogation des états d’ébriété mystiques d’où peuvent jaillir les grands textes, et il termine en formulant le souhait de «contempler encore un enthousiaste, un fanatique, un adorateur de quelque chose…» Gageons que le Mendiant Ingrat eût reconnu en François Esperet un soupirant de tous les infinis et qu’il eût rédigé sur les Larrons (1) un article complètement fiévreux de dithyrambes. Car ce recueil poétique de quatre chants démentiels se révèle fondamentalement bloyen par ses torrents prédicatifs, mais aussi par ses rédemptions magnifiques, ceci dans la mesure où le Christ, subtilement omniprésent au fil de ces pages, répand la délivrance sur les bandits de grand chemin comme il a racheté les malfaiteurs crucifiés au Golgotha. Qu’il soit bon ou mauvais, qu’il soit à la droite ou à la gauche du Christ, le larron est admissible au Royaume parce que nous pouvons exhumer de lui la meilleure part de son cœur. Cette approche indulgente de l’humanité culmine tout au long de la poésie de François Esperet et pas seulement dans ces Larrons fabuleux. Les putains de Gagneuses, les bâtards de Sangs d’emprunt et les imperfections recensées dans les Visions de Jacob, tout cela, tout ce quota d’humanité mortifiée, a droit de participation aux prolongements de Dieu sur Terre. Le présent livre nous offre une poésie côtoyant «les princes dérisoires de la nuit» parisienne (p. 15), les blousons noirs de Paname, ceux qui «[honorent] passionnément Paris la pute insatiable» (p. 95), capitale de la spéculation opiomane et cité perpétuelle des plaisirs prohibés. Ex-gendarme en faction dans les taudis courroucés, ancien lieutenant des sociétés privilégiées, François Esperet a vu passer le convoi de Paris dans son intégralité, du centre-ville aux quartiers périphériques. Il a observé la clochardisation des banlieues distantes et la gentrification des places fortes. Il a étudié cette antinomie de la raison impure au milieu de laquelle vont et viennent les destins de quelques malfrats nyctalopes. En poète, en intercesseur aussi, François Esperet ponctionne d’emblée au sein de ce vivier majestueux «l’une de ces carnes qui fuit sans fin l’abattoir» (p. 15). On traque avec lui la frénétique condition d’un homme qui remue ciel et terre pour s’individualiser dans le chaos marginal de l’illégalité. C’est une sommité crépusculaire dont il s’agit au cours de ce Chant précurseur, un oiseau de nuit qui va plus loin que les ténèbres municipales d’Edward Hopper, un couche-tard accommodé aux heures des «femmes offertes aux éjaculations téléphoniques» (p. 53), après que le bon peuple a forniqué modérément, laissant au peuple despérado le loisir de ses méthodes infra-catholiques. On assiste au débit d’une confession misérable : ce larron stigmatise sa femme exilée contractuelle dans les bras d’une «petite frappe» redoublée d’un «petit maquereau» (p. 18), elle, pourtant, «sa légitime épouse / l’iranienne répudiée qui a porté l’enfant de son malheur» (p. 23). Par association de rancœurs, il ne supporte pas non plus que sa fille soit tatouée «gracile en bas des reins [du] nom bédouin d’un amant apatride» (p. 19), et ce «père amer» (p. 19), cocaïnomane pris en flagrant délit de récriminations déplacées, se lamente de «la perte / injuste d’un diamant de sa couronne» (p. 19). Il est dorénavant un roi tombé dans la disgrâce, privé de tous ses divertissements, battant la campagne urbaine en proférant des pensées comminatoires à l’égard de ses rivaux – les amants déplorables de sa femme et le musulman expatrié de ses collines qui a eu l’impudence de séduire sa gamine. Il s’inflige «des suspicions impitoyables de partouzes exploratoires / des illusions de complots des mirages de bagarres ordurières» (p. 22), finalement point si différent du narrateur proustien de La Prisonnière qui se consume de jalousie et de paranoïa. Mais là où le héros de Proust transcende un genre de langage animal pour le stabiliser dans le dressing-room de la civilisation la plus raffinée, le gangster de François Esperet, lui, ne triche pas et subit de plein fouet ce que Roland Barthes nommait un fascisme de la langue (2), en l’occurrence cette contrainte à parler, cet instinct tout-puissant d’oralité, cette impossibilité de se taire et de contourner la pression des affects en attente de verbalisation.
C’est en outre tout l’intérêt de ce recueil et de tous les autres du même auteur : s’y déploie une langue foncièrement spontanée, comme sise à l’embouchure des passions, dépourvue de la simplicité artificielle d’un Prévert ou des complexités khâgneuses d’un Jaccottet. L’effet d’hypotypose n’est donc pas rare dans les Larrons et les derniers moments du Chant inaugural saisissent à merveille les désarrois de ce sinistre maître déclinant, lassé de ses safaris punitifs, en escale dans une «garçonnière» (p. 25) qui ressemble à la crypte de Raskolnikov ou au souterrain des Carnets du sous-sol. Après avoir tant erré de par le monde parisien, l’œil exorbité, à la recherche de ses ennemis présumés, le voilà en escale dans son baisodrome occulte, son «nid d’aigle» de «solitaire empereur» (pp. 24-5). Il se console infructueusement de ses infamies, peut-être en se ressouvenant de son empire de la came, peut-être encore en lorgnant sur «un lamentable gode oublié / orphelin d’orifice» (p. 25), symbole éclatant des vestiges d’une copulation secondée, témoin à charge et témoin muet, révélateur de son paradoxe d’homme amoureux à en mourir et néanmoins sujet aux infidélités criantes. Ceci étant, à l’instar de tous les gredins, il est nanti d’un sens de l’honneur priapique, tant et si bien que ses digressions extra-conjugales n’ont pas vocation à desserrer l’étau qui sangle sa famille : s’il peut déshonorer les siens en risquant l’infection vénérienne, eux, en revanche, ne peuvent le déshonorer en allant perquisitionner d’autres sexes, d’autres peaux. Il est un mari et un père avec les pleins pouvoirs d’un sultan, par conséquent il ne tolère pas les désobéissances ou les infimes trahisons vis-à-vis de son dispositif patriarcal. Mais comme cette réalité subsiste davantage dans son imagination que dans le fait brut de l’existence, il en devient émouvant, presque bouleversant, car la cécité qu’il entretient sur son impuissance est proportionnelle à la sensibilité monumentale qui le caractérise.
Simon de Cyrène en filigrane
Le Chant suivant exhibe le parcours scabreux d’un éclopé «loin des esprits malins politiques» (p. 27), par-delà tous les «rhéteurs arrogants» (p. 27), eau vive qui incarne le courage de la vérité. Plus précisément, cet exorde critique à propos du pouvoir officiel souligne l’emplacement du mensonge, le lieu même des mythomanies d’État. Il est dit entre les lignes que la vérité ne peut pas apparaître dans les appareils du gouvernement. De surcroît, si l’on poursuit la pente de cette intuition, les hors-la-loi ne le seraient principalement que par la désignation arbitraire de ce qui est légal ou illégal de la part de ceux qui font profession de législateurs assermentés. Il faut sous-entendre contre Rousseau que les lois ne fournissent pas un supplément de liberté, mais qu’elles inclinent plutôt à criminaliser une certaine population de contrebande. Dans le cas particulier de cet homme qui dépend pour partie des «sous de [son] allocation tu sais d’handicapé» (p. 29), on suppose que l’accident originel, l’invalidité innée ou acquise, n’a fait que s’enlacer naturellement à la biographie d’un scélérat en vue de joindre les deux bouts. En cela exactement, que «son corps tordu [se soumette] chaque jour à la question du crack» (p. 30), qu’il soit du reste le factotum occasionnel des acheminements de psychotropes, go fast à bas prix, nous n’y apercevons que les commandements de la survie et les actes légitimes d’un damné du statu quo administratif. Si sa culpabilité ne ferait absolument aucun débat à l’intérieur des tribunaux classiques, il ne va pas de soi que ce demi-paralytique serait condamné par le regard de Dieu car c’est au cœur, et uniquement au cœur, que le Père investit son irréprochable vision. Et la méfiance envers les forts assortie d’une mansuétude pour les faibles n’est pas une idée neuve, pas davantage qu’elle n’est réductible au délire d’un fou de Dieu : Montesquieu, par exemple, en traçait les linéaments lorsqu’il remettait en cause la rigidité des flux commerciaux, la façon dont le commerce pouvait être une loi du plus fort rejouée sous d’autres latitudes conceptuelles, par contraste avec les peuples soi-disant brigands, certes moins organisés, moins superficiellement pacifiques, mais auprès desquels nous sommes susceptibles de dénicher une authentique solidarité (3). N’est-ce pas d’ailleurs l’impression générale qui domine dans les Larrons de François Esperet ? Tous autant qu’ils sont, ces nobles désaxés propagent un étrange rayon d’innocence, au contraire des systèmes accrédités qui les déterminent à être des méchants irrémissibles. Plus proche de nous dans le temps et relativement à ce qui précède, comme s’il s’agissait de l’ancêtre direct des truands de François Esperet, Jack Black, dans Personne ne gagne, récapitule son apparente vie de félon et nous montre en creux la nécessité de tester les limites du modèle occidental ainsi que ses vertus putatives.
Dans le sillage de Jack Black, nous comprenons en effet que nul n’est vainqueur parmi les défaillances millénaires d’une société occidentale qui n’a pas su – ou qui n’a pas voulu – interroger les semences abyssales de la pauvreté. Que l’on soit au sommet ou à la base de la pyramide humaine, que l’on soit honnête ou malhonnête ici ou là, voire les deux à la fois, on perd de toutes les façons dans la mesure où nous léguons à nos enfants une pauvreté planétaire, cyniquement cumulative. Et nous sommes d’autant plus perdants qu’il nous semble que les sommets du monde abritent des vices que les bas-fonds ne connaîtront jamais. De sorte que la quantité des vices qui cataractent sous la plume de François Esperet doit être appréhendée non pas comme l’épicentre infernal d’une zone illicite, mais tout à l’inverse comme un minimum de dépravation en comparaison du maximum de perversion qui l’a engendré. L’intégralité de cette poésie fonctionne ainsi en trompe-l’œil habile : l’obscénité récurrente, la ruse pour échapper aux condés, le machisme suprême, tout cela n’est rien par rapport à l’invisible arrangement des choses, par rapport à l’indécelable matrice des puissants qui vascularise l’inégalité malfaisante.
En dépit de la densité du pouvoir, au mépris de toutes les déclinaisons de la surveillance, le mutilé de ce Chant – Éric de son prénom – continue de perpétuer l’odyssée de ses «épopées douteuses» (p. 48) où des «sommes irrédentes» (p. 49) sont à collecter. À côté de ces mandats typiques, cet Ulysse déporté dans une guerre de Troie toxicomane appartient aussi à la phalange des amoureux hypersensibles. Entiché d’une Pénélope qui s’appelle Sylvie et qui tapine pour des proxénètes balkaniques, elle est «[l’ulcère] malin de sa folie» (p. 33), la «funambule hystérique» qui a remplacé «Ruth la miséricordieuse abeille au centre / de la ruche» (p. 33). Dans cette perspective de dégradation ontologique de la relation sentimentale, Sylvie, «déculottée Pythie des squats» au «vagin hanté» (p. 39), Sylvie la nouvelle asphalteuse d’une Babylone panaméenne, suscite chez le soupçonneux Éric des serments sur l’honneur et des désirs de vengeance, des levées de boucliers qui dynamisent cette physionomie de Quasimodo. Comme jadis il était la mule qui effectuait des trajets entre l’Algérie et l’Espagne, la caisse inondée de marie-jeanne, vaniteux pilote des berlines interlopes (cf. pp. 40-6), le voici désormais déguisé en braconnier des animaux souteneurs, prêt à rendre la justice distributive ou commutative, peu importe, Don Quichotte soucieux de laver la réputation de sa Dulcinée, avec «son corps [qui] menace insolemment la rue horizontale de s’écraser» (p. 33), progressant dans le paysage de Paris avec des allures de «horde sanguinaire / de cavaliers confédérés aux derniers jours avant Appomattox» (p. 35). Il serait enclin à tous les pactes méphistophéliques pour ramener Sylvie dans le giron de sa propriété, alors même qu’elle figure ordinairement un «[amas] comateux de chair hagarde» (p. 48), assommée de ses accouplements avec toutes les queues des tauliers de ce monde. Mais ces luxures sont de faibles répulsifs aux yeux volontiers charitables d’Éric. Cet homme, également, nous intimide par le don de sa personne, par la fureur de ses espérances, et quoique ses déambulations dans Paris fassent écho aux chevauchées de Luc dans Le vent noir de Paul Gadenne (cf. pp. 54-5), elles n’ont pas la même sournoise intention, elles ne sont pas sœurs de la même préméditation criminelle, pas plus qu’elles n’ont la corruption funeste du bourgeois qui répugne à voir une apprentie bourgeoise lui résister. Le Paris de Paul Gadenne et du professeur de lettres Luc n’est pas du même ordre que le Paris des Larrons et du voyou Éric : le premier ressemble sinon à une exaspération des péchés du second, du moins à une conversion de l’honneur enragé en déshonneur complet.
Les éternels crucifiés
Au troisième et avant-dernier Chant, le paradigme de l’homme louche qui se sacrifierait pour sa femme se prolonge. Laurent, taulard intermittent et trafiquant pérenne, profite d’une libération conditionnelle pour préparer la réforme de ses attitudes. Malgré sa «queue démoniaque empereur et satyre» (p. 59), il voudrait décélérer du «génie dans les braquages extorsions de fonds sédentaires» (p. 72) afin de s’acheter une conduite de petit copain édifiant. Malgré ses expéditions à tropisme sidéen où il écumait les «boîtes à cul» (p. 84), «épuisé d’avoir ensemencé des putes à perte» (p. 64) en ayant cru qu’il capterait là-bas des indics sodomites hétérosexuels, Laurent veut s’affranchir du cosmopolitisme de ses amitiés enténébrées (cf. pp. 67-70), s’éloigner des «orifices indifférents / des putes au cœur inerte aux yeux vitreux» (p. 72). Maintenant, et pour toujours, il nourrit le projet d’aimer Jenny, sa Jenny «châtelaine érotique assoiffée de lui» (p. 63), nantie de son «anus à dénicher sous l’hémisphère / adoré du cul» (p. 63), sa Jenny qui fut sa «complice érotique» (p. 80) du temps d’un braquage à Cannes où plusieurs bijoux volés devaient ceindre le crâne de cette muse racaille. Mais la fatalité rattrape le coefficient des possibles, la nécessité s’invite parmi les contingences de Laurent, et le pardon s’apparente à un Dies Irae matérialisé par une rafale balistique trouant la peau du néo-repenti (cf. p. 88).
Les Ultima verba, au quatrième Chant, exposent d’abord la dépouille de Laurent tel un vaurien du Mexique régurgité par la médecine légale. Son éplorée Jenny est agenouillée devant le mythe défunt parce qu’il «exigera que tu demeures à jamais sa veuve embaumée de regrets» (p. 92). Ensuite le cousin Boston entre par effraction dans cette lugubre atmosphère, ruminant des représailles à dessein de sauver la notoriété du monarque assassiné (cf. pp. 95-8). Mais dès lors que le cercueil est emporté par «six chevaliers des sépultures» (p. 105), dès l’instant où Laurent rejoint son «mausolée de granit incrusté d’hommages» (p. 105), la rage filiale de Boston s’atténue, comme apaisée par les motifs universels de la mort. Se venger drastiquement ou gravir les monts de la sagesse ? Le dilemme tracasse Boston et celui-ci se formule une évidence du milieu : il n’a pas envie de partir avant les femmes de sa vie (cf. pp. 106-7). Et puis, graduellement, l’ambition rejaillit et Boston pressent la passation des pouvoirs : «les temps sont venus que je croisse et que lui diminue» (p. 116), l’époque est au retentissement de l’hallali, à la dévoration réelle et symbolique du cadavre de Laurent. En opportuniste, en hyène bohémienne, Boston est paré «à plonger d’extase ineffablement tout au fond des chattes ardentes» (p. 117), content d’avoir «le choix des armes et des orifices» (p. 117). Il est semblable à un soleil prévaricateur qui se lève à «[l’aube] abandonnée du verbe» (p. 119), emblème du mauvais larron qui sera quand même rédimé, immondice allégorique ramassée par les «éboueurs» (p. 119) de l’aurore, tels ces « ramasseurs d’ordures » évoqués par Faulkner au tout dernier chapitre de Pylône. Il est encore une espèce de Josué terrible, conquérant défiant, qui tournera plusieurs fois autour de la ville dans le but de soumettre la Jéricho panaméenne aux mystérieuses vertus de l’extra-muros.
Notes
(1) François Esperet, Larrons (Éditions Le Temps des Cerises, 2013).
(2) Roland Barthes, Leçon.
(3) Montesquieu, De l’esprit des lois.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, françois esperet, gregory mion |  |
|  Imprimer
Imprimer




























































