L’Architecture de Marien Defalvard ou le roman de l’anthropologie dogmatique ?, 2, par Baptiste Rappin (16/09/2021)
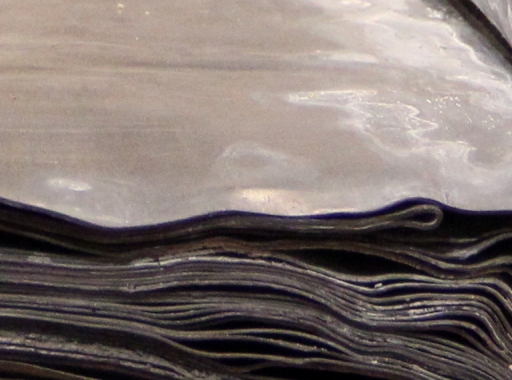
Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Marien Defalvard dans la Zone.
Marien Defalvard dans la Zone. L’Architecture de Marien Defalvard ou le roman de l’anthropologie dogmatique ?, 1.
L’Architecture de Marien Defalvard ou le roman de l’anthropologie dogmatique ?, 1.Débridement du désir et nécessité entravée de la séparation
Mais dire, avec Legendre puis Defalvard, que l’architecture des civilisations est dogmatique, institutionnelle, liturgique; affirmer, toujours avec eux, que la Société est un assemblable et une généalogie de textes, c’est simultanément soutenir la nécessité du Père, c’est prétendre que la pulsion, arbitraire par définition, doit se soumettre à l’arrangement symbolique (ou juridique, dans le cas de l’Occident). Que doit, par conséquent, primer la séparation.
Il est à vrai dire étrange de constater, après les développements précédents, que nos deux auteurs se rattachent à des traditions bien différentes quand il s’agit de penser le désir. Legendre n’a jamais caché l’importance de sa pratique clinique ainsi que sa fidélité à la psychanalyse freudienne, et même sa «relation, orageuse, avec Jacques Lacan» (Legendre, 2021, p. 22); et l’on sait bien, pour l’exposer ici de façon quelque peu caricaturale, que la pulsion de l’inconscient ne doit pas s’exprimer de façon brute, sous peine de provoquer l’anomie sociale. La pulsion passe par un processus de transformation – condensation, déplacement, sublimation, etc. – afin de s’exprimer dans une activité socialement désirable. Tout autre est le prisme de Defalvard, qui donne raison «à René Girard dont l’antifreudisme avait toujours énoncé que le désir, loin d’être le garant d’une singularité, était le plus faible dénominateur commun» (Defalvard, 2021, p. 188); c’est la raison pour laquelle, «dans le Désir, [l’animal humain] perdrait toute singularité de langage et toute propriété personnelle sur sa phrase» (Defalvard, 2021, p. 188-189). Alors que le Désir procède de l’individuation chez Freud, elle mène à l’homogénéisation chez Girard.
On pourrait alors se dire que, ne partageant pas les mêmes fondements anthropologiques du désir, Legendre et Defalvard divergent quant à leur appréciation de sa place dans la société contemporaine. Il n’en est pourtant rien. Tous deux se rejoignent en premier lieu sur un diagnostic commun : la société de consommation consacre l’expression débridée des désirs et la revendication des sujets à s’autofonder, c’est-à-dire à se passer de Référence et d’institutions. Et ils n’ont pas de mots assez durs pour qualifier cette situation inédite : «fondamentalisme» chez Legendre («Sous le fatras des amalgames contemporains, se découvre le fondamentalisme de notre époque : la revendication de l’autofondation, chaque sujet prenant statut souverain, autrement dit devenant une caricature d’État» (2005a, p.116)), «fascisme» chez Defalvard («[…] pour lui, le fascisme, c’était d’empêcher de jouir (de l’empêcher de jouir), de mettre une limite à la jouissance; alors qu’à l’évidence, c’est de n’en mettre pas« (Defalvard, 2021, p. 219)). Plus encore, cette tyrannie revêt les atours de la démocratie, dans la mesure où chacun peut prétendre à jouir au même titre que tout le monde, de telle sorte que l’on pourra appeler «démocratique» une société qui garantit un accès égalitaire à la jouissance. Force est alors de conclure que «[…] l’unanimisme de la comédie organisée, de la comédie sociale, avait cédé le pas devant le régime sans exemple des pulsions : régime idéal puisque chacun avait l’impression d’y jouir autant que l’autre […]» (Defalvard, 2021, p. 242).
Et les deux auteurs, en outre, de s’accorder sur la logique sous-tendant ce primat du désir. Le renoncement au Tiers, au Dogme, mène directement à la fusion et à l’absolutisme (au sens étymologique : «l’absence de lien»); ainsi Defalvard (2021, p. 25) évoque-t-il «le désir immature, absolutiste de fusion» ainsi que «l’intégrisme de la fusion» tandis que Legendre (2005b, p. 175) note, à propos du totalitarisme qui n’est pas sans rapport avec le fondamentalisme de notre époque, constate «un non-lien, un état de fusion avec l’absolu». Où mène alors ce fusionnisme ? Où conduit l’exacerbation du désir au mépris de toute équerre normative ? «Il n’y avait plus qu’à attendre, donc, en regardant les bras croisés ce déferlement comme on aurait regardé les mouvements fous de la mer. Attendre quoi ? Ce à quoi aspire le fantasme, sa note ultime, ce dérèglement qu’il cherche dès l’orée quand on l’a libéré, qu’on lui a donné le plein jour : le meurtre, le désir du meurtre, le couronnement de tout fantasme dans le meurtre institué» (Defalvard, 2021, p. 200). Ce que décrit ici le romancier n’est autre que ce que Legendre a analysé dans ses Leçons VIII, Le crime du caporal Lortie (Legendre, 1989). Le juriste se penche en effet sur la tuerie qui eut lieu le 8 mai 1984 à Québec; Denis Lortie, revêtu d’un uniforme militaire, pénètre dans l’enceinte du Parlement afin d’assassiner des députés du Parti Québécois; bilan : trois morts et treize blessés. Mais, plus que l’objectivité des faits, c’est la mise en scène et le motif avoué de Lortie qui retiennent toute l’attention de Legendre : «Une clé nous est offerte par Lortie lui-même; évoquant, dans l’après-coup de la tuerie, "le visage de (son) père"« (Legendre, 1989, p. 27), aveu qui conduit alors à interpréter son acte comme relevant du parricide. C’est l’image du Père, son symbole, son effigie, qu’il est venu tuer en se rendant dans une institution, lieu même de la «ligature généalogique« (Legendre, 1989, p. 30) qui distribue les places entre les générations. Lortie, en tuant le droit civil qui assure le départ entre les parents et les enfants, accomplit le règne de la fusion par le meurtre, paroxysme de l’expression du désir qui se substitue à la norme dans les sociétés post-hitlériennes.
Mais dire que le désir fusionnel fait régner sa loi paradoxale de l’anomie, cela revient à affirmer que la séparation n’a pas lieu : «Simplement, aucune épée n’avait jamais tranché en lui cette armature par laquelle son fantasme – son fantasme absolutiste – s’arrimait au monde : ce fantasme l’envahissait. Il n’en avait jamais été séparé : individus véritablement, indivisible» (Defalvard, 2021, p. 222). Le Père ne joue plus son office : lui qui, désormais devenu «papa» – évolution des termes qui témoigne à elle-même de la désymbolisation de la fonction paternelle –, ne détache plus l’enfant de sa mère, renforce les processus fusionnels et devient lui-même, dans cette situation, un obstacle à l’émergence de l’altérité, de soi, des autres, du monde. La loi symbolique est enrayée, paralysée, elle qui se trouve pourtant au cœur du processus de séparation : «Symboliser : tel est l’enjeu de la ternarité, quel que soit le champ considéré. Symboliser, cela veut dire, pour le sujet, rendre habitable l’écart, le vide, la séparation, en d’autres termes assumer la négativité» (Legendre, 1998, p.115). Le monde ternaire s’éclipse devant la société plate de la binarité : interactions et contrats deviennent alors les principales modalités de la vie sociale. De ce point de vue, c’est la condition même de l’être humain, cet animal langagier, cet «animal qui écrit« (Legendre, 2021, p. 115), qui se trouve promise à un avenir des plus sinistres.
La donne anthropologique : l’animal langagier
S’il est, avec le recul, une convergence anthropologique qui se dessine entre Defalvard et Legendre, c’est bien celle que nous venons d’énoncer : l’homme est cet animal qui dématérialise la texture du réel pour le faire ressusciter dans les mots et les images : «Il y a eu l’envers de l’intuition d’origine : le monde fuyant entier vers le langage comme pris par une cascade au lit impossible à contenir, démettant tout de la matière» écrit ainsi Defalvard (2021, p. 21). La fusion de l’homme avec le réel n’advient que par l’absence ou la défaillance du langage; là où il y a langage, advient la séparation, c’est-à-dire l’arrachement à l’opacité du réel. On mesure alors le risque de la prolifération contemporaine des langues de bois politiques, des novlangues de l’expertise, des multiples langages autoréférentiels qui sempiternellement bouclent les mots sur eux-mêmes : avec ces nouvelles langues, froides comme le métal, qui se substituent tant à la langue quotidienne, commune, professionnelle, vernaculaire, qu’à la langue travaillée, polie, littéraire, véhiculaire, advient l’impossibilité de la séparation du sujet d’avec le monde, prisonnier qu’il reste de l’indépassable répétition. Quoi qu’il en soit, force est d’admettre nous parlons comme nous respirons : «La vérité est ailleurs, dans le langage; dans l’emprise entière du langage sur la conscience, dès le lever. L’air et le langage se mélangeaient, comme une buée au fond des yeux; le langage était la matérialité, l’air, l’abstraction des souvenirs» (Defalvard, 2021, p. 13). Cette condition langagière de l’animal humain est d’ailleurs si prononcée qu’elle pousse Defalvard, qui pousse ici le raisonnement jusqu’à son terme logique, à rejeter la causalité au nom de la croyance dans le pouvoir des mots : «L’esprit historique, d’une manière générale, me rebutait; l’absurde idée de la causalité, de la foi dans les hommes plutôt que dans les mots – l’absurdité du spectacle donné ou cru de la volonté, la maladie de la volonté, le labourage de la mer, les grandes orgues de morbidité du désir. […] L’Histoire, je m’en passais et d’autres auraient pu s’en passer qui s’agrippaient à elle dans l’illusion du sens, de la puissance, de la totalité – attachés obscurément au fantasme de la causalité» (Defalvard, 2021, p. 85). Croire en la causalité plus qu’au langage, c’est au fond passer à côté de l’essence symbolique de l’homme et des sociétés, et ramener l’action aux forces qui s’exercent sur la matière, ou à travers la matière; on pourrait même affirmer, de ce point de vue, que l’obnubilation pour la causalité historique constitue l’un des facteurs insoupçonnés du procès de désymbolisation caractéristique de l’époque contemporaine.
De son côté, Legendre (2004, p. 9) rappelle qu’»une caractéristique fait de l’humain une chose à part dans le vivant : la parole». Mais, convient-il d’ajouter sur le champ, l’être humain parle autant qu’il est parlé; il est même parlé avant que de parler, avant que d’apprendre à manier le langage : «Avant même d’être né, tout individu est parlé, du seul fait que les institutions existent et fonctionnent» (Legendre, 2004, p. 75). De sorte que le nouveau-né, avant d’être l’enfant de ses parents, est avant tout celui du Texte, celui des institutions et des dogmes qui l’accueillent au sein du structure qui lui assigne une place et lui offre la possibilité d’inscrire son existence dans une trame préalable de sens.
Le raisonnement peut encore être étendu à un niveau ontologique que Legendre désigne par l’expression, récurrente sous sa plume, d’»interlocution du Monde et de l’homme» : «[…] le Monde nous parle et nous lui parlons. De cette interlocution structurale, qu’ignore la Science ultramoderne et que néanmoins elle pratique sur un mode inédit, aussi aveugle soit-il, mes Leçons apportent maintes illustrations, dont regorgent les arts sous toutes leurs formes, incluant l’art de fabriquer les objets industriels» (Legendre, 2021, p. 48). Selon cette optique, on peut sans hésiter qualifier la méthode et la pensée de Legendre d’»herméneutiques» : il fait le pari du sens, il gage que le Monde offre un horizon de sens, ou une pluralité d’horizons de sens, qu’il nous parle et même nous comprend; réciproquement, il postule que l’animal parlant est aussi l’animal qui cherche à comprendre et interprète, qui explore les continents de la signification et leurs diverses frontières, de telle sorte que s’installe une interlocution du Monde et de l’homme qui renvoie à cet universel socle animiste déjà évoqué plus haut.
Mais quoique le langage constitue indéniablement une donne anthropologique fondamentale, il n’empêche qu’il peut s’user, s’épuiser voire se consumer, et que les mots perdent de leur portée; l’interlocution du Monde et de l’homme s’en trouve alors affaiblie, diminuée, et même empêchée. Lisons Defalvard : «Au réveil, oui, j’avais les yeux tuméfiés. Et le langage s’est insinué, dès la première banderille de la conscience, sans dire son mot, bestial, brutal, une évidence propre; un aphorisme s’est inscrit, un vieil aphorisme sans méthode, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus aisé, de plus mesquin dans le langage : son, usage direct, sans distance. La fausse monnaie du langage, dans le cerveau, au réveil […]» (Defalvard, 2021, p. 14). Nous l’avons lu, nous le savons : Defalvard n’apprécie guère Nietzsche, c’est le moins que l’on puisse dire, et il juge Montherlant en tous points supérieur; il n’empêche que «cette fausse monnaie» a tout des accents de la pièce de monnaie émoussée etvieillie qu’évoque le philosophe allemand dans l’opuscule Vérité et mensonge au sens extra-moral pour parler de la vérité : «Qu’est-ce donc que la vérité ? Une armée mobile de métaphores, de métonymies, d’anthropomorphismes, bref une somme de corrélations humaines qui ont été poétiquement et rhétoriquement amplifiées, transposées, enjolivées, et qui, après un long usage, semblent à un peuple stables, canoniques et obligatoires : les vérités sont des illusions dont on a oublié qu’elles le sont, des métaphores qui ont été usées et vidées de leur force sensible, des pièces de monnaies dont l’effigie s’est effacée et qui ne comptent plus comme monnaie mais comme métal» (Nietzsche, 1997, p. 16-17).
Legendre entretient également ce même souci de la vigueur des mots et c’est précisément la raison pour laquelle il abandonne le terme de «religion» et privilégie celui, plus expressif, de «fiduciaire» : «Faire le ménage. J’entends par là prendre acte de l’usure du concept de religion, c’est-à-dire poser les repères historiques et tirer les conséquences, mettant au jour l’enjeu suprême du langage : le fiduciaire» (Legendre, 2012, p. 72). Usure du concept de religion ? C’est ce que détaillent justement les pages suivantes, tout au long desquelles Legendre met en évidence le flou voire le chaos qui règne autour de ce mot et de son champ lexical incluant «mythe», «idéologie», «rituel», «théologie», «mystique», etc. La conclusion s’impose alors d’elle-même : «la notion de religion a épuisé son crédit» (Legendre, 2012, p. 82).
La geôle de la langue
Si nos deux auteurs partagent une même conviction anthropologique, s’ils s’accordent sur le phénomène d’érosion des mots, ils entretiennent néanmoins un rapport différent à la langue. Pour Legendre, nous l’avons vu ci-dessus, la condition langagière de l’animal humain ouvre les portes de l’herméneutique qui traverse l’interlocution du Monde et de l’homme, ménage un accès de la théâtralité des civilisations et ouvre la porte à l’étude des textes qui forment la structure porteuse des sociétés. En quelque sorte, entrer dans le langage, c’est modestement prendre conscience de soi à travers la découverte d’une généalogie dogmatique. Au fond, cette démarche témoigne du crédit général que Legendre accorde au langage, malgré l’érosion des mots et des effigies que le vent des siècles, fatalement, amène avec lui. Et cela n’est guère étonnant : ce que révèle l’anthropologie dogmatique, c’est bien le montage ternaire des sociétés qui met en scène, par le maniement des symboles par les institutions, une Référence extérieure au plan horizontal des relations sociales, et cette ternarité relève justement du langage, elle est une «structure spécifique, coextensive au langage, hors de laquelle la vie de tout sujet et la constitution sociale où que ce soient seraient impossible» (Legendre, 1998, p. 21). Il n’existe pas d’autre horizon que celui du langage, et, comme le rappelaient Martin Heidegger dans Sein und Zeit [1927] puis Hans-Georg Gadamer dans Vérité et Méthode [1960], l’important n’est pas, par conséquent, de s’extraire du cercle herméneutique, impossible ambition toutefois nourrie par la science moderne, mais de savoir y rentrer de façon perspicace.
Toute autre nous semble être la tournure d’esprit de Defalvard. Que nous soyons irrémédiablement pris par le langage et la dématérialisation du réel qui inévitablement s’ensuit, loin de paver la voie à l’herméneutique et à l’enquête généalogique, renvoie tout au contraire chez le romancier à une situation ontologique à proprement parler carcérale; la condition langagière séquestre en effet l’homme dans un pénitencier à ciel ouvert au sein duquel l’asservissement aux mots se fait règlement général : «Il faudrait dire un jour pour de bon ce qu’il a d’acceptation absolue dans l’emploi d’un simple mot, de soumission sans distance à la réalité qu’il désigne» (Defalvard, 2021, p. 53). Cette dernière phrase marque l’envers de la dématérialisation opérée par le pouvoir des mots : notre séparation du réel, qui met un terme à l’expression débridée du principe de plaisir, ne se paie-telle pas, en retour, d’une fusion avec le langage ? Cela signifierait alors, si l’on développe cette hypothèse en suivant un raisonnement logique, que l’animal humain balance entre deux servitudes : celle à la réalité qui provient d’une absence de langage d’une part, celle des mots qui émane de l’omnipotence du langage d’autre part. Et, dans ce dernier cas, nul pan de notre existence ne se réalise en dehors de la parole et de l’écriture, si bien que le langage devient une obsession et une dépendance : «Ma dépendance aux mots était une dépendance de drogué» (Defalvard, 2021, p. 150).
Mais les addictions drainent leur lot de pathologies, tant physiologiques que psychologiques. Qu’en est-il alors de ce langage-drogue ? Il génère «la maladie de l’excès de sens« (Defalvard, 2021, p. 22) ou encore un «excès de conscience» que le romancier définit comme «un empêchement souffreteux, comme un lit de pierres sèches sur un chemin en descente empêche le libre mouvement des jambes» (Defalvard, 2021, p. 271). Curieuse maladie que celle de l’excès de sens, ou de l’excès de conscience, à l’époque où l’on ne cesse de se plaindre de la perte des repères et de la crise du sens ! Mais Defalvard a bel et bien raison : l’épuisement du réel dans le langage, «la vérification du monde par le langage», «la confirmation nécessaire de la langue» (Defalvard, 2021, p. 20), ne saurait mener qu’à l’épuisement de la liberté et à l’accablement de l’homme. À une fatigue métaphysique. À une profonde et sempiternelle lassitude. Cette thèse rapproche étonnamment le romancier du sociologue et essayiste Jean Baudrillard qui n’eut de cesse, tout au long de sa vie, de livrer à ses lecteurs de stimulantes analyses de la société cybernétique; par exemple : «J’appelle "Réalité Intégrale" la perpétration sur le monde d’un projet opérationnel sans limites : que tout devienne réel, que tout devienne visible et transparent, que tout soit "libéré", que tout s’accomplisse et que tout ait un sens (or le propre du sens est que tout n’en a pas). / Qu’il n’y ait plus rien dont il n’y ait rien à dire» (Baudrillard, 1995, p. 47). Mais ce que Baudrillard dit de la métaphysique du code propre à la société digitale contemporaine, Defalvard l’étend à la condition langagière de l’homme : le mouvement d’épuisement du réel est en effet interne à la langue elle-même.
Mais à vouloir subsumer l’entièreté du réel sous les mots, le langage perd en intension ce qu’il gagne en extension : «[…] tout ce qui existe fortement, réellement, se passe de la réflexion superficielle du langage – de cette réflexion superflue : le langage» (Defalvard, 2021, p. 25). En fin de compte, le langage serait à l’image d’un voile de Māyā qui installe une fine pellicule d’illusions entre le moi et le monde. Si bien que la quête de Defalvard, plutôt que d’être herméneutique comme l’est l’entreprise de Legendre, se révèle pleinement phénoménologique; ce qu’il vise, en effet, c’est bien de retrouver le sol du monde par-delà les mots, en-deçà des mots, avant même les mots : «Il m’est parfois venu ce doute : ai-je jamais connu une existence hors du langage ? Si je compare mentalement ces deux scènes, celle qui a eu lieu la veille et celle qui date d’il y a trente ans, ou plus, des abysses clairs de l’enfance, je vois dans la première une destruction, un avènement de destruction par le langage et dans la seconde, la présence absolue, la présence parfaite d’un monde sans confirmation, existant présentement dans des formes absolument révélées, absolument sensibles, d’un monde clarifié par sa propre présence […]» (Defalvard, 2021, p. 22).
La question du nihilisme
Cette divergence à propos du langage introduit une autre discordance qui a cette fois-ci trait non plus au crédit placé dans les mots, mais à la confiance portée dans l’avenir. Du côté de Legendre, la mise en évidence d’invariants le conduit, malgré ses implacables descriptions et analyses du monde moderne (la désymbolisation et la casse généalogique; le nihilisme de la rationalité techno-gestionnaire; la prétention du sujet à l’autofondation; le délabrement de l’Université et plus encore du droit, qu’il qualifie de «discipline sinistrée« (Legendre, 2021, p. 101)), à soutenir un optimisme que nous qualifierions volontiers de «logique», car découlant des principes mêmes de l’anthropologie dogmatique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle sa conférence de 2007, intitulée La Balafre, s’adresse à la «jeunesse désireuse», appel répété dans L’avant dernier des jours lorsque le juriste évoque «l’exigence du dépassement de soi par l’écriture qui habite les jeunesses du Monde entier» (Legendre, 2021, p. 185). Tout au plus Legendre pose-t-il la question de la possible poursuite de notre civilisation : «Dans le contexte d’un psycho-sociologisme assaisonné de science cognitive et saturé d’abstractions ou de mathématique décorative, l’exigence normative liée à la socialisation du sujet inconscient s’efface, la médiation de l’Art, désormais absorbée par le marché, n’a plus cours. Momentanément, ou assistons-nous à quelque chose d’obscur, qui serait la face cachée du Nihilisme ?» (Legendre, 2021, p. 237). Les nécessités inhérentes à l’espèce douée de parole rendent la fiction indispensable à l’habitation du monde et, de ce point de vue, la Science fournit un imaginaire et un dogme aussi bien que la Religion ou l’État; elle n’échappe pas à la condition théâtrale de l’animal humain : «Toute société répète, parce qu’elle se reproduit. Partant de là, on peut dire : en ce qu’elle concerne la reproduction, la normativité se définit comme loi de la répétition» (Legendre, 1992, p. 67). De surcroît, Legendre observe que l’Occident n’a pas encore avalé le monde, que les civilisations ne sont pas toutes encore placées sous le joug euro-américain, et qu’elles résistent à la mondialisation en ayant recours à leurs propres traditions : à ce sujet, les scènes du documentaire Dominium Mundi. L’empire du Management tournées au Japon sont tout à fait révélatrices de l’encastrement de la production et de la vente dans les rituels ancestraux. Bref, Legendre refuse toute lecture univoque et péremptoire de l’époque contemporaine.
Defalvard ne partage guère cet optimisme, et nulle issue se semble se dégager de L’Architecture. Très tôt dans le roman se trouve mise en cause l’anthropologie matérialiste «qui faisait son mouvement de labourage, de labourage uniforme et massif comme le vent, la nuit, l’idée simple du vent dans la nuit, et l’extinction de la dernière bougie à Saint-Aubin, du dernier espoir avec elle, et l’oubli du dernier texte d’accomplissement, du dernier château intérieur lu […]» (Defalvard, 2021, p. 15), et qui ne peut mener à rien d’autre qu’à une «impasse historique» (Defalvard, 2021, p. 18). Le labourage matérialiste ne laisse pas d’abolir toute dualité, de combler tous les écarts, d’aplanir les hommes et le monde; il n’est alors guère surprenant que le même tuf d’aluminium et d’acier habille la terre comme le ciel, une terre désormais aride et stérile, un ciel désormais obturé et dépourvu de promesses : «et puis cet immense ciel de chlore métallique, d’où aucune divinité ne pourrait plus surgir» (Defalvard, 2021, p. 204). Que reste-t-il alors à l’homme contemporain, maintenant que tout est accompli, maintenant que tout est réalisé, maintenant que tout a été écrit et même codé, mis en algorithme ? À peine le sentiment de naître trop tard, quand plus rien de décidable ni de décisif se trouve en jeu; à peine le sentiment et même la réalité du délai, c’est-à-dire, comme l’expose Gunther Anders, la vie dans l’intervalle qui sépare la fin de la fin. C’est au fond un ethos gnostique que décrit alors Defalvard à travers son narrateur qui se sent étranger à son temps : «Toujours le même mouvement ultime et sédentaire de ce qui vient une fois que tout a été dit, qu’on vient trop tard depuis qu’il y a des hommes et qu’ils pensent» (Defalvard, 2021, p. 124).
Les dés sont jetés, l’évidence du nihilisme est là, étalée devant nous, à chaque coin de rue : «Mais il n’y avait pas de civilisation, il suffisait d’ouvrir les yeux» (Defalvard, 2021, p. 204). Est-ce à dire que les invariants de l’anthropologie dogmatique seraient ébranlés ? émiettés ? anéantis ? Et qu’en est-il alors du langage ? «[…] l’homme était-il encore un mammifère social ? On pouvait en douter. Et pourtant il y avait le langage – le probe, le merveilleux langage, le poinçon de l’animal social, sa référence qui ne lâchera jamais. Et pourtant…» (Defalvard, 2021, p. 251). Des points de suspension lourds de sens, qui révèlent ce que Defalvard n’écrit pas et laisse le soin à son lecteur de déchiffrer : à savoir que les digues du langage ont fini par lâcher, par céder, par rompre devant les vagues répétées et déchaînées de l’océan industriel.
La généalogie a-t-elle pour autant disparu ? On peut sincèrement en douter quand on observe les multiples opérations de réhabilitation et de valorisation du patrimoine, ou encore l’engouement des Français pour l’établissement de leur arbre généalogique. À ce constat par trop superficiel, Defalvard oppose la thèse selon laquelle la crise de la généalogie se marque moins par l’absence de généalogie que par son excès, son trop-plein : «Est-ce que la généalogie, la frénésie généalogique qui semblait s’être emparée de tant, n’était pas une passion décadente ?» (Defalvard, 2021, p. 87). Jamais autant d’études historiques ne furent publiées, jamais l’accès au passé ne fut aussi facile – il suffit pour cela de pianoter sur son clavier –, et pourtant, cette abondance témoigne plus d’une objectivation, voire d’une muséification, des traditions que de leur effectivité dans les sociétés contemporaines. Plus encore, le dogme et les symboles se trouvent convoqués par intérêt, dans le cadre d’une stratégie rhétorique ou politique : «Car même lorsqu’une concession était faite à l’esprit, au dogme, à la morale, au passé, à la tradition, c’était toujours le cynisme qui l’imposait : ainsi allaient, à ce moment du monde, les stratégies politiques occidentales» (Defalvard, 2021, p. 213), de sorte qu’ils survivent à l’état de spectres, de fantômes ou de simulacres : «Comme il ne leur restait plus rien à jouer, ils jouaient l’idée de leur culture, le cadre mythifié inopérant, enfin tout ce qui avait été détruit. Ils préféraient encore jouer le souvenir de la civilisation qu’ils défendaient, comme si elle existait encore, comme si elle n’avait pas été ruinée, contre les barbares hypothétiques» (Defalvard, 2021, p. 215). Ainsi la droite conservatrice, implicitement visée par Defalvard dans cette dernière citation, ne cesse-t-elle de s’agiter en vain : mais elle ne brasse que le néant et justifie de la sorte son inane activité plus qu’elle ne ressuscite un passé englouti.
Conclusion : le catholicisme en ligne de partage
Nous voici parvenus au terme de notre étude de L’Architecture et du rapport que le roman entretient avec l’anthropologie dogmatique. Et nous en venons au fond de l’affaire, lentement préparé par les questions du langage et du nihilisme : il s’agit ni plus ni moins du christianisme en général, et du catholicisme en particulier.
Legendre confesse, dans L’avant dernier des jours, que «la religion chrétienne [lui] glissait des mains» (Legendre, 2021, p. 57, p. 58), témoignage explicite de son abandon voire de son refus de la foi chrétienne. Le vide créé par ce rejet fut comblé par le socle animiste universel dont la prise de conscience provient, paradoxalement, de l’exercice de la copie pratiquée par les moines : «J’ai donc découvert l’animisme, non par l’ethnographie, mais à travers l’expérience de la main qui écrit. Élève docile des copistes médiévaux, après avoir admiré le geste précis des anciens imprimeurs alignant les caractères, j’ai saisi, dans l’après-coup d’une activité qui passe pour mécanique, que le manuscrit, "l’écrit à la main", fût-ce en recopiant le texte d’un autre, était un objet animé, une créature spirituelle qui, à l’image et ressemblance de l’homme, provient d’un néant, vit un temps, et retourne au néant» (Legendre, 2021, p. 65). Expérience animiste de la copie plus tard confirmée par l’érudition : «[…] la Recherche historique ne soupçonne pas que le Moyen Âge politique et juridique véhicule un vague regret de ce qu’il combat : la pensée païenne et son foisonnement mythologique« (Legendre, 2021, p. 315). Tel est le rapport paradoxal que Legendre noua avec le catholicisme : rebuté par la sécheresse monothéiste qui réduit voire réprime les liturgies et les emblèmes, au point d’interdire les chorégraphies et la danse inspirées par le Démon, il n’en développa pas moins une sensibilité animiste, qui forme le fond de l’anthropologie dogmatique, à son contact prolongé.
Defalvard l’entend d’une autre oreille; pour lui, au fond, le nihilisme en son principe tient de «l’éventrement païen définitif des choses» (Defalvard, 2021, p. 24). Le paganisme forme d’ailleurs un puissant leitmotiv de L’Architecture, comme en témoignent de multiples apparitions, dont les suivantes : «Je crois – hélas – qu’il y a quelque chose d’irrémédiablement païen en nous» (Defalvard, 2021, p. 75); «Celle qui se disait aussi bien regardez ces braves jeunes militaires, est-ce qu’ils ont encore quoi que ce soit de chrétien, ce sont des païens, des païens comme les autres vous dis-je, ils sont démis, défaits, orduriers – douze péchés par jour, ou treize, ce doit être« […]» (Defalvard, 2021, p. 169); «Ils prendraient goût aux joutes païennes et aux courses païennes et aux ébats païens dans les cheires du Puy-de-Dôme, et aussi à la folie des miroirs» (Defalvard, 2021, p. 198). Tout cela revient à dire qu’en dernier ressort L’architecture ne peut être lue – et comprise nous semble-t-il – qu’en gardant en tête un décor biblique, plus précisément celui de la Genèse incluant à la fois l’épisode de la Tour de Babel (rappelons que la construction, c’est-à-dire l’architecture, cesse dès la création des langues et la séparation des hommes), et celui du péché originel et de la Chute : qu’est-ce qu’en effet que retrouver un monde d’avant le langage, un monde phénoménologiquement pur, si ce n’est poser le pied dans un jardin originel encore non contaminé par la prison du langage ? Et c’est bien pourquoi Defalvard donne à son lecteur, très tôt dans son roman, la clef de lecture du Mal : «Le Mal, c’était la vérité de l’air, la pureté de l’air s’introduisant dans la poussière des idées, dans les rayonnages sans contrepartie; le Mal, c’était la défaite, la bonne défaite de l’Idée» (Defalvard, 2021, p. 13). Le Mal, ce serait alors peut-être de ne point pouvoir respirer un autre air que celui chargé des particules du langage.
Le rapport que Legendre entretient au christianisme ne se limite guère à une simple expérience personnelle; il relève également d’un long travail d’enquête et d’une fréquentation assidue des textes médiévaux. Nous en avons déjà relevé un trait plus haut : la révolution papale joue un rôle décisif dans l’avènement de la modernité occidentale fondée sur la rationalité technique du droit. D’une part, elle offre un réservoir juridique dans lequel les États viendront puiser pour assurer leur propre construction, participant de la sorte à la structuration institutionnelle et politique du bloc euro-américain; de l’autre, son maniement technique et décontextualisé du droit romain préfigure la société industrielle et le déploiement uniforme des méthodes managériales dont Legendre ne cesse de souligner le nihilisme. Ambivalence de la réforme grégorienne, donc. Mais un autre aspect, bien plus décisif à notre sens, est encore à signaler : la Trinité, en dépit des apparences, joue contre la ternarité. Certes, «[le chiffre ternaire] comporte implicitement la signature des trois éléments de la construction humaine : corps, image et mot, et leur combinatoire déployée dans chacun de ces trois registres différenciées« (Legendre, 2021, p. 146). Ainsi, de prime abord, la Trinité chrétienne reprendrait les éléments constitutifs de l’anthropologie dogmatique. Cependant, ce serait aller trop vite en besogne que de s’en tenir à l’évidence de ce jugement, car, en seconde lecture, «cette position a enfermé l’Ouest dans une impasse, qui porte à conséquence à l’échelle de la culture» (Legendre, 2021, p. 151). De quelle impasse parle donc Legendre ? «Le Fils mis au même rang (pariter) que le Père quant à la procession du Saint Esprit, ce trait introduit une binarité derrière la façade trinitaire. Cette parité des deux termes se révèle ruineuse autant pour le Fils que pour le Père, en ce sens que la ternarité s’en trouve compromise» (Legendre, 2021, p. 151-152). Ainsi donc le statut théologique d’identité du Père et du Fils met-il à mal la nécessaire séparation anthropologique de ces deux instances dans le processus généalogique. Notons que Peter Sloterdijk, citant Albrecht Koschorke (2016, p. 291 : «L’identité chrétienne entre le père et le fils ne fonde pas un continuum généalogique, elle le brise au contraire»), use de la même argumentation pour rendre la crise contemporaine de la filiation intelligible. Selon ces analyses, le christianisme serait porteur, du fait même de la théologie trinitaire, de l’effondrement généalogique que nous connaissons de nos jours sous le joug de l’Industrie.
Tout au contraire, pour Defalvard, il n’est d’avenir que chrétien, l’avenir n’étant autre, d’ailleurs, que l’essence temporelle du christianisme : «[…] mais cette épreuve de reconnaissance de l’antériorité, dans le christianisme, ne révélait pas un monde englouti mais un monde, naturellement, toujours à venir : ainsi dans la nostalgie chrétienne, dans la nostalgie de la trace chrétienne, on lisait l’espérance à venir […]» (Defalvard, 2021, p. 29). L’étude des textes médiévaux ne devrait ainsi pas mener à voir dans la religion chrétienne une impasse généalogique, mais bien plutôt la possibilité de surmonter le nihilisme industriel. C’est ainsi qu’un même souci de l’architecture et de ses emblèmes, qu’une même attention portée aux dogmes, cachent entre Legendre et Defalvard une profonde divergence dont la ligne de partage n’est autre que la foi.
Références bibliographiques
Baudrillard Jean, Le crime parfait (Galilée, 1995).
Defalvard Marien, L’Architecture (Fayard, 2021).
Legendre Pierre, Leçons VIII. Le crime du Caporal Lortie. Traité sur le Père (Fayard, 1989).
Legendre Pierre, Leçons VI. Les enfants du Texte. Étude sur la fonction parentale des États (Fayard, 1992).
Legendre Pierre, Leçons I. La 901e conclusion. Étude sur le théâtre de la raison (Fayard, 1998).
Legendre Pierre, Sur la question dogmatique en Occident (Fayard, 1999).
Legendre Pierre, Leçons IV. L’inestimable objet de la transmission. Étude sur le principe généalogique en Occident (Fayard, 2004 [1985]).
Legendre Pierre, L’amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique (Éditions du Seuil, coll. Champ Freudien, 2005a [1974]).
Legendre Pierre, Leçons VII. Le désir politique de Dieu. Étude sur les montages juridiques de l’État du Droit (Fayard, 2005b [1988]).
Legendre Pierre, La Balafre. À la jeunesse désireuse… (Mille et Une Nuits, 2007).
Legendre Pierre, Argumenta Dogmatica. Le Fiduciaire suivi de Le Silence des mots (Mille et Une Nuits, 2012).
Legendre Pierre, L’avant-dernier des jours. Fragments de quasi mémoires (Ars Dogmatica Éditions, 2021).
Nietzsche Friedrich, Vérité et mensonge au sens extra-moral, trad. Nils Gascuel (Actes Sud, 1997 [1873]).
Rappin Baptiste, dans l'article William Penn, figure tutélaire de l’industrialisme et du management scientifique ?, in Revue de Théologie et de Philosophie, n°250, pp. 267-85.
Rappin Baptiste, dans l'article Pierre Legendre ou le droit du point de vue de l’anthropologie dogmatique, in Droit et Société, n°102, pp. 397-411.
Sloterdijk Peter, Après nous le déluge. Les Temps modernes comme expérience antigénéalogique (traduction d’Olivier Mannoni, Éditions Payot & Rivages, 2016 [2014]).
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, l'architecture, marien defalvard, pierre legendre, anthropologie dogmatique, baptiste rappin |  |
|  Imprimer
Imprimer
