Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley (28/02/2022)

Photographie (détail) de Juan Asensio.
 Nous autres d'Eugène Zamiatine mais, avant, le Journal d'un détenu de Petter Moen.
Nous autres d'Eugène Zamiatine mais, avant, le Journal d'un détenu de Petter Moen.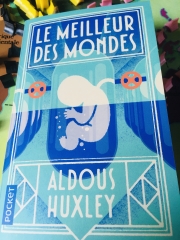 Finalement, il serait possible d'interpréter le si célèbre Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, paru en 1932, auquel l'écrivain ajouta une préface en 1946 (1), comme l'illustration, bien souvent naïve alors même qu'elle dut surprendre voire effrayer à l'époque de sa parution, de la légende du Grand Inquisiteur, autrement dit comme une fable sur la résolution du «problème du bonheur», ou encore, précise l'auteur, comme «le problème consistant à faire aimer aux gens leur servitude» (pp. 18-9).
Finalement, il serait possible d'interpréter le si célèbre Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, paru en 1932, auquel l'écrivain ajouta une préface en 1946 (1), comme l'illustration, bien souvent naïve alors même qu'elle dut surprendre voire effrayer à l'époque de sa parution, de la légende du Grand Inquisiteur, autrement dit comme une fable sur la résolution du «problème du bonheur», ou encore, précise l'auteur, comme «le problème consistant à faire aimer aux gens leur servitude» (pp. 18-9).Mustapha Menier se revêt ainsi des atours du plus impeccable des suborneurs, ce Maître de la Terre selon Robert Hugh Benson, Grand Inquisiteur d'autant plus persuasif qu'il comprend, admirablement, les idées déviantes, puisque lui-même en a nourri plus d'une, surtout en matière scientifique. Pas davantage nous ne sommes étonnés qu'il connaisse Shakespeare, comme le Sauvage qui le cite à tour de bras ou plutôt, qui n'a que ses vers à la bouche, en toutes circonstances de la vie quotidienne. Quoi qu'il en soit, le bonheur, nous assure-t-il, est «un maître exigeant, surtout le bonheur d'autrui» et même, remarque-t-il avec une pointe d'ironie, «un maître beaucoup plus exigeant, si l'on n'est pas conditionné pour l'accepter sans poser de questions, que la vérité» (p. 281). De la même manière, «le bonheur n'est jamais grandiose» (p. 274), comme peuvent l'être les pièces de Shakespeare toutes pleines de ces «phrases à rayons X» (p. 231) dont parle Huxley, phrases dont la déclamation, dans des situations pour le moins banales dans notre meilleur des mondes (comme le partage de tous par tous, la mort de pseudo-vieillards au milieu d'affreux bambins tous semblables qui multiplient les facéties autour des agonisants, etc.), ne peut donc que provoquer un effet de ridicule garanti. Shakespeare a élevé, incontestablement, l'esprit du Sauvage, qui est après tout le fils d'une femme ayant connu, avant sa déchéance physique au contact de l'extérieur, le meilleur des mondes, et y reviendra pour mourir, bourrée de drogues.
Le bonheur est la clé, mais celui-ci est impossible à obtenir sans l'assurance de la stabilité. Mustapha Menier, encore lui, nous donne la meilleure définition de la dictature invisible qu'exerce le Gouvernement mondial de Sa Forderie lorsqu'il déclare que : «Le monde est stable, à présent. Les gens sont heureux; ils obtiennent ce qu'ils veulent, et ils ne veulent jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils sont à l'aise; ils sont en sécurité; ils ne sont jamais malades; ils n'ont pas peur de la mort (2); ils sont dans une sereine ignorance de la passion et de la vieillesse; ils ne sont encombrés de nuls pères ni mères; ils n'ont pas d'épouses, pas d'enfants, pas d'amants, au sujet desquels ils pourraient éprouver des émotions violentes; ils sont conditionnés de telle sorte que, pratiquement, ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent». Et, si par hasard, ajoute Menier bien conscient qu'il est impossible de sortir de pareil cercle enchanté, «quelque chose allait de travers» (pp. 272-3), il serait toujours possible de s'abrutir et de s'évader, illusoirement, avec deux ou trois mesures d'une drogue du nom de soma distribuée en grandes doses (bien que de manière très contrôlée) aux foules, comme l'est le davamesk dans la société décrite par L'inassouvissement de Stanislaw Ignacy Witkiewic, comme le seront la supercaréisne et le félicitol dans Le Congrès de futurologie de Stanislas Lem, et tant d'autres puissants psychotropes dans les romans de Philip K. Dick qui permettent de s'évader et, bien sûr, provoquent, du moins chez ce dernier, les enfermements infernaux de la paranoïa.
Dans cet «essaim d'identité» (p. 260) provoqué par des techniques de clonage produisant des êtres parfaitement adaptés au labeur auquel on les réserve, nulle possibilité d'une île en somme, si ce n'est la vie dans quelque réserve dûment clôturée où, dans la crasse et les maladies, des femmes et des hommes vivent dans une espèce de sauvagerie à peine policée par quelques rites ridicules, dévorés par les maladies et la saleté. C'est finalement par le Sauvage que nous prendrons connaissance de l'horreur que représente le meilleur des mondes, mais Huxley a eu l'intelligence de nous montrer que l'homme, prétendûment libre, est lui-même confronté à un état proche de l'animalité (cf. p. 166), à peine moins enviable que celui que Mustapha Menier réserve à nos trois récalcitrants, autrement dit, pour le coup, le bannissement sur une île, une situation qui, comme il le confie à Helmholtz, serait presque enviable, s'il n'y avait bien sûr pas, au-dessus, le sacrifice volontaire de son propre bonheur pour le bien de l'humanité.
De nombreux récits post-apocalyptiques nous présentent, dans une scène plus ou moins développée, la persistance, inquiétante, douloureuse ou ridicule, d'une bibliothèque déserte, en ruines, ou d'un seul livre miraculeusement conservé, comme c'est le cas dans le texte d'Huxley avec ce «gros livre, qui paraissait fort ancien», dont «la reliure avait été mangée» par les «souris» et quelques-unes des pages en étant «détachées et froissées», vieux de «plusieurs centaines d'années» (p. 170) et, je l'ai dit, rempli de mots qui «peuvent ressembler aux rayons X : si l'on s'en sert convenablement, ils transpercent n'importe quoi» (p. 103) puisque ce sont les mots du plus grand des dramaturges, alors que les très plates informations, elles, réservées à l'une des sous-castes du meilleur des mondes, les Gammas, sont imprimées «sur papier kaki et exclusivement en mots d'une syllabe» (p. 99).
Est-ce, alors, dans le langage, dans tel exemplaire de vieux livre sauvé des ravagesde la guerre que va résider le salut consistant, comme l'expose Aldous Huxley dans sa préface, dans le fait de promouvoir «un mouvement populaire à grande échelle en vue de la décentralisation et de l'aide individuelle» qui seul pourra «arrêter la tendance actuelle à l'étatisme» ? Las car l'auteur constate qu'il n'y a, «présentement», aucun indice «permettant de penser qu'un semblable mouvement aura lieu» (p. 17), et cela alors même que le problème du bonheur, nous l'avons dit, consiste «à faire aimer aux gens leur servitude» (pp. 18-9), le but de tout conditionnement étant, encore une fois, de «faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper» (p. 40).
Nous avons vu que le texte de Shakespeare, lorsqu'il est employé par le Sauvage qui interprète la réalité du meilleur des mondes en déclamant des extraits des différentes pièces du dramaturge élisabéthain, n'est pas exactement le meilleur miroir, mais il y a évidemment fort à parier qu'il ne serait pas beaucoup plus idoine pour décrire notre propre réalité, car il évoque un monde plein de bruit et de fureur ne convenant que dans des situations par définition exceptionnelles à tel ou tel événement inédit pouvant crever l'épaisse couche d'asphalte sous laquelle la civilisation moderne a recouvert la planète. N'oublions pas, aussi, que la société décrite par Aldous Huxley a pour habitude d'associer la vision de fleurs ou de livres à des expériences traumatisantes de douleur, le Directeur appuyant son propos par cet adage pour le moins inquiétant selon lequel «Ce que l'homme a uni, la nature est impuissante à le séparer» (p. 46). Une dernière mention des livres est faite par Huxley, durant le long entretien entre l'Administrateur, Mustapha Menier et le Sauvage mais cette thématique n'est pas davantage explorée, comme elle ne sera pas plus dans l'essai que nous évoquerons plus loin, si ce n'est de façon anecdotique.
Le recours à un langage à rayons X, pour reprendre l'image de l'auteur, ne permet l'évasion que d'un seul homme, le Sauvage et, peut-être, caché des regards, celle de Mustapha Menier, lorsqu'il s'avise de parcourir les pages des quelques livres qu'il cache dans un coffre-fort, comme la Bible ou L'Imitation de Jésus-Christ. Est-ce, alors, dans une disparition, à terme ou, tout du moins, un arrêt des machines (3) que réside une mince possibilité de salut ? Nous savons que «la machine tourne, tourne, et doit continuer à tourner, à jamais» car, si elle s'arrêtait, «c'est la mort» (p. 69) mais Huxley n'est pas radical comme Samuel Butler, et fait même dire à Mustapha Menier que la stabilité, clé de l'édifice social du meilleur des mondes (cf. p. 70), pourrait être mise à mal par trop de progrès technologiques : «D'ailleurs, il nous faut songer à notre stabilité. Nous ne voulons pas changer. Tout changement est une menace pour la stabilité. C'est là une autre raison pour que nous soyons si peu enclins à utiliser des inventions nouvelles» (p. 278).
C'est durant ce même entretien final entre le Sauvage et Mustapha Menier qu'est abordée la question de Dieu, l'Administrateur, jouant à merveille le rôle du Grand Inquisiteur, expliquant que le soma peut à bon droit être considérée comme un «christianisme sans larmes» (p. 294), fin de non-recevoir apposée aux propos du Sauvage qui, lui, ne veut pas du confort mais désire Dieu, et aussi de la poésie, du «danger véritable» (p. 296), de la liberté, de la bonté, du péché, autant d'aberrations passéistes que Mustapha Menier rejette : en somme, dit-il, «vous réclamez le droit d'être malheureux» (p. 297), les dernières pages du Meilleur des mondes nous montrant quelle est la seule échappatoire possible pour le dernier homme qui se sera voulu libre, ayant tenté de fuir «la contamination envahissante par l'ordure de la vie civilisée» (p. 305).
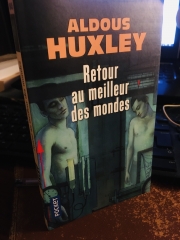 La possibilité d'une île, finalement, n'aura eu pas plus de réalité qu'un mirage et, revenant en 1958 à sa fable, Aldous Huxley a bien du mal à conjurer le sort qu'il entrevoit, d'«interminables colonnes de jeunes gens sans uniforme, blancs, noirs, rouges, jaunes, marchant docilement vers la fosse commune» comme il l'écrit dans sa préface (4). Ce qu'il appelle «le cauchemar de l'organisation intégrale» paraît nous guetter, maintenant (nous sommes à la fin des années 50, je le rappelle !) «au premier tournant» (p. 10), alors même que se sont singulièrement améliorées les techniques de persuasion des masses que l'auteur évoque quelque peu naïvement, puisque nous sommes entrés, en France comme dans le reste de l'Europe occidentale, dans des sociétés où «la terreur en tant que procédé de gouvernement rend moins bien que la manipulation non violente du milieu, des pensées et des sentiments de l'individu» (p. 11), comme si Aldous Huxley, puis notre propre société, avaient remis à jour l'invention (qui jamais ne vit le jour et condamna son auteur à la banqueroute) de Jeremy Bentham appelée panoptique pour, sur les brisées de Zamiatine, abolir les murs et nous vouer à l'absolue transparence des uns aux autres, des prisonniers (qui finiront par oublier qu'ils sont prisonniers) et de leurs gardiens (qui ne se douteront jamais qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de tous les autres regards) : «On conviendra donc facilement qu'une idée aussi utile que neuve, serait celle qui donnerait à un seul homme un pouvoir de surveillance qui, jusqu'à présent, a surpassé les forces réunies d'un grand nombre» (5).
La possibilité d'une île, finalement, n'aura eu pas plus de réalité qu'un mirage et, revenant en 1958 à sa fable, Aldous Huxley a bien du mal à conjurer le sort qu'il entrevoit, d'«interminables colonnes de jeunes gens sans uniforme, blancs, noirs, rouges, jaunes, marchant docilement vers la fosse commune» comme il l'écrit dans sa préface (4). Ce qu'il appelle «le cauchemar de l'organisation intégrale» paraît nous guetter, maintenant (nous sommes à la fin des années 50, je le rappelle !) «au premier tournant» (p. 10), alors même que se sont singulièrement améliorées les techniques de persuasion des masses que l'auteur évoque quelque peu naïvement, puisque nous sommes entrés, en France comme dans le reste de l'Europe occidentale, dans des sociétés où «la terreur en tant que procédé de gouvernement rend moins bien que la manipulation non violente du milieu, des pensées et des sentiments de l'individu» (p. 11), comme si Aldous Huxley, puis notre propre société, avaient remis à jour l'invention (qui jamais ne vit le jour et condamna son auteur à la banqueroute) de Jeremy Bentham appelée panoptique pour, sur les brisées de Zamiatine, abolir les murs et nous vouer à l'absolue transparence des uns aux autres, des prisonniers (qui finiront par oublier qu'ils sont prisonniers) et de leurs gardiens (qui ne se douteront jamais qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de tous les autres regards) : «On conviendra donc facilement qu'une idée aussi utile que neuve, serait celle qui donnerait à un seul homme un pouvoir de surveillance qui, jusqu'à présent, a surpassé les forces réunies d'un grand nombre» (5).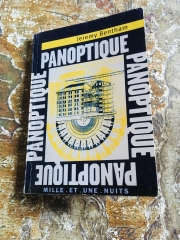 Si donc «bien des chemins mènent au Meilleur des Mondes», il semblerait que «le plus direct et le plus large» soit «peut-être celui que nous parcourons aujourd'hui, celui qui y conduit par la prolifération gigantesque et l'accroissement accéléré» (p. 18) et que nous puissions dès lors parodier, sans craindre de nous tromper et en songeant encore à Bentham (6), la phrase de Winston Churchill selon laquelle «jamais tant d'hommes n'auront été manipulés par aussi peu» (p. 30). Huxley confirme, si nous devions être convaincus, que Mustapha Menier n'est que la défroque aimable, à peu de chose près parfaitement inoffensive, du Grand Inquisiteur puisque, «dans les dictatures plus efficaces de demain, il y aura sans doute beaucoup moins de force déployée» (p. 40), l'auteur ne cessant à vrai dire de répéter cette antienne de bien des façons comme celle-ci, pleine d'humour : «avec les méthodes utilisées aujourd'hui pour vendre du candidat politique comme s'il s'agissait d'un désodorisant, le corps électoral est positivement garanti contre tout contact avec la vérité, sur quelque sujet que ce soit» (p. 78).
Si donc «bien des chemins mènent au Meilleur des Mondes», il semblerait que «le plus direct et le plus large» soit «peut-être celui que nous parcourons aujourd'hui, celui qui y conduit par la prolifération gigantesque et l'accroissement accéléré» (p. 18) et que nous puissions dès lors parodier, sans craindre de nous tromper et en songeant encore à Bentham (6), la phrase de Winston Churchill selon laquelle «jamais tant d'hommes n'auront été manipulés par aussi peu» (p. 30). Huxley confirme, si nous devions être convaincus, que Mustapha Menier n'est que la défroque aimable, à peu de chose près parfaitement inoffensive, du Grand Inquisiteur puisque, «dans les dictatures plus efficaces de demain, il y aura sans doute beaucoup moins de force déployée» (p. 40), l'auteur ne cessant à vrai dire de répéter cette antienne de bien des façons comme celle-ci, pleine d'humour : «avec les méthodes utilisées aujourd'hui pour vendre du candidat politique comme s'il s'agissait d'un désodorisant, le corps électoral est positivement garanti contre tout contact avec la vérité, sur quelque sujet que ce soit» (p. 78).Poursuivons avec ces extraits du texte, qui sonne si juste, par exemple lorsqu'il évoque l'uniformisation des citoyens du Meilleur des mondes, où il est possible «de fabriquer des servants standardisés pour les machines standardisées. Et l'uniformisation des êtres était encore parachevée après la naissance par le conditionnement infantile, l'hypnopédie et l'euphorie chimique destinée à remplacer la satisfaction de se sentir libre et créateur». Il serait faux de penser que Huxley a exagéré en parlant d'une uniformisation, y compris génétique, aussi poussée que celle qu'il décrit dans son roman et il suffirait, au sceptique, d'aller se promener dans une quelconque surface commerciale et de déambuler dans les rayons achalandés de fruits et légumes pour y constater que, quel que soit le fruit ou le légume concerné, nous ne disposons que d'une assez maigre diversité de pommes de terre, de poires ou de haricots, alors que plusieurs centaines d'espèces, au bas mot, existent pour chacun d'entre eux, la faute à une agriculture très industrialisée qui doit à tout prix plaire aux goûts des consommateurs ! De là, bien sûr, à mettre en batterie des êtres humains, vous me direz qu'il reste un grand pas à franchir, et je vous rétorquerai que, grand ou plutôt moins grand qu'on ne le suppose, ce pas sera tôt ou tard franchi, et sans doute pour les meilleures raisons qui soient ! Et puis, quand bien même le règne des jumeaux non différenciables serait-il de mise, demain ou après-demain, qu'à cela ne tienne, nous saurons trouver des palliatifs : «N'ayant pas la possibilité d'imposer l'uniformité génétique aux embryons, les dirigeants du monde trop peuplé et trop organisé de demain essaieront d'imposer une uniformité sociale et intellectuelle aux adultes et à leurs enfants. Pour y parvenir, ils feront usage (à moins qu'on les en empêche) de tous les procédés de manipulation mentale à leur disposition, et n'hésiteront pas à renforcer ces méthodes de persuasion non rationnelle par la contrainte économique et des menaces de violence physique» (p. 135) même si, nous l'avons vu, rien ne vaut la méthode de persuasion la plus douce, donc invisible, possible.
Encore une fois, et Huxley annonce Philip K. Dick, «les vieilles formes pittoresques» comme les «élections, parlements, hautes cours de justice», etc., «demeureront, mais la substance sous-jacente sera une nouvelle forme de totalitarisme non violent», ce qui permettra à «l'oligarchie au pouvoir et son élite hautement qualifiée de soldats, de policiers, de fabricants de pensée, de manipulateurs mentaux» de mener «tout et tout le monde comme bon lui semblera» (p. 144).
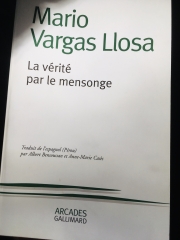 Dans sa toute dernière page, Aldous Huxley ne tempère guère son très lucide pessimisme, qui semble même infirmer telle affirmation téméraire de Mario Vargas-Llosa rendant compte du roman (7), car «il semble qu'il n'y ait aucune raison valable pour qu'une dictature parfaitement scientifique soit jamais renversée» (p. 154), s'il est vrai que «tout oiseau qui a appris à gratter une bonne pitance d'insectes et de vers sans être obligé de se servir de ses ailes renonce bien vite au privilège du vol et reste définitivement à terre», évidence livrée en guise d'illustration du triste mais inéluctable destin du dodo qui a disparu de la planète, alors qu'il se passe «quelque chose d'analogue pour les humains» si pressés de se débarrasser du fardeau de leur liberté, comme le rappelle le Grand Inquisiteur que cite nommément, enfin, Aldous Huxley, comme s'il voulait signifier que ces deux textes n'auront constitué qu'une intelligente actualisation de la magnifique parabole imaginée par Dostoïevski : «ils déposeront leur liberté à nos pieds et nous diront : faites de nous vos esclaves, mais nourrissez-nous» (p. 152).
Dans sa toute dernière page, Aldous Huxley ne tempère guère son très lucide pessimisme, qui semble même infirmer telle affirmation téméraire de Mario Vargas-Llosa rendant compte du roman (7), car «il semble qu'il n'y ait aucune raison valable pour qu'une dictature parfaitement scientifique soit jamais renversée» (p. 154), s'il est vrai que «tout oiseau qui a appris à gratter une bonne pitance d'insectes et de vers sans être obligé de se servir de ses ailes renonce bien vite au privilège du vol et reste définitivement à terre», évidence livrée en guise d'illustration du triste mais inéluctable destin du dodo qui a disparu de la planète, alors qu'il se passe «quelque chose d'analogue pour les humains» si pressés de se débarrasser du fardeau de leur liberté, comme le rappelle le Grand Inquisiteur que cite nommément, enfin, Aldous Huxley, comme s'il voulait signifier que ces deux textes n'auront constitué qu'une intelligente actualisation de la magnifique parabole imaginée par Dostoïevski : «ils déposeront leur liberté à nos pieds et nous diront : faites de nous vos esclaves, mais nourrissez-nous» (p. 152).Notes
(1) Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes (Brave New World, traduction de l'anglais par Jules Castier, Presses Pocket, 2020). Signalons, à la première page de cette préface (p. 9), une de ces erreurs grotesques dues à la paresse des éditeurs français qui ne font plus relire les textes qu'ils impriment que de manière exceptionnelle, se contentant de passer les ouvrages anciens, le plus souvent beaucoup moins fautifs, sous les yeux imbéciles d'un logiciel de reconnaissance de caractères : «passer sondage mûr» au lieu, bien sûr, de son âge mûr. Dans cette même préface, nous trouvons une majuscule fautive (p. 12 : la science et non «La science»). Relevons encore d'autres fautes comme : «Un petit nombre mouraient» (p. 29), «au voisinage de mètre» (p. 39), ses yeux et non «ces yeux» (p. 120), canyon et non «canon» (p. 141), «son conditionnement a posé [et non pesé] des rails le long desquels il lui faut marcher» (p. 275),«de leurs mille pointes elle le [et non te] piquèrent» (p. 310) et enfin «As flies to wanton [et non want on] boys are we to the gods (note 2 p. 313).
(2) «Chaque marmot, passe deux matinées par semaine dans un Hôpital pour Mourants. On y trouve tous les jouets les plus perfectionnés, et on leur donne de la crème au chocolat les jours de décès. Ils apprennent à considérer la mort comme une chose allant de soi» (p. 207).
(3) Rappelons que c'est là le motif d'une nouvelle d'Edward Morgan Forster, antérieure au Meilleur des mondes puisqu'elle date de 1909 et dont Huxley a pu se souvenir.
(4) Retour au Meilleur des mondes (Brave New World Revisited, traduction de l'anglais par Denise Meunier, Presses Pockets, 2018), p. 8, les italiques sont de l'auteur. Quelques fautes à signaler, comme toujours : intégrante et non «intégrande» (p. 83), victimes et non «victimies» (p. 86), les et non «des diverses substances chimiques» (p. 94), etc.
(5) Jeremy Bentham, Panoptique (notes et postface de Christian Laval, Librairie Arthème Fayard, coll. Mille et une nuits, 2002), p. 10.
(6) «L'inspection : voilà le principe unique, et pour établir l'ordre et pour le conserver; mais une inspection d'un genre nouveau, qui frappe l'imagination plutôt que les sens, qui mette des centaines d'hommes dans la dépendance d'un seul, en donnant à ce seul homme une sorte de présence universelle dans l'enceinte de son domaine» (p. 12).
(7) Dans La vérité par le mensonge (traduction de l'espagnol par Albert Bensoussan et Anne-Marie Casès, Gallimard, coll. Arcades, 2006, p. 122), Vargas-Llosa écrit que, un demi-siècle après que le roman d'Huxley a paru, «nous constatons que la réalité s'est éloignée de cette sombre prédiction encore davantage qu'en 1931», les «empires totalitaires» s'étant écroulés ou "semblent de jour en jour plus rongés par leurs échecs économiques et leurs contradictions internes.»
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, science-fiction, le meilleur des mondes, aldous huxley, samuel butler, légende du grand inquisiteur |  |
|  Imprimer
Imprimer
