Sur la route de Jack Kerouac : pourquoi les hommes partent à l’aventure, par Gregory Mion (21/02/2022)

Crédits photographiques : Gary Hershorn (Getty Images).
 Gregory Mion dans la Zone.
Gregory Mion dans la Zone.«Je régnais sur le ruban de bitume velouté par l’été.»
Jacques Laurent, Histoire égoïste.
«Il nous faut, nous qui n’avons que ce que nous avons, qui ne savons que ce que nous savons et qui ne sommes que ce que nous sommes, trouver notre Amérique.»
Thomas Wolfe, L’Histoire d’un roman.
«Probable que je suis son idée du héros de feuilleton.»
William Burroughs, Le festin nu.
Initiation aux vastitudes, aux affranchissements tous azimuts et aux caprices d’une jeunesse insolemment extatique
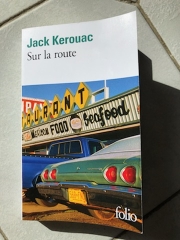 Né il y a un siècle et mort misérablement – comme tous les saints de ce bas monde – en 1969 au même âge que Malcolm Lowry, plus ou moins des mêmes sinistres causes, Jack Kerouac ne fera perdre de temps à personne le lisant ou le relisant, à condition bien sûr d’appartenir à une phalange spécifique de l’humanité. En effet, au-delà des raisons populaires qui ont fait du nom de Kerouac le commode label de tous les désaxés officiels et le miteux talisman des voyageurs de première classe en manque de vertige (souvent des lecteurs frivoles en l’occurrence), au-delà des fondements très relatifs d’un engouement proverbial qui n’intéresse que les journalistes, l’écrivain des Clochards célestes et de Satori à Paris, en dépit de ses inopportunes clowneries qui ont pu le desservir (1), n’a vécu absolument que de littérature, de mystique et de liberté, trois choses inconnues de beaucoup de mortels quand elles sont des absolus. Il s’est dévoué à ces trois apothéoses sans toutefois déclarer forfait devant les épreuves qui font l’homme, devant ce que l’on appelle banalement les réalités de la vie, les trivialités de l’existence, toute cette visqueuse médiocrité vivante qui constitue les raisons privées – voire impopulaires – d’une œuvre que peu d’entre nous malheureusement savent apprécier selon ses vraies valeurs, faute d’avoir du vécu ou faute d’avoir accumulé une suffisante expérience de l’adversité.
Né il y a un siècle et mort misérablement – comme tous les saints de ce bas monde – en 1969 au même âge que Malcolm Lowry, plus ou moins des mêmes sinistres causes, Jack Kerouac ne fera perdre de temps à personne le lisant ou le relisant, à condition bien sûr d’appartenir à une phalange spécifique de l’humanité. En effet, au-delà des raisons populaires qui ont fait du nom de Kerouac le commode label de tous les désaxés officiels et le miteux talisman des voyageurs de première classe en manque de vertige (souvent des lecteurs frivoles en l’occurrence), au-delà des fondements très relatifs d’un engouement proverbial qui n’intéresse que les journalistes, l’écrivain des Clochards célestes et de Satori à Paris, en dépit de ses inopportunes clowneries qui ont pu le desservir (1), n’a vécu absolument que de littérature, de mystique et de liberté, trois choses inconnues de beaucoup de mortels quand elles sont des absolus. Il s’est dévoué à ces trois apothéoses sans toutefois déclarer forfait devant les épreuves qui font l’homme, devant ce que l’on appelle banalement les réalités de la vie, les trivialités de l’existence, toute cette visqueuse médiocrité vivante qui constitue les raisons privées – voire impopulaires – d’une œuvre que peu d’entre nous malheureusement savent apprécier selon ses vraies valeurs, faute d’avoir du vécu ou faute d’avoir accumulé une suffisante expérience de l’adversité. À l’inverse donc de tant de ses admirateurs bourgeois, de tant de romanciers de boudoir, de tant de poètes conformistes vite consacrés ou de faux-monnayeurs de la persécution qui le citent abondamment, Jack Kerouac, déjà, ne fut pas étranger à la démoniaque anomalie du champ d’honneur, ni, d’autre part, aux luttes plus communes mais plus longues, presque plus tragiques encore que la guerre, que sont la pauvreté, l’enchaînement des petits boulots, la charité des amis vagabonds et la furieuse attraction de l’alcool. C’est sans doute cette tétrarchie de l’indigence, associée de surcroît à la biographie d’un soldat de vingt ans, qui justifie la présence d’un écrivain, d’un véritable créateur, d’un homme ayant quelque chose à dire et qui à cet égard n’emprunte pas les voies détournées du maniérisme ou les pentes insupportables des lamentations à vocation lacrymale, autant de défauts, reconnaissons-le, plus nombreux en France que de l’autre côté de l’Atlantique. Par conséquent la littérature, avec Kerouac, ne s’en trouve jamais dévoyée, trahie, salie, instrumentalisée, mais toujours exhaussée à son plus haut sommet, là où se confondent finalement les livres et la vie, les mots et le réel, le langage et le divin. C’est du reste à ce point de jonction si particulier que peuvent s’unir des éléments aussi disparates que Dieu et l’Antéchrist, que l’immaculé et la malpropreté, toute l’œuvre de Kerouac n’étant peut-être que la libre et spirituelle recherche de la beauté en plein cœur de la laideur, essentiellement l’épicentre de la laideur morale touchant à l’irrésistible expansion de la société néolibérale. De là naît en toute logique le désir de prendre fictivement et authentiquement le large, de «[voguer] toutes voiles dehors dans la nuit de la liberté» (p. 365), de fuir une époque de plus en plus malade, de critiquer une civilisation américaine partie à la dérive sur les ineffables affluents des fleuves infernaux, première de cordée sur les avilissantes parois du capitalisme et des pactes faustiens. Aux grimaces et aux monstruosités de son temps, aux ténèbres envahissantes, Jack Kerouac, inlassablement, leur oppose les soleils printaniers de l’Évangile, les paysages infinis et les forçats de la souveraine aventure, les métèques de tous les horizons, tous prophètes à leur manière, tous impliqués dans la pulsion de vie qui caractérise à gros traits la Beat Generation d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Ce préambule non dénué de partialité assumée nous amène alors précisément aux arguments et aux situations qui jalonnent Sur la route (2), ce fameux roman de 1957, à moins qu’il ne faille d’emblée parler d’une confession à peine romancée, des aveux spontanés d’un saint Augustin moderne dont la conversion progressive se réaliserait tout au long des milliers de kilomètres avalés en autobus, en camion, en voiture et même on foot, parmi les prodigieux et incalculables espaces d’un pays possédant trois fuseaux horaires, sur l’infinité bitumeuse qui sépare et qui relie, mais qui, fondamentalement et corrélativement à l’atmosphère sacrée dominante du livre, rassemble les désorbités ou plutôt les inadaptés des quatre coins de la nation, formant peu à peu les bases d’une nouvelle Jérusalem très ample. Si bien que ce potentiel confiteor évolue chaque fois du côté de ceux qui ont une prédilection pour le walk on the wild side, pour l’Amérique des bas-fonds où la solide vertu se décèle comme nulle part ailleurs, enfuie des vicieuses allées des beaux quartiers, sauvée des centres municipaux où les tours du pouvoir financier se dressent en une obscène et insoutenable érection.
Ce qui se dessine nettement au gré de ces pages vagabondes est une remarquable fraternité des outsiders où culmine la relation du narrateur Sal Paradise (Jack Kerouac) avec l’étincelant Dean Moriarty (Neal Cassady). Né exactement sur la route un hiver de 1926 tandis que la voiture de ses parents fendait la dévote Salt Lake City en direction de Los Angeles (cf. p. 15), l’ambulant et fulgurant Moriarty incarne le symbole parfait de l’homme libre, le vent de folie qui desserre tous les étaux de la raison pure, le tempérament hit-the-road qui transmet à tous ceux qui le rencontrent la démangeaison du départ ou l’élan du périple. Et il est probable que la croissante volonté de Sal de quitter New York pour l’extrême Ouest ne soit qu’une subtile incubation de ses fréquentations de Dean, ce dernier étant venu au monde dans un exode qui allait d’Est en Ouest, going westward, un exode tout entier polarisé par les promesses californiennes et par les puissants rouleaux du Pacifique rédempteur. À l’instar de ces paysans de l’Oklahoma qui dans Les raisins de la colère de Steinbeck se sentaient portés à vaincre la dépression sociale en pariant sur l’euphorie des terres de Californie, Sal Paradise entrevoit de plus verts pâturages loin de chez lui, là où le soleil physique se couche pendant que le soleil métaphysique perdure. Mais avant ce déplacement magnétisé par les rayons d’un astre singulier, avant de se laisser galvaniser par l’espoir, le jeune Sal essuie d’abord le choc des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, le choc du combat sanglant redistribué dans le combat hypocrite et ambigu du capitalisme, le scandale d’être égaré dans une sorte d’Oklahoma psychique et d’être le captif d’une prison urbaine assoiffée d’argent facile, à l’extrême Orient de sa patrie vampirisée, sous les eaux marécageuses d’une dédaignable Atlantide. Il est en manque de perspectives au milieu de ces lignes droites existentielles peu encourageantes pour un individu en quête de sinuosités en tout genre. Il voudrait partir afin de ne plus souffrir de l’ordre corrompu de l’argent (suscitant une entropie de civilisation) et afin de se rassasier d’un apparent désordre qui dissimule en réalité un ordre incorruptible (la néguentropie de ceux qui ne croient pas au modèle des classes supérieures). Il aimerait se rapprocher intuitivement d’un terreau fertile et antédiluvien, du sol d’une immarcescible nativité, d’une origine plus archaïque (l’Archè), cela dans le but de conjurer une société outrageusement développée qui se présente comme le résultat favorable d’une succession de décennies misarchiques.
Le renouveau de Sal Paradise débute concrètement lorsque Dean Moriarty entre dans sa vie à dessein de lui ravir quelques conseils d’écriture (cf. p. 18). Ce sera l’occasion d’un échange du vues créatrices, l’aubaine d’une décisive combinaison des faisceaux créateurs : l’un possède déjà ses habitudes littéraires, il traduit intelligiblement les motifs de sa sensibilité en récession depuis son retour du front de guerre, et l’autre, par contraste, évoque une espèce de personnage vivant, héros d’une fresque débordante, à la recherche de techniques affûtées pour déférer dans l’intelligible de la narration le haut débit de son activité sensible. Autrement dit, à ce moment-là de leurs existences respectives, l’un crée davantage dans l’esprit et l’autre davantage dans le cœur, et la conjonction des deux va induire un mouvement alternatif grâce auquel la raison de Sal s’initiera à l’instinct et l’instinct de Dean à la raison. Cette courte période de transaction des qualités paraît plus probante pour Dean, mais, nous l’avons rappelé, la révolution primitive du caractère de Sal dépend d’un phénomène d’incubation proprement invisible. Ceci explique en outre que Dean soit beaucoup plus que ses camarades un agent de transformation intérieure pour celles et ceux qui le côtoient, un vecteur dans l’essentiel, alors que Sal, sans rien négliger de ses mérites, se découvre sous les traits du disciple dont le rôle vis-à-vis du maître (qui fut au préalable un élève supposé) a surtout consisté à remanier l’accidentel.
D’autre part, assez rapidement, il s’est avéré que Dean était plus autonome qu’il n’en avait l’air et que ses demandes esthétiques auprès de Sal n’ont été possiblement que des prétextes, des opportunités habilement déployées pour se lier avec un garçon qui avait un cruel besoin d’embardée, un impérieux besoin de reprendre contact avec un accent aigu de la vie. Sa curiosité à l’égard de la philosophie et son désir d’apprendre à manipuler des concepts sous l’autorité de Sal se sont plus ou moins condensés en un simulacre, et, mutatis mutandis, Dean a été assigné au statut de «mélancolique et poétique truqueur» (p. 20). Au premier regard, si Dean Moriarty a pu refléter une allure de Martin Eden, si son attitude a pu trahir l’aspirant écrivain à l’état incertain de diamant brut, il a adroitement rectifié le tir par la suite. Il est soudainement apparu comme un individu en pleine maîtrise de ses moyens d’écriture tout en prétendant pourtant le contraire. Au fond il n’a sûrement jamais été miscible avec la redoutable perfectibilité d’un Martin Eden car il était déjà presque parfait à ce niveau-là, mais, en revanche, il a toujours appartenu à cette région des âmes dionysiaques où se recrute l’immémoriale intensité d’un Alexis Zorba : «C’était un gosse furieusement excité par la vie et s’il était un truqueur, s’il roulait le monde, c’est seulement parce qu’il voulait vivre de toutes ses forces et se mêler aux autres qui, autrement, n’auraient fait aucun cas de lui» (p. 19). En résumé, s’il est acceptable de conclure hâtivement quoi que ce soit sur le compte de Dean Moriarty, l’on dira de lui qu’il fut un éducateur spécialisé pour les indécis, les sceptiques et les apolliniens. L’on dira encore de cet acrobate de la subjectivité qu’il fut un semeur d’aventures au sein d’un univers dramatiquement exposé aux mésaventures grandissantes du néolibéralisme. Et n’omettons pas de signaler non plus que Dean Moriarty eut souvent les mains dans le cambouis comme du reste bon nombre de poètes, d’écrivains et même de philosophes américains. Quoique sa trinité destinale au cours de sa jeunesse dans l’Ouest émancipateur se composât déraisonnablement de «salles de jeux», de «prison» et de «bibliothèques publiques» (p. 20), il n’y eut sur cette trajectoire loufoque aucune propension à reculer devant les nécessités du travail et les besognes les moins reluisantes. Il est d’ailleurs quasiment certain que ce sont ces assortiments de capacités à la fois mercenaires et inspirantes qui ont séduit Sal Paradise en alimentant son attirance pour «ceux qui ont la démence de vivre, la démence de discourir, la démence d’être sauvés», pour «ceux qui ne savent pas bâiller ni sortir un lieu commun mais qui brûlent, qui brûlent, pareils aux fabuleux feux jaunes des chandelles romaines explosant comme des poêles à frire à travers les étoiles» (p. 21). Les représentants et les adorateurs d’une telle confrérie bénissent inconsciemment l’héritage teutonique du Sturm und Drang (cf. p. 21). Ils empruntent par là même les chemins d’un romantisme réformé où l’action artistique ne se déprend pas de l’action de survivre en gagnant des salaires de va-nu-pieds. Ainsi devait-il en être de Dean Moriarty et de ses épigones.
Nous sommes alors en 1947 lorsque Sal Paradise prend conscience qu’il va basculer dans une forme de vie tout à fait inédite : «J’étais un jeune écrivain et je me sentais des ailes» (p. 25). Il a été touché par une intraduisible grâce et Dean lui a d’une certaine manière administré l’onction des baroudeurs. Se fiant à un savoir animal plus qu’à un savoir classique, Sal est convaincu des ouvertures qui l’attendent, des tournants qui vont chambarder la ligne droite de son assoupissement, et donc, «quelque part sur le chemin [il savait] qu’il y aurait des filles, des visions, tout, quoi» (p. 25). Il était sûr que les lendemains chanteraient après avoir tellement soupiré et que «la perle rare» (p. 25) lui serait tendue par les mains allégoriques qui avaient dûment serré celles de Dean. Il s’agit ni plus ni moins d’un baptême du feu, d’une immersion dans le combustible héraclitéen qui sanctifie les âmes pyriques. Rien d’étonnant à ce que le maître de cérémonie de cette flamboyante métamorphose soit de la «race solaire» (p. 25), du gabarit de ceux qui véhiculent un «appel de la vie neuve» et «un horizon neuf» (p. 25), de l’envergure de ces aéronautes qui sont l’incarnation d’une «sauvage explosion de la joie américaine» (p. 24). De là se déduit la «criminalité» de Dean (p. 24), sa responsabilité pénale au cœur d’un système national de moins en moins disposé à tolérer les épiphanies de la liberté, sa culpabilité d’être «l’Ouest» et même «le vent de l’Ouest» (p. 24), son péché d’être un souffle purificateur à une époque essoufflée ou sur le point de le devenir durablement.
On mesure ainsi tout le potentiel d’attraction positive de Dean Moriarty pour les mendiants qui ont pu partager avec lui des moments fondateurs ou ne serait-ce que des instants cruciaux. On ne saurait du reste remettre en cause la crédibilité de ce trimardeur clairvoyant dont l’enfance a connu «les rues légendaires et ardentes de Denver» (p. 90), probablement celles qui ont engendré un peu plus tard les volontés romanesques d’un Benjamin Whitmer. Le parcours initial de Dean le légitime en tant que personnalité charismatique et en tant que redresseur des libertés bafouées. Celui qui fut voleur de voitures par nécessité et par goût de la route protectrice, celui qui vécut la plupart de son temps en maisons de correction de onze à dix-sept ans, celui-là ne peut pas être un mystificateur ou un envoyé spécial du capitalisme (cf. pp. 63-4). Il ne peut être que la table d’orientation des brebis égarées dans le marasme du paradigme philistin. Et bien que l’impulsion du voyage soit contre-intuitive en un siècle – et en un pays aussi – où le confort de l’installation bourgeoise profite d’un maximum de ralliements, Sal Paradise ne se sent pas menacé de poursuivre la tentation de l’Ouest, de prêter le flanc au risque enivrant de la clochardisation nimbée d’un soleil biblique et justicier (cf. p. 26). D’un château l’autre, du château hanté de l’Est jusqu’au château enchanté de l’Ouest, Sal Paradise veut reconquérir sa destinée, s’élançant depuis «l’Est de [sa] jeunesse» pour atteindre hypothétiquement «l’Ouest de [son] avenir» (p. 35). Il voudrait en quelque sorte couper le cordon avec les cités inconsolables d’Edward Hopper afin de rejoindre les foudroyantes plénitudes de Georgia O’Keeffe, les déserts mirifiques où affleurent paradoxalement toutes les présences et où l’on se guérit de la fausse animation du centre-ville ultramoderne.
Dès lors se précise la promesse de la route, la fascination de l’asphalte, l’insaisissable vaudou des twisting ramps par lesquelles on se rapproche des villes ou par lesquelles nous les abandonnons. Il faut avoir vu et pratiqué ces réseaux tentaculaires de voies bétonnées pour en apprécier le quotient chamanique, tant dans une direction que dans l’autre, tant pour s’acheminer vers les falaises vitrées des gratte-ciels que pour s’en défaire et s’embarquer dans les infinis de la plaine ou des reliefs. Dans le cas de Sal Paradise, la préférence va aux insondables espaces, aux lointains anamorphosés parmi les secrets ondoiements de la nature, aux contradictions de toutes les verticalités artificielles de New York. Pour lui les frénésies de New York ne sont que des échos de la scélérate Babylone et son esprit contredit cette morale du vice en se forgeant la représentation d’une Jérusalem innovante qui serait localisée à San Francisco. Bien évidemment cette affinité élective pour San Francisco n’est pas dépourvue de fantasme, et, d’ailleurs, elle l’est d’autant plus qu’elle provient de l’influence magique de Dean Moriarty. À ce stade de ses résolutions, le tribunal psychologique de Sal ne pourrait accorder aucun bénéfice du doute à la métropole new-yorkaise. L’Est en général et New York en particulier se sont mués en opérateurs ontologiques du ralentissement voire de la stagnation. Il n’y a donc plus d’autre choix que celui de prendre la clé des champs, d’entretenir les espérances de la Californie, de vider les lieux de la Grosse Pomme et d’envisager un changement radical de méthode existentielle. Les virages de la route à venir proclament la réfutation catégorique du cadastre urbain et de sa géométrie orthogonale. Or c’est littéralement ce formalisme de la chaussée profane que Sal Paradise aspire à quitter afin de mieux se séparer des conséquences figurées de cette organisation euclidienne des flux : à savoir une profanation du principe dynamique de la vie au profit d’une sacralisation blasphématoire du code statique de la bourgeoisie. C’est pourquoi s’attarder à New York reviendrait à supprimer en soi-même toutes les semences de la sainteté car on ne ferait que donner du grain à moudre aux fixations sociales des classes dominantes. Et s’il n’est en outre pas du tout admis que la ville de San Francisco soit une herbe plus verte que celle de New York, il n’en demeure pas moins que le chemin à parcourir jusqu’à elle suggère des détours, des surprises, des improvisations qui permettront d’arriver là-bas dans un état d’esprit complètement différent, peut-être dans une humeur qui nous permettra de faire des concessions ou de réévaluer le degré de notre idéalisme. Mais objectivement parlant, pour être drastiquement fidèle aux opinions novices de Sal, New York souffre d’un genre de tendance Vieux Continent, d’une ombre épaisse de l’Histoire qui a pétrifié la souplesse de l’odyssée humaine et qui a médusé quantité de vocations, tandis que San Francisco, par dissonance, respire un air de Nouveau Monde, une atmosphère d’indépendance – parfois d’irrévérence – qui offre à cette ville une réputation certes mythique mais pas vraiment usurpée. De ce point de vue nous pouvons plus facilement comprendre les passions de Sal Paradise, ses empressements, ses tropismes de néo-migrateur et la façon dont il perçoit dans l’entrelacs des routes américaines tous les serments d’une liberté à conquérir, tout un faisceau de possibilités pour exorciser le démon de la fatalité sociale, comme Thomas Wolfe avait pu les pressentir naguère en digressant mystiquement sur le réseau ferroviaire américain (3).
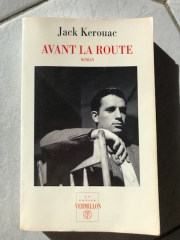 Au cours de cette première excursion (il y en aura trois malgré le fait que Sal se voyait partir pour l’éternité aussitôt le dos tourné aux donjons endiablés de New York), une constante apparaît (cf. pp. 15-154) : une immense majorité des bohémiens a pris la route moins par souci de satisfaire à une éthique de la liberté que par impératif de fuir «les rigueurs de la loi». Cette récurrence des fugitifs de la légalité ouvre la porte d’un monde parallèle où s’affirme une communion des hommes légitimes. Ce ne sont pas tant des hors-la-loi que des individus criminalisés par un appareil normatif rigide et arbitraire. Illégaux selon les jugements ordinaires, ces hommes et ces femmes font miroiter un sauve-qui-peut salvateur. Ils sont forcément justes aux yeux de Dieu puisqu’ils sont injustes aux yeux d’une civilisation qui ne s’aperçoit même pas qu’elle est en train de s’effondrer moralement. Leurs échecs dans l’univers des hommes traduisent par conséquent leurs triomphes dans l’univers divin. Abaissés ici-bas, humiliés sur la Terre, ils sont relevés tout en haut de la voûte céleste, dans les firmaments d’une invincible théodicée. Tels sont ces itinérants tour à tour abordés sur l’exubérant trajet de Sal. En eux s’esquisse le véritable mât de misaine, l’authentique droiture, le vivant reflet de ces montagnes Rocheuses qui impressionnent tant Sal Paradise durant son passage dans le Colorado (cf. pp. 59-60). Eu eux se devine aussi la réelle vastitude qui destitue les douteuses grandeurs de New York. Et c’est à travers ce halo de nomades que se profile l’idée d’une génération battue, d’une branche bannie de la généalogie américaine, épouvantails et zombies d’une nation vendue au capitalisme, fantômes des catacombes où reposent les squelettes des proscrits, les carcasses des «épaves des bas-fonds de l’Amérique», membres émérites d’une «nouvelle génération foutue» (pp. 83-4) pour lesquels les bras de Sal Paradise sont fougueusement et princièrement accueillants. On a là une occurrence très nette de la Beat Generation et de ses «[spectres brisés]» menant «une existence libre et folle» (p. 151). C’est aussi une synthèse accomplie du sensuel dérèglement rimbaldien auquel Sal va graduellement se vouer corps et âme.
Au cours de cette première excursion (il y en aura trois malgré le fait que Sal se voyait partir pour l’éternité aussitôt le dos tourné aux donjons endiablés de New York), une constante apparaît (cf. pp. 15-154) : une immense majorité des bohémiens a pris la route moins par souci de satisfaire à une éthique de la liberté que par impératif de fuir «les rigueurs de la loi». Cette récurrence des fugitifs de la légalité ouvre la porte d’un monde parallèle où s’affirme une communion des hommes légitimes. Ce ne sont pas tant des hors-la-loi que des individus criminalisés par un appareil normatif rigide et arbitraire. Illégaux selon les jugements ordinaires, ces hommes et ces femmes font miroiter un sauve-qui-peut salvateur. Ils sont forcément justes aux yeux de Dieu puisqu’ils sont injustes aux yeux d’une civilisation qui ne s’aperçoit même pas qu’elle est en train de s’effondrer moralement. Leurs échecs dans l’univers des hommes traduisent par conséquent leurs triomphes dans l’univers divin. Abaissés ici-bas, humiliés sur la Terre, ils sont relevés tout en haut de la voûte céleste, dans les firmaments d’une invincible théodicée. Tels sont ces itinérants tour à tour abordés sur l’exubérant trajet de Sal. En eux s’esquisse le véritable mât de misaine, l’authentique droiture, le vivant reflet de ces montagnes Rocheuses qui impressionnent tant Sal Paradise durant son passage dans le Colorado (cf. pp. 59-60). Eu eux se devine aussi la réelle vastitude qui destitue les douteuses grandeurs de New York. Et c’est à travers ce halo de nomades que se profile l’idée d’une génération battue, d’une branche bannie de la généalogie américaine, épouvantails et zombies d’une nation vendue au capitalisme, fantômes des catacombes où reposent les squelettes des proscrits, les carcasses des «épaves des bas-fonds de l’Amérique», membres émérites d’une «nouvelle génération foutue» (pp. 83-4) pour lesquels les bras de Sal Paradise sont fougueusement et princièrement accueillants. On a là une occurrence très nette de la Beat Generation et de ses «[spectres brisés]» menant «une existence libre et folle» (p. 151). C’est aussi une synthèse accomplie du sensuel dérèglement rimbaldien auquel Sal va graduellement se vouer corps et âme. Mais il importe de ne pas réduire ce mouvement générationnel à un stéréotype ou à une didactique affectée de la calamité. Que ces jeunes personnes aient été broyées par la logique libérale ascendante est une évidence. Qu’elles aient été encouragées à inventer des alternatives en est une autre. Mais sont-elles pour autant condamnées au registre du naufrage ou aux terminologies réductrices de la paupérisation ? On oublie ainsi trop souvent que les hérauts de la Beat Generation furent les symboles des invaincus, des immortels, des élus de l’éternité, en cela que leurs maximes officieuses étaient solidaires du beat cosmique, du rythme le plus sain qui puisse exister, de l’harmonie la plus harmonieuse. Ils étaient tous – et sont encore – des cœurs battants au milieu de la poitrine oppressée des États-Unis (et au milieu d’un monde asphyxié par l’impitoyable législation du marché). Ils continuent à sauver leur pays et assurément la planète entière d’un arrêt cardiaque métaphorique, et, ce faisant, ils nous protègent des langages de la pulsion de mort et de toutes les suprématies ténébreuses qui essaient d’abolir le droit de vivre en poète ou en flâneur magnifique.
L’arrivée à San Francisco entérine par ailleurs toutes les représentations de Sal Paradise. Il y savoure le panorama d’une baie séraphique et il ne tarde pas à rattacher cette ville à un miracle urbain digne d’une callipolis. Non loin de San Francisco, en effet, s’est érigé le prodige de Mill City, «un ramassis de baraques dans une vallée, une cité ouvrière que l’on avait bâtie pour les travailleurs», mais, par-delà ces aspects sordides, il s’agit de la «seule communauté d’Amérique où les blancs et les nègres vivaient ensemble de plein gré» (p. 92). Il se dégage de cette observation la preuve d’un inclassable syncrétisme. Dans cet endroit de la profonde et laborieuse Amérique, un idéal politique a pu naître, un idéal aussi indéniablement lisible et rassurant que la «ligne blanche de la route sacrée» (p. 195) tant de fois vénérée par Sal. Des palanquées d’énergumènes ont réussi là où des professionnels de la gouvernance ont lamentablement échoué. À ciel ouvert, Mill City exhibe ses bagnards et ses vauriens, ses fous et ses sorciers, ses improbables alliances où se sont constituées des vérités du cœur à l’encontre des mensonges démocratiques d’une litigieuse raison d’État. On ressent parmi ces baraquements de fortune la recevabilité des êtres humains qui résistent délibérément ou instinctivement à l’irrecevabilité des better-off districts. Il s’ensuit que les ponctuels et ostensibles écarts de conduite de ces gens de Mill City sont pardonnés tandis que les irréprochables comportements des citoyens intégrés aux plus flambantes zones résidentielles du pays sont inculpés à un niveau surnaturel pour leurs profits engrangés au moyen d’une crypto-corruption endémique. En ces lieux de pauvreté où règnent des arrangements avec la loi mais où la Loi de Dieu persévère d’une façon directe ou indirecte, à rebours des lieux saturés de lois et purgés de la Loi, le brave Sal Paradise expérimente une catharsis opportune. Il ressaisit la valeur des petits boulots et leur hybridation avec l’alcool, les concubines éphémères et la rage d’écrire. Il réhabilite également les appâts occasionnels de la kleptomanie car cette pratique diminue certaines dépenses et permet de surcroît de se reposer de l’emprise néolibérale. En Californie, en ces «fantastiques confins de l’Amérique» (p. 121), toute stratégie de contournement du modèle hégémonique est la bienvenue, ne serait-ce déjà que pour éviter «le relent putassier d’une grande ville» (p. 121) comme Los Angeles, sorte de parabole tumorale qui compromet la monumentale aura thérapeutique de San Francisco. Et là, perché sur une colline du Golden State à l’instar d’un grandiloquent contemplateur issu de l’œuvre de Caspar David Friedrich, Sal Paradise avise «l’immense panse sauvage et la masse brute de [son] continent américain», avec la sensation d’avoir mis une distance providentielle entre lui et New York, entre lui et cette Sodome «sinistre, loufoque, [vomissant] son nuage de poussière et de vapeur brune» (p. 116).
Il va de soi qu’il ne faut pas faire abstraction non plus de l’espèce d’hypnose suscitée par la Californie et son large éventail de terres promises, mais qu’on le veuille ou non, sur ce terrain mythologique de son pays, Sal souffre moins de louvoyer avec le fric et le flou de ses perspectives. La Californie lui procure des «nuits brutales», des «nuits toutes remplies du gémissement des sirènes» (p. 125), d’étranges symphonies nocturnes où les tourments du jour disparaissent par exemple dans le giron d’une môme mexicaine qui l’admet définitivement à la gamme de l’instant présent. Dans les bras de cette amante ostracisée qui va par monts et par vaux afin d’échapper aux cyniques variétés de la ségrégation, dans le sillage de cette fiancée intempestive aux airs de temple maya, l’instabilité de Sal se convertit en stabilité temporaire. Avec elle, ce garçon à la poursuite de lui-même se corrige volontiers, adoucissant la table parfois binaire de ses catégories, nuançant des rapports de force qu’il avait jusqu’ici arbitrés avec fanatisme, s’apercevant notamment que Los Angeles, en sus d’être une garce, est aussi une «jungle», une folle Babel «foisonnante en solitude et en brutalité», alors que New York, malgré ses hivers sibériens, possède «une exaltation chaleureuse dans certaines de ses rues» (p. 126). C’est comme si l’amour venait rééquilibrer les idées quelquefois extravagantes de Sal, héritées des conceptions encore plus extravagantes de Dean, l’incitant à séparer le bon grain de l’ivraie et à ne pas être piégé par d’insidieux mécanismes de subordination amicale. D’ailleurs l’absence physique de Dean lors de ce premier trip est significative : Sal ne fait que courir après un Dean qui le devance à telle ou telle étape de leurs vœux de locomotion perpétuelle, Dean, ici, n’étant pour l’heure qu’une étoile filante que Sal s’évertue à traquer tout en procédant à des ajustements intéressants parmi les flots déchaînés de ses émotions. Ce que l’on augure en ce sens de la psyché de Sal, c’est, à coup sûr, un sérieux désir de sortir de ses gonds en vue de collectionner une somme d’expériences uniques, mais, d’un autre côté, il sait qu’il a un livre à écrire et que ce travail ne pourra pas s’accorder au diapason d’une épopée permanente et casse-cou. Autrement dit la lucidité de Sal compense l’aberration cérébrale de Dean et bien des fois durant les croisades affolantes de ce binôme, si celui-ci a pu fournir à celui-là les matériaux faramineux d’un livre gigantesque, celui-là aura tendu à celui-ci les perches pour ne pas qu’il sombre tout à fait dans les précipices de la mort prématurée (4). Ainsi faut-il probablement parler d’une amitié à la vie à la mort entre Kerouac et Cassady, d’une amitié aussi bien édificatrice que destructrice, d’un lien formidable vécu sur la surface ténue d’une corde raide où la moindre secousse pouvait provoquer le sommeil sans rêves ou le rêve d’une existence constamment sublimée.
Du reste, au soir de cette primo-virée californienne, au moment de repartir pour New York et de refermer la parenthèse de cette expédition inoubliable, Sal Paradise aura connu sur cet angle de l’échiquier national des cosmopolitismes ébouriffants, ceci au sein des villes et des vignobles qui ont imprégné l’imaginaire d’innombrables artistes. Il aura entre autres choses ruminé la philosophie du mañana (cf. p. 137), la doctrine qui s’appuie sur le soleil qu’il fera nécessairement demain, et il l’aura d’autant mieux ruminée qu’il l’aura méditée dans la chaleur amoureuse de sa dulcinée hispanique. Il aura peu à peu assimilé une confiance à l’égard du futur proche en dépit des difficultés du jour même, et, par voie de conséquence, il aura aussi appris à refondre les instances du proverbial et galvaudé Carpe Diem. Tout cela se sera incroyablement ordonné en synchronisant d’une part un quotidien de durs labeurs, d’autre part un quotidien de filles et de cuisine épicée, l’ensemble illustrant une sorte d’aménagement de projections paradisiaques et réprouvant toutes les circonstances malvenues d’un pessimisme de la faiblesse. C’est la raison pour laquelle Sal n’a jamais succombé au désespoir de la privation pendant ses scabreux itinéraires californiens. Il aura chaque fois surmonté la mélancolie et de la même manière évité le point de non-retour des disetteux toxicomaniaques. Et lorsque la bouche de l’abysse n’était pas loin de l’engloutir, un invisible levier se sera manifesté, une subvention divine aura surgi, comme ces grappes de raisin tombées d’un camion trop vivement passé sur un dos-d’âne et offrant à la terrible équation de la famine une admirable solution (cf. p. 138). Au fond, contrairement au touchant M. Micawber de Dickens qui ne cesse de croire qu’une opportunité finira par se présenter tout en accumulant des déconvenues avant de connaître ultimement un relatif succès (5), Sal Paradise ne parie pas vraiment sur la sollicitude de son époque, ni sur les dispositifs concrets d’insertion. Il mise plutôt sur les flexibles décrets d’un royaume où le trône suprême se verrait attitré à un dieu qui serait la combinaison de tous les dieux référencés ou merveilleusement extravagués. C’est là son bouclier, sa digue mentale, son réservoir d’infinité tandis qu’il est revenu à la ville dont on dit qu’elle ignore l’acte de dormir, prise continuellement dans les rets maléfiques d’un rush hour. À New York se produit «la démence absolue» et une «fantastique fanfaronnade», avec la complicité de «ses millions et ses millions de types se chamaillant pour un dollar, le cauchemar démentiel : empoigner, prendre, céder, soupirer, mourir, tout cela pour finir dans les ignobles cités funéraires qui se trouvent derrière Long Island City» (p. 153). Ici même gisent les dangereuses axiologies de l’argent, les préceptes de l’infâme bourgeoisie de l’usure, les bruyantes stridulations du libéralisme découlant du maudit clairon fêlé de l’Amérique prostituée.

La suite de cette étude se trouve dans L'Amérique en guerre, disponible sur le site de l'éditeur.
Lien permanent | Tags : littérature, critique littéraire, jack kerouac, gregory mion, sur la route |  |
|  Imprimer
Imprimer